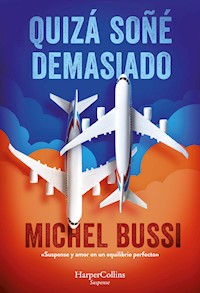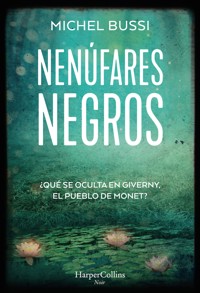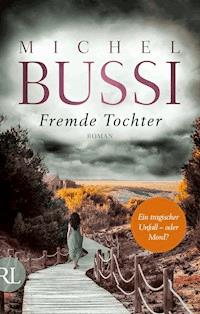Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions des Falaises
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Découvrez deux des premiers romans de l'auteur de best-sellers Michel Bussi : Code Lupin, une invitation au voyage et un jeu de piste à la recherche d'un trésor, dans les pas d’Arsène Lupin et Mourir sur Seine, un polar captivant vendu à plus de 100 000 exemplaires !
Code Lupin
L’aiguille creuse d’Étretat, les tours blanches de l’abbaye de Jumièges, le vieux phare de Tancarville, le tombeau de Rollon sous les ruines de Thibermesnil, la valleuse déserte de Parfonval, les îles englouties de la Seine, les marées d’équinoxe de la Barre-y-va… Autant de lieux mystérieux dont les énigmes sont percées par Arsène Lupin, dans de fascinantes chasses aux trésors, au cœur du triangle d’or, le fameux triangle cauchois, imaginé par Maurice Leblanc. Imaginé ? Est-ce si sûr ?
Et si les aventures d’Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d’un trésor normand, bien réel celui-là ?
Le professeur Roland Bergton en est convaincu. Il dispose d’une journée pour percer l’énigme, avec pour seuls indices une pièce d’or trouvée sous les falaises, une nouvelle inachevée de Maurice Leblanc… et l’aide d’une jeune étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.
Mourir sur Seine
Sixième jour de l’Armada 2008. Un marin est retrouvé poignardé au beau milieu des quais de Rouen ! Un meurtre… huit millions de témoins.
Quel tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ? Quel étrange pacte semble lier des matelots du monde entier ? De quels trésors enfouis dans les méandres de la Seine sont-ils à la recherche ? Quel scandale dissimulent les autorités ?
Une implacable machination… qui prend en otage huit millions de touristes. Une course effrénée contre la montre avant la parade de la Seine. L’histoire de la navigation en Seine, stupéfiante et pourtant bien réelle, livre la clé de l’énigme. Les quais de Rouen, le cimetière de Villequier, les rues médiévales de Rouen, le marais Vernier… deviennent autant de scènes de cette enquête défiant l’imagination.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Code Lupin, une sorte de Da Vinci Code à la normande, sur fond de falaises crayeuses, à Étretat." -Anne Letouzé, L’Union
"De Michel Bussi, j'avais beaucoup aimé Nymphéas noirs et Un avion sans elle. J'avais apprécié le style et l'originalité des intrigues. J'ai retrouvé dans Mourir sur Seine le sens du suspense, du mystère et des fausses pistes, de celles qui mènent le lecteur sur des voies sans issue ou des culs de sac. - Cecilestmartin, Babelio
"La piraterie normande est oubliée et c'est le grand mérite de Michel Bussi de la faire revivre dans cette superbe enquête. Espérons que chercheurs et écrivains exploiteront ce filon et ressusciteront ces grandes figures évoquées dans ces pages…" - migdal, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michel Bussi est l’un des auteurs de romans policiers les plus lus et les plus primés en France. Ses romans, des page-turner sans surenchère de détails macabres, parviennent à faire la synthèse entre le meilleur de l’atmosphère des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense américains. Et c’est ce que les lecteurs adorent... Code Lupin est son premier livre de fiction publié. Mourir sur Seine s'est vendu à des milliers d'exemplaires et a obtenu en 2008 le prix du Comité régional du livre de Basse-Normandie (prix Reine Mathilde).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 863
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement
Ne cherchez pas les clefs pour savoir qui est caché, dans la réalité, sous tel ou tel personnage de ce roman. Il n’y en a pas. Ce texte n’est que pure imagination de l’auteur. Toute ressemblance avec une personne existante ne serait que fortuite.
Aux amours nées sous les voiles
« Ah ! Ah ! Je me rappelle, je me rappelle le beau trois-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier !
Je le trouvai si joli, si blanc, si gai ! L’Être était dessus, venant de là-bas, où sa race est née ! Et il m’a vu ! Il a vu ma demeure blanche aussi ; et il a sauté du navire sur la rive. Oh ! mon Dieu !
À présent, je sais, je devine. Le règne de l’homme est fini. »
Guy de Maupassant, Le Horla
1 Dérive
7h45, octobre 1983, Marais Vernier
Le timide soleil du matin commençait à rougir l’horizon de la baie de Seine. Le jour se levait sur le Marais Vernier. Un mince brouillard s’échappait du fleuve vers les falaises de La Roque. La route ondulait comme un serpent d’argent dans ce paysage lunaire.
Le 4 × 4, seul sur la route sinueuse, filait presque sans bruit sur la départementale. Quelques kilomètres avant le pont de Tancarville, il ralentit, puis tourna perpendiculairement, pour s’engager dans un étroit sentier de randonnée.
Le chemin défoncé était bordé de chaque côté d’un large talus inondé, que ne parvenaient pas à drainer les rangées d’aulnes et de saules têtards. De part et d’autre du chemin s’étendaient d’étranges parcelles cultivées en lanières, planes et longues, de la route à la Seine.
Muriel clignait des yeux. Le reflet du soleil naissant, qui semblait jouer à cache-cache entre les arbres, l’agaçait. Elle apercevait dans le rétroviseur le pâle rayon lumineux du phare de La Roque, perché sur son étrange falaise, tel le donjon d’un château fort, commandant l’entrée de l’estuaire.
Malgré les amortisseurs du 4 × 4, les secousses devenaient pénibles dans le véhicule. Muriel jeta un œil vers son mari, à côté d’elle. Il conduisait avec prudence.
Concentré.
Pourtant, Muriel ne se sentait pas rassurée.
Cette virée en baie de Seine n’était pas une bonne idée.
Elle avait un mauvais pressentiment. Peut-être n’était-ce dû qu’à cette ambiance lunaire de la baie, dans le matin. Ce silence. Ces cris d’oiseaux au-dessus d’elle. Ces milliers d’oiseaux dont ils venaient déranger le réveil.
Oui, cette histoire de plongée dans la Seine l’inquiétait ! Cette passion étrange l’avait amusée au début. Ces légendes. Ces plongées sous-marines. Mais désormais, toutes ces histoires commençaient à tourner à l’obsession. Elle jeta un nouveau coup d’œil vers son mari. Il ne remarqua même pas le regard posé sur lui. Il restait toujours concentré sur sa conduite, les mains fermement accrochées au volant, le regard fixe…
Ailleurs. Dans son univers.
L’autoradio diffusait une chanson que Muriel aimait bien. Morgane de toi, ce tube de Renaud.
Muriel tourna la tête vers leur fille, Marine, qui dormait encore, à l’arrière de la voiture.
La tête posée contre la portière. Un sourire d’ange. Un petit souffle régulier. Un peu de buée sur la vitre. Une jolie frimousse de fillette de dix ans. L’image même de l’innocence. Marine s’était levée très tôt ce matin. Mais avec quel enthousiasme ! La perspective d’une plongée l’excitait vraiment. Elle ne s’était pas endormie avant d’être sur l’autoroute. Pourtant, Muriel ne parvenait pas à chasser ce mauvais pressentiment.
Pourquoi prendre de tels risques ?
De tels risques ?
Bien entendu, son mari n’avait pas du tout la même analyse.
Des risques ? Quels risques ? Il était un plongeur expérimenté. Il avait exploré toutes les eaux de la planète. Il possédait son diplôme de moniteur fédéral et même un Open Water Diver, cette espèce de passeport international de plongée. Plonger était presque une routine pour lui désormais. Il n’y avait rien à craindre ! Marine possédait elle aussi une petite expérience. Elle plongeait depuis ses huit ans. Oh, pas bien profond, c’est clair. Entre trois et cinq mètres. Cet été, en Corse, elle avait plongé presque tous les jours.
Marine adorait cela.
Oui… Mais la Méditerranée, les eaux turquoise, les vacances… Ce n’était pas la même chose de plonger dans cette eau froide et trouble de la Seine, dans cette eau polluée, dans les remous des hélices.
Seuls !
À la radio, la chanson de Renaud étirait ses derniers accords. Le 4 × 4 ralentit et se gara sur une sorte de petit parking, face à un signal lumineux de la Seine. Muriel lut « Feu de l’épi » sur le petit édifice de béton blanc et vert. Ils se trouvaient dans une clairière, au carrefour de sentiers de randonnées. Muriel se sentit un peu plus rassurée. Son mari connaissait bien l’endroit, apparemment. Personne ne connaissait mieux que lui ces coins perdus le long du fleuve. Toujours cette obsession de la Seine et de ses mystères. Ils descendirent du véhicule.
Marine s’éveilla, frissonna, s’étira et lança un sourire de contentement à ses parents. Muriel la prit dans ses bras et lui frotta énergiquement le dos.
C’était bon.
Ils s’avancèrent encore vers la Seine, gravissant les quelques marches en béton du signal dont la faible lueur se perdait dans la clarté naissante.
Ils restèrent de longs instants tous les trois, sans un mot, émerveillés par le paysage. Sur leur droite, à quelques centaines de mètres, la silhouette élégante du pont de Tancarville, seule trace humaine dans la blancheur matinale de l’estuaire, entre ciel et mer. Devant eux, la surface sans ride du grand fleuve. Telle une immense bassine de mercure, froide, mystérieuse, insondable.
Immédiatement, le sinistre pressentiment submergea à nouveau Muriel.
Plonger là-dessous ?
— Regarde ! lança Marine dans le silence.
Quelques dizaines d’oiseaux, des balbuzards pêcheurs, se posèrent à quelques mètres d’eux.
Le regard de Muriel embrassa l’immensité. Aussi loin que ses yeux portaient, elle apercevait des oiseaux, des centaines d’oiseaux : des sarcelles, des spatules, des mouettes, elle ne les reconnaissait pas tous.
Un spectacle unique, Muriel devait bien le reconnaître.
Mais cela n’enlevait rien à son angoisse.
Elle se retourna, fouilla le coffre du véhicule et proposa une tasse d’un café brûlant dans le Thermos à son mari. Il but doucement.
Il était parfaitement calme, sûr de lui. Heureux, sans aucun doute. Marine avalait un croissant. Elle lança un grand sourire à sa mère. Cela la rassura. Un peu.
Après avoir bu son café, son mari se frotta les mains et rompit à son tour le silence de l’estuaire :
— Au travail !
C’était presque la première phrase qu’il prononçait. Une peur sans doute presque religieuse de troubler cette ambiance ouatée. Ils fouillèrent à nouveau l’arrière du 4 × 4. Tout le monde participa au portage du lourd et complexe matériel de plongée : les bouteilles, les combinaisons, les palmes.
Muriel regardait son mari agir avec précision. Il était un époux, un père très raisonnable. Accroupi, il vérifiait avec méticulosité les détendeurs et les compresseurs. Elle l’admirait. Elle l’aimait sans aucun doute. Même si parfois cette passion dévorante se glissait entre eux. Comme une maîtresse de plus en plus possessive. Une maîtresse qui lui volait son homme. Muriel se força, comme toujours, à penser autrement, à chasser la jalousie de ses pensées. Elle n’allait pas être comme toutes ces femmes désespérées des passions inutiles de leur homme ; cherchant à réduire leur originalité, leur essence ; occupées à les formater à leur image. Non, elle n’était pas comme cela ! Elle acceptait son mari tel qu’il était.
Mais…
Mais elle ne parvenait pas à éliminer en elle cette impression lancinante : la passion de son mari, cette obsession, ces recherches insensées prenaient petit à petit possession de son esprit, le dévoraient, faisaient de lui un autre homme.
Non ! Muriel se fit violence. Elle raisonnait comme une gamine jalouse. Son homme aimait la plongée sous-marine et les mystères. Voilà tout ! Sa fille aussi d’ailleurs, et Muriel avait simplement du mal à accepter d’être mise hors-jeu de leur complicité. Après tout, c’était elle qui refusait de s’initier à la plongée.
Oui, Marine était ravie, elle, de la passion de son père. Radieuse. Elle finissait d’enfiler sa combinaison de Néoprène noire et mauve. Ils se chargèrent du matériel de plongée ; Muriel suivit Marine et son père à quelques pas du 4 × 4, vers une petite crique, une sorte de petite plage en pente douce formée artificiellement par de gros blocs de pierres.
Au départ, devant cette idée de plongée dans la Seine, Muriel avait surtout eu peur des bateaux : la Seine était un fleuve navigable. Y plonger sans autorisation était sans doute interdit, à cause des paquebots. Mais dans cette crique, il n’y avait objectivement aucun danger.
Pourtant, loin de la rassurer, ce pressentiment morbide se faisait de plus en plus fort, cette impression oppressante qu’un drame allait se jouer, ici dans les minutes à venir.
Cela n’avait aucun sens.
— On ne sera sous l’eau que quinze minutes, vingt au plus, précisa son mari calmement. Ça ne sera pas long.
Muriel avait l’habitude d’attendre sur la rive, d’observer la surface de l’eau et de guetter avec angoisse qu’un visage la perce. Elle ne plongeait pas. Elle nageait peu, ce n’était pas son truc. Elle préférait marcher, randonner.
— Soyez prudents, murmura-t-elle.
Son mari ne releva pas. Marine non plus, déjà concentrée sur les infimes détails ressassés tant de fois par son père. Le souffle, les gestes calmes, le langage des mains sous l’eau.
L’espace d’un instant, Muriel se sentit à nouveau jalouse de cette complicité qui se nouait entre sa fille et son père, de sa capacité à l’enchanter à travers ses histoires, ses aventures, ses risques maîtrisés.
Muriel sourit doucement aux deux plongeurs.
Non, elle n’était pas jalouse. Elle était à sa place, elle aussi. À sa place quand elle tendrait la serviette chaude à sa fille qui sortirait grelottante de la Seine, qu’elle la serrerait dans ses bras, qu’elle écouterait ses récits enthousiastes. À sa place de mère. Ici, exactement, sur la rive.
— Qu’est-ce que tu vas faire ? demanda son mari.
Muriel se rapprocha de lui :
— Vous attendre… Me promener un peu peut-être.
Elle l’embrassa furtivement sur les lèvres et ajouta :
— Tu as toujours le don de découvrir des petits paradis pour la promenade.
Elle les regarda s’enfoncer dans l’eau morte avec une angoisse qu’elle ne put réfréner.
Lorsque la Seine se referma sur eux, elle leva les yeux, malgré elle. Deux hérons cendrés se poursuivaient, dans un vol gracieux, rappelant les courbes élégantes du pont de Tancarville.
Les instants qui suivirent lui parurent une éternité. Muriel n’eut pas le courage de rester sur la berge. Elle décida de marcher un peu, de s’enfoncer quelques instants dans le marais, observer de plus près les oiseaux, tomber peut-être nez à nez avec une vache des Highlands ou un cheval de Camargue, réintroduits dans le marais depuis quelques années.
Perdue dans ses pensées, concentrée sur son instinct de protection de mère et d’épouse, elle n’entendit pas les détonations, au loin, vers les tourbières.
La chasse était ouverte depuis moins d’une semaine. Mais Muriel n’en savait rien.
***
En ressortant de l’eau, la première chose que fit Marine, comme toujours, fut de chercher sa mère des yeux. Elle scruta la berge pour apercevoir sa silhouette rassurante.
Personne…
Marine se tourna vers son père : lui aussi cherchait Muriel des yeux.
Ils avancèrent doucement. La vase spongieuse qui faisait office de plage rendait malaisée leur progression. Ils ôtèrent leurs palmes et parvinrent sur la berge.
— Maman n’est pas là ? demanda Marine.
— Elle est partie se promener, la rassura son père. Elle va revenir tout de suite. En priorité, il faut nous sécher et nous rhabiller.
Marine fut déçue. Dans son souvenir, toutes les fois qu’elle avait plongé avec son papa, sa maman était là, sur le bord, à l’attendre avec un grand sourire, une serviette épaisse, une bouteille d’eau fraîche quand il faisait trop chaud.
Pas ce matin.
Elle n’eut plus trop l’occasion de réfléchir dans les instants suivants. Son père tira avec énergie la fermeture Eclair de sa combinaison. Marine détestait ce moment. Enlever la combinaison, c’était comme vous arracher une seconde peau, surtout celle des bras et des jambes. Son papa tira sur le Néoprène, plus fort, plus brutalement que ne le faisait maman d’habitude. Marine se fit la réflexion que cela lui avait fait moins mal, finalement. Elle ne se plaignait jamais quand elle était avec son papa.
Elle se retrouva enfouie dans une immense serviette.
— Rhabille-toi vite ! ordonna son père.
Marine ne se le fit pas dire deux fois. Il faisait vraiment très froid ! Rien à voir avec la Corse. Elle attrapa ses habits pendant que son père se changeait. Elle commençait à se réchauffer. Elle enfila son pull et n’oublia pas de poser sur sa tête un bonnet de laine écru à fleurs mauves. Marine se souvenait des conseils de sa maman : toujours se couvrir la tête en sortant de l’eau, toujours quand il fait froid.
Et il faisait froid ! De plus, Marine aimait bien ce bonnet dont elle avait elle-même choisi la laine et la couleur, avant que sa maman ne le lui tricote. La même laine que celle du pull que portait maman.
Maman ?
Où était-elle passée ? Que faisait-elle ?
Son père était en train de ranger les bouteilles et les combinaisons dans le coffre. Marine s’avança pour regarder la Seine. On voyait bien les deux ponts maintenant.
Soudain, quelque chose d’étrange dans le paysage troubla Marine, quelque chose d’anormal, de différent. Elle réfléchit mais n’arriva pas à trouver ce qui clochait.
Le coffre du 4 × 4 claqua. Son père avait terminé. Une lueur traversa l’esprit de Marine.
Les oiseaux !
Il n’y avait plus aucun cri d’oiseau ! Il n’y avait plus aucun oiseau, ni sur l’eau de la Seine, ni sur les arbres. Seuls quelques-uns, très loin, dans le ciel.
Pourquoi ?
Marine jeta un regard un peu inquiet vers son père. Il lui renvoya un sourire rassurant. Il était habillé. Il lui tendit sa large main :
— On va à la rencontre de maman ?
Ils entendirent à peine la détonation. Ce fut surtout l’envol de corbeaux freux, juste au-dessus de leur tête, qui les surprit.
— C’était quoi ? demanda Marine.
— Des chasseurs, répondit son père avec douceur. La chasse doit sûrement être ouverte. Mais ne t’inquiète pas, ils sont loin. Ils ont des zones exprès pour eux dans le marais…
— Ils tirent sur les oiseaux ?
— Ils essaient…
Marine tenait son explication pour la disparition des oiseaux, mais cela ne la rassurait pas. Elle avait envie d’en savoir plus sur cette histoire de zone réservée pour les chasseurs, mais elle sentit que ce n’était pas le moment. La main de son papa était humide. C’était rare. Généralement, il ne suait presque pas. Sans savoir l’expliquer, Marine avait l’impression que son père n’était pas tout à fait comme d’habitude, qu’il avait peur et voulait lui cacher. D’ailleurs, il marchait de plus en plus vite.
Marine avait du mal à suivre.
Sa main glissait.
— Papa ! Marche moins vite !
Son père ne ralentit pas. Ils continuèrent d’avancer sur le chemin. Il était mal entretenu. Des herbes hautes, encore humides de rosée, mouillaient le jean de Marine jusqu’aux genoux. Elle ne protesta pas. Ce n’était pas le moment.
— On pourrait l’appeler, proposa Marine.
Il y eut deux autres détonations, pas très loin. C’était difficile à évaluer. Marine était de moins en moins rassurée. À sa droite, elle aperçut un chemin qui partait vers une grande vasière bordée de roseaux. Le sol était de plus en plus marécageux. Un instant, elle eut peur que son père tourne à droite. Elle avait les pieds trempés. Elle avait froid. Elle en avait assez.
Son père ne tourna pas.
Il s’arrêta.
Marine sentit soudain la main de son papa mollir dans la sienne, comme si elle s’était vidée brusquement de tous ses os. Elle ne voyait rien, elle était trop petite, les herbes étaient trop hautes.
Elle se hissa sur la pointe des pieds.
Dans les roseaux, elle reconnut d’abord les fleurs mauves du pull en laine.
Elle échappa à la main sans vie de son père et s’avança.
Sa mère gisait dans l’herbe.
Les yeux grands ouverts. Son corps trempait dans une mare informe de boue et de sang mêlés. Un affreux trou noir à la place du ventre.
La main de son père rattrapa celle de Marine, brutalement, jusqu’à lui briser les phalanges. Marine ne ressentit aucune sorte de douleur. De son autre main, son père couvrit les yeux de sa fille.
Trop tard.
Elle avait eu le temps fixer l’horreur, d’imprimer à jamais dans sa mémoire l’image de l’effroyable drame.
Une nouvelle détonation retentit dans le ciel cotonneux de la baie de Seine et une dizaine de grives s’échappèrent d’un sureau, à une vingtaine de mètres d’eux.
L’étau des deux mains ne se desserra pas sur la paume et les yeux de Marine.
Elle était plongée dans le noir, le noir le plus absolu.
Seules les pulsions cardiaques au bout des doigts de son père la retenaient à la vie, au temps, au reste du monde.
Les pulsions cardiaques de son père.
Marine ne put jamais percevoir autre chose ce matin-là.
Elle ne vit pas le regard de son père se troubler, ses yeux se vider de leur humanité, une part de lui-même disparaître à jamais. Elle ne perçut pas, du haut de ses dix ans, plongée dans l’obscurité, dans la chaleur protectrice de son père, cette ligne franchie.
Cette infime frontière.
Entre la raison et la folie.
Cette infime bascule.
Marine ne pouvait rien savoir, rien percevoir.
Pourtant, ce matin-là, lentement, inexorablement, son père glissa sur la pente de la déraison.
De cette vision cauchemardesque repassée les mois et les années suivantes dans sa mémoire dérangée, allaient naître une obsession, des certitudes irrationnelles, l’implacable spirale de la folie…
Une folie qui allait devenir meurtrière lorsque les événements eux-mêmes s’affoleraient.
Marine ne pouvait pas savoir.
Cette main qui la reliait encore au monde, qui broyait ses doigts d’enfant, cette poigne paternelle ne la lâcherait jamais ; l’entraînerait, elle aussi, vers le précipice.
Vingt-cinq ans plus tard…
2 Le vertige de l’uniforme
Vendredi 4 juillet 2008, Quillebeuf-sur-Seine
Il était presque midi lorsque la silhouette du Cuauhtémoc surgit du méandre de Quillebeuf.
Une clameur parcourut les deux rives de la Seine. Le Cuauhtémoc n’était pas le premier des bateaux de l’Armada 2008 à remonter la Seine vers Rouen, mais il était sans aucun doute l’un des plus majestueux. Lentement, le trois-mâts, blanc de la coque aux voiles trapézoïdales, se rapprocha du bon millier de spectateurs massé sur les bords de Seine. Rive gauche, la petite ville de Quillebeuf semblait avoir retrouvé son lustre d’antan, du temps où elle fut le principal port de l’estuaire. Les terrasses ensoleillées étaient prises d’assaut. Une foule compacte se tassait sur les quais.
Juste en face, rive droite, la raffinerie de Port-Jérôme s’était brusquement vidée de son personnel. Secrétaires, ouvriers, cadres avaient profité de la pause déjeuner pour savourer un pique-nique improvisé et la parade des voiliers. Les navires utilisaient la marée pour remonter la Seine et le défilé des vieux gréements était assez dense.
Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque sculpté sur l’impressionnante figure de proue du voilier mexicain, le regard fier tourné vers l’horizon, semblait indifférent à l’enthousiasme du public. Tel n’était pas le cas des marins mexicains. Quillebeuf et Port-Jérôme étaient les premiers villages de la Seine depuis Le Havre. Leur premier bain de foule… Pour rendre hommage à leurs admirateurs, un bon nombre de matelots s’était hissé sur les vergues des trois-mâts, dans un impressionnant numéro d’équilibriste. Funambules à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la Seine, défiant le vertige, les marins saluaient le public avec l’air le plus naturel du monde.
Les visages bronzés des jeunes Mexicains, leurs impeccables chemises rayées blanches et noires, ajoutaient encore un peu d’exotisme à la scène. Les jeunes marins souriaient, certains étaient surpris par l’accueil si enthousiaste ; d’autres, déjà présents dans les Armadas précédentes, connaissaient la chaleur du public et l’appréciaient d’autant plus…
Ils savaient que des centaines de photographes amateurs immortalisaient l’instant. Ils devinaient également sur eux le regard admiratif de la gent féminine parmi la foule.
— Regardez ! cria soudain une voix sur le quai de Port-Jérôme.
Un doigt se tendit.
Des regards se tournèrent vers un point précis du mât de misaine, le premier des trois-mâts.
— Ce n’est pas vrai, il ne va pas le faire, gloussa une jolie petite blonde en s’agrippant à deux autres de ses collègues.
— Si ! répondit l’une d’elles en braquant l’objectif de son téléphone portable.
Sur la première vergue du mât de misaine, un des marins mexicains commençait lentement à remonter sa chemise.
La surprise des spectateurs des quais semblait partagée par les autres marins du Cuauhtémoc. Le strip-tease n’était sans doute pas prévu au programme officiel… Sans perdre l’équilibre, le jeune marin fit passer par-dessus sa tête sa chemise, la retint quelques instants par la manche, la fit tournoyer, pour la laisser tomber sur le pont du navire.
Le Mexicain exhiba avec désinvolture son torse parfait, musclé, bronzé, imberbe… Un frisson parcourut l’assistance. Quelques femmes applaudirent ou sifflèrent. Des spectatrices bien inspirées braquèrent leurs jumelles vers le jeune homme. Un petit parfum de folie gagna les quais, tandis qu’apparemment, sur le bateau, on ne goûtait guère à la plaisanterie, et qu’un certain nombre d’officiers semblait s’affairer.
— Il va sauter ! hurla soudain une voix dans la foule.
Un frisson saisit les spectateurs.
Les rires laissèrent petit à petit place à une forme d’inquiétude.
Il se passait quelque chose d’anormal ! Le regard incrédule des autres marins le confirmait.
Chacun écarquilla les yeux. Il n’y avait aucun doute, le jeune Mexicain avait détaché le crochet de sécurité qui le reliait à la vergue. Le marin regarda le ciel, sembla prononcer quelques mots, peut-être une prière, puis scruta à nouveau les quais, comme s’il cherchait à repérer la plus séduisante de ses admiratrices.
Soudain, il salua la foule d’un geste de toréador et s’élança.
Pendant quelques instants irréels, il défia le ciel et la Seine, les bras en croix, comme les ailes déployées des immenses oiseaux.
Des cris d’épouvante traversèrent la foule. Des appareils photos crépitèrent.
Il ne s’était pas passé une seconde lorsque le marin mexicain rassembla ses bras, droit devant lui, dans le prolongement exact de ses épaules. Le corps du plongeur s’inclina, suivant une courbe parfaitement maîtrisée.
Telle une torpille, il transperça l’eau grise de la Seine.
Sans presque une éclaboussure.
Un plongeon de plus de quinze mètres. Esthétiquement, d’une absolue perfection.
Les spectateurs sur les quais, décontenancés, hésitaient sur la conduite à tenir. Il y eut à peine quelques applaudissements. Chacun observait la surface de l’eau déjà redevenue calme. Les zooms des appareils photos et les jumelles se braquèrent, guettant le moindre mouvement de l’onde. Sur le Cuauhtémoc, des dizaines de cadets mexicains se précipitèrent sur le franc bord, tous aussi inquiets. Le trois-mâts mexicain ralentit sa course, jusqu’à s’arrêter, avec une rapidité surprenante pour un tel navire.
De longues secondes s’écoulèrent. L’inquiétude monta à son paroxysme.
Déjà plus d’une minute que le marin mexicain avait disparu dans la Seine.
Sur le pont du Cuauhtémoc, on décrochait en hâte un canot.
Le silence sur les quais était désormais insupportable. Une autre minute.
— Il faut faire quelque chose ! cria une voix.
Quelques spectateurs, sans attendre, avaient déjà appelé le SAMU ou la police. Quelques autres étaient sur le point de se jeter à l’eau.
Deux minutes et dix-sept secondes.
La surface du fleuve se troubla soudainement et le fin visage du marin mexicain surgit de l’eau. Tout sourire.
Dans l’instant qui suivit, une immense clameur emplit les deux rives du fleuve, unies dans la même émotion. Sur le Cuauhtémoc, on renonça à jeter le canot à l’eau. Le jeune héros mexicain salua une nouvelle fois la foule et rejoignit le voilier dans un crawl impeccable. En montant l’échelle de corde du navire, il fit un dernier signe à ses admirateurs, d’ailleurs surtout des admiratrices.
Quelques centaines de photographies immortalisèrent une ultime fois son torse luisant, son pantalon en toile blanc trempé, presque transparent, collant ses cuisses.
Le plongeur disparut sur le pont. Le Cuauhtémoc continua sa course et la foule se dispersa, non sans se questionner sur la signification du spectacle auquel elle venait d’assister.
Pari stupide ? Acte insensé ? Provocation ? Opération puérile de séduction ?
Aucun des spectateurs pourtant n’approchait la vérité.
Aucun ne pouvait se douter que ce qu’il avait vu n’avait aucune importance. La véritable explication tenait à ce que personne n’avait vu !
Personne sauf ce marin mexicain.
Carlos Jésus Aquileras Mungaray, dit Aquilero.
Il savait ce qu’il risquait : une mise à pied, un blâme, des corvées interminables. Plusieurs jours de consigne sur le bateau, sans aucun doute. Avec interdiction stricte de sortie.
Tout ceci, il le savait, il l’acceptait. Le jeu en valait la chandelle.
Tout ceci, toute cette mise en scène n’avait qu’un but. Passer deux minutes dix-sept sous la Seine, au large de Quillebeuf.
***
Le mercredi 9 juillet, à 18 heures exactement, soit cinq jours après son « exploit » de Quillebeuf, Carlos Jésus Aquileras Mungaray fut autorisé pour la première fois à prendre une permission hors du Cuauhtémoc. Son plongeon de Quillebeuf avait fait beaucoup de bruit pendant quelques jours. Des plus hauts gradés jusqu’à ses camarades de chambrée, chacun avait cherché à comprendre son geste. Peine perdue.
Pour faire pression, les autorités du Cuauhtémoc avaient prévenu la famille du jeune marin mexicain. Mais chacun savait sur le voilier que les Mungaray appartenaient à une riche et puissante famille de propriétaires forestiers mexicains, qui avait fait fortune dans le commerce de bois exotique depuis plusieurs générations. Le jeune Carlos Jésus, qui exigeait de ne se faire appeler que par le surnom d’Aquilero, était jeune, beau, riche… et arrogant.
Il se fichait bien des menaces de ses supérieurs.
Aquilero quitta le Cuauhtémoc peu après 18 heures, en compagnie de trois autres marins mexicains, bien décidé à rattraper le temps perdu. Casquettes blanches vissées sur le crâne, chemises blanches immaculées, galons aux épaules, pantalons impeccables, les quatre marins, dont trois d’entre eux étaient déjà présents lors d’Armadas précédentes, savaient que la nuit allait être longue. Ils connaissaient le prestige de leur uniforme. Pendant les heures qui suivirent, ils arpentèrent les rues médiévales de Rouen. Ils répondirent aux sourires charmés des belles estivantes, plaisantèrent en espagnol, acceptèrent sans rechigner de se laisser prendre en photo, échangèrent leurs casquettes, s’arrêtèrent aux terrasses, commandèrent des Corona en admirant les jambes qui passaient.
Le temps s’écoula rapidement. Lorsque la nuit commença à tomber, presque une dizaine de bières plus tard, les quatre marins mexicains se décidèrent à passer aux choses sérieuses.
La Cantina !
Pas seulement parce que le tarif des consommations y était réduit pour les marins, mais avant tout parce que tous les soirs, près de deux mille danseurs s’entassaient sous l’immense tente. Une incroyable fête ininterrompue, toutes les nuits. Une fête dont, bien entendu, les marins étaient les rois…
Dans le petit jeu de la concurrence entre équipages, les quatre marins du Cuauhtémoc savaient qu’ils n’avaient pas grand-chose à craindre. Leur cote était au plus haut. Une réputation qu’ils avaient patiemment bâtie et confirmée au fil des Armadas, depuis 1989.
Les latins lovers de l’Armada !
Aquilero avait tourné comme un aigle dans une volière depuis quatre nuits, écoutant avec une envie toujours plus pressante les récits incroyables des conquêtes amoureuses de ses camarades de chambrée.
Si facile !
Si facile lorsque l’on sait danser sur des rythmes latins, que l’on sait porter l’uniforme et que l’on connaît quelques compliments galants français à prononcer avec l’accent sud-américain.
La Cantina était déjà pleine à craquer lorsqu’ils arrivèrent. La chaleur était étouffante, la file d’attente pour accéder aux bières, impressionnante. Les quatre marins mexicains se séparèrent en se souhaitant bonne chance.
Aquilero se fraya un chemin à travers les corps en sueur. La salsa succédait à la timba. La plupart des danseurs ne percevaient aucune différence.
Il observa un instant la scène avant de se jeter dans l’arène. Dans un manège incessant de jupes, les filles passaient de main en main, dansant, riant, totalement désinhibées.
Les corps se collaient, se décollaient. Les boutons des chemises des marins sautaient les uns après les autres. Aquilero observa, amusé, quelques jeunes rouennais tenter de concurrencer les marins sud-américains, se déhanchant, empoignant avec le plus de naturel possible hanches, fesses et chutes de reins… Sans doute des heures d’entraînement. Aquilero sourit : il ne leur manquait pas que l’uniforme, il leur manquait surtout une cambrure, une ondulation, quelque chose qui ne s’apprend pas.
À la salsa succéda le tango. Aquilero décida d’entrer dans la danse. Il avait repéré une sculpturale petite brune dont les cheveux descendaient presque plus bas que la jupe. Il fendit la foule et la jeune fille se retrouva comme par magie dans ses bras puissants. Rapidement, un cercle se forma autour des deux danseurs. Le mélange des corps tournoya durant de longues minutes avant qu’Aquilero n’abandonne sa partenaire, épuisée, pour en choisir une autre dans le cercle des jeunes rouennaises qui le couvaient des yeux.
Des filles de tout âge, plus au moins excitées, sachant plus ou moins danser, se succédèrent entre ses bras pendant de longues heures.
La sueur était descendue dans son dos, trempant sa fine chemise blanche. Après une salsa torride avec une fille qui devait faire presque deux fois son poids, et qui pourtant bougeait remarquablement bien, Aquilero retourna vers le bar boire une bière et laisser à d’autres marins du Cuauhtémoc le soin d’animer la soirée.
Il resta de longues minutes à reprendre son souffle.
Un instant, il repensa à ce qu’il cherchait, vraiment. Le véritable motif pour lequel il était revenu à Rouen, alors qu’il aurait pu depuis longtemps abandonner cette vie de marin. Vivre de la fortune familiale avec la jeunesse dorée de Cancun. Cette mission qu’il ressassait dans sa tête depuis des mois. Ces quelques jours qu’il préparait depuis cinq ans. Il allait devoir être méfiant. Il n’avait qu’une confiance limitée dans les autres. Il ne connaissait de ce coin du monde, la vallée de la Seine, que ce qu’il en avait lu, étudié, même s’il l’avait fait avec une incroyable minutie.
Son regard accrocha le ventre plat d’une danseuse qui ondulait à moins d’un mètre de son entrejambe.
Cette mission attendrait demain ! Ce soir, il allait vivre, pleinement, jusqu’au bout de la nuit. Ensuite, il lui faudrait reprendre contact avec les autres. Penser au butin. Rechercher des preuves. Plonger. Il savait ce qu’il avait à faire.
Il vida son verre de bière d’une traite et s’immergea dans la foule.
Sa chemise était désormais ouverte jusqu’au nombril. La plupart des filles qu’il approchait détournaient les yeux. D’autres plus rares, soutenaient son regard d’aigle. Parfois, au détour d’un mouvement, des seins le frôlèrent, des mains osèrent s’aventurer sur son torse nu.
Aquilero continua de danser, de multiplier les partenaires, avec un peu moins d’entrain toutefois. Les rangs de la Cantina commençaient à se clairsemer. Les uniformes se faisaient moins nombreux. Ils repartaient, souvent accompagnés.
Aquilero campa bientôt au bar, discutant avec les filles les plus proches, les yeux dans les yeux, en anglais ou en espagnol.
Vers un peu plus de deux heures du matin, Aquilero quitta la Cantina, dans les bras d’une jolie blonde.
Personne ne le remarqua.
Les rares témoins ne s’en souvinrent que le lendemain, lorsque la police les interrogea. Ils furent beaucoup à avoir remarqué Aquilero. Par contre, aucun d’entre eux ne fut capable de décrire le visage de la jeune fille avec qui il quitta la Cantina.
Seuls quelques témoins évoquèrent la perfection des courbes, observées de dos, de la jeune fille pendue au coup du marin mexicain.
Jeudi 10 juillet 2008 :
3 Nature morte
5h45, quai Boisguilbert, Rouen
Maxime Cacheux s’engagea sur les quais de Seine, son chevalet sous le bras, un peu avant six heures du matin. Le soleil venait à peine de se lever. Il faisait partie de cette poignée de peintres en herbe qui se levait tous les matins aux aurores pour profiter de la vue des voiliers dans le jour naissant, sans la foule.
Il s’installa face au Cuauhtémoc pour terminer l’aquarelle qu’il avait esquissée la veille. Il voulait parvenir à peindre une dizaine de toiles pendant l’Armada. Il avait organisé son travail en conséquence. Son chef, à la Chambre régionale des comptes, avait accepté qu’il ne travaille qu’à mi-temps cette semaine.
Il ouvrit son chevalet, positionna sa palette, recherchant l’endroit exact où il se trouvait la veille. Il pesta.
La lumière n’était pas la même ! Il rumina contre sa stupidité : il devait esquisser un tableau par matin, un point c’est tout. Ne pas chercher à en commencer un autre. Il pensa avec envie à cette galerie d’Honfleur qui lui avait fait la vague promesse d’exposer ses œuvres, en août. Il savait bien que ses toiles n’étaient pas très originales. Il savait également que le thème de l’Armada faisait vendre… Il soupira en regardant le ciel. Le temps était déjà trop lumineux. Il était arrivé cinq minutes trop tard. La veille, il y avait un ciel extraordinaire.
Tant pis. Il attrapa un pinceau et commença par une observation minutieuse du paysage.
Les quais étaient déserts.
Les gens sont stupides, pensa Maxime. C’est pourtant la meilleure heure.
Il reprit son examen. Un détail attira son regard. Plus qu’un détail d’ailleurs.
Sur le côté droit de l’angle de son tableau, un homme était allongé par terre, à une dizaine de mètres du Cuauhtémoc.
Maxime sourit. Un pauvre type qui avait sans doute trop bu la veille.
Dans l’instant suivant, son œil aiguisé repéra un détail anormal.
Une flaque rouge sous le corps du marin.
— Merde, pesta Maxime Cacheux.
Il pensa qu’il allait perdre un temps précieux, ce court moment avant que la foule n’envahisse les quais. Il hésita. À contrecœur, il se décida et s’approcha du corps étendu.
Jamais, par la suite, Maxime Cacheux n’oublia ce qu’il vit ce matin-là. Il paraît que depuis, ses aquarelles sont bien meilleures. Plus sombres, plus profondes.
Maxime se pencha sur le corps inerte. Ce n’était pas un clochard.
C’était un marin, un marin mexicain. Il reconnut sa chemise blanche, ses insignes.
Un marin mexicain ayant trop abusé de tequila pour pouvoir atteindre son bateau ?
Non, hélas, ce n’était pas cela.
Le jeune Mexicain avait les yeux grands ouverts, révulsés.
Une large entaille, béante, rougie de sang, tachait sa chemise, à la place exacte de son cœur.
Carlos Jésus Aquileras Mungaray, dit Aquilero, gisait mort, poignardé sur les quais de la Seine, juste devant le Cuauhtémoc.
4 Quai du crime
7h15, quai Boisguilbert, Rouen
Le commissaire Gustave Paturel fendit la foule avec autorité. Le poids de ses quatre-vingt-dix kilos l’aida à bousculer la masse compacte de badauds. Sa voix de stentor fit le reste :
— Police ! Laissez passer !
Comme il s’en doutait, la densité de visiteurs était déjà impressionnante.
Qu’est-ce que cela allait être dans la matinée ?
Il fallait régler cette affaire rapidement. Rapidement, mais sans prendre aucun risque.
Sur la route, il avait essayé de faire le point. Un cadavre sur les quais, pendant l’Armada, c’était une première ! Mais à bien y réfléchir, c’était quelque chose qui devait bien arriver un jour. Alcool, mélange des genres, excitation. Malgré le déploiement de la police, les caméras partout, un jour ou l’autre, une altercation pouvait dégénérer. L’enquête n’inquiétait pas trop le commissaire. Étant donné l’affluence, de jour comme de nuit, trouver des témoins ne serait pas difficile. L’assassin de ce marin allait peut-être même venir se dénoncer tout seul, une fois dessaoulé. Non, ce qui préoccupait le plus le commissaire Paturel, c’était la gestion médiatique de cette affaire. L’Armada de Rouen, avec ses millions de touristes sur les quais, était désormais la deuxième plus importante manifestation populaire française, derrière le Tour de France. La plus importante, même, si l’on considérait que le Tour de France se déroulait sur trois semaines et sur tout le territoire national.
Alors, en tant que responsable de la sécurité sur l’Armada, il lui fallait marcher sur des œufs. Il allait devoir tout gérer en direct avec le préfet, tout le gratin des élus de Rouen. Un tel fait divers devait faire le moins d’éclaboussures possible… Il allait être en première ligne… Il aperçut les voiles blanches du Cuauhtémoc.
Il y était !
Il écarta d’un geste ferme le dernier rang de badauds :
— Police. Circulez.
Il franchit le ruban orange installé en hâte sur les quais autour du cadavre. Il commençait à avoir l’explication de l’encombrement sur les quais. En plus des touristes qui venaient assouvir une sorte de curiosité morbide, le cordon sanitaire autour du corps étendu occupait les trois quarts du quai, créant un goulot d’étranglement devant le Cuauhtémoc.
Le commissaire Paturel s’épongea le front. Il jeta un coup d’œil à la scène du crime et fut rassuré. Ses deux principaux adjoints, les inspecteurs Colette Cadinot et Ovide Stepanu, étaient déjà en place.
Colette Cadinot vint la première à la rencontre du commissaire, visiblement rassurée par l’arrivée de son patron :
— Bonjour Gustave. Enfin… On t’attendait.
L’inspectrice jeta un coup d’œil appuyé à sa montre. Le commissaire ne releva pas l’allusion à son retard. Il n’allait tout de même pas avouer à son inspectrice que lorsqu’on l’avait appelé à son domicile, vers six heures du matin, il était seul chez lui avec ses deux enfants en garde, et qu’il avait mis du temps pour trouver une solution, en l’occurrence l’appel à un réseau de baby-sitters sur internet. Avec ses enfants sur les bras en juillet, ce crime tombait particulièrement mal !
Le commissaire Paturel observa quelques instants l’inspectrice Cadinot. Plus elle vieillissait, plus elle ressemblait à Miss Ratched, l’infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucous. Une petite femme stricte au regard clair. Le commissaire la connaissait depuis près de trente ans. Difficile de croire, à la vue de cette quinquagénaire raidie, qu’elle avait été jeune, séduisante et presque drôle à son début de carrière. Depuis, la longue lutte de ce petit bout de femme pour faire sa place dans la police l’avait rendue sérieuse et aigrie. Pourtant, le commissaire Paturel l’aimait bien. Une longue complicité les unissait. Il reconnaissait de plus qu’elle était une collaboratrice intègre, efficace, précise. Un peu fatigante sur les bords, certes, mais une sacrée professionnelle, sur laquelle il savait pouvoir compter. C’était bien là le principal.
— Faites-moi reculer toute cette foule, commanda le commissaire.
Une dizaine d’agents de police en uniforme tenta de faire reculer, sans grand succès, les badauds.
— Colette, tu me fais le point ? continua Paturel d’une voix suffisamment basse pour que les détails ne sortent pas du cordon sanitaire.
— OK. On est là depuis une heure environ. C’est un peintre amateur qui a trouvé le corps, à 5h45. Un certain Maxime Cacheux. Il travaille à la Chambre des comptes. On est en train de l’interroger, mais il n’y aura rien à tirer de ce côté-là.
— Et la victime ?
— On l’a identifiée. Ce n’était pas difficile. Il avait ses papiers sur lui. C’était une petite vedette locale.
Elle consulta ses notes et lut :
— Carlos Jésus Aquileras Mungaray. Matelot depuis cinq ans sur le Cuauhtémoc. Un des cadres du voilier, après y avoir été cadet il y a quatre ans. D’après ce qu’on sait, il appartient à une famille mexicaine influente. On a lancé des recherches de ce côté-là. Le capitaine du Cuauhtémoc se charge de prévenir la famille. Apparemment, Mungaray était une sorte de tête brûlée. Il se faisait surnommer Aquilero. C’était un pilier des soirées rouennaises, le genre play-boy, casse-cou… Il y a une semaine, il s’était amusé à plonger dans la Seine au large de Quillebeuf, du haut du mât du Cuauhtémoc, pour fêter son arrivée sur l’Armada…
Toutes ces informations rassuraient le commissaire. La victime était un séducteur invétéré, un provocateur. Il avait sans doute dû tirer un peu trop sur la corde face à un rival éméché. Il jeta un coup d’œil sur le drapeau mexicain qui flottait sur le Cuauhtémoc. Venir de si loin pour se faire assassiner bêtement au petit matin…
— Et le meurtre, continua le commissaire. Quels détails ?
— Mungaray a passé la soirée en ville hier, avec d’autres marins du Cuauhtémoc. Ensuite, ils sont allés danser à la Cantina, jusqu’à environ deux heures du matin. D’après les premiers témoignages, on l’aurait vu partir au bras d’une blonde que personne n’a encore pu identifier.
— Et après ?
— Rien. Rien avant que le peintre ne trouve le corps… Un objet tranchant en plein cœur. Sans doute un poignard, mais il n’y aucune trace de l’arme du crime près du corps…
Le commissaire observa les rangs serrés de badauds agglutinés à dix mètres, dont le cordon de policiers parvenait simplement à limiter la progression.
Il réfléchit un instant.
Peut-être que couper complètement les quais, pour quelques heures, le temps de l’enquête, serait la meilleure solution. Il pensa immédiatement aux implications d’une telle initiative. Les protestations, les plaintes. Peut-être pourrait-on trouver une sorte de déviation pour les touristes.
Il soupira.
Il n’avait pas le temps. Il fallait agir au plus vite. Dans une heure, peut-être moins, la police aurait vidé les lieux et embarqué le cadavre. Faire maintenir la foule à bonne distance par un cordon de policiers était sans doute la meilleure solution. C’était le plus souvent comme cela que l’on gérait un accident sur une voirie, il suffisait de travailler rapidement. Les journalistes n’allaient pas non plus tarder à rappliquer. Ils étaient peut-être même déjà là. Mais le commissaire Paturel savait également qu’il ne devait prendre aucun risque, qu’il devait laisser la police scientifique faire son travail. Il devait respecter scrupuleusement toutes les étapes, même si les circonstances étaient exceptionnelles. Si jamais l’affaire se compliquait, il serait le premier à sauter en cas d’oubli dans la procédure.
— Et toi Colette, tu penses quoi de tout ça ? demanda Paturel.
L’inspectrice répondit avec une précision clinique :
— Si on fait abstraction de l’Armada, des touristes, de la pression que tout cela va générer, je dirais qu’on a affaire à un vulgaire fait divers. Une bagarre qui tourne mal.
— On a mesuré le taux d’alcoolémie de la victime ?
— C’est en cours. Mais selon les témoignages, il avait bu plus d’une dizaine de bières au cours de la soirée.
Le commissaire afficha un sourire de soulagement. Tout ceci allait se résoudre rapidement. Il tourna la tête et remarqua qu’un cadet se hissait sur la martingale du Cuauhtémoc pour mettre en berne le drapeau vert, blanc et rouge du voilier mexicain.
Déjà !
Il se retourna vers l’inspectrice.
— Tout ça va dans ton sens, Colette. Mungaray avait-il de l’argent ? On lui a volé quelque chose ?
— Visiblement, non. Il avait juste quelques euros sur lui…
— Mouais… Il faut retrouver cette fille. Cette fille blonde. C’est elle la clé. Sans faire de psychologie de bazar, je verrais bien une affaire de cœur qui a mal tourné. Le beau Sud-Américain tourne la tête d’une jeune fille et l’entraîne dans un coin sombre. La belle avait un amoureux local qui n’apprécie pas trop cette concurrence déloyale. Il suit Mungaray et sa conquête. L’explication tourne mal… Ça te semble plausible, Colette ?
— C’est possible…
— Le commissaire Paturel sentit, au peu d’enthousiasme de l’inspectrice, qu’il lui manquait encore un certain nombre d’éléments dans cette affaire. Colette Cadinot ne lui avait pas encore tout dit. Il posa une question qui lui semblait anodine.
Elle ne l’était pas.
— On a une idée de l’heure de la mort ?
Colette Cadinot respira plus lentement. Paturel perçut immédiatement qu’il y avait un problème.
— Le légiste est en train de travailler dessus, répondit lentement l’inspectrice. D’après lui, la mort a été instantanée. Elle remonte à un peu plus de deux heures du matin. Mais il va affiner…
Le commissaire tiqua :
— Deux heures du matin ? Et on a retrouvé le corps à six heures ?
Il jeta un coup d’œil aux quais bondés. Une tension montait en lui. Cette affaire prenait une mauvaise tournure. Il hurla à l’encontre des policiers qui faisaient ce qu’ils pouvaient :
— Mais faites-moi reculer cette foule, nom de Dieu ! Ils vont finir par nous piétiner !
Il se retourna vers Colette et continua, un peu calmé :
— Entre deux et six heures du matin, il est impossible que personne n’ait remarqué le corps sur les quais. Il y a forcément eu du passage toute la nuit ! Le légiste est vraiment sûr de son diagnostic ? Mungaray n’a pas pu être seulement blessé, puis avoir tenté de se traîner jusqu’au Cuauhtémoc ?
Colette Cadinot secoua la tête :
— Il est formel. Le coup a été mortel. Un peu après deux heures du matin.
— Merde ! Tu sais ce que cela signifie, Colette ?
— Oui, répondit l’inspectrice avec flegme. Que Mungaray a été tué ailleurs, et ramené seulement ensuite, quatre heures plus tard, à proximité du Cuauhtémoc. C’est d’ailleurs ce que les experts semblent confirmer. Mungaray n’a pas été tué sur les quais… Du coup, l’hypothèse du crime passionnel dans la panique se complique un peu…
— À voir, se rassura le commissaire. À voir. Le meurtrier a pu vouloir cacher le corps. Le ramener au Cuauhtémoc. Il y a sans doute une explication rationnelle.
— Il y en a toujours une…
Le commissaire toussota. Il dévisagea un type qui tentait de prendre une photo entre deux uniformes et se défoula sur lui :
— Les photos sont interdites ! Encore une et je vous confisque l’appareil.
L’homme se recula sans protester. Le commissaire s’épongea le front :
— OK. Bon, que les légistes se magnent de faire leur travail. Il faut qu’on libère les lieux avant que ça tourne à l’émeute. Je vais contacter également la police scientifique nationale pour l’examen du corps. ADN et tout le tintouin. On ne va prendre aucun risque.
Le commissaire s’avança et se pencha sur le corps étendu du jeune marin. Divers policiers en civil s’affairaient, équipés de matériels sophistiqués, passant une lampe polylight pour repérer d’éventuelles empreintes digitales, attrapant le moindre cheveu à l’aide de pincettes minuscules et les déposant dans des petits sachets, recueillant à l’aide d’une sorte de long coton-tige le sang sur le goudron du quai.
Pas étonnant que le public se bouscule pour observer la scène !
Les Experts, en live !
Le commissaire se retourna, énervé, et interpella un autre badaud qui tentait de s’approcher pour prendre un cliché :
— La foire Saint-Romain, c’est sur l’autre rive !
Le touriste recula sans demander son reste.
Une main se posa sur l’épaule du commissaire. Paturel se retourna et reconnut Ovide Stepanu, le second inspecteur qu’il avait dépêché sur l’affaire. D’origine roumaine, l’inspecteur Ovide Stepanu était arrivé en France depuis une vingtaine d’années. Il était un flic remarquable, doté d’une intuition et d’une imagination hors du commun.
Parfois trop.
Dans son dos, au commissariat de Rouen, courait sur lui le surnom d’inspecteur « Cassandre ». Orthodoxe pratiquant, superstitieux, il semblait parfois porter la misère du monde sur ses épaules et avait le don de prendre l’air désolé pour annoncer des catastrophes ou des explications les plus terrifiantes possibles aux crimes… qui bien souvent se révélaient exactes !
Cela n’aidait pas beaucoup à sa popularité. Pas plus que cette allure dépressive de vieux garçon, ses vêtements sans forme comme s’il n’en avait pas changé depuis sa venue de Roumanie, ou cette absence presque permanente de sourire. Le commissaire Paturel avait mis plusieurs années avant de comprendre pourquoi l’inspecteur Stepanu ne souriait jamais. Ce n’était aucunement une question de caractère. C’était simplement de la pudeur. Stepanu avait ramené de Roumanie une vilaine dentition. Avec le temps, il avait su développer des rictus qui lui permettaient d’exhiber le moins possible ses dents jaunies, notamment en évitant les sourires inutiles.
Le commissaire avait compris, contrairement à beaucoup de ses collègues, que l’inspecteur Stepanu n’était pas un type blasé faisant la tête en permanence, mais au contraire un brave type, brillant, timide et complexé.
— C’est la merde Gustave, attaqua l’inspecteur Stepanu, avec cette façon inimitable de parler sans bouger les lèvres.
Un type brillant, timide, complexé… et qui ne prenait la parole que pour vous annoncer des kilos d’emmerdements !
Paturel soupira :
— Qu’est-ce qu’il y a, Ovide ?
— Je ne voudrais pas jouer les trouble-fêtes. J’ai écouté votre théorie, commissaire. Le crime passionnel… Je suis désolé, mais ça ne colle pas…
Le commissaire croisa le regard tout aussi abattu de l’inspectrice Cadinot.
— Il faut que je vous montre quelque chose, commissaire, continua Ovide Stepanu.
L’inspecteur se pencha sur le corps du jeune marin mexicain, demanda à la police scientifique de faire un peu de place et commença à déboutonner la chemise du cadavre. Stepanu dénuda une épaule du corps inerte, puis, sans aucune gêne apparente, tourna légèrement le tronc pour dévoiler toute l’omoplate.
— Regardez.
Le commissaire et l’inspectrice se penchèrent. L’épaule, l’omoplate et le haut du dos d’Aquilero étaient couverts de tatouages. Ils observèrent avec plus d’attention. Ils reconnurent distinctement quatre animaux : une colombe, un crocodile, un tigre et un requin. Les tatouages étaient sobres, les traits des animaux précis.
— Et alors ? demanda le commissaire. Où est le problème ? Ça doit être courant, les tatouages chez les marins. Non ?
— Ce n’est pas cela le problème, Gustave, continua Ovide sans se départir de son attitude de croque-mort.
Il dénuda encore un peu plus le dos du marin. Un cinquième tatouage apparut.
Mais celui-ci était méconnaissable !
Le tatouage était brûlé. La peau du cadavre, à l’endroit exact du cinquième tatouage, cloquait atrocement et commençait à se disloquer en lambeaux.
Colette Cadinot détourna les yeux. Le commissaire déglutit.
Nom de Dieu ! Il ne s’attendait pas à cela !
— C’est… C’est récent cette brûlure ? articula le commissaire.
— Selon les légistes, répondit Stepanu, à peu près l’heure de la mort. Soit un peu avant la mort, soit un peu après… On en saura plus dans quelques heures. Je vous l’accorde commissaire, le détail a de l’importance. Surtout pour ce pauvre garçon d’ailleurs.
Des gouttes de sueur perlaient sur le front du commissaire Paturel.
Cette fois-ci, il y était, dans la merde !
A ce rythme-là, la thèse du crime passionnel ou crapuleux n’allait pas tenir longtemps. Il osait à peine imaginer l’hypothèse d’un sadique en liberté. En pleine Armada, au milieu de millions de touristes.
Il fallait que cela tombe sur lui !
La somme d’ennuis en perspective lui donna le vertige. Il n’osait même plus affronter du regard la foule de curieux. Avec un peu de malchance, un journaliste avait tout vu.
— On sait ce que représentait le tatouage qui a été brûlé ? demanda le commissaire d’une voix blanche.
— Oui, répondit Stepanu presque avec entrain. Il n’y a pas de doute. C’était un aigle.
— Aquilero, fit l’inspectrice Cadinot, s’imposant dans la conversation. Aquila signifie aigle en espagnol. L’aigle, c’était lui… C’est lui qu’on a voulu brûler… Une vengeance ?
Des gouttes de sueur coulaient maintenant dans le bas du dos du commissaire Paturel. Tout allait trop vite. Pourtant, Stepanu ne lui laissa aucun répit et enfonça encore un peu plus le clou :
— Au risque de paraître rabat-joie, il y a encore autre chose, commissaire.
Paturel aurait aimé être blasé. Il ne l’était pas.
— Quoi ?
— La brûlure… Elle n’est pas banale… La chair donne l’impression d’avoir été marquée au fer rouge. Un peu comme on marque une bête… Et…
Il hésita à continuer.
— Et ? insista malgré lui le commissaire.
— Selon les légistes, la brûlure présente une forme, comme une signature.
Il sortit une page d’agenda déchirée de sa poche.
— Une signature qui ressemble à cela.
Paturel et Cadinot se penchèrent. L’inspecteur Stepanu tendit devant leurs yeux le dessin suivant : M<.
Un M et une sorte de V penché sur le côté…
— J’ai déjà balancé le symbole par le net à Paris, indiqua Stepanu. Ils vont faire des recoupements. Ils ont des cryptologues. Il s’agit peut-être d’un symbole cabalistique, d’un truc religieux, d’une secte, je ne sais pas quoi… Ils ont des banques de symboles…
Le commissaire Paturel n’écoutait plus son inspecteur. Il n’avait pas besoin de tous ces détails.
Il sentait les pavés des quais glisser sous ses pieds.
Il fixa son regard sur le drapeau mexicain en berne, puis regarda Colette Cadinot.
Elle aussi avait compris.
Comme le commissaire, elle habitait le pays de Caux depuis longtemps. Elle connaissait l’histoire de l’estuaire de la Seine. Ses légendes, ses traditions. Nul besoin d’experts parisiens et de banque de données. Le commissaire et son inspectrice savaient parfaitement à quoi correspondait ce mystérieux symbole.
M<
D’où il venait et ce qu’il signifiait.
Pourtant loin d’éclairer le mystère, il le rendait plus épais encore.
Insondable. Invraisemblable.
— Bordel, fit le commissaire. Pas un mot de tout ceci à la presse ! Black-out total. La seule piste officielle, c’est le crime passionnel et l’appel à témoin, en particulier cette fille blonde qui est sans doute la dernière à avoir vu Mungaray vivant. Officiellement, on mise tout là-dessus !
Le commissaire pensait en avoir terminé avec les émotions. Pouvoir se ressaisir, s’organiser.
Le pire était pourtant à venir.
Au moment où la police scientifique se penchait à nouveau sur le corps du jeune Mexicain, un téléphone portable sonna.
A moins d’un mètre d’eux.
Chacun se regarda. Personne ne décrocha.
De longs instants s’écoulèrent, rythmés par la sonnerie insistante.
— Bordel, hurla le commissaire, est-ce que le propriétaire de ce téléphone peut se donner la peine de répondre ?
— Ça va être difficile, glissa sobrement Ovide Stepanu. Le commissaire se rendit compte que tous les regards étaient tournés vers le corps étendu sur les quais de la Seine.
La sonnerie provenait de la poche du cadavre.
Quelqu’un cherchait à entrer en conversation téléphonique avec un mort !
5 Colombages et gueule de bois
7h30, 13, rue Saint-Romain, Rouen
Maline Abruzze dormait d’un sommeil de plomb lorsque le téléphone sonna. Elle aventura une main hors de son lit pour attraper l’appareil. Une voix enjouée lui déchira le tympan :
— Debout, citoyenne !
La journaliste identifia immédiatement la voix de son rédacteur en chef, Christian Decultot. Elle ne prit même pas la peine de répondre et le laissa débiter sa tirade :
— Maline ? Tu es là ? Je ne te réveille pas tout de même ? Allez ! Oust ! Rapplique au journal. Dans mon bureau dans une demi-heure. J’ai un scoop pour toi !
— Hein ? fut tout ce que réussit à émettre la voix mal réveillée de Maline.
— Allez ma belle. Une douche et au rapport. Un scoop je te dis. On a un meurtre sur les bras ! Le meurtre d’un marin, cette nuit, au beau milieu des quais de Rouen.
Le rédacteur en chef raccrocha.
Maline peinait à sortir de sa torpeur.
Un crime ? Un marin ? Sur les quais ?
Sans doute un banal règlement de comptes… Pas de quoi s’exciter.
Elle tenta de se redresser dans son lit. Sa tête lui faisait atrocement mal. Elle repoussa les draps et s’assit au bord du lit. Maline se sentait vidée.
Un orchestre semblait encore jouer la fanfare dans sa tête. Des restes du concert de la veille.
Les pensées de la journaliste s’échappèrent quelques instants vers la nuit précédente. Après l’immense concert sur les quais de Rouen, le traditionnel feu d’artifice, elle avait fini la soirée dans un petit pub de Déville-lès-Rouen. Le programme off de l’Armada. Un groupe local de blues, Rock en Stock, avait enfilé les standards jusqu’au petit matin.
Maline tenta de se lever. Elle tituba un peu. Elle s’approcha de la fenêtre de son appartement, sans même se soucier de sa nudité. Il faisait une chaleur étouffante dans les appartements du centre-ville. Dans sa tête, des ululements fantomatiques répondaient à une sorte de rythmique infernale. Des percussions qui lui semblaient rebondir sur les parois de son crâne.
Le leader du groupe de blues, après une dizaine de rappels, avait entamé un dernier morceau en hommage à la commune du concert. Déville… Le fameux Sympathy for the devil, des Stones. Avant ce soir, Maline ne s’était jamais fait la réflexion que la commune qui s’étendait le long du Cailly portait le nom du diable… Amusant. L’improvisation sur le standard des Rolling Stones avait duré près de trois quarts d’heure. Tout le public du bar avait accompagné les musiciens par des « hou hou » lancinants, attrapant tout ce qui pouvait servir à faire du bruit pour accompagner les percussions vaudoues. Maracas improvisées, cuillers pour frapper sur des verres, phalanges et paumes sur les tables…. Des filles étaient debout sur les chaises, décoiffées en tigresses, adoptant des poses félines, devant des garçons s’essayant à des déhanchements de zombies haïtiens.
Maline colla son visage à la fenêtre. Il faisait déjà beau. Elle jeta un cachet d’aspirine dans un verre d’eau et soupira.
A trente-cinq ans, bientôt trente-six, elle avait décidément du mal, maintenant, à se remettre de ces soirs de fiesta.
Elle se traîna jusqu’à la douche. Le jet d’eau tiède la réveilla un peu. Elle se fit la remarque qu’elle en était seulement au cinquième jour de l’Armada, et qu’elle était déjà sur les rotules.
Epuisée.
Elle le savait, elle devait être plus raisonnable.
D’accord ! Elle semblait entendre son père lui parler. Mais le problème, c’était que l’Armada ne revenait que tous les quatre ans, parfois cinq. Dix jours, dix nuits à peine tous les cinq ans ! Comment ne pas en profiter ? Comment ne pas profiter à fond de cette poignée de jours invraisemblables où Rouen, la belle endormie, se réveillait, avant de sombrer dans une nouvelle léthargie.
Le jet de la douche vira de tiède au franchement glacé. C’était habituel. Le chauffe-eau était pourri.
Maline repensa à sa première Armada, en 1989. Elle avait à peine dix-huit ans. Elle conservait de cette semaine le souvenir d’une fête sans fin, de sa première liberté, de ses premiers émois… Elle avait vu sous ses yeux incrédules, comme tous les autres Rouennais, la sage capitale normande se transformer en un immense forum multiculturel. Le centre du monde, où tout était permis. Une révolution culturelle. Un incroyable cadeau pour sa majorité ! Ceux qui n’avaient pas eu dix-huit ans pendant les « Voiles » de 1989 ne pourraient jamais comprendre. Heureusement que son père n’avait jamais été au courant du quart des virées dans lesquelles elle avait été entraînée avec ses copines pendant cette folle semaine. Elle avait appris à parler une dizaine de langues en quelques jours. Au moins les mots essentiels. Sa passion pour les voyages était sans doute née à ce moment-là. Elle était devenue reporter parcourant le monde, pour les plus grands journaux, pendant onze ans. Même si cette passion avait explosé en vol, et si Maline s’était échouée dans sa ville natale, Rouen.
Journaliste au SeinoMarin. Le plus grand hebdomadaire de la région…
Maline sortit de la douche, sans même s’essuyer, inondant abondamment un linoléum défraîchi.
De 1989 à 2008, même lorsqu’elle se retrouvait à l’autre bout de la planète, Maline n’avait jamais raté une Armada. Elle était toujours revenue, même en 1994, alors qu’elle couvrait encore quelques semaines auparavant le génocide rwandais. Les trois dernières Armadas, 1999, 2003 et 2008, elle les avait vécues comme journaliste locale officielle… au SeinoMarin. A chaque Armada, elle parvenait à débaucher son réseau de copines. Celles du temps béni de 1989 ! Presque toutes étaient mariées, mères de familles, divorcées, déprimées, fanées… Vieilles ! Maline se sentait différente. Différente et seule. Quel calvaire pour faire sortir de son quotidien sa poignée de copines rangées…
Était-elle à ce point anormale ?
Presque trente-six ans ? Célibataire ?
Maline attrapa une serviette en boule et essuya le miroir ovale de la salle de bain. Elle observa quelques instants son reflet.
D’accord, elle était plutôt petite, mais elle se savait encore bien faite, bien proportionnée, mieux même qu’à vingt ans. Plus pulpeuse… Plus en chair…
— C’est parce que tu grossis, ma vieille ! ironisa Maline pour elle-même. T’es fière des tes formes, de ton cul et de tes seins, mais dis-toi bien que ce sont les dernières années, les derniers mois avant la dégringolade. Faut te remettre au sport, ma belle !
Elle repensa furtivement au temps où elle faisait du sport presque tous les soirs, cinq fois par semaine ! Aujourd’hui, c’était plutôt une fois par mois. Piscine ou jogging. Et encore. Courir seule et croiser des couples l’insupportait, maintenant.
Maline fit une moue devant la glace. De toutes les façons, son piège à mecs, ce n’était pas son corps de petite poupée, c’était son visage. Sa bouille de clown. Son visage mutin comme on dit plus sérieusement. Des yeux noirs comme des billes, des pommettes rondes, une tignasse ébouriffée. Châtain aujourd’hui. Passée par toutes les couleurs ces vingt dernières années.