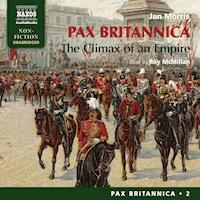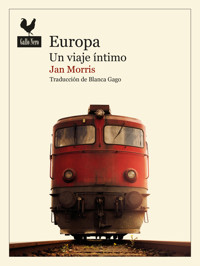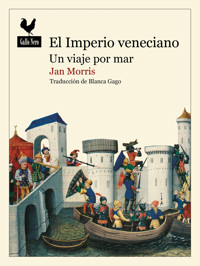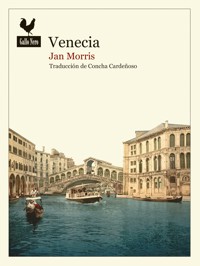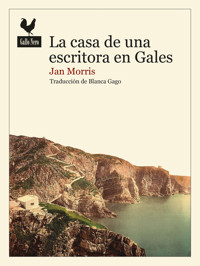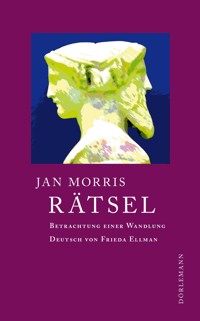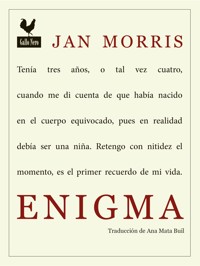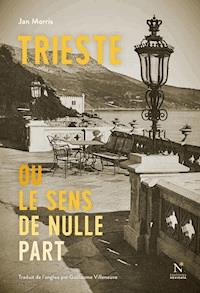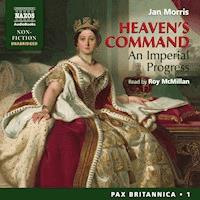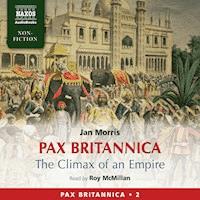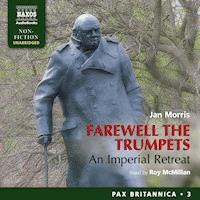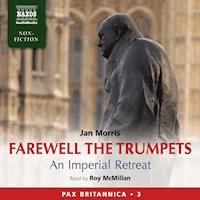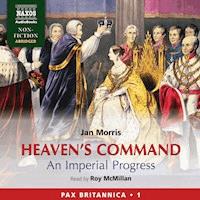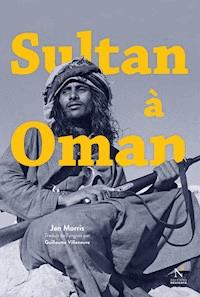
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Une tournée historique du sultan aux confins du grand désert d'Arabie.
En 1955, les vents du changement commençaient à souffler sur les montagnes et déserts du sultanat d’Oman. Les effluves troublants du pétrole promettaient de bouleverser cet État encore médiéval. Les rumeurs de révolte se mélaient aux intrigues de puissances étrangères. Pour le sultan, il était temps d’agir.
Appuyé par les Britanniques, à l’époque encore influents, le souverain entreprit une grande tournée jusqu’aux coins les plus reculés de son royaume afin d’y affirmer son autorité. L’expédition quitta un beau matin la ville côtière de Salala en direction de Mascate, la capitale du Nord. Le voyage était historique, jamais le sultan n’avait parcouru l’intérieur de son pays.
Ce fut probablement la dernière traversée « classique » du grand désert avant la révolution du pétrole – et la première en véhicule motorisé. Le sultan invita Jan Morris, alors journaliste au
Times, à l’accompagner comme observateur.
Le récit de cette aventure royale, tout en finesse et non dénué d’humour, est une ode à un monde disparu.
EXTRAIT
Nous ne nous arrêtions pas pour manger, ni vérifier nos pneus, ni nous allonger à l’ombre de nos camions, comme font les soldats ou les camionneurs, mais à midi, le convoi faisait halte pour les prières. Alors toute la compagnie, sauf peut-être de rares domestiques profanes et impénitents, s’égaillait discrètement dans le désert, accomplissait d’abord ses ablutions puis ses dévotions : les Noirs dans leurs chandails bleus ; les Bédouins, qui déposaient leurs fusils à côté d’eux, dans leurs belles robes amples ; le cadi, avec un craquement audible de ses os ; le sultan, à présent vêtu d’une robe couleur fauve pour le voyage. C’était un spectacle émouvant, me disais-je, de les voir ponctuer le désert autour de nous, bleus, noirs, bruns et blancs, se prosterner au soleil avec les mouvements souples et gracieux que l’islam exige du fidèle ; quand le klaxon du sultan sonnait au loin, c’était drôle de les voir revenir en hâte et sauter dans les camions, dans une diversité si effrénée de costumes, souvent gênants, les cheiks de Yal Wahiba toujours bons derniers, qui allaient en trottinant, vifs et saccadés, comme de superbes gros oiseaux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née en 1926,
Jan Morris est l’un des plus célèbres écrivains de voyage de langue anglaise. Elle est l'auteur de
Pax Britannica, une histoire de l’empire britannique, et de délicats portraits de Venise, Trieste, Oxford, New York ou Hong Kong. Elle vécut et écrivit sous son nom James Morris jusqu’en 1972, année où elle a changé de sexe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Mark Morris
À propos de l’auteur
Née en 1926, Jan Morris est l’un des plus célèbres écrivains de voyage de langue anglaise. Elle est l’auteur de nombreux essais et récits, dont Pax Britannica, une histoire de l’empire britannique, et d’élégants portraits de villes, dont Venise, Oxford, New York, Hong Kong ou Trieste.
Elle vécut et écrivit sous son nom James Morris jusqu’en 1972, année où elle a changé de sexe.
Remerciements
Ce livre n’est pas long et toutes les opinions qu’il exprime m’appartiennent ; mais le voyage qu’il décrit s’est fait dans un pays si écarté et difficile d’accès que je n’aurais pu l’écrire sans le concours de beaucoup de gens. Je suis notamment reconnaissant aux personnes suivantes : Son Altesse le sultan de Mascate et d’Oman ; le rédacteur-en-chef et les propriétaires du Times ; le major St John Armitage de la Dhufar Force ; Sir Bernard Burrows et les membres de son équipe de la Résidence politique de Bahreïn ; le Lt-Colonel W. A. Cheeseman et les officiers de la Field Force de Mascate et d’Oman1 ; le colonel Jasper Coates et d’autres membres de la Royal Air Force en Arabie ; M. Neil Innes, ministre des Affaires étrangères du sultan de Mascate et d’Oman ; et nombre d’aimables cheiks, walis, qadis, guides, askaris et membres de tribus dont le nom m’a trop souvent échappé. Je me rappelle aussi avec gratitude la compagnie des esclaves du sultan (qu’on décrirait mieux comme sa suite, n’y eût-il un lien de propriété entre eux, tant celui-ci paraissait lâche et grand leur enjouement).
1 Force d’intervention. (NdT)
Introduction
Le voyage raconté ici fut, à sa modeste façon, la dernière des traversées classiques de la péninsule arabe. Il a connu peu des tribulations et des dangers de ses redoutables devancières car il s’est fait en convoi motorisé, sous la conduite d’un prince arabe compétent, à l’intérieur de ses propres domaines, servi par d’infatigables esclaves. Mais tels les plus importantes explorations des Burton, Doughty, Philby ou Thesiger, il a ouvert une corne de l’Arabie à l’examen du monde, a instauré un précédent, a eu un certain effet sur le cours de l’histoire arabe2.
En 1955, le sultanat de Mascate et d’Oman était un État islamique vraiment médiéval, fermé à tout progrès sous l’égide d’un maître conservateur et autocrate. Peu d’étrangers le connaissaient et nul en totalité car son immense arrière-pays rocailleux restait pour l’essentiel inhabité et non-exploré, en séparant absolument les différentes parties du royaume. Notre voyage a ouvert quelques fenêtres sur cet endroit reculé et caché, non sans provoquer en même temps quelques courants d’air décisifs : il s’intéressait surtout au pétrole, cet agent irrésistible du changement, et sa réussite même signifiait que le territoire que nous traversions pour la première fois serait changé à jamais.
Cette aventure s’inscrivait aussi dans la continuité impériale, presque à son terme, car à l’époque le gouvernement britannique restait puissant en Arabie et, bien que je sois le seul Européen dans ces véhicules, l’épisode évoquait d’évidence les voitures découvertes, les Rolls-Royce blindées et les sphères d’influence de la Pax Britannica. Si le drapeau flottant sur nos têtes était l’emblème rouge de Mascate, les fantômes de Curzon et Gertrude Bell chevauchaient à nos côtés d’un air approbateur.
2 Sir Richard Burton (1821–1890) fameux explorateur de l’Arabie et des sources du Nil et traducteur des Mille et Une Nuits ; Charles Doughty (1843–1926), explorateur et auteur notamment des Travels in Arabia deserta (1888) ; Harry St John Philby (1885–1960), explorateur et ornithologue, espion, converti à l’islam en 1930 et conseiller d’Ibn Séoud ; Sir Wilfred Thesiger (1910–2003), peut-être le « dernier grand explorateur anglais », en Afrique et en Arabie, auteur d’Arabian Sands (1959) et des Marsh Arabs (1964) en Irak. (NdT)
Chapitre 1
Un beau matin arabe, vers la mi-décembre 1955, j’entrai dans le palais du sultan de Mascate et d’Oman au Dhufar3, au bord de l’océan Indien. Je franchis le grand portail de la cour extérieure et les esclaves s’inclinèrent profondément ; le portail de la cour intérieure, et vis scintiller la mer derrière le rempart ; pénétrai dans le vestibule étincelant du palais, où s’alignaient les serviteurs barbus dans leurs longues robes, fusils en main ; jusqu’à ce qu’approche de moi, sorti des replis ombreux du bâtiment, une petite silhouette digne, en aba brun et or, enturbannée, épée au côté, exhalant un doux parfum d’encens.
– Bonjour M. Morris, dit Son Altesse le sultan Saïd bin Taimur. Je me demande à quel point la carte de l’Arabie du Sud-Est vous est familière ?
Elle ne me l’était aucunement, ne fût-ce que parce que ce coin éloigné de la péninsule arabique demeurait le moins connu de tous les pays arabes. Il apparaissait vaguement dans l’atlas, grand triangle brun sablonneux, bordé par le golfe d’Oman d’un côté et la mer d’Arabie de l’autre, avec un pâté de montagnes au centre et un terrible désert sur son périmètre. Au surplus, comme si l’on n’était pas tout à fait sûr de soi, on le désignait sous le nom de « Mascate et Oman ». Le cartographe ne semblait pas du tout savoir où commençait Mascate et où finissait Oman ; ce qui n’avait rien d’étonnant car personne ne le savait.
Mon sultan encensé, descendant d’une dynastie qui avait jadis régné sur Zanzibar et occupait le trône depuis 1744, estimait être le souverain légitime du triangle entier. Le Dhufar, la province littorale méridionale, lui appartenait sans doute ; de même que Mascate, sur le rivage du Golfe ; de même, on le présumait, que la côte peu habitée qui court autour de la corne de la péninsule et relie les deux régions. Mais pour l’intérieur du pays, baptisé Oman de manière imprécise, il en allait autrement. C’était un territoire accidenté, montagneux, isolé par de hautes chaînes et des déserts, peuplé de tribus dures, turbulentes, d’une quiétude relative : tantôt elles se querellaient, tantôt elles s’associaient pour repousser un ennemi commun ; elles devaient divers hommages aux chefs tribaux et à de brumeuses fédérations historiques ; elles étaient souvent féroces, cupides et xénophobes ; plusieurs étaient affiliées à une secte islamique, l’Ibâdhiya, qui avait disparu partout ailleurs en Arabie. Le sultan urbain, plein d’usage du monde, autocrate paternel éduqué en Inde, était-il le maître accompli et légitime de ces peuples rétifs ?
Le gouvernement britannique, qui protégeait les domaines du sultan pour lui et gérait l’essentiel de sa politique étrangère – qui restait en d’autres termes la principale puissance en Arabie du Sud-Est –, était persuadé qu’il était bien légitime et le reconnaissait dans ses traités comme le maître absolu de Mascate et d’Oman tout à la fois (comme l’impliquait son titre). Ailleurs, les avis variaient. Les frontières séparant l’Arabie Saoudite – qui contrôlait le gros de la péninsule arabique – des divers petits États bordant le Golfe persique n’avaient jamais été clairement définies et tel ou tel estimaient que le roi Saoud d’Arabie détenait, avant quiconque, la suprématie légale sur les tribus d’Oman. Au surplus, depuis d’innombrables générations, les Ibâdhites d’Oman élisaient leur propre imam, à l’origine chef spirituel, qui avait fini par revêtir un pouvoir politique substantiel. Le détenteur actuel de cette charge, Ghalib bin Ali, apparemment aiguillonné par un frère ambitieux, Talib, avait tenté de faire d’Oman un État totalement indépendant, délivrant ses propres passeports et réclamant un siège à la Ligue arabe. Les Saoud appuyaient sa démarche, qui lui fournissaient de l’argent et des armes, et lui imprimaient ses passeports, de même que l’Égypte, la plus importante puissance locale du Moyen-Orient, dont les dirigeants entendaient éradiquer toute influence occidentale dans le monde arabe et préféraient en conséquence un imam nationaliste à un sultan raisonnablement anglophile. Leur position était parfaitement plaidable. En 1913, nombre de tribus de l’intérieur s’étaient soulevées contre le sultan et avaient assez nettement remporté la guerre. Par l’accord y mettant un terme – le traité de Sib – le perdant s’engageait à ne pas se mêler des affaires intérieures d’Oman. Pouvait-il encore en être le sultan légitime compte tenu d’une telle limitation de son autorité ? À l’époque, certains observateurs britanniques avaient considéré que le traité créait de fait deux États distincts ; et l’imam était du même avis.
Quarante ans plus tard, les Anglais auraient pu n’y prêter que peu d’attention, n’eût-il été question de pétrole : mais la recherche de nouveaux gisements à l’extrémité de la péninsule arabique ranimait toute la question épineuse des frontières et des allégeances. Plus haut dans le Golfe, les lignes de démarcation entre les concessions étaient bien précisées et généralement reconnues ; mais la frontière nébuleuse entre Oman et Arabie Saoudite, objet d’innombrables escarmouches diplomatiques, était devenue une ligne de bataille économique. Depuis des années, une entreprise des États-Unis, opérationnelle en Arabie Saoudite, avait apporté à l’antique autocratie une immense richesse et un pouvoir politique considérable ; qu’Oman soit légalement intégré à l’orbite saoudite et tout son pétrole serait aussi exploité par les États-Unis. Le sultan avait toutefois déjà accordé une concession (ignorant le traité de Sib) sur l’ensemble de Mascate et d’Oman à une firme majoritairement anglaise ; et bien que son droit à le faire fût contesté par l’imam, les Saoudiens, les Égyptiens et plus d’un avocat des firmes pétrolières américaines, le gouvernement britannique le soutenait avec force. En vérité, on pouvait penser que l’avenir des champs de pétrole du Golfe persique pourrait décider du destin de la Grande-Bretagne. Les champs septentrionaux du Golfe constituaient déjà l’assise de la zone sterling : il était vital que tout nouveau gisement de pétrole fût contrôlé par des firmes de cette même zone. De fait, à en croire un article à peu près contemporain du New York Times, « qui contrôle ces nouveaux puits de pétrole pourra contrôler les principales sources d’énergie du monde jusqu’à ce que l’énergie atomique soit disponible. » Pour y parvenir, les Anglais étaient même prêts à risquer de froisser les États-Unis et notre gouvernement avait appuyé le sultan et les pétroliers anglais avec une énergie et une détermination inhabituelles.
L’accès le plus important ouvert sur ces régions était une oasis (ou plus exactement un groupe d’oasis) appelée Buraimi, située à l’intersection de l’Arabie Saoudite, des domaines de l’émir d’Abou Dhabi (lié par traité à l’Angleterre) et du sultanat de Mascate et d’Oman. La souveraineté sur ce lieu n’était pas très bien définie. Les Anglais la revendiquaient au nom de l’émir et du sultan qui chacun s’estimait le maître d’une partie de l’oasis. Les Saoudiens la réclamaient pour eux-mêmes. Suite irrégulière de palmeraies et de villages, Buraimi était un centre de communications et d’activité politique : la puissance contrôlant Buraimi était bien placée pour contrôler toute cette partie de la frontière. La traversaient l’or et les armes de l’imam issus d’Arabie Saoudite, laquelle faisait de son mieux pour suborner les fonctionnaires qui y étaient stationnés. D’après les Anglais, on avait proposé vingt millions de livres à quelqu’un pour qu’il se rallie au roi Saoud (la plupart n’accordaient à ce chiffre qu’une croyance relative) ; assurément d’amples largesses étaient distribuées aux membres des tribus locales. En 1952, le gouvernement saoudien, avec des véhicules fournis par la société pétrolière américaine, avait convoyé des forces dans l’oasis pour en occuper une partie. Le gouvernement britannique, parce qu’il ne souhaitait pas alors compromettre ses relations avec les États-Unis, avait dissuadé le sultan furieux de les assaillir ; mais tout arbitrage échouant, les Anglais eux-mêmes avaient expulsé les occupants saoudiens. À mon arrivée en Arabie du Sud-Est, des troupes arabes, sous contrôle et commandement anglais, occupaient fermement, effrontément, Buraimi : à n’en pas douter, la souveraineté était de facto détenue par l’émir et le sultan.
Le reste du monde, à considérer ces événements et les querelles diplomatiques inextricables les accompagnant, supposait en général que Buraimi était situé juste au-dessus d’un champ de pétrole fabuleux. En réalité, les sociétés pétrolières et leurs gouvernements convoitaient surtout un territoire situé plus au sud-est. Buraimi était la clef de cette région : mais pour les prospecteurs, le mot magique – un simple nom sur une carte d’ordonnance – était Fahoud. Là où le grand désert arabe de l’Empty Quarter4 rencontrait les hautes terres d’Oman se trouvait une vaste plaine semi-déserte, ponctuée de rares buissons, où ne vivaient que de pauvres nomades : un pays de gazelles et d’oryx, où l’on avait même aperçu le guépard. Sur cette steppe se dressait un petit cirque régulier de collines, traversé d’un défilé étroit, qui semblait promettre de très importants forages aux géologues. On l’appelait le Djebel Fahoud. La compagnie pétrolière avait installé un petit camp à l’extérieur du cirque et y acheminait son matériel par air et par camions à travers le désert depuis la côte méridionale. Bientôt les foreuses commenceraient à travailler. C’était un endroit extrêmement écarté, à peine visité par les Européens auparavant ; en le survolant, en route pour Dhufar, je n’y avais aperçu qu’une moucheture de cabanes, une piste d’atterrissage et des pistes convergentes de camions venues du désert. Mais il était à la lisière d’un territoire encore plus reculé.
Le Fahoud était peuplé d’une tribu bédouine, les Dourous, qui, n’ayant pas accepté le traité de Sib, auraient eu peine à contester cette concession, à supposer qu’ils aient su le faire ; mais toute la chaîne montagneuse le dominant était placée sous l’autorité de l’imam. En outre, c’était un endroit notoirement turbulent et rebelle. La firme pétrolière avait été obligée d’aider le sultan à financer une nouvelle armée privée, la Field Force de Mascate et d’Oman, pour protéger ses intérêts : elle hésitait évidemment à poursuivre ses activités alors que l’avenir politique du pays était à ce point incertain.
À l’été 1955, il y avait un vrai risque de voir l’imam joindre ses forces à celles de ses amis saoudiens : du coup, la concession serait au mieux difficile à conserver ou elle tomberait entièrement aux mains des Américains au pis (sans parler du fait que la légalité de la concession du sultan restait pendante tant qu’on n’avait pas décidé de la souveraineté d’Oman). Cette perspective était fort détestable aux yeux du gouvernement britannique. Pour commencer, un gros gisement à Fahoud contribuerait grandement à redresser une économie anglaise flageolante. Ensuite, les stratèges du ministère de la Guerre, privés de la plupart de leurs atouts du Moyen-Orient, s’intéressaient particulièrement au pétrole d’Oman, lequel pourrait être acheminé directement par oléoduc vers le sud et l’océan Indien, en évitant les dangers stratégiques d’un Golfe persique quasi enclavé. Troisièmement, toute la position britannique dans la région du Golfe, essentiellement préservée par une série de traités avec les chefs locaux, était menacée par des intrigues égyptiennes et saoudiennes, analogues au flirt qu’entretenaient ces puissances avec l’imam. Les autorités britanniques, bien qu’elles détestent s’étendre sur leurs liens avec le sultan ou les firmes pétrolières, étaient préoccupées par la situation d’Oman, cruciale pour elles.
Le sultan n’était pas davantage en mesure de la considérer avec l’équanimité distante d’ordinaire prêtée aux magnats orientaux. Ce n’était pas un sultan riche, parmi les sultans. Son père avait été harcelé par de graves problèmes financiers et il s’efforçait de redresser les finances de l’État grâce une gestion prudente. Avec de la chance, une demi-participation dans les gisements de pétrole du Fahoud serait en mesure d’en faire l’un des hommes les plus riches de la terre et de son sultanat l’un des petits royaumes dont les décisions font frissonner les budgets du monde. (Le maître du Koweït n’était-il pas déjà le principal bailleur d’argent frais à investir sur le marché londonien ? On estimait son revenu à 1,25 million de livres par semaine.) En outre, le pétrole mis à part, le sultan ne goûtait évidemment pas la perspective de voir surgir un royaume distinct, sous protection étrangère, sur des terres qui lui revenaient par l’hérédité. Il n’était jamais allé à Oman, mais sa famille était originaire de l’intérieur des terres, et son point de vue était donc tout à la fois économique, politique et vaguement sentimental. À la différence du cartographe, il avait un avis très tranché sur les situations relatives de Mascate et d’Oman : tous deux lui appartenaient.
De sorte qu’un jour le gouvernement britannique et la firme pétrolière concessionnaire (peut-être dans cet ordre ou peut-être pas) décidèrent que le moment était venu de régler la question une fois pour toutes. Les pétroliers étaient sur le point de commencer les forages dans le cirque de Fahoud. Pour l’heure, la prise de Buraimi avait pacifié la frontière car Saoudiens et Américains étaient plutôt médusés par une initiative politique aussi énergique de la part des Anglais. La zone sterling était branlante et dans tout le Moyen-Orient, la propagande égyptienne et communiste, souvent adossée à l’or saoudien, grignotait la position britannique. La nécessité même d’une politique anglo-américaine commune à l’égard des Arabes semblait moins importante à l’Angleterre que celle de nouvelles ressources pétrolières dans un territoire stable et amical. Quant au sultan, ses quatre milices privées distinctes étaient à présent opérationnelles sous leur commandement britannique et il s’était déjà emparé d’un ou deux villages, à l’orée des hautes terres, dont le statut, l’allégeance, les opinions, la valeur et les intentions paraissaient également obscurs. La scène était dressée. Dans un profond secret, on mit au point des plans pour que le sultan puisse imposer son autorité, par la force, sur les montagnes intérieures d’Oman.
Seuls une demi-douzaine d’Européens avaient jamais visité ces repaires et moins encore s’étaient aventurés dans les plus xénophobes et fanatiques de ces villages. On savait très peu de chose sur la région. Certes, des marchands apportaient leurs articles jusqu’à Mascate : il y avait des caravanes de chameaux qui descendaient régulièrement des montagnes jusqu’au rivage ; quelques explorateurs anglais distingués avaient tracé des cartes rudimentaires ; des avions avaient survolé la chaîne. Mais du point de vue politique, l’endroit était plus ou moins neutre. Tous les fonctionnaires locaux étaient nommés par l’imam et les soldats du sultan, ses juges, ses administrateurs, ses percepteurs et instituteurs n’y avaient pas droit de cité. Les premiers explorateurs européens s’étaient introduits dans les montagnes avec la bénédiction du sultan, à l’époque où son autorité était incontestée à Oman ; mais les plus récents, courant le risque d’une mort certaine, avaient parfois voyagé déguisés.
La stratégie du sultan, inspirée par l’Angleterre, était donc soigneusement mise au point. On fit des vols de reconnaissance sur Nizwa, capitale de l’imam ; la Field Force de Mascate et d’Oman, avec ses officiers britanniques mercenaires, était stationnée à Fahoud ; sur le flanc littoral des montagnes, à Mascate, la Force de Batinah (autre milice privée) était en alerte. Des contacts avaient été noués avec des chefs amicaux de l’intérieur et un petit coup d’État*5 encouragé au sein d’une des tribus les plus influentes. On attira les dignitaires hésitants à Dhufar, pour les bien recevoir et parfois leur offrir de nouveaux fusils, en gage de souvenir. On consolida l’amitié des Bédouins à la lisière des montagnes. Il devint vite clair, au vu de ces coups de rabot préliminaires et de ces subterfuges, que le sultan préparait une campagne.
Le plan prévoyait d’avancer sur Nizwa depuis l’ouest, en repoussant l’imam et ses partisans dans les hautes montagnes se trouvant entre la citadelle et la mer. S’il tentait de s’échapper par l’un des deux défilés praticables sur les collines, sa route serait obstruée par la Force de Batinah qui aurait aussi éliminé tous les ennemis situés du côté littoral de la chaîne. Les communications radio furent définies ; on prépara des pistes d’atterrissage ; on acquit une paire d’encombrants obusiers de montagne ; les soldats attendaient avec impatience une saine petite guerre à l’ancienne mode. Mais les forces du sultan étaient si grandes, d’après les critères de l’Arabie du Sud-Est (où chacun est certes armé en permanence, mais en général d’un unique vieux fusil capricieux) qu’une grande résistance semblait fort peu probable, le moment venu. À certains égards, les montagnes d’Oman étaient au nombre des lieux les plus arriérés de la planète – on n’y avait encore jamais vu de camion, ni entendu sonner de téléphone, ni même crépiter de mitrailleuse : la colonne mécanisée de la Field Force produirait sans doute un effet moral aussi profond qu’instantané. Aussi prépara-t-on simultanément l’impressionnant voyage triomphal du sultan, en automobile à travers ses domaines, sa chevauchée victorieuse à travers sa modeste Persépolis personnelle. Avant que les derniers échos des combats aient ricoché parmi les collines, il quitterait en secret Dhufar à travers le grand désert de gravier appelé Jaddat al-Harasis, grande terre vaine inconnue. Puis il se dirigerait vers le nord, empruntant la piste pétrolière vers Fahoud et surgirait soudain dans les montagnes, inattendu, pour recevoir l’hommage de ses ennemis vaincus. À Buraimi, il consacrerait solennellement sa souveraineté retrouvée par une rencontre cérémonieuse avec son collègue l’émir d’Abou Dhabi ; puis, franchissant les collines, il descendrait vers le rivage du Golfe persique pour faire une entrée triomphale à Mascate, sa capitale, si prudemment abritée dans des criques rocheuses que les antiques navigateurs grecs l’appelaient « le port caché ».
Ce voyage était inédit, en tout cas en véhicule motorisé. On n’avait jamais traversé le Jaddat al-Harasis ; nul n’avait conduit du Dhufar à Mascate ; les montagnes d’Oman étaient presque inexplorées ; même le Wadi Jeziz, le défilé entre Buraimi et la mer, n’avait été décrit (jusqu’aux années toutes récentes) que par les plus audacieux des voyageurs arabes. Aller en camion du Dhufar à Mascate prouverait pour la première fois qu’il était possible de conduire une automobile sur toute la longueur de l’Arabie du Sud, d’Aden au golfe d’Oman. Ce ne serait pas un voyage comparable aux anciens voyages, de ceux entrepris par les grands explorateurs d’Arabie – passant des mois à dos de chameau, harcelés par le climat et l’hostilité des peuples traversés – mais ce serait tout de même ouvrir une piste, ce serait un parcours royal remarquable.
C’est ainsi que je me retrouvais en ce début décembre à Salala, capitale du Dhufar, pour solliciter la permission (par une lettre d’un formalisme chantourné) d’accompagner le sultan dans son aventure. La campagne d’Oman allait commencer ; nous n’avions pas encore de nouvelles de l’intérieur ; mais un soir me parvint, du palais, le billet suivant, dactylographié par le sultan lui-même sur son papier bleu armorié :
Mes salutations.
J’ai reçu votre lettre datée de ce jour et vous remercie de vos aimables compliments.
J’allais vous écrire quand votre lettre m’est parvenue. J’ai le plaisir de vous informer que vous avez l’autorisation de m’accompagner au cours de mon voyage vers Oman. J’apprécie beaucoup votre projet d’écrire une relation du voyage dont j’espère qu’il vous sera agréable et confortable.
Pouvez-vous, s’il vous plaît, être prêt à partir lundi 19 décembre vers 13 h 45 ?
Saïd Bin Taimur
3 Aussi translittéré Dhofar. (NdT)
4 « Le Désert des déserts ». (NdT)
5 Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte.
Chapitre 2
Dans l’intervalle, j’étais libre d’explorer la délicieuse province du Dhufar – ou presque libre. Depuis plusieurs années, il existait un terrain d’atterrissage de la Royal Air Force à l’extérieur du villagecapitale Salala, mais à ce jour aucun étranger n’avait pu vagabonder sans l’escorte d’un des askaris armés du sultan. Mes souvenirs du Dhufar se colorent ainsi de la présence constante de ces agréables petits hommes. Ils étaient pour la plupart originaires d’Aden ou de l’Hadramaout, tous très petits, très agiles et très aimables ; ils avaient des barbes noires et buissonneuses ; de larges sourires ; leur salut habituel consistait à lever et abaisser rapidement les sourcils, façon d’exprimer des messages aussi amicaux qu’embarrassés, mais dont le style semblait infiniment salace pour l’Occidental. Les askaris portaient de vagues turbans sur de longues robes amples, chargées de cartouchières et de dagues courbes ; lorsqu’ils se hâtaient pieds nus sur le sol, ils avaient une allure étrangement charmante, comme s’ils trottaient avec des sabots de chèvres.
À la base aérienne, où j’étais l’hôte de la RAF, ces gardiens à l’air de gnomes occupaient des quartiers voisins de l’entrée et passaient toute la longue journée à tenter d’attirer quelque passant mal informé pour lui servir une interminable tasse de café autour d’une ou deux heures de badinage inintelligible. La nuit, ils se dispersaient dans le camp, serrant des cannes et de vieux fusils Martini, si bien qu’en allant vous coucher vous en trouviez deux tranquillement installés sur votre seuil ; parfois, au milieu de la nuit, vous entendiez l’un d’eux chantonner une chanson d’amour – d’abord une voix profonde, de gorge, grondante, habituelle chez les askaris, puis d’un fausset tremblant et craintif censé exprimer les réponses hésitantes de la vierge. (Le Somali d’Afrique se parle à lui-même, lui aussi, avec différentes voix, mais pas seulement pour s’amuser ou se tenir compagnie dans la longue nuit ; il mime la conversation de trois ou quatre personnes pour persuader tout ennemi à l’affût qu’une horde de guerriers sûrs d’eux est prête à repousser toute attaque.) Les askaris étaient toujours alertes et toujours ardents. « Askari ! » beuglait-on en franchissant les portes au matin : déboulaient deux ou trois petits hommes souriants, ajustant leurs cartouchières et brandissant leurs fusils, rivalisant de vivacité pour avoir le plaisir de nous accompagner.
Nos activités, au Dhufar, étaient encadrées par une ou deux modestes contraintes. Nous n’avions pas le droit de fumer en public car le tabac était interdit par le pieux sultan (même s’il n’était pas du tout inconnu). Nous n’avions pas le droit de boire de l’alcool en public car les liqueurs fortes étaient interdites partout sauf sur la base de la RAF. Si l’on voulait prendre des photos, il fallait le faire depuis sa voiture. Dhufar était un petit paradis arriéré sur le rivage et le sultan (qui le gérait comme son domaine privé) ne voulait pas le voir défigurer.
À quiconque se représentait l’Arabie comme un unique désert de sable immense, Dhufar offrait une surprise exaltante. Certes, des déserts l’entouraient, mais la province elle-même consistait en une chaîne montagneuse descendant vers la mer à l’est et à l’ouest et renfermant un vaste croissant de plaine verte. Ce lieu s’inscrivait jadis dans la côte de l’encens, si célébrée par les géographes antiques, qui avait abrité une civilisation sabéenne riche et féconde : l’encens cultivé du côté abrité des collines avait permis la fondation de maints opulents comptoirs qui l’expédiaient ensuite par Dhufar vers d’innombrables marchés exotiques et lointains. (Il y poussait encore et les seuls articles artistiques de la province, ou presque, étaient de petits brûleurs d’encens, ternes, en argile jaunâtre.) C’était peut-être la partie la plus bénie de toute la péninsule arabe. Grâce à une bizarrerie climatique, la mousson atteignait tout juste ce coin précis de l’Arabie, où les feuillages étaient donc luxuriants et semi-tropicaux. Le long du rivage, il y avait des halliers de cocotiers et des champs fertiles de cannes à sucre, de bananiers, de blé, de millet, d’indigo et de coton. À travers la plaine de Jurbaib, derrière Salala, couraient deux cours d’eau vigoureux et frais pour arroser les moissons et les jardins de la capitale. Ici et là, on trouvait une vieille noria d’irrigation autour de laquelle tournaient sans cesse deux vieux chameaux, pressés par un Noir au dos nu et luisant, dans un grincement de mécanismes en bois désajustés et de harnais, un bouillonnement d’eau, un fracas et un cliquetis de seaux. La plaine était douce et jonchée de monuments : ici c’était la tombe immensément longue de quelque religieux oublié, de 6 à 9 mètres d’un bout à l’autre, aux extrémités délimitées par des pierres dressées ; là, un immense entassement d’éboulis marquait tout ce qui restait de la ville préislamique de Balid. Pas de routes au Dhufar, mais de bonnes pistes grossières longeant la côte qui s’enfonçaient dans les collines ; au bord se tenait souvent un vieil homme barbu, fusil en travers des épaules, tentant d’obtenir qu’on l’emmène à Salala.
Ce n’était pas une riche métropole que cette capitale de la province de Dhufar, mais un groupe sans prétention de trois villages pénétrés du calme le plus paisible. En son centre s’élevait une masse proéminente de hauts bâtiments carrés : de loin, ils avaient l’air de gratte-ciels, et décorés dans un style assez proche de celui cultivé par les Nabatéens de Pétra ; mais on découvrait à leurs pieds que c’étaient de pauvres bâtisses décrépites, sans prétention au faste. Les prospères marchands d’encens avaient quitté le Dhufar depuis longtemps et Salala n’était pas davantage, désormais, qu’une ville de marché et un port modeste, le Balmoral du sultan. Une étrange compagnie mêlée arpentait les rues. Il y avait des Arabes de différentes tribus : les hommes, quoique minces et petits, évoluaient avec une dignité et une fierté évidentes ; les femmes, sévèrement surveillées, voilées d’un masque hideux, noir, inquiétant comme un bec, carcan raide qui leur donnait un air à la fois théâtral et pathétique. Puis il y avait les esclaves et les affranchis – des Noirs costauds, charnus et bien vêtus, aux visages inexpressifs et sans rides ; leurs femmes allaient libres, sans voiles et surgissaient souvent de leurs logis de palmes pour regarder les passants, pleines de vivacité, aguicheuses, aux ornements tintinnabulants. Des hommes originaires des collines, à peau foncée, vagabondaient, porteur de bâtons et d’une tenue indéfinissable, les yeux brillants sous des cheveux crépus et bouffants. Une myriade d’enfants couraient dans les venelles en pépiant, les garçons pas encore circoncis parfois stigmatisés par un crâne grotesquement rasé, où se dressait seule une haute crête de cheveux comme celle d’un singe. On voyait de temps en temps des soldats en kaki (dans leur caserne, en dehors de la ville, on pouvait les entendre pratiquer le morse sur des sifflets) ; parfois, un superbe chef bédouin de l’intérieur passait, plein de panache, avec son escorte.
Mais le palais dominait la ville, comme le château à Windsor ou le tabernacle mormon à Salt Lake City. Toutes ces capitales littorales d’Arabie orientale possédaient leurs grands palais fortifiés où le potentat se prélassait parmi les siens et ses flatteurs, son allure comme ses biens dépendant en général grandement des revenus de son pétrole. Celui du Koweït était le plus impressionnant ; celui de Bahreïn le plus élégant ; celui de Doha le plus laid ; et celui de Salala, sans doute le plus charmant. Il était posé sur le rivage, longue bâtisse crénelée entourée de hautes murailles, pleine de cours et d’allées communicantes et labyrinthiques. Une large avenue de palmiers menait à la double tour de l’entrée. Une fenêtre surmontant les portes encadrait souvent un Sikh barbu enturbanné de blanc qui observait les alentours ou réfléchissait à un problème d’échecs : c’était l’ingénieur public du sultan. Parfois, un petit Indien coiffé d’un trilby cabossé franchissait les portes en camion : c’était le mécanicien du sultan. Tous les mardis matins, un jeune Anglais mince, en uniforme, quittait le palais au pas cadencé après son audience hebdomadaire avec le sultan : c’était le commandant de la Dhufar Force, l’armée locale du sultan. Des esclaves musclés et bien armés gardaient la porte du palais ; dans un coin se trouvait la prison où languissait toute la population criminelle du Dhufar. (« Voici nos statistiques d’homicides, remarqua un fonctionnaire de Scotland Yard quand le sultan visita Londres. Je suppose que vous avez le même genre de problèmes chez vous ? » « Laissez-moi réfléchir, dit le sultan en se tournant vers son aide de camp, quelle est la dernière fois que nous avons eu un homicide ? Était-ce avant ou après la guerre ? »)
Un peu plus bas sur le rivage, le sultan avait un palais entouré d’un jardin et c’est lui qui m‘évoque la voluptueuse luxuriance de Dhufar. Il est rare que l’environnement de l’Arabie moderne fasse écho au poème de Walter de la Mare :
Douce à mon cœur est la musique
D’Arabie, quand sorti des rêves
Je discerne, calmes dans l’obscure clartéDe l’aube, ses flots ruisselants
— mais ici ces mots me revenaient spontanément, délicieux et parfaitement adaptés au cadre, allongé que j’étais un matin dans la piscine devant le petit palais blanc. L’eau de la montagne courait tout autour de moi, fraîche et vibrante. Le jardin était baigné des parfums de fleurs, rehaussés par un soupçon