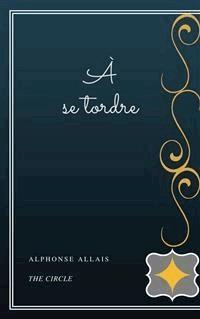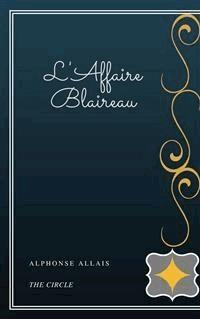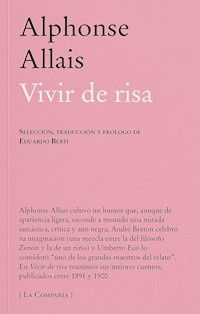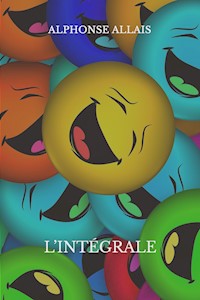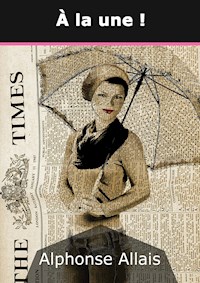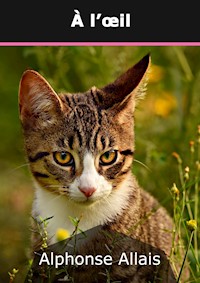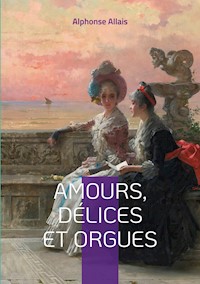
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Amours, délices et orgues" est un recueil captivant des oeuvres d'Alphonse Allais, un maître de l'humour et de la satire littéraire française. Ce livre rassemble une série de nouvelles et de récits courts, où l'auteur déploie son talent pour la comédie et l'absurde. Avec une plume acérée et un sens aigu de l'observation, Allais explore les travers de la société de son époque, jouant avec les mots et les situations pour provoquer le rire et la réflexion. Les personnages, souvent caricaturaux, évoluent dans des situations cocasses et improbables, révélant les contradictions et les absurdités du quotidien. Ce recueil est une invitation à découvrir le génie comique d'Alphonse Allais, qui, à travers ses écrits, continue de séduire par son originalité et son esprit mordant. Par son style inimitable, Allais parvient à capturer l'essence de la comédie humaine, offrant au lecteur un voyage littéraire plein de surprises et de délices. Les récits, bien que souvent légers en apparence, cachent une profondeur qui incite à une réflexion sur la condition humaine et les conventions sociales. "Amours, délices et orgues" est ainsi un témoignage de l'ingéniosité littéraire de son auteur, qui réussit à marier le rire à la critique sociale avec une habileté rare. L'AUTEUR : Alphonse Allais, né le 20 octobre 1854 à Honfleur et mort le 28 octobre 1905 à Paris, est un écrivain, journaliste et humoriste français reconnu pour son esprit caustique et son humour absurde. Après des études de pharmacie, qu'il abandonne rapidement, Allais se tourne vers le journalisme et la littérature. Il collabore avec plusieurs journaux parisiens, dont "Le Chat Noir" et "Le Journal", où il publie des chroniques pleines de verve et de fantaisie. Allais est célèbre pour ses jeux de mots, ses calembours et son style unique qui mêle humour noir et non-sens. Ses oeuvres, souvent courtes et incisives, dépeignent avec ironie les moeurs et les travers de la société de la Belle Époque. Parmi ses écrits les plus connus figurent "À se tordre" et "Le Parapluie de l'escouade". Bien qu'il soit parfois perçu comme un simple humoriste, Allais est en réalité un observateur avisé de son temps, dont les écrits révèlent une critique sociale subtile. Son influence sur la littérature humoristique est indéniable, et il est souvent cité comme précurseur du surréalisme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mon excellent ami LÉON LAURENT (de Reims) en souvenir des Journées de Juin.
Sommaire
À la russe ou La basane collective
Isidore
Le lion, le loup et le chacal
Ébénoïd
Cupides médicastres
Le lard vivant
La malencontreuse prononciation
Simple croquis
Poète départemental
L’inhospitalité punie
Un nouveau pneu
Un point de droit
Unification
Pratique
L’art de s’amuser quand même au théâtre
Abaissement du prix du gaz
Un bonhomme vraiment pas ordinaire
La nouvelle direction de l’Odéon
L’année diplomatique
Pour un faux-col
Une vocation
Un patriote
Néfaste – parfois – influence de Jean Richepin sur la lyre moderne
Le kangoucycle
Farce légitime
Historique d’une mode beaucoup plus vieille qu’on ne croit généralement
Mieux qu’une sœur !
Le charcutier pratique
Fâcheuse confusion
Le bon bûcher
Une innovation à laquelle tout le monde applaudira
Truc funèbre et canaille employé par cette vieille fripouille de père Furet
Fraude
Dynastic
L’ascenseur du peuple
Artillerie
The Smell-Buoy
Batrachomatisme
La profession tue le sentiment
Le veau aux carottes
Un nouveau monopole d’État
Stricte observance
Pénible malentendu
Révolution dans la navigation à voile
L’homme qui aime à se rendre compte
Terrible éveil
À la russe ou La basane collective
Si nous voulons rester en bons termes avec le peuple russe, respectons ses traditions, sa foi, son idéal ; n’exigeons de lui aucune concession à nos façons de croire et de penser, car, dans une enveloppe souple, l’âme russe est rigide et tout d’une pièce, comme qui dirait une bille d’acier égarée dans un pneu.
De même aussi, n’empruntons à leurs coutumes que celles qui s’accordent à notre complexion, si différente de la leur.
En agissant ainsi, nous éviterons bien des gaffes, surtout celles d’une nature plutôt pénible, comme vous allez pouvoir en juger par ce récit.
Je commence par déclarer que l’histoire n’est pas de moi : elle me fut contée par le célèbre chansonnier américain Raphaël Shoomard, un garçon assez sérieux pour que je puisse garantir la véracité de cette aventure.
C’était, il y a quelques années, au début des manifestations de sympathie entre France et Russie.
Dans certains régiments, ces manifestations avaient pris tout de suite le caractère du pur délire.
Tous les officiers apprenaient le russe, se nourrissaient de caviar et ne buvaient plus que kummel ou vodka.
Au bout d’un mois, dans maintes garnisons, l’astrakan avait doublé de prix.
Parmi les plus frénétiques de ces russophiles, se fit particulièrement remarquer certain colonel d’infanterie, officier dont la rudimentaire intelligence se panachait de la plus exquise brutalité envers le subordonné.
Cet homme de guerre déclara un beau jour qu’il allait mener son régiment à la russe.
La discipline russe, il n’y a que ça, pour une armée qui se respecte !
Une coutume militaire russe l’avait particulièrement séduit.
En Russie, quand un colonel arrive devant son régiment, il le salue de la main en disant d’une voix forte : « Bonjour, mes enfants ! »
Et les soldats de répondre, comme un seul homme : « Bonjour, mon colonel ! »
Il fut donc annoncé, au rapport, qu’à la prochaine revue, les choses se passeraient ainsi.
Hélas ! les choses se passèrent autrement.
Le jour de la revue arriva.
Toute la population était rassemblée au Champ de Mars de l’endroit, préfet et notabilités dans une superbe tribune.
Les cœurs haletaient à l’émotion du beau spectacle de bientôt.
Splendide, le régiment, sous les armes, attendait son colonel.
Un petit nuage de poussière, là-bas ! C’est lui, le père du régiment !
Au galop de son petit cheval arabe, il arrive sur le front du régiment, met la main à son shako et, d’une voix de tonnerre, gueule : « Bonjour, mes enfants ! »
Alors, sans quitter le port d’armes, deux mille mains gauches s’abattent sur deux mille cuisses gauches, produisant deux mille claques formidables.
Le geste se termine en forme de basane ; mais quelle basane mon empereur ! et combien inoubliable !
En même temps, deux mille voix répondent : « Zut ! hé ! vieux daim ! »
Et le plus terrible, c’est que les hommes employèrent, en leur clameur, des expressions autrement vives que zut et que daim.
Raphaël Shoomard ne nous raconta pas ce qu’il advint ensuite ; mais j’ai tout lieu de penser que l’infortuné colonel n’alla pas plus avant dans son essai d’acclimatation des mœurs militaires russes.
Isidore
Mon ami Georges Street m’avait dit :
– En revenant d’Italie, vous repasserez par Vintimile et Nice ?
– Très vraisemblablement.
– Alors, ne manquez pas, quand vous serez à Nice, de pousser une pointe jusqu’à N... et d’aller saluer, de ma part, le brave curé de ce village.
– Je n’y manquerai point.
– Vous le prierez en outre de vous laisser interviewer son perroquet.
– Son perroquet ?
– Son perroquet... Ce volatile est un des plus braves perroquets avec lesquels il me fut jamais donné d’échanger quelques propos.
– La nature de ses propos ?
– Souffrez, mon cher Allais, que je vous laisse la volupté de ce frisson nouveau.
Je n’eus garde, comme aisément vous l’imaginez, de manquer cette promise aubaine.
N... (je fausse à dessein l’initiale de la bourgade) n’est éloigné de Nice que d’une heure quarante-trois minutes de voiture (je fausse également à dessein l’évaluation de la distance et le mode de communication).
L’excellent abbé Z... (je fausse de plus belle) allait précisément sortir, quand je me présentai à la porte de son presbytère.
L’abbé Z... (conservons-lui cette désignation fantaisiste) est un de ces dignes ecclésiastiques comme il en fourmille en Provence, chez lesquels le mysticisme s’est mué, comme par enchantement, en ronde jovialité.
Le brave ecclésiastique fut visiblement satisfait du bon souvenir de l’ami Street.
Il s’informa comment il allait et si, bientôt, on aurait l’occasion de se revoir et de trinquer ensemble sous la lumineuse et embaumée petite tonnelle.
– Et votre perroquet, monsieur le curé ?
Il paraît que vous avez un perroquet qui n’est pas dans une musette ?
– Dans une musette ! Isidore dans une musette ! Qu’y ferait-il, le pauvre ?
Isidore ! Le perroquet s’appelait Isidore !
Tout de suite – lointaine pourtant, mais pernicieuse encore, influence de Grosclaude ! – je pensai à Isidore de Lara, Isidore de l’Ara !
– Venez, invita l’abbé, venez avec moi.
Et me faisant traverser son petit jardin, le digne prêtre m’amena jusqu’au perchoir d’Isidore, sis au bord d’un petit chemin qui passe derrière la cure.
Telle une petite folle, notre volatile s’amusait à imiter les aboiements du chien, ce pendant que sur la route un épagneul de passage s’éperdait à rechercher son congénère ainsi clamant.
À la fin, Isidore éclata d’un rire interminable ; se sentant bafoué, le pauvre chien se retira lentement.
Isidore m’aperçut.
Une évidente méfiance s’indiqua au rond virant de ses petits yeux, un grommellement de mauvais accueil ronchonna du plus creux de sa gorge.
– Allons, Isidore, sois bien gentil avec Monsieur qui vient exprès de Paris t’apporter le bonjour de ton ami Street. (À moi.) Donnez-lui vos doigts à compter. (À Isidore.) Compte les doigts de Monsieur.
Je présentai mes mains larges ouvertes, les doigts écartés.
Isidore compta :
– Une, deux, trois, quatre, cinq, sept... M... ! je me trompe !
Il reprit :
– Une, deux, trois, quatre, cinq, sept... M... ! je me trompe !
Et tant que je lui montrai ma main, Isidore ne se rebuta pas :
– Une, deux, trois, quatre, cinq, sept... M... ! je me trompe !
Ce fut moi qui me lassai le premier.
Aussi bien, j’avais fort besoin de mes deux mains pour me tenir les côtes, tant cette petite séance de numération parlée dépassait tout ce qu’on peut rêver de comique !
Et en rentrant à Nice, le soir, doucement bercé par la voiture, je me surprenais à murmurer, moi aussi :
– Une, deux, trois, quatre, cinq, sept... M... ! je me trompe !
Le lion, le loup et le chacal
Fabliau bien moderne
Il était une fois un Loup qui avait un procès de mur mitoyen avec son voisin le Chacal.
Toute tentative de conciliation ayant échoué, on résolut de porter le litige devant la cour suprême des animaux, autrement dit le tout-puissant seigneur Lion.
Le Lion, exact au rendez-vous, battait négligemment de la queue ses flancs redoutables, tout prêt à rendre sentence sous son chêne ordinaire, un chêne d’au moins cinquante louis.
(Comme tout augmente, hein ! Du temps de Blanche de Castille et de son fils, un simple chêne de cinq louis suffisait amplement aux justiciables.)
Arrivèrent les plaideurs : le Loup accompagné de son avoué le Renard, le Chacal défendu par une vieille Pie, insupportable raseuse qui, tout de suite, indisposa le seigneur Lion.
– Assez ! s’écria brusquement ce dernier, ma religion est suffisamment éclairée.
– Ah ! firent les deux parties anxieuses.
– Loup, c’est toi qui as raison ! Chacal, ta cause ne tient pas debout ! Loup, je te livre ton adversaire et t’engage à le dévorer dans l’enceinte même de ce sylvestre prétoire.
Le Loup ne se le fit pas dire deux fois ; en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, du pauvre Chacal ne restaient plus que risibles déchets.
Discrètement, le Renard et la Pie s’étaient retirés vers leurs cabinets respectifs.
Quand la curée fut terminée :
– Mon cher Loup, dit le Lion, tu me feras plaisir en venant ce soir chez moi me remercier de ma sentence.
– Entendu, Seigneur. À ce soir.
Le Loup n’eut garde de manquer à sa parole : vers sept heures, sept heures et demie, il pénétrait dans la tanière du magistrat suprême.
Le Lion, comme en façon de familiarité gentille, lui mit sa forte patte sur l’échine, et :
– Eh bien, mon vieux Loup, digéras-tu à ta convenance ?
– On ne saurait imaginer mieux, mon Lord.
– Alors, à mon tour.
Le Loup, à ce moment, vit que le Lion ne badinait pas, et il devint blanc comme un linge.
– Quoi ! vous allez me manger ?
– Non, je vais me gêner ! Car j’ai une faim de Loup, si j’ose m’exprimer ainsi.
– Mais alors, pourquoi n’avez-vous pas, ce matin, dévoré le Chacal, puisque lui était dans son tort ?
– Dans son tort ou non, le Chacal vivant exhale une odeur qui me coupe l’appétit.
– Et moi, pourquoi avoir attendu jusqu’à ce soir, puisque vous me teniez ce matin en votre pouvoir ?
– Ce matin, tu étais trop maigre, mon pauvre ami.
Et, passant à l’action, le Lion mangea le Loup, dans des conditions exceptionnelles de prestesse et de bonne humeur.
Moralité
Soyez chacals ou soyez loups,
Les juges sont plus forts que vous.
Écoutez-moi (la chose est sûre),
Méfiez-vous d’la magistrature !
Ébénoïd
Or, un matin, toute rose d’émoi, elle lui murmura :
– Ça y est ! j’en suis sûre, maintenant. Ça y est !
Et lui, tout au plus réveillé, grommelant, s’étirant :
– Quoi ? qu’est-ce qu’y est ?
Mais elle, plus rose encore, si rose qu’à peine on entendit sa voix :
– Mon ami, le ciel a béni notre union.
L’homme sursauta de ravissement :
– Tu blagues ? douta-t-il encore, trivial.
– Je ne blague jamais avec ce sujet-là.
Ce fut alors une joie par toute la chambre.
Mariés depuis tantôt huit ans, les époux Duzinc n’avaient jamais pu, malgré d’incessants labeurs, obtenir l’ombre d’une progéniture.
À quoi tenait cet état de choses ? On ne sait pas. La faute à l’un ? La faute à l’autre ? La faute aux deux ?
Quien sabe ? comme disait Montaigne au toréador qui le rasait de ses questions indiscrètes.
Du coup, M. Duzinc décida qu’il n’irait pas à son bureau ce jour-là.
Père ! il allait être père !
Au déjeuner, sauta le bouchon du mousseux Léon Laurent.
Et au dîner aussi.
À la santé du petit !
Ou de la petite !
La grossesse de madame Duzinc se présenta aussi bien que les plus favorisés phénomènes de ce genre.
Comme toutes ses congénères, Mme Duzinc eut des envies.
Quelques-unes étranges.
Par exemple, celle de déguster l’odieuse ratatouille de confitures de fraises mélangées à des tripes à la mode de Caen.
Ce mets n’était pas d’un très joli ton.
Et de plus étranges, encore !
Renouveler tout leur mobilier, leur mobilier clair, qu’on remplacerait par un en ébène.
Un mobilier en ébène !
Voilà qui serait gai !
M. Duzinc, net, refusa !
La belle-mère de M. Duzinc eut beau représenter à M. Duzinc tout le danger qui peut résulter d’une non exécutée envie, M. Duzinc tint bon.
Un mobilier en ébène !
Jamais de la vie !
La pauvre petite Mme Duzinc pleura toutes les larmes de son corps.
Et puis arriva ce qui devait arriver.
Au bout du temps requis, Mme Duzinc mit au monde un enfant noir.
Un enfant d’un très beau noir.
Je dois, pour l’honneur de la vérité, finir par où j’aurais dû commencer.
Mme Duzinc, neuf mois avant la naissance du surprenant baby, avait cru devoir partager la couche d’un jeune attaché à la légation d’Haïti.
Cette histoire de mobilier d’ébène n’était qu’une frime.
Habile, d’ailleurs.
Cupides médicastres
Certains journaux sont fort durs, en ce moment, pour le corps médical.
MM. les médecins de Paris, au dire des folliculaires, auraient décidé la création d’un Livre noir, où seraient inscrits les noms de tous les malades mauvais payeurs, et se seraient mutuellement engagés à ne plus les soigner avant le règlement des notes préalables.
Et les gazettes de crier à l’inhumanité et d’appeler sur les médecins les foudres vengeresses du tollé général.
La situation très délicate que me crée, dans le gouvernement, le dernier vote du Sénat, m’interdit de prendre parti pour ou contre, en cette question.
Néanmoins, je dois reconnaître que certains praticiens ne brillent pas par une excessive sensibilité et qu’ils suppriment volontiers les saucisses dans le système d’attache de leurs fidèles toutous.
Il s’en rencontre même dont le mémoire ne concorde jamais avec celle du malade.
Témoin ce médecin qui réclamait le prix de deux visites à une bonne femme, laquelle semblait bien certaine de ne lui en devoir qu’une.
– Mais, docteur, je vous assure que vous n’êtes venu qu’une fois chez moi !
– Parfaitement, répondit le morticole, je suis venu une fois chez vous ; mais quelques jours après, je vous ai donné une consultation dans la rue.
– Vous appelez ça une consultation ! s’indigna la cliente. Eh bien ! vous avez du toupet ! Vous m’avez demandé comment j’allais... je vous ai répondu que j’étais tout à fait bien... Vous m’avez dit de continuer.
– Eh bien ! mais, c’est une consultation, cela.
– Bon ! je vais vous payer vos deux visites, mais dorénavant, quand vous me rencontrerez dans la rue, je vous défends de m’adresser la parole, et même de me saluer. Ça coûte trop cher, votre politesse !
Un autre exemple de rapacité peu commune chez un médecin de campagne :
Ce thérapeute avait coutume de se rendre, chaque jour, à un café de la ville, en lequel il faisait sa petite partie avec des messieurs, toujours les mêmes.
Un de ces derniers, personnage timoré et fort soucieux de son estomac, ne manquait jamais, en commandant son absinthe, de se tourner vers le médecin.
– Une petite absinthe, docteur, ça ne me fera pas de mal ?
– Mais non, mais non ; une petite absinthe n’a jamais fait de mal à un honnête homme.