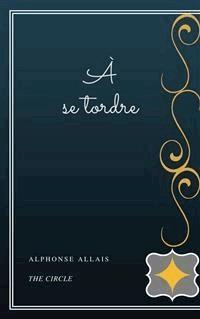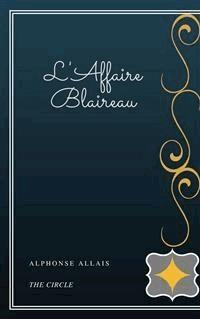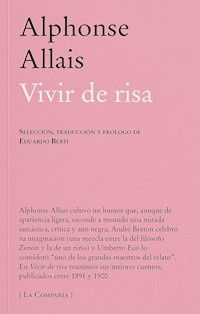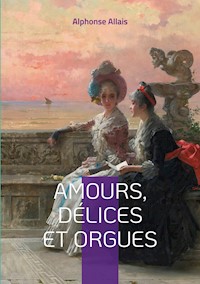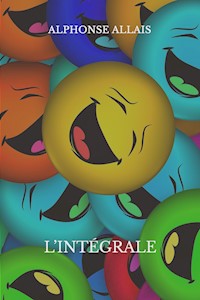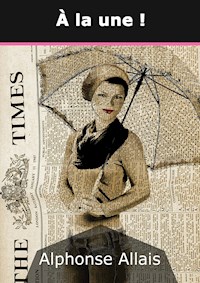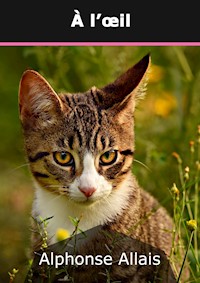2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans ce volume, chacun des contes a été sélectionné pour illustrer un des différents aspects de l'humour selon Allais. On y trouve des jongleries verbales ("On dit "Francfort-sur le-Mein" et "avoir le coeur sur la main". Comment voulezvous que les étrangers s'y reconnaissent ? "), qui mènent vite au saugrenu (un " garçon sensible " refuse de faire crever le riz, d'exécuter un travail, s'émeut de voir la nuit... tomber) ; des " charges " contre le " bonhomme " La Fontaine, coupable, selon Allais, de répandre des idées pleines de bon sens - ce qu'il a en horreur ; des contes construits sur les postulats absurdes ; d'autres dans lesquels la logique est appliquée jusqu'à la déraison, ou qui témoignent d'un humour grinçant... Jules Renard, qui n'a jamais succombé à la complaisance, venait de découvrir Mark Twain : " Cela me paraît fort inférieur à ce qu'écrit notre Allais ; et puis, c'est trop long. Je ne supporte que l'indication d'une plaisanterie. Ne nous rasez pas ! " Monsieur est servi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Plaisir d'humour
Pages de titreChoix de 40 contesLa belle inconnueLe Phénix CellulaireInconvénients du baudelairisme outrancéHistoire peu croyableUne drôle de lettreMon recordIngénieux touringVégétarisme intégralLexPlaisanterie posthumeL’agonie du papierTitreLes misères de la vie conjugaleConte de NoëlLa fusible esthétiqueUn curieux point de droit criminelLe crime enfin récompensé 1Une belle causeSuite et fin d’une « belle cause1 »Les culs-de-jatte militairesFin aoûtUne sale blagueLe mariage à bailLes beaux-arts devant M. Francisque SarceyIdylleL’inhospitalité punieLes deux cousins jumeauxVengeanceLa fin d’une collectionUn enterrement aux champsEt les esprits frappaient toujours...Littérature couranteL’esprit d’EllenIdylle bourgeoiseVitrailLoup de merLa sécurité dans le chantageTriste fin d’un tout petit groomDe quelques réformes cosmiquesFestina lenteTablePage de copyrightAlphonse Allais
Plaisir d’humour
Choix de 40 contes
Plaisir d’humour
Édition de référence :
Le Livre de poche, no 1956.
La belle inconnue
Il descendait le boulevard Malesherbes, les mains dans les poches, l’esprit ailleurs, loin, loin (et peut-être même nulle part), quand, un peu avant d’arriver à Saint-Augustin, il croisa une femme.
(Une jeune femme dont la description importe peu ici. Imaginez-la à l’instar de celle que vous préférez et vous abonderez dans notre sens.)
Machinalement, il salua cette personne.
Mais elle, soit qu’elle n’eût point reconnu notre ami, soit qu’elle n’eût point remarqué son salut, continua sa route sans marque extérieure de courtoisie réciproque.
Et pourtant, se disait-il, il l’avait vue quelque part, cette bonne femme-là, mais où diable ! et dans quelles conditions ?
En tout cas, insistait-il à part lui, c’était une bien jolie fille, avec laquelle on ne devait pas s’embêter.
Au bout de vingt pas, n’y pouvant tenir, obsédé, il rebroussa chemin et la suivit.
De dos aussi, il la reconnut.
Où diable l’avait-il déjà vue, et dans quelles conditions ?
La jeune femme remonta le boulevard Malesherbes jusqu’à la jonction de cette artère avec l’avenue de Villiers.
Elle prit l’avenue de Villiers et marcha jusqu’au square Trafalgar.
Elle tourna à droite.
Et lui, la suivant toujours, se disait :
« C’est drôle, j’ai l’air de rentrer chez moi. »
Avec tout ça, il ne se rappelait encore pas où diable il l’avait déjà vue, cette jeune femme, et dans quelles conditions.
Arrivée devant le no 21 de la rue Albert-Tartempion, la dame entra.
Ça, par exemple, c’était trop fort ! La voilà qui pénétrait dans sa propre maison.
Elle prit l’ascenseur.
Lui, quatre à quatre, grimpa l’escalier.
L’ascenseur stoppa au quatrième étage, son étage !
Et la dame, au lieu de sonner, tira une clef de sa poche et ouvrit la porte.
Quelque élégante cambrioleuse, sans doute.
Lui, ne faisait qu’un bond.
« Tiens, dit la belle inconnue, tu rentres bien tôt, ce soir ! »
Et seulement à ce moment il se rappela où, diable ! il l’avait vue, cette jeune femme, et dans quelles conditions.
C’était sa femme.
Le Phénix Cellulaire
(Compagnie d’Assurances contre les risques
de la détention pénale)
Maître Casimir, le jurisconsulte bien connu, m’adresse la communication suivante, me priant, en des termes touchants, de lui accorder, sans compter, la vaste publicité du « Sourire ».
Vous avez la parole, mon cher maître :
Le Phénix Cellulaire
Il s’est fondé à Paris, il y a tantôt deux ans, une « Compagnie d’Assurances sur le Vol » dont la prospérité croissante est la meilleure preuve que l’exercice du vol est définitivement entré dans nos mœurs et constitue même un genre de sport des plus courants. L’idée qui inspire cette institution est ingénieuse et nous applaudirons sans réserve à son application pratique si nous n’avions à déplorer que la Compagnie, qui se montre si soucieuse des intérêts du volé, ne se soit préoccupée en rien de ceux de l’auteur même du vol. S’il y a des volés, c’est qu’il y a des voleurs, et on ne voit pas pourquoi on accorde aux premiers une protection qu’on refuse aux seconds.
Sous un régime de liberté et d’égalité parfaites comme celui dont nous jouissons, cet oubli, volontaire ou non, apparaît comme une injustice criante. J’ajoute que c’est parfaitement immoral car, en somme, à qui revient l’honneur de l’action toujours hardie et souvent périlleuse, si ce n’est au voleur lui-même ?
Un vieux juge d’instruction de mes amis, qui a puisé dans l’étude des dossiers criminels une connaissance approfondie des choses de la cambriole, ce qui a fait de lui un homme doublement dangereux, me contait un jour les exploits d’un de ses meilleurs clients. C’est merveilleux. Ce sont des prouesses, des prodiges d’audace auprès desquels les hauts faits des paladins d’autrefois ne sont que de la Saint-Jean. Quand on songe à tout ce qu’il a fallu de patientes et longues études pour acquérir cette science, au milieu d’une société plutôt hostile à ces genres de manifestations, on ne peut se défendre d’un véritable sentiment d’admiration pour ces modestes travailleurs du rossignol et de la pince-monseigneur.
Le métier, du reste, est on ne peut plus ingrat ; tandis que le volé, confiant en sa police d’assurance et en celle de M. Lépine, reste paisiblement chez lui dans un doux farniente, sans rien faire pour faciliter le vol et s’efforçant même d’en entraver l’exécution, le voleur, lui, n’a pas une minute de repos ; jour et nuit il bat les chemins de nos campagnes ou les rues de nos cités. Quelquefois même il doit se résoudre à battre les bourgeois récalcitrants qui cherchent à lui susciter des difficultés imprévues. Les gendarmes, stimulés par les magistrats cruels, lui donnent une chasse acharnée ; véritable gibier de la loi, il est traqué sans merci. Sa liberté, sa vie même sont perpétuellement en jeu.
Croyez-vous qu’après tant de vicissitudes, si un beau vol puissamment conçu et élégamment exécuté vient à être commis, justice sera au moins rendue à son auteur ? Détrompez-vous ; toutes les sympathies iront au volé, à la « victime », dira-t-on. Quant au voleur, on n’en dira rien ou, si l’on en parle, ce ne sera que pour proférer des choses désagréables sur son compte. Écoutez les procureurs sur leurs sièges.
En présence d’une pareille injustice, je ne songe pas sans effroi à ce qu’il adviendrait si, dégoûtés d’un métier qui ne nourrit plus son homme, les pickpockets, les escarpes et autres panamistes se mettent en grève. La grève des voleurs ; mais c’est-à-dire que ce serait la fin de tout. D’abord, « la propriété, c’est le vol ». Donc, plus de vol, plus de propriété et, par suite, plus de propriétaires, plus de concierges, plus de termes ! Voyez-vous ça ? Sans compter que, les tribunaux étant condamnés à faire relâche, le juge déchirerait sa toge et Pandore retirerait ses bottes. Cette dernière perspective fait frémir !...
Le danger est réel, il importe de le conjurer et, pour cela, il faut s’intéresser au sort de tous les braves gens sans lesquels les institutions de la justice et de la maréchaussée ne se concevraient pas. Nous proposons donc la fondation d’une « Compagnie d’Assurances contre les Risques de la Détention pénale », destinée à indemniser les malheureux qu’une société marâtre envoie gémir sur la paille humide des prisons.
Le « Phénix Cellulaire », c’est la raison sociale que je propose pour la nouvelle Compagnie, aurait son siège à Paris et établirait des agences en province, particulièrement dans les localités où le danger des condamnations est le plus à redouter.
La Compagnie assurerait tous les risques de détention, y compris la détention pour crime ou délit politique. Dans ce dernier cas cependant, la prime serait majorée, ces sinistres devenant chaque jour plus fréquents. De plus, le Phénix Cellulaire ne répondrait pas des risques pouvant résulter des poursuites devant la Haute Cour. Moyennant une légère surprime, la police assurerait contre les dangers de « l’idem » : passages à tabac, rafles et autres accidents auxquels on se trouve exposé dans la rue. Pour les perquisitions et interrogatoires du juge d’instruction, un taux spécial serait établi d’après les qualités intellectuelles du magistrat et la couleur politique de l’assuré.
L’assurance contre les risques de la détention pénale se recommande non seulement au voleur de profession, mais à toutes personnes qui peuvent être l’objet d’un mandat de dépôt. À ce titre, elle est aussi indispensable au député, au sénateur et au ministre qu’au cambrioleur et au rasta vulgaires. Enfin, à une époque où les erreurs judiciaires tendent à se multiplier, une police d’assurances souscrite à notre Compagnie sera, pour le malheureux innocent condamné, le seul moyen pratique d’éviter la ruine complète.
Telle est l’œuvre que nous voudrions voir se fonder en France et sur laquelle j’attire toute l’attention de nos lecteurs, dans la conviction où je suis qu’ils lui accorderont leur puissant appui moral et financier. Il s’agit d’humanité et de patriotisme. Notre appel sera entendu.
MeCasimir
Inconvénients du baudelairisme outrancé
Faut du Baudelaire, c’est entendu, mais pas trop n’en faut. L’historiette qui suit indiquera, pour la partie intelligente de ma clientèle, ce qu’on doit prendre du baudelairisme et ce qu’il conviendrait d’en laisser.
Un grand jeune homme blond, à l’âme d’azur, était élève dans une excellente pharmacie de Paris. Son temps s’écoulait entre les préoccupations officinales et la lecture, jamais close, des Fleurs du Mal.
Pas un mot murmuré près de lui, pas une image évoquée, pas un rien du tout, quoi ! qui ne déclenchât en sa tête, et tout de suite, un vers ou deux du divin beau-fils du général Aupick.
Or, un jour, une dame entra dans la pharmacie et lui dit :
« Nous venons, mon mari et moi, de mettre du vin en bouteilles, mais le fond de la barrique est affreusement trouble, et je viens vous prier de me donner un filtre. »
Le jeune potard donna le filtre.
Soit que ce filtre fût, vraiment, composé d’une matière irrésistante, soit que la dame y eût, trop brusquement, versé le liquide, le filtre creva.
Et la dame revint à la pharmacie, disant au jeune homme :
« Vous n’auriez pas de filtre plus fort ? »
Alors subitement déclenché par ces mots, le jeune baudelairien clama :
Ah ! les philtres les plus forts
Ne valent pas ta paresse,
Et tu connais la caresse
Qui fait revenir les morts !
Légitimement froissée de ce quatrain interpellatif qu’elle n’avait aucunement mérité, et auquel, disons-le, elle était loin de s’attendre, la dame alla conter la chose à son mari, lequel s’empressa de venir administrer à l’éthéré potard une raclée noire.
Avais-je raison de dire en débutant : Faut du Baudelaire, c’est entendu, mais pas trop n’en faut ?
Histoire peu croyable
Je viens d’envoyer à M. le Directeur du Journal des Débats ma – dûment et durement motivée – démission d’acheteur au numéro.
Cause de mon ire : la publication, en ce vespéral et grave organe, d’une histoire extraordinaire, froidement racontée comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, histoire qui n’eût certes pas été déplacée sous la plume du folâtre M. Georges Auriol.
Or, si j’achète les Débats, c’est pour y lire du sérieux, et vous aussi, n’est-il pas vrai, mes bons amis ?
Quand les gens graves se mettent à faire des blagues, il ne les font pas à moitié.
Oyez plutôt :
(Je copie presque textuellement.)
« M. Henrik Dahl, de Talesund (Norvège), naturaliste distingué et fervent darwiniste, voulut suivre dans toutes ses phases l’évolution d’un être animé.
« À cet effet, il se procura un hareng pêché tout vif au fjord voisin ; il le plaça dans un aquarium dont il renouvela l’eau de mer, en diminuant chaque jour, la quantité de liquide.
« D’abord un peu gêné, notre hareng se montra philosophe et, ne pouvant plus se livrer à ses nautiques ébats, s’habitua peu à peu à vivre en amphibie, tantôt dans l’air, tantôt dans l’eau.
« M. Dahl poursuivit l’expérience : il vida l’aquarium.
« Le hareng parut incommodé ; mais il en prit son parti, s’accoutuma au régime sec, respira comme un terrien et s’éleva d’un degré dans l’échelle des êtres.
« Pour le récompenser, M. Dahl le tira du bocal inutile, le posa sur le sol et lui apprit à vivre ainsi que le comportait sa nouvelle dignité.
« La bête était intelligente, affectueuse, souple ; elle fit tout ce qu’on voulut.
« Elle s’accommoda de nourritures inusitées chez les poissons, mangea dans la main de ses hôtes et s’éprit pour son maître d’une amitié si vive qu’elle témoignait un chagrin véritable quand celui-ci la quittait pour se rendre à ses occupations (sic !).
« Alors, M. Dahl jugea le moment venu de franchir la seconde étape : il instruisit le docile animal à ramper comme le font les serpents.
« Après quelques mois d’entraînement, le brave hareng se mouvait avec agilité : le naturaliste l’emmenait dans ses promenades et s’en faisait suivre comme d’un caniche (resic ! ).
Abrégeons et arrivons au drame :
« Un jour que M. Henrik Dahl et son hareng fidèle se promenaient dans le quartier du port, voilà qu’ils s’engagèrent sur un pont fait de planches disjointes !
« Hélas ! la malheureuse bête glissant par une fissure, tomba dans le bassin. »
... Et le Journal des Débats ajoute froidement :
« Il y a tout lieu de croire que, déshabitué de l’eau, le hareng s’est noyé. »
Une drôle de lettre
Cannes, décembre 1893.
Un jeune garçon de mes amis, M. Gabriel de Lautrec, m’envoie une lettre de conception tourmentée et de forme – dirai-je ? – incohérente.
L’idée m’est venue, un instant, de ne la publier point. Mais, au seul horizon de la remplacer par une vague littérature de mon cru, le sang ne m’a fait qu’un tour, un seul, et encore !
Il fait du soleil sur la promenade de la Croisette, comme s’il en pleuvait. La tournée Saint-Omer est dans nos murs, dans le but évident de jouer ce soir Le Sous-Préfet de Château-Gandillot, par notre sympathique camarade, le jeune et déjà célèbre auteur dramatique Ernest Buzard. Je ne voudrais pas manquer la petite pièce qui sert de lever de rideau. Alors quoi ? je n’ai qu’à me dépêcher.
La seule ressource me demeure donc d’insérer dans nos colonnes la missive de ce Gabriel de Lautrec, qui ne sera jamais, décidément, sérieux :
« Mon cher Allais,
« Je couvre mes yeux de ma main, un instant ; je rejette en arrière, d’un mouvement convulsif, mes cheveux où mes doigts amaigris mettent un désordre voulu ; je ranime la flamme jaune des bougies dans les chandeliers d’ébène, en cuir de Russie, qui sont le plus bel ornement de mon intérieur ; j’envoie un sourire voluptueux et morne à l’image de la seule aimée, et, après avoir disposé sur mes genoux, symétriquement, les plis du suaire à larmes d’argent qui me sert de robe de chambre, je vous écris – c’est à cette circonstance bien personnelle que la lettre qui va suivre emprunte son intérêt (avec l’intention formelle de ne jamais le lui rembourser).
« Si j’ai tardé à vous répondre, c’est que j’ai fait ces jours derniers un petit voyage – en chemin de fer.
« En chemin de fer ! direz-vous – mon cher ami ! » Oh oui ! je suis bien revenu de mes idées arriérées. Les chemins de fer ont leur avantage ; il faut faire quelques concessions à son siècle. La vie est faite de concessions – à perpétuité.
« Lorsque votre lettre m’est parvenue, je relisais les épreuves de mon volume sur L’adaptation des caves glacières à la conservation des hypothèques pendant les chaleurs de l’été ; j’ai suspendu aussitôt tout travail, ai-je besoin de le dire ? et tout en regrettant de la recevoir si tard, je l’ai lue attentivement.
« Votre idée de la montre-revolver est très séduisante, à première vue. Elle est, en outre, pratique, ce qui ne gâte rien. Le mécanisme tel que vous me le décrivez, avec trois dessins à l’appui (les dessins, entre parenthèses, sont assez mal faits), cette double détente de la montre et du revolver, ingénieusement reliée par l’ancre d’échappement, tout cela est merveilleusement trouvé.
« Tout le jour, vous portez votre montre dans la poche de votre gilet. Vous la regardez, vous savez l’heure, c’est très commode.
« Le soir venu, quelqu’un vous attaque, sous le prétexte fallacieux de demander l’heure, précisément. Vous exhibez votre montre, vous tirez dix ou douze coups, et voilà des enfants orphelins (ou du moins dangeureusement blessé, le père).
Et cependant, à voir l’objet, c’est une simple montre, comme vous et moi.
« C’est merveilleux, voilà tout.
« Je sais qu’il y a un inconvénient.
« Toutes les fois que l’on tire un coup de revolver, la montre s’arrête.
« Je trouve cela très naturel.
« Il serait difficile qu’il en fût autrement.
« Vous avouez, d’ailleurs, cet inconvénient au lieu d’en chercher le remède, et combien vous avez raison !
« Car un inconvénient auquel on remédie n’en est plus un.
« Est-il nécessaire, d’ailleurs, d’y remédier ?
« Pour ma part, je vois là, tout au contraire, un grand avantage.
« Je pense que si l’on pouvait faire adopter votre modèle de montre-revolver par les assassins, au moyen d’une remise de la force de plusieurs chevaux, ce serait d’une sérieuse utilité pour les constatations judiciaires.
« On serait immédiatement fixé, rien qu’en regardant l’instrument du crime, sur l’heure précise de la mort.
« L’expression usuelle : l’heure de la mort, cesserait dès lors d’être une vaine métaphore, pour devenir une palpable réalité.
« Or, je vous le demande : toutes les fois qu’on a l’occasion de réaliser une métaphore, doit-on hésiter un seul instant ?
« ... Au moment de terminer ma lettre, un remords vient me visiter. Je lui offre un siège et des cigares, courtoisement.
« Ce que je vous ai dit, en commençant, au sujet des chemins de fer, vous a peut-être fait croire que j’étais un partisan résolu de ce nouveau moyen de transport : il n’en est rien.
« Les désagréments qu’il présente sont nombreux.
« Pourquoi, par exemple, placer les gares, toujours, et exactement, sur la ligne de chemin de fer ?
« Le train s’arrête, vous descendez ; il y a cent contre un à parier que vous trouverez une gare devant vous.
« Et le pittoresque, et l’imprévu, qu’en fait-on ?