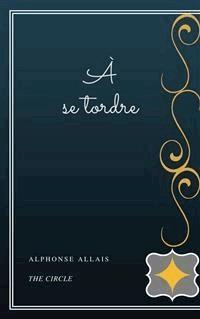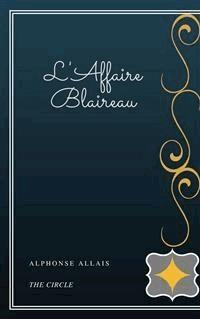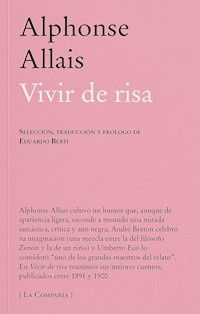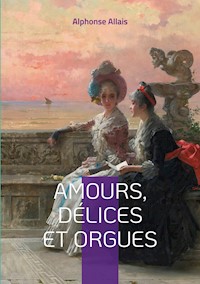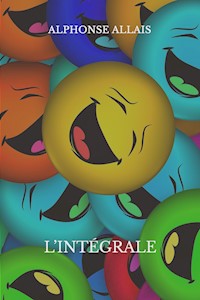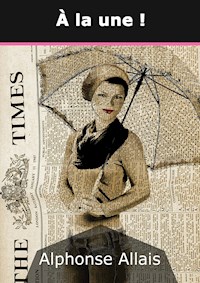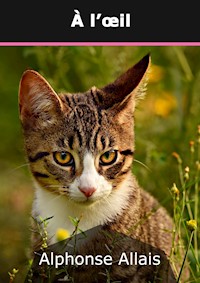2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sauf un : celui d'un brave garçon, qui s'appelait et s'appelle encore, d'ailleurs, Gaston de Puyrâleux. Récemment libéré du service militaire, Gaston avait eu juste le temps de dévorer l'héritage d'un oncle, lequel mérite en passant une courte mention. Le vieux duc Loys de Puyrâleux, après une existence toute d'austérité et d'agronomie, tomba, au cours d'un de ses voyages à Paris, dans les lacs charmeurs d'une jeune femme sans conduite qu'on appelle la Môme-Pipi. Une nuit, le pauvre gentilhomme apoplectique succomba dans les bras de cette sirène enrouée, au troisième étage d'un garni de la rue Lamarck (XVIIIe arrondissement). Très fin-de-siècle, Gaston fit un joli cadeau à la Môme-Pipi, organisa de décentes funérailles à son oncle Loys et ne connu point de répit que sa petite fortune n'eût passé dans les mains, moitié de cocottes, moitié de grecs. ? Quand je n'aurai plus d'argent, se disait-il, avec la philosophie de la vingt-cinquième année, je me ferai sauter le caisson. L'heure arriva, plutôt qu'à son tour, et le caisson ne sauta pas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
L'arroseur
Pages de titreL’arroseurColydorLe moderne FinancierL’aventure de l’Homme-orchestrePète-SecCurieux cas de sensibilitéDressageSupériorité de la vie américaine sur la nôtreAvec des briquesLa langue et l’armée françaiseUtilité à Paris du Bottin des DépartementsUne Maison prolifiqueLe vitrierLe bouchonL’inattendue FortuneUne curieuse industrie physiologiqueRoyal-CambouisLe pauvre rémouleur rendu à la santéLes culs-de-jatte militairesLe mystère de la Sainte-TrinitéVéritable révolution dans la mousqueterie françaiseL’acide carboniqueSimplementMaldonneTrépidationLa flamme éteintePage de copyrightAlphonse Allais
L’arroseur
L’arroseur
Édition de référence :
Paris, Félix Juven & Cie, Éditeurs, 1901.
L’arroseur
C’était le printemps !
Un printemps tard éclos, mais tout de suite redevenu radieux et peut-être même torride.
Les petites femmes enfin désemmitouflées – oh qu’enfin ! – trottinaient alertes, jolies comme des cœurs, avec leurs robes claires et leurs chapeaux où s’apâlissaient les rubans bleu tendre ou les plumes roses, si peu roses qu’on eût dit des plumes arrachées à des ailes d’âme. C’était le printemps !
De leurs tables et chaises, les limonadiers encombraient tout l’asphalte ambiant, ne laissant à la passée des pédestres que l’insuffisante et granitique bordure des trottoirs. C’était le printemps !
Les dames de la petite bourgeoisie examinaient l’alpaga d’antan de leur mari et, non sans liesse, constataient qu’il pourrait encore aller très bien cette année. C’était le printemps !
Dans les cafés de la rive gauche, des jeunes hommes tumultueusement chevelus demandaient de quoi écrire, pour, en des vers brisés mais définitifs, dire la Gloire du Renouveau. C’était le printemps !
L’oxygène et l’azote de l’air avaient poliment fait place à l’arome volatilisé du tant doux lilas, et de toutes parts, dans la ramure, les bourgeons pétaient comme de petits malappris. C’était le printemps !
L’allégresse était peinte sur tous les visages, sauf un.
Sauf un : celui d’un brave garçon, qui s’appelait et s’appelle encore, d’ailleurs, Gaston de Puyrâleux.
Récemment libéré du service militaire, Gaston avait eu juste le temps de dévorer l’héritage d’un oncle, lequel mérite en passant une courte mention.
Le vieux duc Loys de Puyrâleux, après une existence toute d’austérité et d’agronomie, tomba, au cours d’un de ses voyages à Paris, dans les lacs charmeurs d’une jeune femme sans conduite qu’on appelle la Môme-Pipi. Une nuit, le pauvre gentilhomme apoplectique succomba dans les bras de cette sirène enrouée, au troisième étage d’un garni de la rue Lamarck (XVIIIe arrondissement).
Très fin-de-siècle, Gaston fit un joli cadeau à la Môme-Pipi, organisa de décentes funérailles à son oncle Loys et ne connu point de répit que sa petite fortune n’eût passé dans les mains, moitié de cocottes, moitié de grecs.
– Quand je n’aurai plus d’argent, se disait-il, avec la philosophie de la vingt-cinquième année, je me ferai sauter le caisson.
L’heure arriva, plutôt qu’à son tour, et le caisson ne sauta pas.
Est-ce qu’on se fait sauter le caisson quand il fait ce temps-là ! (Car je crois avoir fait observer plus haut que c’était le printemps.)
Gaston de Puyrâleux en était là de ses réflexions, quand il rencontra sur le Boulevard un gros homme qu’il avait connu au Tréport.
– Tiens, monsieur de Puyrâleux !... Comment allez-vous ?
– Très bien, je vous remercie... c’est-à-dire, quand je dis très bien, vous savez...
– Seriez-vous souffrant ?
– Non, mais...
Et Gaston narra au gros homme sa triste situation.
Le gros homme se trouvait être, détail ignoré de Gaston, un fort entrepreneur d’arrosage de la ville de Paris. Il compatit vivement à la détresse du jeune homme.
– Si j’osais vous offrir une place dans mes bureaux ?
– Oh ! les bureaux, vous savez, ça n’est pas beaucoup mon affaire.
– Je ne peux pourtant pas vous proposer de mener un tonneau d’arrosage.
– Pourquoi pas ?
– Comment, vous consentiriez ?...
– Parfaitement !... Moi, pourvu que j’ai le cul sur un siège et des guides dans les mains, je me fiche du reste.
– ! ! ! !
– Quant à ce qui est de la capacité, vous pouvez vous en rapporter à moi. Je sors du Royal-Cambouis, et je conduirais une prolonge de Paris à Orléans sur un fil télégraphique.
– Entendu alors.
– Entendu.
Et le lendemain matin, le dernier des Puyrâleux se mettait en devoir d’arroser copieusement la place de la Concorde, qui lui avait été assignée.
C’était le printemps !
Les petites femmes enfin désemmitouflées – oh ! qu’enfin !... (Voir plus haut.)
C’était si bien le printemps que Gaston perdit complètement la notion exacte des choses.
Les voitures affluaient au Bois.
Gaston, une fleur de marronnier à la boutonnière, crut qu’il en était encore à son époque de splendeur.
Il enveloppa d’un coup de fouet son robuste percheron et enfila l’avenue des Champs-Élysées. (Avez-vous remarqué que, dans les histoires, les percherons sont toujours de robustes percherons ?)
Maintenant, il allait au petit trot, sans souci des grandes eaux qu’il traînait derrière lui.
Tous ses vieux amis, toutes ses anciennes maîtresses le reconnaissaient, effarés. Lui les saluait gracieusement de la main : bonjour, bon ! Bonjour, chère ! Salut, vieux C... !
La vérité m’oblige à reconnaître que ses avances étaient accueillies plus froidement.
Le tonneau se vidait un peu sur tout le monde, sur les jambes des chevaux, sur les roues des voitures. Une famille qui se promenait dans une charrette fort basse fut totalement inondée.
C’est ainsi que Gaston arriva au Lac.
La présence d’un tonneau d’arrosage au trot parmi la carrosserie fine causa un scandale abominable.
Un gardin du bois s’interposa et remit Gaston avec son appareil hydraulique à deux sergents de ville, qui conduisirent le tout à la fourrière.
Le jeune comte prit gaiement la chose ; mais tous les vieux Puyrâleux, depuis ceux d’Azincourt jusqu’à celui de la rue Lamarck, eurent en leur sépulcre un long frémissement (un joli alexandrin, ma foi !) : pour la première fois, on menait en fourrière l’équipage d’un des leurs.
C’était le printemps !
Colydor
Son parrain, un maniaque pépiniériste de Meaux, avait exigé qu’il s’appelât, comme lui, Polydore. Mais nous, ses amis, considérant à juste titre que ce terme de Polydore était suprêmement ridicule, avions vite affublé le brave garçon du sobriquet de Colydor, beaucoup plus joli, euphonique et suggestif davantage.
Lui, d’ailleurs, était ravi de ce nom, et ses cartes de visite n’en portaient point d’autre. Également, on pouvait lire en belle gothique Colydor sur la plaque de cuivre de la porte de son petit rez-de-chaussée, situé au cinquième étage du 327 de la rue de la Source (Auteuil).
Il exigeait seulement qu’on orthographiât son nom ainsi que je l’ai fait : un seul l, un y et pas d’e à la fin.
Respectons cette inoffensive manie.
Je ne suis pas arrivé à mon âge sans avoir vu bien des drôles de corps, mais les plus drôles de corps qu’il m’a été donné de contempler me semblent une pâle gnognotte auprès de Colydor.
Quelqu’un, Victor Hugo, je crois, a appelé Colydor le sympathique chef de l’école Loufoque, et il a eu bien raison.
Chaque fois que j’aperçois Colydor, tout mon être frémit d’allégresse jusque dans ses fibres les plus intimes.
– Bon, me dis-je, voilà Colydor, je ne vais pas m’embêter.
Pronostic jamais déçu.
Hier, j’ai reçu la visite de Colydor.
– Regarde-moi bien, m’a dit mon ami, tu ne me trouves rien de changé dans la physionomie ?
Je contemplai la face de Colydor et rien de spécial ne m’apparut.
– Eh bien, mon vieux, reprit-il, tu n’es guère physionomiste. Je suis marié.
– Ah bah !
– Oui, mon bonhomme. Marié depuis une semaine. Encore mille à attendre et je serai bien heureux !
– Mille quoi ?
– Mille semaines, parbleu !
– Mille semaines ? À attendre quoi ?
– Quand je perdrais deux heures à te raconter ça, tu n’y comprendrais rien !
– Tu me crois donc bien bête ?
– Ce n’est pas que tu sois plus bête qu’un autre, mais c’est une si drôle d’histoire !
Et, sur cette alléchance, Colydor se drapa dans un sépulcral mutisme. Je me sentais décidé à tout, même au crime, pour savoir.
– Alors, fis-je de mon air le plus indifférent, tu es marié...
– Parfaitement.
– Elle est jolie ?
– Ridicule.
– Riche ?
– Pas un sou.
– Alors quoi ?
– Puisque je te dis que tu n’y comprendrais rien.
Mes yeux suppliants le firent se raviser.
Colydor s’assit dans un fauteuil, n’alluma pas un excellent cigare et me narra ce qui suit :
« Tu te rappelles le temps infâme que nous prodigua le Seigneur durant tout le joli mois de mai ? J’en profitai pour quitter Paris, et j’allai a Trouville livrer mon corps d’albâtre aux baisers d’Amphitrite.
« En cette saison, l’immeuble, à Trouville, est pour rien. Moyennant une bouchée de pain, je louai une maison tout entière, sur la route d’Honfleur.
« Ah ! une bien drôle de maison, mon pauvre ami ! Imagine-toi un heureux mélange de palais florentin et de chaumière normande, avec un rien de pagode hindoue brochant sur le tout.
« Entre deux baisers d’Amphitrite, j’excursionnais vaguement dans les environs.
« Un dimanche entre autres, – oh ! cet inoubliable dimanche ! – je me promenais à Houlbec, un joli petit port de mer ma foi, quand des flots d’harmonie vinrent me submerger tout à coup.
« À deux pas, sur une place plantée d’ormes séculaires, une fanfare, probablement municipale, jetait au ciel ses mugissements les plus mélodieux.
« Et autour, tout autour de ces Orphées en délire, tournaient sans trêve les Houlbecquois et les Houlbecquoises.
« Parmi ces dernières...
« Crois-tu au coup de foudre ? Non ? Eh bien, tu es une sinistre brute !
« Moi non plus, je ne croyais pas au coup de foudre, mais maintenant !...
« C’est comme un coup qu’on reçoit là, pan ! dans le creux de l’estomac, et ça vous répond un peu dans le ventre. Très curieux le coup de foudre !
« Parmi ces dernières, disais-je donc, une grande femme brune, d’une quarantaine d’années, tournait, tournait, tournait.
Est-elle jolie ? Je n’en sais rien, mais à son aspect, je compris tout de suite que c’en était fait de moi. J’aimais cette femme, et je n’aimerais jamais qu’elle.
« Fiche-toi de moi si tu veux, mais c’est comme ça.
« Elle s’accompagnait de sa fille, une grande vilaine demoiselle de vingt ans, anguleuse et sans grâce.
« Le lendemain, j’avais lâché Trouville, mon castel auvergno-japonais, et je m’installais à Houlbec.
« Mon coup de foudre était la femme du capitaine des douanes, un vieux bougre pas commode du tout et joueur à la manille aux enchères, comme feu Manille aux enchères lui-même.
« Moi, qui n’ai jamais su tenir une carte de ma vie, je n’hésitai pas, pour me rapprocher de l’idole, à devenir le partenaire du terrible gabelou !
« Oh ! ces soirées au Café de Paris, ces effroyables soirées uniquement consacrées à me faire traiter d’imbécile par le capitaine, parce que je lui coupais ses manilles ou parce que je ne les lui coupais pas. Car, à l’heure qu’il est, je ne suis pas encore bien fixé.
« Et puis je ne me rappelais jamais que c’était le dix le plus fort à ce jeu-là. Oh ! ma tête, ma pauvre tête !
« Un jour enfin, au bout d’une semaine environ, ma constance fut récompensée. Le gabelou m’invita à dîner.
« Charmante, la capitaine, et d’un accueil exquis. Mon cœur flamba comme braise folle. Je mis tout en œuvre pour arriver à mes détestables fins, mais je pus me fouiller dans les grandes largeurs.
« Je commençais à me sentir tout calamiteux, quand un soir – oh : cet inoubliable soir !... Nous étions dans le salon : je feuilletais un album de photographies, et elle, l’idole, me désignait : Mon cousin Chose, ma tante Machin, une belle-sœur de mon mari, mon oncle Un Tel, etc., etc.
« – Et celle-ci, la connaissez-vous ?
« – Parfaitement, c’est Mlle Claire.
« – Eh bien ! pas du tout ! C’est moi à vingt ans.
« Et elle me conta qu’à vingt ans, elle ressemblait exactement à Claire, sa fille, si exactement qu’en regardant Claire elle s’imaginait se considérer dans son miroir d’il y a vingt ans.
« Était-ce possible !
« Comment cette adorable créature, potelée si délicieusement, avait-elle pu être une telle fille sèche et maigre ?
« Alors, mon pauvre ami, une idée me vint qui m’inonda de clartés et de joies.
« Enfin, je tenais le bonheur !
« Si la mère a ressemblé si parfaitement à la fille, dis-je, il est certain qu’un jour, la fille ressemblera parfaitement à la mère.
« Et voilà pourquoi j’ai épousé Claire la semaine dernière.
« Aujourd’hui, elle a vingt ans, elle est laide. Mais dans vingt ans, elle en aura quarante, et elle sera radieuse comme sa mère.
« J’attendrai, voilà tout. »
Et Colydor, évidemment très fier de sa combinaison, ajouta :
– Tu ne m’appelleras plus loufoc, maintenant... hein !