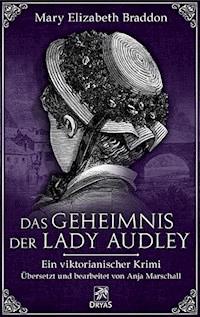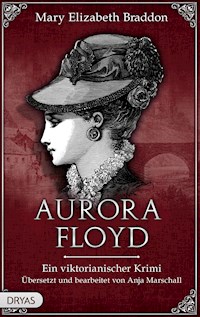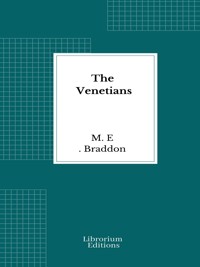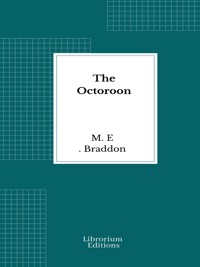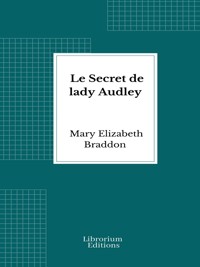1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les faibles rayons d’une lueur rougeâtre éclairent çà et là les épais ombrages des bois du Kent. Le doigt vermeil de l’automne s’est légèrement posé sur le feuillage, — avec cette sobriété de touche que déploie un peintre lorsqu’il se sert de ses plus brillantes couleurs pour parachever son tableau : mais le soleil, qui se couche dans toute la majesté qu’il conserve encore au mois d’août, dore le paisible paysage et l’embrase de sa splendeur.
Les bois environnants, les luxuriantes prairies, les étangs calmes et limpides, les haies coquettement taillées, les routes unies et sinueuses ; les sommets des collines se fondant au loin dans l’horizon empourpré ; les chaumières apparaissant comme des points blancs à travers le feuillage qui les enveloppe ; les auberges isolées au bord de la route avec leurs toits de chaume brunis et les souches moussues de leurs cheminées ; les nobles manoirs cachés derrière des chênes centenaires ; les petites maisons gothiques ; les chalets rustiques à la mode suisse ; les portails soutenus par des colonnes et surmontés d’écussons sculptés dans la pierre, qu’enlacent de gracieuses guirlandes de lierre ; les églises de village, les élégantes écoles, enfin tout ce qui compose un merveilleux paysage anglais est baigné dans une brume vaporeuse, qui s’épaissit à mesure que des obscures profondeurs des forêts et des sentiers bordés de haies se répandent les ombres du crépuscule, et que tous les contours du paysage se détachent d’une manière plus indécise sur le fond du ciel dont la pourpre prend une teinte de plus en plus foncée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aurora Floyd
Mary Elizabeth Braddon
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385747275
CHAPITRE I Comment un riche banquier épousa une actrice.
CHAPITRE II Aurora.
CHAPITRE III Ce qu’il advint d’un bracelet de diamants.
CHAPITRE IV Après le bal.
CHAPITRE V John Mellish.
CHAPITRE VI Refusé et accepté.
CHAPITRE VII L’étrange pensionnaire d’Aurora.
CHAPITRE VIII Retour du pauvre Mellish.
CHAPITRE IX Comment Bulstrode passa son jour de Noël
CHAPITRE X La lutte.
CHAPITRE XI Au château d’Arques.
CHAPITRE XII L’idiot.
CHAPITRE XIII Les courses du printemps.
CHAPITRE XIV « L’Amour prit le sablier et le renversa de sa main charmante. »
CHAPITRE XV La lettre de Pastern.
CHAPITRE XVI James Conyers.
CHAPITRE XVII Le messager de l’entraîneur.
CHAPITRE XVIII Par la pluie.
CHAPITRE XIX Affaires d’intérêts.
CHAPITRE XX Le Capitaine Prodder.
CHAPITRE XXI Il dit seulement : « Je m’ennuie ! »
CHAPITRE XXII Constance.
CHAPITRE XXIII Sur le seuil des plus sombres malheurs.
CHAPITRE XXIV Le Capitaine Prodder apporte de mauvaises nouvelles chez sa nièce.
CHAPITRE XXV Ce qui s’était passé dans le bois.
CHAPITRE XXVI Au Lion d’Or.
CHAPITRE XXVII « Ma femme !… ma femme !… ma femme !… je n’ai plus de femme ! »
CHAPITRE XXVIII Fuite d’Aurora.
CHAPITRE XXIX Mellish trouve sa maison dans la désolation.
CHAPITRE XXX Un visiteur inattendu.
CHAPITRE XXXI Le conseil de Bulstrode.
CHAPITRE XXXII En garde !
CHAPITRE XXXIII Le Capitaine Prodder retourne à Doncastre.
CHAPITRE XXXIV Découverte de l’arme avec laquelle Conyers a été tué.
CHAPITRE XXXV Sous un nuage.
CHAPITRE XXXVI Réunion.
CHAPITRE XXXVII Le bouton de cuivre de Crosby, de Birmingham.
CHAPITRE XXXVIII Dépisté.
CHAPITRE XXXIX Bulstrode expie le passé.
CHAPITRE IComment un riche banquier épousa une actrice.
Les faibles rayons d’une lueur rougeâtre éclairent çà et là les épais ombrages des bois du Kent. Le doigt vermeil de l’automne s’est légèrement posé sur le feuillage, — avec cette sobriété de touche que déploie un peintre lorsqu’il se sert de ses plus brillantes couleurs pour parachever son tableau : mais le soleil, qui se couche dans toute la majesté qu’il conserve encore au mois d’août, dore le paisible paysage et l’embrase de sa splendeur.
Les bois environnants, les luxuriantes prairies, les étangs calmes et limpides, les haies coquettement taillées, les routes unies et sinueuses ; les sommets des collines se fondant au loin dans l’horizon empourpré ; les chaumières apparaissant comme des points blancs à travers le feuillage qui les enveloppe ; les auberges isolées au bord de la route avec leurs toits de chaume brunis et les souches moussues de leurs cheminées ; les nobles manoirs cachés derrière des chênes centenaires ; les petites maisons gothiques ; les chalets rustiques à la mode suisse ; les portails soutenus par des colonnes et surmontés d’écussons sculptés dans la pierre, qu’enlacent de gracieuses guirlandes de lierre ; les églises de village, les élégantes écoles, enfin tout ce qui compose un merveilleux paysage anglais est baigné dans une brume vaporeuse, qui s’épaissit à mesure que des obscures profondeurs des forêts et des sentiers bordés de haies se répandent les ombres du crépuscule, et que tous les contours du paysage se détachent d’une manière plus indécise sur le fond du ciel dont la pourpre prend une teinte de plus en plus foncée.
Le soleil à son déclin illumine encore d’une splendeur éblouissante la façade monumentale d’un vaste château, construit en briques rouges, du style en faveur au commencement de l’ère des Georges, et semble la quitter à regret. Les longues rangées de fenêtres étroites paraissent comme embrasées sous le reflet de cette lueur vermeille, et plus d’un brave villageois, en retournant au logis, s’arrête pour regarder au-delà de la pelouse couverte de rosée, et du paisible lac, craignant presque que l’éclat de ces fenêtres ne provienne d’une cause surnaturelle et que la maison de M. Floyd ne soit en feu.
Ce superbe château en briques rouges appartient à maître Floyd, comme les paysans du Kent l’appellent dans leur patois, à Archibald-Martin Floyd, de la grande maison de banque Floyd, Floyd et Floyd, de Lombard Street, dans la Cité.
Les paysans du Kent connaissent très-peu cette maison de banque de la Cité, car depuis longtemps Archibald-Martin, l’associé principal, ne prend plus une part active aux affaires, qui sont gérées entièrement par ses neveux André et Alexandre Floyd, l’un et l’autre entre deux âges, hommes rangés, possédant famille et maisons de campagne ; tous deux sont redevables de leur fortune à leur oncle qui, quelque trente ans auparavant, les avait placés dans sa maison, alors qu’ils n’étaient encore que de jeunes Écossais rougeauds, grands, efflanqués, d’un blond ardent, tout frais débarqués d’un village situé au nord d’Aberdeen, et d’un nom impossible à prononcer.
Dans les premiers temps qu’ils étaient entrés dans la maison de leur oncle, ces jeunes messieurs écrivaient leurs noms Mc Floyd ; mais ils n’avaient pas tardé à suivre le sage exemple de leur parent et à abandonner la redoutable particule. « Nous n’avons pas besoin de dire à ces gens du Midi que nous sommes Écossais, » fit remarquer Alick à son frère, la première fois qu’il écrivit son nom A. Floyd tout court.
La maison de banque écossaise avait merveilleusement prospéré dans l’hospitalière capitale de l’Angleterre. Un succès sans précédent avait couronné toutes les entreprises de la vieille et honorable maison Floyd, Floyd et Floyd. Il y avait plus d’un siècle, en effet, que la raison commerciale était constamment Floyd, Floyd et Floyd ; car à mesure qu’un membre de la maison venait à baisser ou à mourir, du vieux tronc surgissait une branche plus vivace, et il n’y avait pas encore eu lieu de changer la triple répétition du nom si bien connu sur les plaques de cuivre qui ornaient les portes en acajou de la maison de banque. C’est une de ces plaques de cuivre que, trente ans environ avant la soirée du mois d’août où commence mon récit, Archibald-Martin Floyd montrait du doigt à ses neveux, qui n’avaient encore que la peau et les os, la première fois qu’il leur fit franchir le seuil de sa maison d’affaires.
— Voyez, mes enfants, — dit-il, regardez les trois noms gravés sur cette plaque de cuivre. Votre oncle George a plus de cinquante ans et il est célibataire : c’est le premier nom ; notre cousin germain, Stephen Floyd, de Calcutta, va se retirer des affaires avant peu : c’est le second nom ; le troisième est le mien, et j’ai trente-sept ans, souvenez-vous-en, mes enfants, et je ne suis pas disposé à faire la folie de me marier. Bientôt on aura besoin de vos noms pour remplir les vides ; en attendant, faites bien attention à les conserver purs ; car, pour peu qu’ils soient souillés d’une tache, il leur faudra renoncer à jamais à être inscrits sur cette plaque de cuivre.
Peut-être nos jeunes Écossais tout frais débarqués prirent-ils à cœur cette leçon ; ou peut-être bien la probité était-elle une vertu naturelle et innée dans la maison Floyd. Quoi qu’il en soit, ni Alick ni André ne déshonorèrent leurs ancêtres ; et lorsque Stephen Floyd, le négociant des Indes orientales, eut liquidé, et que l’oncle George fut fatigué des affaires et de la manie de bâtir, cette marotte des vieux garçons, les jeunes gens prirent la place de leurs parents et se chargèrent de la gestion de la maison. Archibald-Martin Floyd avait induit ses neveux en erreur sur un seul point, et ce point le regardait personnellement. Dix ans après avoir tenu aux jeunes gens le langage que nous avons rapporté, non-seulement le banquier fit la folie de se marier, mais, si vraiment on peut qualifier pareilles choses de folies, il descendit encore plus bas du piédestal sur lequel se drape la sagesse humaine, en tombant amoureux, à en perdre la tête, d’une femme fort jolie, mais sans fortune, qu’il ramena avec lui après une tournée dans les provinces manufacturières, et qu’il présenta presque sans cérémonie à ses parents et à ses voisins de campagne comme son épouse.
Tout cela s’était fait si précipitamment, que ces mêmes voisins étaient à peine revenus de la surprise que leur avait causée la lecture d’un certain paragraphe du Times, annonçant le mariage de « Archibald-Martin Floyd, banquier, de Lombard Street et de Felden, avec Éliza, fille unique de feu le Capitaine Prodder, » lorsque la berline de voyage du nouveau marié passa rapidement devant le pavillon gothique, situé à l’entrée du domaine du banquier, longea l’avenue et franchit le grand portail en pierre attenant à la maison, et qu’Éliza Floyd mit le pied dans le château, en saluant d’un air plein de bonté les domestiques ravis, rangés dans le vestibule pour recevoir leur nouvelle maîtresse.
L’épouse du banquier était une jeune femme de trente ans environ ; elle avait la taille haute, le teint brun et de grands yeux noirs dont le feu faisait rayonner d’une beauté éblouissante des traits qui, autrement, n’eussent en rien attiré les regards.
Que le lecteur se représente un de ces visages dont tout le charme consiste dans l’éclat surnaturel de deux yeux magnifiques, et se rappelle jusqu’à quel point ces visages-là ont une puissance de fascination supérieure aux autres. La même somme de beauté, répartie sur un nez bien fait, des lèvres roses et saillantes, un front symétrique et un teint délicat, ne fera qu’une femme pourvue d’attraits ordinaires ; mais concentrée sur un seul point, dans l’éclat merveilleux des yeux, elle en fait une divinité, une enchanteresse. On peut rencontrer la première de ces deux femmes tous les jours ; on ne rencontre la seconde qu’une fois dans sa vie.
Floyd présenta sa femme à la bourgeoisie du voisinage, dans un grand dîner qu’il donna peu de temps après son arrivée à Felden, nom que portait sa maison de campagne ; et, une fois cette cérémonie accomplie, il ne dit pas un mot de plus sur le choix qu’il avait fait ni à ses voisins, ni à ses parents, qui eussent été fort aises d’apprendre comment s’était consommé ce mariage inattendu, et qui trahissaient leur curiosité en pure perte par des demi-mots à l’adresse de l’heureux époux.
Cette discrétion de la part d’Archibald ne fit, bien entendu, que mettre plus activement à l’œuvre les mille langues de la renommée. À en croire les rumeurs qui circulaient dans Beckenham et dans West Wickham, villages près desquels Felden était situé, il n’y avait guère dans la société de condition basse et vile d’où Mme Floyd ne fût sortie. C’était, selon les uns, une ouvrière travaillant dans une manufacture, et le vieux sot de banquier l’avait vue dans les rues de Manchester, avec un mouchoir de couleur sur la tête, un collier de corail au cou, marchant dans la boue, sans bas et sans souliers ; c’est ainsi qu’il l’avait rencontrée ; il en était devenu amoureux sur-le-champ, et lui avait proposé de l’épouser sans tambour ni trompette. C’était, selon les autres, une actrice, et il l’avait vue au théâtre de Manchester. Bien pis encore, disaient ceux-ci, c’était une pauvre saltimbanque, affublée d’une robe de mousseline d’un blanc sale, de velours de coton rouge parsemé de paillettes, faisant des tours dans une baraque de toile, en compagnie d’une misérable troupe de vagabonds nomades et d’un cochon savant. D’autres disaient encore que c’était une écuyère, et que ce n’était pas dans les contrées manufacturières, mais au Cirque d’Astley, que le banquier l’avait rencontrée ; et il y avait même des gens qui étaient prêts à jurer l’avoir vue, de leurs propres yeux, dans cette arène couverte de sciure de bois, sauter au travers de cerceaux dorés et danser la cachucha sur six chevaux nus. On répétait aussi tout bas des cancans qui allaient plus loin encore, et que je n’ose pas rapporter ici, car les bouches qui déchiraient si impitoyablement et à si belles dents le nom et la réputation d’Éliza étaient inspirées par la méchanceté. Il pouvait se faire que quelques-unes de ces femmes eussent des raisons personnelles pour éprouver du dépit contre la nouvelle épouse, et que, dans ces charmantes villas du Kent, plus d’une beauté sur le déclin eût spéculé sur les revenus du banquier et sur les avantages d’une union avec le propriétaire de Felden.
La partie féminine de la société était étonnée et indignée de l’indolence des deux neveux écossais et de George Floyd, le vieux célibataire, frère d’Archibald Floyd. Pourquoi ces gens-là ne montraient-ils pas un peu de caractère et n’organisaient-ils pas un conseil de famille pour faire enfermer leur parent insensé dans une maison de fous ? Il le méritait bien.
La vieille noblesse du faubourg Saint-Germain, les duchesses hors d’âge et les vidames de l’autre siècle n’auraient pu médire d’un orléaniste enrichi avec plus de rancune mordante que tout ce monde n’en mettait à jaser sans relâche sur le compte de la femme du banquier. Chacun de ses actes était un nouveau sujet de critique ; à propos même de ce premier grand dîner dont nous avons parlé, quoiqu’Éliza ne se fût pas plus mêlée des préparatifs du cuisinier et de la femme de charge que si elle eût été en visite au palais de Buckingham, les invités dans leur mauvaise humeur trouvèrent que tout avait dégénéré depuis que « cette femme » était entrée dans la maison. Ils détestaient l’heureuse aventurière : ils la détestaient pour ses beaux yeux et pour ses magnifiques bijoux, présents extravagants d’un mari passionné ; ils la détestaient pour sa majestueuse prestance et pour ses mouvements pleins de grâce qui ne trahissaient jamais la prétendue obscurité de son origine ; ils la détestaient surtout pour son insolence, parce qu’elle n’avait pas le moins du monde l’air effrayé à la vue des imposants membres du nouveau cercle dans lequel elle se trouvait.
Si elle se fût débonnairement soumise aux nombreuses humiliations que ces provinciaux étaient prêts à lui faire subir ; si elle eût recherché leur protection et si elle se fût laissé tancer par eux ; peut-être avec le temps lui auraient-ils pardonné. Mais elle ne fit rien de tout cela. Si on venait la voir, c’était fort bien ; elle était franchement et complétement charmée de recevoir des visites. On pouvait la trouver les mains couvertes de gants de jardinage, les cheveux sans apprêt, portant un arrosoir, occupée dans ses serres, et elle vous accueillait avec autant de sérénité que si elle fût née dans un palais et accoutumée depuis sa plus tendre enfance à recevoir des hommages. On avait beau être d’une politesse aussi froide que possible, elle était toujours affable, franche, gaie et bonne. Elle aimait à parler sans cesse de son « cher vieil Archy, » comme elle se permettait d’appeler celui qui était en même temps son bienfaiteur et son mari ; ou bien elle montrait à ses hôtes quelque nouveau tableau qu’il avait acheté, et elle osait, l’impudente, l’ignorante, la prétentieuse créature ! parler d’art, comme si tout le jargon ronflant sous lequel ils essayaient de l’écraser lui eût été aussi familier qu’à un membre de l’Académie royale. Quand l’étiquette exigeait qu’elle rendît ses visites de cérémonie, elle avait l’audace de se rendre chez ses voisins dans un petit panier traîné par un seul poney à tous crins, car cette femme artificieuse avait le tort d’affecter de la simplicité dans ses goûts, et de ne point faire d’étalage. La grandeur qui l’entourait était pour elle chose toute naturelle ; elle causait et riait avec sa verve théâtrale, à la grande admiration des jeunes gens assez aveugles pour ne pas voir les charmes de race de celles qui la dénigraient, mais qui ne se lassaient jamais de vanter les manières aimables et les yeux superbes de Mme Floyd.
Je serais curieux de savoir si la pauvre Éliza connaissait la totalité ou même la moitié des méchancetés qu’on débitait sur son compte. Je soupçonne fort qu’elle chercha d’une façon ou d’une autre à être mise au courant de tout, et qu’elle ne fit qu’en rire. Elle était habituée à une vie d’émotions, et Felden eût pu lui paraître un séjour monotone sans ces médisances sans cesse renouvelées. Elle prenait un malin plaisir à la déconvenue de ses ennemis.
— Il faut qu’elles aient eu bien envie ou bien besoin de vous épouser, Archy, — disait-elle, — pour qu’elles me haïssent avec tant d’acharnement. Pauvres vieilles filles sans dot, penser que je leur ai arraché leur proie ! Je sais que c’est dur pour elles de songer qu’elles ne peuvent me faire pendre pour avoir épousé un homme riche.
Mais le banquier était si profondément blessé lorsqu’Éliza, qu’il adorait, lui répétait les cancans que lui avait rapportés sa femme de chambre, fermement dévouée à sa bonne et aimable maîtresse, qu’Éliza prit le parti de ne plus les lui raconter. Ils la divertissaient, elle ; mais lui, ils le piquaient au vif. Fier et sensible, comme presque tous les hommes intègres et consciencieux, il ne pouvait endurer que personne osât toucher au nom de la femme qu’il aimait si tendrement. Que faisait l’obscurité d’où il l’avait tirée pour l’élever jusqu’à lui ? Une étoile est-elle moins brillante, parce qu’elle scintille, au milieu de la nuit, sur une mare aussi bien que sur la mer ? Une femme vertueuse et bonne est-elle moins estimable parce qu’elle gagne misérablement sa vie par le seul travail auquel elle puisse se livrer, et parce qu’elle joue le rôle de Juliette devant un auditoire composé d’ouvriers qui payent à raison de six pence par tête le privilège de l’admirer et de l’applaudir ?
Oui, il faut révéler le crime, les mauvaises langues n’avaient pas tout à fait tort dans leurs conjectures : Éliza Prodder était actrice, et c’était sur les sales planches d’un théâtre de second ordre du comté de Lancastre que l’opulent banquier l’avait vue pour la première fois. Archibald nourrissait une admiration traditionnelle, passive, mais sincère, pour le vrai drame anglais. Oui, le drame anglais, car il avait vécu à une époque où le drame était anglais, où George Barnwel et Jane Shore figuraient parmi les chefs-d’œuvre favoris d’un public qui hantait les théâtres. Ah ! que nous avons tristement dégénéré depuis ces jours classiques, et qu’il est rare aujourd’hui qu’on nous mette sous les yeux la charmante histoire de Milwood et de son novice admirateur ! C’est vraiment déplorable. Pénétré, donc, de la solennité de Shakspeare et du drame anglais, Floyd, de passage, un soir, dans une petite ville du comté de Lancastre, entra dans une loge poudreuse du théâtre pour assister à la représentation de Roméo et Juliette : le rôle de l’héritière des Capulet était rempli par Mlle Éliza Percival, Prodder, de son véritable nom.
Je ne crois pas que Mlle Percival fût bonne actrice ou qu’elle se fût jamais distinguée dans sa profession, mais elle avait une voix grave et mélodieuse qui prononçait les paroles de l’auteur dont elle se faisait l’interprète avec une certaine richesse de ton qui, quoiqu’un peu monotone, faisait plaisir à entendre, et sur la scène elle était vraiment belle, car son visage illuminait le petit théâtre mieux que ne le faisait tout le gaz que le directeur liardait aux spectateurs clair-semés dans la salle.
Ce n’était pas encore, à cette époque, la mode de faire des pièces de Shakspeare des drames à effet. On n’avait pas encore intercalé dans Hamlet la fameuse scène nautique, et le prince de Danemark ne piquait pas une tête pour sauver la pauvre Ophélie. Dans ce petit théâtre du comté de Lancastre, on eût considéré comme une impardonnable infraction à toutes les lois de l’art dramatique qu’Othello ou son porte-fanion s’avisassent de s’asseoir à aucun moment de l’auguste représentation. L’espérance du Danemark n’était pas un homme du Nord accoutré d’une longue robe, et laissant flotter sa blonde chevelure ; c’était tout bonnement un individu portant un court justaucorps de velours de coton noir passé, taillé comme une blouse d’enfant, et garni de perles de Venise, qui pendaient et sur lesquelles l’acteur marchait de temps en temps dans le cours de la pièce. Les acteurs, dans leur simplicité, prétendaient que la tragédie, pour être la tragédie, doit ne ressembler à rien absolument de ce qui a jamais eu lieu sous la calotte des cieux. Or, Éliza suivait patiemment le vieux sentier battu ; car c’était une créature trop bonne, trop peu sérieuse, trop complaisante pour tenter follement de contrarier les travers du siècle, qu’elle n’était pas née pour corriger.
Que dire alors de sa manière de jouer le rôle de la jeune Italienne passionnée ? Elle portait une robe de satin blanc ornée de paillettes qu’on avait cousues sur le bord d’une jupe fanée, dans la ferme persuasion, persuasion partagée par toutes les actrices de province, que les paillettes sont l’antidote de la saleté. Elle était en train de rire et de babiller dans le petit foyer, une minute avant d’entrer en scène pour pleurer son frère assassiné et son amant exilé. Mlle Percival ne prenait pas sa profession fort à cœur ; les émoluments qu’elle touchait dans le comté de Lancastre la rémunéraient à peine des tracas et des fatigues que lui causaient des répétitions commençant de fort bonne heure et des représentations finissant très-tard ; quelle compensation y eût donc trouvé l’épuisement moral auquel s’assujettit le véritable artiste qui vit de la vie du personnage qu’il représente ?
Les comédiens avec lesquels jouait Éliza échangeaient entre eux, dans les intervalles d’un dialogue, où ils se prodiguaient les menaces les plus vindicatives, des observations amicales sur leurs affaires particulières ; pendant les moments de répit que le jeu de la scène leur laissait, ils calculaient à demi-voix, mais parfois de façon à être cependant entendus, le chiffre de la recette ; et quand Hamlet appelait Horatio sous le feu de la rampe pour lui demander : « Vois-tu cela ? » il était assez probable que le confident du prince était au fond du théâtre en train de raconter à Polonius la manière honteuse dont sa maîtresse d’hôtel s’y prenait pour lui voler du thé et du sucre.
Ce ne fut donc pas le jeu de Mlle Percival qui captiva le banquier. Archibald savait qu’elle était aussi mauvaise actrice qu’aucune femme qui ait jamais joué la tragédie et la haute comédie pour vingt-cinq shillings par semaine. Il avait vu Mlle O’Neil dans ce même rôle, et il ne put s’empêcher de sourire de pitié en entendant les ouvriers applaudir la pauvre Éliza dans la scène de l’empoisonnement. Mais, malgré tout, il tomba amoureux d’elle. Ce fut une nouvelle édition de l’éternelle histoire, vieille comme le monde. Ce fut l’histoire d’Arthur de Pendennis ensorcelé et transporté par Mlle Fotheringay au petit théâtre de Chatteries, avec cette différence que, au lieu d’un faible et impressionnable adolescent, c’était un homme de quarante-sept ans, versé dans les affaires, calme, posé, qui n’avait jamais, avant ce soir-là, ressenti le plus léger frémissement d’émotion en voyant un visage féminin. À partir de ce soir-là, par exemple, le monde ne renferma plus pour lui qu’un seul être, la vie n’eut plus qu’un seul but. Il retourna au théâtre le lendemain, puis le surlendemain, et s’arrangea de façon à lier connaissance avec quelques-uns des acteurs dans une taverne voisine du théâtre. Ils le grugèrent d’importance, ces comédiens râpés ; ils lui firent payer une infinité de grogs, le flattèrent, le cajolèrent, et arrachèrent le secret de son cœur ; puis ils allèrent rapporter à Éliza qu’elle était tombée sur une bonne aubaine, qu’un vieux garçon, qui avait toujours de l’argent plein ses poches, était amoureux fou d’elle, et que, si elle savait bien mener sa barque, elle l’épouserait dès le lendemain. Ces bons apôtres le lui montrèrent par un trou percé à la toile : il était assis presque tout seul dans une des loges, attendant que la pièce commençât et que les yeux noirs d’Éliza vinssent l’éblouir encore une fois.
Éliza rit de sa conquête ; ce n’en était qu’une de plus parmi un grand nombre d’autres analogues, qui avaient toutes eu le même dénoûment et ne l’avaient conduite à rien de mieux qu’à la location d’une loge le soir de son bénéfice, ou à un bouquet laissé pour elle à la porte du théâtre. Elle ne connaissait pas la force d’un premier amour sur un homme de quarante-sept ans. Une semaine ne s’était pas écoulée, qu’Archibald lui avait fait l’offre sérieuse de sa main et de sa fortune.
Il avait appris beaucoup de choses sur son compte par ses camarades de théâtre, et il n’en avait entendu dire que du bien. C’étaient des tentations auxquelles elle avait résisté ; des bracelets de diamants qu’elle avait refusés avec indignation ; des actes touchants de tendre charité qu’elle avait faits en secret ; son indépendance, qu’elle avait conservée, malgré toute sa pauvreté et ses rudes épreuves ; ils lui racontèrent une centaine d’anecdotes sur sa bonté, qui lui firent monter le sang au visage d’orgueil et de généreuse émotion. Elle-même lui fit le simple récit de son existence ; elle lui dit qu’elle était la fille d’un Capitaine de navire marchand appelé Prodder ; qu’elle était née à Liverpool ; qu’elle se souvenait peu de son père, qui était presque toujours en mer, ni de son frère, son aîné de trois ans, qui, après s’être querellé avec son père, le Capitaine, avait disparu, et dont on n’avait plus entendu parler, ni de sa mère qui était morte, quand elle, Éliza, était âgée de dix ans. Le reste fut relaté en peu de mots. Elle avait été recueillie dans la famille d’une tante, qui tenait une boutique d’épicerie dans la ville natale de Mlle Prodder. Elle avait appris à faire des fleurs artificielles ; mais elle n’avait pas mordu à ce genre de travail. Elle allait souvent dans les théâtres de Liverpool, et l’idée lui vint qu’elle aimerait à monter sur les planches. Comme elle était jeune, hardie et énergique, un beau jour elle avait quitté la maison de sa tante, était allée droit chez le régisseur d’un des petits théâtres, et l’avait prié de la laisser jouer le rôle de lady Macbeth. Le régisseur lui rit au nez ; mais il lui dit que, en considération de sa belle prestance et de ses beaux yeux noirs, il lui donnerait quinze shillings par semaine pour figurer : terme technique dont il se servait pour désigner l’emploi des femmes qui circulent sur le théâtre tantôt vêtues en paysannes, tantôt en costumes de cour confectionnés avec de la cotonnade garnie d’or, et qui regardent d’un air distrait tout ce qui se passe sur la scène. Après avoir été comparse quelque temps, Éliza commença à jouer de petits rôles refusés avec indignation par les actrices qui lui étaient supérieures : de ces rôles modestes, elle se lança dans l’arène tragique, où elle sut se maintenir sans encombre pendant neuf ans, jusqu’à la veille du vingt-neuvième anniversaire de sa naissance, où le destin jeta le riche banquier sur son chemin, et où, dans l’église paroissiale d’une petite ville de province, l’actrice échangea le nom de Prodder contre celui de Floyd.
Elle avait accepté le banquier en partie parce qu’elle était mue par un sentiment de reconnaissance pour l’ardeur généreuse de son affection, et portée à l’aimer mieux que tout autre homme qu’elle connaissait, et en partie d’après les avis de ses amis du théâtre, qui lui avaient dit, avec plus de franchise que d’élégance, qu’elle serait une étrange folle de laisser échapper une pareille chance ; mais à l’époque où elle donna sa main à Floyd, elle n’avait aucune idée de l’énormité de la fortune qu’elle était invitée à partager. Il lui dit qu’il était banquier, et son active imagination évoqua incontinent l’image de la seule femme de banquier qu’elle eût jamais connue : c’était une grosse femme qui portait des robes de soie, habitait une maison carrée enduite de stuc et ayant des jalousies vertes, avec une cuisinière et une femme de chambre, et prenait trois billets de loge au bénéfice de Mlle Percival.
C’est pourquoi, lorsque le mari couvrit sa charmante fiancée de bracelets et de colliers de diamants, de soieries et de brocarts qui se tenaient raides et qu’on ne pouvait manier à cause même de leur richesse ; quand il l’amena tout droit de sa province dans l’île de Wight, où il la logea dans de spacieux appartements, au meilleur hôtel de Ryde, et qu’il jeta son argent à droite et à gauche, comme s’il eût porté la lampe d’Aladin dans la poche de son habit, Éliza fit des remontrances à son nouveau maître, craignant que son amour ne l’eût rendu fou, et que cette extravagance alarmante ne fût le premier symptôme de la démence.
Quand Archibald fit entrer sa femme dans la longue galerie de tableaux de Felden, Éliza joignit ses mains dans le sincère transport de sa joie féminine, en voyant les magnificences dont elle était entourée. Elle tomba à genoux et adressa des hommages vraiment dramatiques à son seigneur et maître.
— Ô Archy, — dit-elle, — btout cela est trop pour moi. J’ai peur de mourir de bonheur et que ma grandeur me tue.
Dans toute la maturité de la beauté, d’une santé florissante, pleine de fraîcheur et d’entrain, Éliza était bien peu fondée à songer qu’elle ne jouirait de ces splendeurs que durant très-peu de temps.
Maintenant que le lecteur connaît les antécédents d’Éliza, il y trouvera peut-être l’explication du sans-gêne insolent et de la noble audace avec lesquels Mme Floyd traitait les familles provinciales de second rang qui s’appliquaient à la couvrir de confusion. Elle avait été actrice : pendant neuf ans elle avait vécu dans ce monde idéal, où les ducs et les marquis sont aussi communs que les bouchers et les boulangers dans la vie journalière, où tout noble est généralement pauvre d’esprit, bafoué de tous les côtés et traité avec mépris par les spectateurs, à cause de son rang. Comment eût-elle été interdite en entrant dans les salons de ces manoirs du Kent après avoir, pendant neuf ans, paru tous les soirs sur un théâtre pour être le point de mire de tous les yeux et émerveiller son auditoire toute une soirée ? Était-il probable qu’elle s’en laisserait imposer par les Lenfield, qui étaient des carrossiers de Park Lane, ou par Mlle Manderlys, dont le père avait fait sa fortune grâce à un brevet pour un nouveau genre d’amidon, elle qui avait reçu le roi Duncan à la porte de son château, et s’était assise sur son trône, condescendant à offrir l’hospitalité aux Thanes venus lui rendre hommage à Dunsinane ? Ils avaient donc beau faire, ils n’étaient pas dans le cas de soumettre cette réprouvée ; tandis que, pour accroître encore leur mortification, il devenait chaque jour plus évident que M. et Mme Floyd étaient un des couples les plus heureux qu’on eût jamais vu porter les liens du mariage, et les changer en guirlandes de roses. Si ce que je rapporte ici était une histoire très-romanesque, il ne serait pas déplacé de faire se morfondre Éliza dans sa cage dorée, usant ses forces à pleurer un amant abandonné, délaissé dans un funeste moment d’ambitieuse folie. Mais comme mon récit est véridique, vrai non-seulement dans un sens général, mais rigoureusement vrai quant aux faits principaux que je vais relater, et comme je pourrais désigner, dans un certain comté, assez loin au nord des charmants bois du Kent, la maison même où les événements que je vais rapporter ont eu lieu, je suis obligé de dire aussi la vérité à cet égard, et de donner comme un fait positif que l’amour qu’Éliza avait pour son mari était une affection aussi pure et aussi sincère que jamais homme doit espérer en obtenir du cœur généreux d’une excellente femme. Je ne saurais dire quelle part la reconnaissance pouvait avoir dans cet amour. Si elle habitait une belle maison et était servie par des domestiques pleins d’attention et de déférence ; si elle mangeait des mets délicats et buvait des vins recherchés ; si elle portait de riches toilettes et des bijoux magnifiques ; si elle se prélassait sur les coussins moelleux d’une voiture, traînée par des chevaux vifs et fringants, conduite par un cocher à tête poudrée ; si, partout où elle allait, on lui rendait toutes sortes d’hommages extérieurs ; si elle n’avait qu’à formuler un désir pour qu’il fût satisfait comme par enchantement ; elle savait qu’elle devait tout cela à son mari, à Archibald Floyd ; et il peut se faire que tout naturellement elle finit par l’identifier avec tous les avantages dont elle jouissait et par l’aimer pour toutes ces choses-là. Un amour de ce genre peut paraître une affection basse et méprisable ; et sans doute Éliza aurait dû ressentir un souverain mépris pour l’homme qui épiait tous ses caprices, satisfaisait toutes ses fantaisies et qui l’aimait et l’honorait, toute ci-devant actrice de province qu’elle était, autant qu’il eût pu le faire, si elle eût descendu les marches du trône le plus altier de la chrétienté pour lui donner sa main.
Elle était reconnaissante à son égard, elle l’aimait et elle le rendait parfaitement heureux ; si heureux que le brave Écossais était quelquefois presque frappé d’épouvante en contemplant sa prospérité, et disposé à prier le ciel à deux genoux de ne pas la lui ravir : s’il plaisait à la Providence de l’éprouver, qu’elle le dépouillât de toute sa fortune sans lui laisser un sou, pour débuter de nouveau dans le monde, pourvu que ce fût avec elle. Hélas ! c’était, entre tous, ce bien-là qu’il devait perdre !
Éliza et son mari vécurent pendant un an de cette vie heureuse à Felden. Il voulut l’emmener sur le continent ou à Londres passer la belle saison ; mais elle ne put se résoudre à quitter sa charmante maison du Kent. Elle était plus heureuse que les journées n’étaient longues, dans ses jardins et ses serres, au milieu de ses chiens et de ses chevaux, et parmi ses pauvres. Aux yeux de ces derniers, elle était un ange descendu du ciel pour les consoler. Elle avait l’adresse de se faire aimer de ces gens-là avant d’entreprendre de réformer leurs mauvaises habitudes. Dans les premiers temps, en commençant à faire leur connaissance, elle fermait les yeux sur la malpropreté et le désordre de leurs chaumières, comme elle les eût fermés sur un tapis râpé dans le salon d’une duchesse pauvre ; mais peu à peu elle conseillait adroitement telle ou telle petite amélioration dans le ménage de ses protégés, et finissait, en moins d’un mois, sans sermonner ni blesser personne, par opérer une transformation complète. Mme Floyd était excessivement habile dans sa conduite à l’égard de ces paysans vicieux. Au lieu de leur dire tout de suite d’une manière franche et chrétienne qu’ils étaient tous malpropres, dépravés, ingrats, impies, elle faisait de la diplomatie et agissait avec eux comme si elle eût été un candidat sollicitant les suffrages du comté. Par l’appât de chapeaux neufs, elle amenait les jeunes filles à aller régulièrement à l’église ; au moyen de tabac qu’elle leur donnait pour fumer chez eux, et dans quelques cas (oh ! horreur !), grâce au cadeau d’une bouteille de gin, elle détournait les hommes mariés de continuer à fréquenter les cabarets. Elle parvenait à faire nettoyer une cheminée ou un foyer sales, en faisant présent à la maîtresse du logis d’un brillant vase de porcelaine ou d’un garde-feu en cuivre. Une robe neuve lui servait à corriger une humeur acariâtre, et un gilet de toile de Perse à pacifier une querelle de famille invétérée. Mais une année après son mariage, tandis que les jardiniers étaient à l’ouvrage pour mettre à exécution les plans d’embellissement qu’elle avait tracés ; tandis que l’œuvre de la réforme progressait lentement, mais sûrement, parmi les êtres qu’elle comblait de ses bontés et qui lui en étaient reconnaissants ; tandis que les langues de ses détracteurs continuaient à déchirer à belles dents sa réputation sans tache ; tandis qu’Archibald était transporté de joie de tenir dans ses bras une petite fille ; sans qu’aucun symptôme précurseur fût venu amortir la violence du coup, la lumière s’éteignit lentement de ces yeux si brillants, ils se fermèrent pour l’éternité, et Archibald devint veuf.
CHAPITRE IIAurora.
L’enfant qu’Éliza laissa après elle, lorsqu’elle fut enlevée si subitement à tous les bonheurs et à toutes les joies de ce monde, fut baptisée sous le nom d’Aurora. Ce nom romanesque avait été une fantaisie de cette pauvre Éliza ; et il n’y avait pas un seul de ses caprices, quelque insignifiant qu’il fût, qui n’eût toujours été sacré pour son mari et qui ne lui fût désormais doublement sacré. Personne ici-bas ne connut l’amertume réelle du chagrin qu’éprouva le pauvre Archibald. Ses neveux et leurs femmes lui faisaient constamment des visites de condoléance ; et l’une de ses nièces par alliance, créature douée d une bonté tout à fait maternelle, et femme dévouée à son mari, insista même pour voir et consoler le pauvre affligé. Dieu sait si sa tendresse apporta quelque soulagement à cette âme brisée ! Elle trouva en lui un homme qui semblait frappé de paralysie, engourdi, presque hébété. Peut-être adopta-t-elle le meilleur plan de conduite qu’on eût pu suivre. Elle lui parla peu de l’objet de son affliction ; mais elle alla le voir fréquemment, elle eut la patience de s’asseoir en face de lui durant des heures entières, et lui tint des conversations sur toute sorte de banalités ou de lieux communs : l’état du pays, le temps, le changement de ministère et autres sujets analogues si éloignés de celui qui faisait le chagrin de son existence, qu’une main moins prudente que celle de Mme Alexandre Floyd aurait à peine touché les cordes brisées du cœur du malheureux veuf.
Ce ne fut que six mois après la mort d’Éliza que Mme Alexandre osa prononcer son nom ; mais quand elle vint à en parler, ce ne fut pas en manifestant une hésitation sérieuse, mais d’un ton familier et avec des termes de tendresse, comme si elle eût été habituée à parler de la défunte. Elle comprit tout de suite qu’elle avait eu raison. Le temps était venu où le veuf éprouvait du soulagement à parler de la femme qu’il avait perdue ; et, à partir de ce moment, Mme Alexandre conquit les bonnes grâces de son oncle. Plusieurs années après, il lui dit que, même dans la sombre torpeur de son chagrin, il avait eu la vague intuition qu’elle avait pitié de lui, et qu’elle était une « bonne femme. » Le même soir, cette bonne femme entra, avec une petite fille dans les bras, dans la grande chambre où le banquier se tenait isolé au coin de son feu ; cette petite fille était une enfant au visage pâle, ayant de grands et beaux yeux noirs, qui regardaient fixement Floyd avec un sombre étonnement. Ce baby à l’air grave, à la physionomie déplaisante, devait, en grandissant, se métamorphoser en Aurora Floyd, l’héroïne de mon récit.
L’enfant pâle, aux yeux noirs, devint l’idole d’Archibald-Martin Floyd, le seul objet pour lequel, dans le monde entier, la vie lui parût valoir la peine d’être supportée. À partir du jour de la mort de sa femme, il avait abandonné toute participation active aux affaires de sa maison de Lombard Street, et il n’avait plus d’autre occupation, d’autre plaisir que d’écouter le babil et de flatter les caprices de cette petite fille. Son amour pour elle était une faiblesse, tournant presque à la folie. Si ses neveux eussent été le moins du monde méchants, ils auraient pu concevoir quelques idées vagues de ce conseil de famille, auquel les voisins tenaient tant. Floyd enviait aux bonnes les soins qu’elles étaient payées pour donner à l’enfant. Il les surveillait furtivement, craignant qu’elles ne fussent dures avec elle. Toutes les épaisses portes du grand château de Felden Woods ne pouvaient empêcher le plus faible murmure de cette petite voix enfantine de parvenir à ses oreilles, toujours sur le qui-vive et toujours empressées.
Il la regardait grandir comme un enfant regarde croître un gland qu’il espère voir devenir chêne. Il répétait les syllabes qu’elle balbutiait, au point que l’on était fatigué de son bavardage incessant à propos de cette enfant. De tout cela il résulta naturellement qu’Aurora fut gâtée, dans toute l’acception du mot. Nous ne disons pas qu’une fleur est gâtée, parce qu’elle est cultivée dans une serre où aucun souffle de l’air ne peut l’affecter trop rudement ; mais dans ce cas, la brillante plante exotique est certainement taillée et émondée par la main impitoyable du jardinier, tandis qu’Aurora se développait sans entrave, et il n’y avait personne pour élaguer les branches vagabondes de cette luxuriante nature. Elle disait ce qui lui plaisait ; elle pensait, parlait, agissait comme elle le voulait ; elle apprenait ce qui lui faisait plaisir, et, en grandissant, elle devint une jeune femme brillante, impétueuse, aussi affectueuse, aussi généreuse que sa mère ; mais son caractère était animé d’un feu natif qui lui donnait une certaine originalité. Assez généralement, les petites filles laides dans leur enfance deviennent belles en devenant femmes, et c’est ce qui arriva à Aurora. À dix-sept ans, elle était deux fois aussi belle que sa mère l’avait été à vingt-neuf ; mais elle avait la même irrégularité de traits, compensée par une paire d’yeux semblables aux étoiles de ciel, et par deux rangées de dents blanches d’une perfection sans égale. Quand on la regardait en face, on ne pouvait guère remarquer que ses yeux et ses dents ; car ils vous éblouissaient, vous aveuglaient au point de vous empêcher de critiquer son petit nez douteux ou la grandeur de sa bouche souriante. Quand elle relevait les touffes de sa riche chevelure noir de corbeau, elle laissait voir un front trop bas pour être conforme au type ordinaire de la beauté. Un phrénologue aurait dit que sa tête avait de la noblesse ; un sculpteur aurait ajouté qu’elle était posée sur le cou d’une Cléopâtre.
Mlle Floyd connaissait très-peu l’histoire de sa pauvre mère. Dans le cabinet particulier, du banquier il y avait appendu à la muraille un pastel représentant Éliza dans tout l’éclat de sa beauté et de sa prospérité ; mais ce portrait ne disait rien de l’histoire de son original, et Aurora n’avait jamais entendu parler ni du Capitaine de navire marchand, ni du pauvre logement de Liverpool, ni de la tante à la mine renfrognée qui tenait une boutique d’épicerie, ni des fleurs artificielles, ni du théâtre de province. On ne lui avait jamais dit que le nom de son grand-père maternel était Prodder, et que sa mère avait joué le rôle de Juliette devant un auditoire composé d’ouvriers, pour le modique salaire, incertain quelquefois, de quatre shillings et deux pence par représentation. Les familles du comté acceptèrent l’héritière du riche banquier, et en firent même grand cas ; mais elles ne furent pas longues à dire qu’Aurora était bien la fille de sa mère, que son caractère trahissait fortement l’actrice et l’écuyère, et qu’elle sentait passablement les paillettes et la sciure de bois. La vérité est que Mlle Floyd, ayant à peine quitté les langes, montra une disposition très-marquée à devenir ce qu’on appelle « une femme forte. » À l’âge de six ans elle dédaigna sa poupée et demanda un cheval de bois. À dix ans elle pouvait soutenir une conversation à propos de chiens d’arrêt, de chiens couchants, de chiens pour chasser le renard, de lévriers, etc. ; mais, par contre, elle poussait sa gouvernante au désespoir en oubliant obstinément sous quel empereur romain Jérusalem a été détruite, et quel était le légat du pape à l’époque du divorce de Catherine d’Aragon. À onze ans elle ne se gênait pas pour qualifier les chevaux des écuries des Lenfield de tas de rossinantes. À douze ans elle risqua sa demi-couronne à une poule organisée par les domestiques de son père, et soutint triomphalement le cheval qui remporta la victoire ; à treize ans enfin elle galopait à travers la campagne avec son oncle André, qui était membre de la société des chasses de Croydon. Ce n’était pas sans chagrin que le banquier voyait les progrès de sa fille dans ces talents d’un goût douteux ; mais elle était si belle, si franche, si intrépide, si généreuse, si affectueuse et si sincère, qu’il ne pouvait se décider à lui dire qu’elle n’était pas tout à fait ce qu’il pouvait désirer qu’elle fût. S’il eût pu gouverner ou diriger cette nature fougueuse, il aurait fait d’elle la personne la plus douce, la plus élégante, la plus parfaite et la plus accomplie de son sexe, mais il n’y pouvait réussir, et force lui était de remercier Dieu de la lui conserver telle, qu’elle était, et de satisfaire à tous ses caprices.
Lucy, la fille aînée d’Alexandre Floyd, cousine germaine d’Aurora, autrefois éloignée d’elle, était l’amie et la confidente de cette jeune fille, et venait de temps en temps de la maison de campagne de son père, située à Fulham, passer un mois à Felden. Mais Lucy avait une demi-douzaine de frères et de sœurs, et recevait une éducation bien différente de celle que recevait l’héritière. C’était une jeune fille de petite taille, au visage blond, aux yeux bleus, aux lèvres vermeilles, aux cheveux dorés, qui regardait Felden comme le paradis sur la terre, et Aurora comme plus fortunée que la princesse royale d’Angleterre, ou que Titania, la reine des fées. Elle avait une peur atroce des poneys de sa cousine et de ses chiens de Terre-Neuve, et elle avait la ferme conviction qu’il y avait de grands risques de mort subite à s’approcher d’un cheval ; mais elle aimait et admirait Aurora comme font habituellement les caractères faibles, et elle acceptait le patronage et la protection de Mlle Floyd comme une chose toute naturelle.
Enfin un nuage obscur, mais indéfini, vint assombrir l’intérieur de Felden. Il y eut de la froideur entre le banquier et son enfant bien-aimée. La jeune fille passait la moitié de son temps à cheval, parcourant les sentiers ombreux des alentours de Beckenham, accompagnée seulement de son groom, jeune et joli garçon, qu’à cause de sa bonne mine M. Floyd avait choisi pour le service particulier d’Aurora. Après ces longues courses solitaires, elle dînait dans sa chambre, laissant son père prendre son repas tout seul dans la grande salle à manger, qui paraissait remplie quand elle s’y asseyait, et vide et désolée quand elle n’y était pas.
Les gens de Felden se sont longtemps souvenus de certaine soirée du mois de juin, où la tempête éclata entre le père et la fille.
Aurora s’était absentée depuis deux heures de l’après-midi jusqu’au coucher du soleil, et le banquier arpentait la longue terrasse de pierre, sa montre à la main, le demi-jour lui permettant à peine de distinguer les chiffres sur le cadran ; il attendait que sa fille rentrât à la maison. Il avait renvoyé son dîner sans y avoir touché ; ses journaux étaient restés sur la table sans qu’il les eût coupés, et les espions intimes, nous voulons parler des serviteurs, se racontaient les uns aux autres que sa main avait tremblé si violemment, qu’il avait répandu la moitié d’une carafe de vin sur la table, en essayant d’emplir son verre. La femme de charge et ses satellites se glissaient dans le vestibule, et, au travers des portes vitrées, regardaient leur maître qui, dans son inquiétude, attendait sur la terrasse. Les palefreniers et les garçons d’écurie jasaient à propos du « tapage ; » c’est ainsi qu’ils appelaient la terrible rupture survenue entre le père et l’enfant ; et lorsqu’enfin on entendit les sabots des chevaux dans la longue avenue, et que Mlle Floyd arrêta son alezan pur sang au bas des marches de la terrasse, il y avait un groupe d’auditeurs curieux cachés aux environs, dans l’ombre du crépuscule, et brûlant d’entendre et de voir.
Mais ces yeux et ces oreilles avides furent très-peu satisfaits. Aurora sauta légèrement à terre avant que le groom eût eu le temps de descendre de cheval pour l’aider, et l’alezan, les flancs gonflés et couverts d’écume, fut conduit immédiatement à l’écurie.
Floyd observa le groom et les deux chevaux au moment où ils disparurent par les deux grandes portes qui menaient à la cour des écuries ; puis il dit très-tranquillement :
— Tu abuses de cet animal, Aurora. Une course de six heures ne fait de bien ni à lui ni à toi. Ton groom n’aurait pas dû le tolérer.
Il se dirigea vers son cabinet, après avoir dit à sa fille de le suivre ; et ils restèrent enfermés ensemble pendant plus d’une heure.
Le lendemain matin de bonne heure la gouvernante de Mlle Floyd quitta Felden, et entre le déjeuner et le luncheon le banquier alla visiter les écuries et examiner la jument favorite de sa fille, belle pouliche alezane, qui était tout muscles et tout os, et qui avait été élevée pour faire un cheval de course. L’animal s’était foulé un nerf et boitait en marchant. Floyd envoya chercher le groom de sa fille, lui paya ses gages, et le congédia sur-le-champ. Ce jeune homme ne fit aucune observation, mais il alla tranquillement à sa chambre, quitta sa livrée, fit son paquet dans un sac de nuit, et sortit de la maison sans dire adieu aux autres domestiques, qui se vengèrent de cet affront en déclarant que c’était une brute hargneuse dont l’absence n’était pas une perte pour le château.
Trois jours après celui-là, le 14 juin 1856, Floyd et sa fille partirent de Felden pour Paris, ou Aurora fut placée, pour y achever son éducation, qui était fort imparfaite, dans une pension très-dispendieuse et exclusivement protestante, tenue par les demoiselles Lespard, et dans un superbe hôtel, entre cour et jardins, situé rue Saint-Dominique-Saint-Germain.
Il y a un an et deux mois que Mlle Floyd est partie pour aller s’installer dans cette pension parisienne ; nous sommes dans les derniers jours du mois d’août 1857, et le banquier se promène de nouveau de long en large sur la terrasse en pierre, en face des fenêtres étroites de son château ; il attend l’arrivée d’Aurora qui revient de Paris. Les domestiques n’ont pas manqué d’exprimer leur étonnement de ce qu’il n’avait pas traversé la Manche pour aller chercher sa fille, et, à leurs yeux, c’est une atteinte à la dignité de la maison que Mlle Floyd voyage ainsi sans être accompagnée.
— Une pauvre jeune créature, qui, pas plus qu’un enfant au berceau, ne connaît rien de notre monde pervers, — dit la femme de charge, — toute seule au milieu d’un tas de Français à moustaches !…
Il avait suffi d’un jour pour que Floyd devînt un vieillard : ç’avait été le jour terrible et inattendu de la mort de sa femme ; mais le chagrin même que lui avait causé cette perte n’avait pas paru l’affecter aussi vivement que la privation de la société de sa fille pendant les quatorze mois qu’elle avait été absente de Felden.
Peut-être à l’âge de soixante-cinq ans était-il moins en état de supporter un chagrin même moins fort ; mais ceux qui l’observaient de près déclaraient qu’il semblait aussi abattu par l’absence de sa fille qu’il eût pu l’être par sa mort. Et en ce moment même, où il se promène de long en large sur la vaste terrasse, d’où il peut embrasser le ravissant paysage qui s’étend devant lui et se fond vaguement à l’horizon dans les flots de lumière empourprée que le soleil répand de toutes parts en se couchant ; en ce moment, où il espère à chaque heure, à chaque instant, serrer sa fille unique dans ses bras, Archibald a plutôt l’air d’être en proie à une inquiétude nerveuse que dans les joyeux transports d’une douce attente.
Il ne cesse de regarder à sa montre, et s’arrête pour écouter l’horloge de l’église de Beckenham, qui sonne huit heures ; ses oreilles, d’une sensibilité surnaturelle, ne laissent échapper aucun son, et perçoivent le bruit d’une voiture qui roule au loin sur la grande route. Toute l’agitation, toute l’anxiété qu’il ressent depuis une semaine, n’ont rien été en comparaison de la fièvre concentrée qu’il endure en ce moment. Cette voiture dépassera-t-elle la loge du concierge ou s’y arrêtera-t-elle ? Assurément son cœur n’aurait pu battre si fort, s’il n’eût été sous l’empire d’une merveilleuse prescience magnétique, d’un pressentiment d’espérance et d’amour paternel. La voiture s’arrête. Il entend le grincement de la grille qui s’ouvre ; le paysage empourpré s’obscurcit à ses yeux ; il ne voit, il ne connaît rien jusqu’au moment où deux bras empressés se jettent autour de son cou, et où le visage d’Aurora se cache sur son épaule.
Mlle Floyd était arrivée dans une piètre voiture de louage, qui repartit aussitôt qu’elle eut mis pied à terre et que les domestiques en eurent enlevé le peu de bagage qu’elle apportait avec elle. Le banquier emmena sa fille dans le cabinet où ils avaient eu une longue conférence quatorze mois auparavant. Une lampe brûlait sur la table de la bibliothèque ; Archibald conduisit sa fille sous les rayons de cette lumière.
Une année avait fait une femme de la jeune fille : une femme avec de grands yeux noirs creux, avec des joues pâles et défaites. Le régime suivi à la pension de Paris avait évidemment été trop rude pour l’enfant gâté.
— Aurora !… Aurora !… — s’écria le vieillard d’un ton où perçait la pitié, — comme tu as mauvaise mine !… comme tu es changée !… comme…
Elle lui mit la main légèrement, mais impérieusement, sur les lèvres.
— Ne parle pas de moi, dit-elle, je me remettrai ; mais toi… toi… mon cher père… tu es bien changé aussi !…
Elle était aussi grande que son père, et, les mains appuyées sur son épaule, elle le regarda longtemps et d’un air sérieux. Des larmes vinrent mouiller ses yeux, qui étaient restés secs jusque-là, et inondèrent silencieusement ses joues décolorées.
— Mon père,… mon bon père,… — dit-elle d’une voix tremblante, — je crois que mon cœur, fût-il de roc, se briserait en voyant l’altération de tes traits chéris…
Le vieillard l’interrompit d’un geste nerveux, d’un geste où il y avait presque de la terreur.
— Pas un mot… pas un mot, Aurora, — dit-il brusquement ; si… un mot,… un seul… Cet homme est-il mort ?
— Oui…
CHAPITRE IIICe qu’il advint d’un bracelet de diamants.
Les tantes, les oncles, les cousins et les cousines d’Aurora ne manquèrent pas de pousser des exclamations en observant le triste changement qu’un séjour d’un an à Paris avait opéré chez leur jeune parente. Je crains fort que l’altération de la bonne mine de Mlle Floyd n’ait porté une rude atteinte à la réputation des demoiselles Lespard auprès de la société qui environnait Felden. Aurora était abattue, elle n’avait pas d’appétit, elle dormait mal, elle avait les nerfs agacés, elle était irritable, elle ne prenait plus aucun intérêt à ses chiens ni à ses chevaux ; en un mot, c’était un être complètement changé. Mme Alexandre Floyd déclara qu’il était parfaitement clair que ces cruelles Françaises avaient réduit la pauvre Aurora à l’état d’ombre.
— La pauvre enfant n’avait pas l’habitude d’étudier, — dit-elle ; — elle était accoutumée à l’exercice, au grand air, et sans aucun doute elle a tristement dépéri dans l’atmosphère renfermée d’une salle d’étude.
Mais Aurora était une de ces natures impressionnables qui surmontent promptement toute mauvaise influence. Lucy Floyd vint à Felden dans les premiers jours du mois de septembre, et trouva sa belle cousine presque entièrement remise du régime fatigant de la pension parisienne, mais ayant toujours assez de répugnance à s’entretenir longuement de cette maison d’éducation. Elle répondait très-brièvement aux questions de Lucy ; elle disait qu’elle haïssait les demoiselles Lespard et la rue Saint-Dominique, et que le souvenir même de Paris lui était désagréable. Comme la plupart des jeunes femmes qui ont des yeux noirs et des cheveux noir de corbeau, Mlle Floyd savait couper court à un entretien ; aussi Lucy renonça-t-elle à lui demander de plus amples renseignements sur un sujet qui paraissait si évidemment déplaire à sa cousine. La pauvre Lucy avait été bien élevée, sans pitié ni merci ; elle parlait une demi-douzaine de langues, connaissait tout ce qui concerne les sciences naturelles, avait lu Gibbon, Niebuhr et Arnold, depuis la première jusqu’à la dernière page, et regardait l’héritière comme une grossière ignorante n’ayant que de l’éclat ; c’est pourquoi elle attribua tout tranquillement l’aversion d’Aurora pour Paris au peu de goût que la jeune fille avait pour l’instruction, et ne s’en inquiéta guère davantage. Toute autre raison qu’eût pu avoir Mlle Floyd pour frémir presque d’horreur lorsqu’on lui parlait de Paris dépassait la pénétration bornée de Lucy.
Le 15 septembre était le jour de naissance d’Aurora, et Archibald résolut, pour célébrer ce dix-neuvième anniversaire de la première apparition de sa fille sur la scène du monde, de donner une fête, où ses voisins de campagne et ses connaissances de la ville auraient également l’occasion de voir et d’admirer sa charmante héritière.
Mme Alexandre vint à Felden pour surveiller les préparatifs du bal. Elle emmena Aurora et Lucy pour commander le souper et la musique, et pour choisir des robes et des parures de fleurs. L’héritière du banquier était très-déplacée dans une boutique de modiste ; mais elle savait apprécier et choisir les couleurs et les formes avec cette rapidité de jugement et cette délicatesse de goût qui indiquent l’âme d’un artiste ; et tandis que la pauvre et débonnaire Lucy occasionnait un tracas infini et bouleversait une quantité innombrable de boîtes de fleurs, avant de pouvoir trouver une coiffure en harmonie avec ses joues vermeilles et ses cheveux blonds, Aurora, après avoir jeté un seul coup d’œil sur les brillants parterres de gaze peinte, se décida sans plus tarder pour une guirlande en forme de couronne, composée de graines écarlates et de feuilles emmêlées et retombantes d’un vert foncé et luisant, qu’on eût dites fraîchement cueillies sur le bord d’une eau courante. Elle observait l’embarras de Lucy avec un sourire moitié de pitié et moitié de mépris.
— Regardez cette pauvre enfant, — dit-elle ; — je savais bien qu’elle voudrait mettre du rose et du jaune sur ses cheveux blonds. Mais, niaise de Lucy, ne savez-vous pas que votre beauté est de celles qui n’ont vraiment pas besoin de parure ? Quelques perles ou quelques myosotis en fleur, ou une couronne de nymphéas blancs et un nuage de tarlatane blanche vous donneraient l’air d’une sylphide ; mais je parie que vous voudriez porter du satin de couleur d’ambre et des roses pompons.
De chez la modiste elles allèrent chez Gunter, dans Berkeley Square, et dans cet établissement renommé dans le monde entier, Mme Alexandre commanda des dindes conservées dans leur gelée, des jambons habilement glacés dans leur jus, des vins généreux et toute sorte d’autres chefs-d’œuvre de cet art sublime de la confiserie qui tient le milieu entre l’adresse et la cuisine et dans lequel le dieu de Berkeley Square est sans rival. Si jamais un habitant de la Nouvelle-Zélande vient méditer sur les ruines de Saint-Paul, peut-être visitera-t-il les débris de ce temple d’un rang plus humble, situé dans Berkeley Square, et sera-t-il frappé d’étonnement en voyant les sabotières, les moules à gelées, les ustensiles à réfrigération, les casseroles, les réchauds, négligés depuis longtemps, et tous les mystérieux accessoires d’un art abandonné.
Du West End, Mme