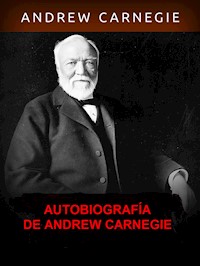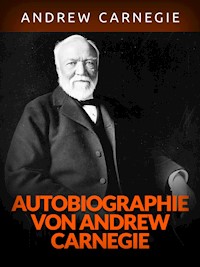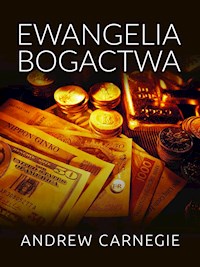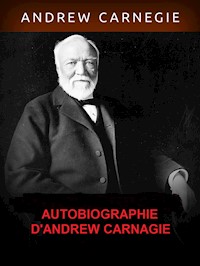
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Andrew Carnegie était un immigrant, un garçon pauvre qui travaillait dans une usine de coton, un homme qui a amassé une grande fortune en tant que baron de l'acier, puis est devenu l'un des philanthropes les plus généreux et les plus influents que le monde ait jamais connus. Son célèbre dicton, selon lequel celui qui meurt riche meurt déshonoré, a inspiré des philanthropes et des entreprises philanthropiques depuis des générations. De son vivant, il a mis ses idées en pratique en créant une famille d'organisations qui continuent d'œuvrer à l'amélioration de la condition humaine, à la promotion de la paix internationale, au renforcement de la démocratie et à la création d'un progrès sociétal qui profite aux hommes, aux femmes et aux enfants des États-Unis et du monde entier.Dans cet ouvrage, M. Carnegie raconte, avec ses propres mots, l'histoire dramatique de sa vie et de sa carrière, en soulignant les principes qui l'ont guidé et qui constituent aujourd'hui les piliers de la philanthropie moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Table des matières
CHAPITRE I - LES PARENTS ET L'ENFANCE
CHAPITRE II - DUNFERMLINE ET LES ÉTATS-UNIS
CHAPITRE III - PIT DU TRAVAIL ET DE PIT DU TRAVAIL
CHAPITRE IV - LE COLON COLON COLON COLON ET LES LIVRES
CHAPITRE V - LE BUREAU DU TÉLÉGRAPHE
CHAPITRE VI - SERVICE FERROVIAIRE
CHAPITRE VII - SURINTENDANT DE LA PENNSYLVANIE
CHAPITRE VIII - PÉRIODE DE LA GUERRE CIVILE
CHAPITRE IX - CONSTRUCTION DE PONTS
CHAPITRE X - L'ATELIER DU FER
CHAPITRE XI – NEW YORK COMME QUARTIER GÉNÉRAL
CHAPITRE XII - NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
CHAPITRE XIII - L'ÂGE DE L'ACIER
CHAPITRE XIV - PARTENAIRES, LIVRES ET VOYAGES
CHAPITRE XV - VOYAGE DE COACHING ET MARIAGE
CHAPITRE XVI - LES MOULINS ET LES HOMMES
CHAPITRE XVII - LA GRÈVE DE L'HOMESTEAD
CHAPITRE XVIII - PROBLÈMES DE TRAVAIL
CHAPITRE XIX - L'ÉVANGILE DE LA RICHESSE
CHAPITRE XX - FONDS D'ÉDUCATION ET DE PENSION
CHAPITRE XXI - LE PALAIS DE LA PAIX ET PITTENCRIEFF
CHAPITRE XXII - MATHEW ARNOLD ET AUTRES
CHAPITRE XXIII - LEADERS POLITIQUES BRITANNIQUES
CHAPITRE XXIV - GLADSTONE E MORLEY
CHAPITRE XXV - HERBERT SPENCER ET SON DISCIPLE
CHAPITRE XXVI - BLAINE E HARRISON
CHAPITRE XXVII - DIPLOMATIE DE WASHINGTON
CHAPITRE XXVIII - HAY ET McKINLEY
CHAPITRE XXIX - RENCONTRE AVEC L'EMPEREE
Autobiographie d'Andrew Carnegie
Andrew Carnegie
Traduction et édition 2021 par David De Angelis
Tous les droits sont réservés
CHAPITRE I - LES PARENTS ET L'ENFANCE
SI l'histoire de la vie d'un homme, vraiment racontée, doit être intéressante, comme le dit un sage, ceux de mes parents et amis immédiats qui ont insisté pour avoir un récit de la mienne ne seront pas déçus outre mesure par ce résultat. Je peux me consoler en me disant qu'une telle histoire doit intéresser au moins un certain nombre de personnes qui m'ont connu, et que cette connaissance m'encouragera à poursuivre.
Un livre de ce genre, écrit il y a des années par mon ami, le juge Mellon, de Pittsburgh, m'a donné tant de plaisir que je suis enclin à me ranger à l'avis du sage dont j'ai donné l'opinion ci-dessus ; car, certainement, l'histoire que le juge a racontée s'est avérée une source de satisfaction infinie pour ses amis, et doit continuer à influencer les générations successives de sa famille à bien vivre. Et ce n'est pas tout : pour certains, au-delà de son cercle immédiat, elle tient le rang de leurs auteurs préférés. Le livre contient une caractéristique essentielle de valeur - il révèle l'homme. Il a été écrit sans aucune intention d'attirer l'attention du public, étant destiné uniquement à sa famille. De la même manière, j'ai l'intention de raconter mon histoire, non pas comme quelqu'un qui se pavane devant le public, mais au milieu de mes proches et de mes amis, éprouvés et fidèles, à qui je peux parler avec la plus grande liberté, en sentant que même des incidents insignifiants ne sont pas totalement dépourvus d'intérêt pour eux.
Pour commencer, donc, je suis né à Dunfermline, dans le grenier d'une petite maison à un étage, à l'angle de Moodie Street et de Priory Lane, le 25 novembre 1835, et, comme on dit, "de parents pauvres mais honnêtes, de bonne famille". Dunfermline était depuis longtemps réputé comme le centre du commerce du damas en Écosse. Mon père, William Carnegie, était un tisseur de damas, le fils d'Andrew Carnegie dont je porte le nom.
Mon grand-père Carnegie était bien connu dans tout le district pour son esprit et son humour, sa nature géniale et son esprit irrépressible. Il était à la tête des jeunes gens animés de son époque et était connu de loin comme le chef de leur joyeux club.
- "Patiemuir College". À mon retour à Dunfermline, après une absence de quatorze ans, je me souviens avoir été abordé par un vieil homme à qui l'on avait dit que j'étais le petit-fils du "Professeur", titre que mon grand-père portait parmi ses copains. Il était l'image même de l'ancien paralysé ;
"Son nez et son menton, ils l'ont menacé aussi."
Alors qu'il traversait la pièce en titubant pour venir vers moi et poser sa main tremblante sur ma tête, il a dit : "Et vous êtes le petit-fils d'Andra Carnegie ! Eh, mon gars, j'ai vu le jour où ton grand-père et moi aurions pu faire sortir un homme raisonnable de ses gonds."
Plusieurs autres personnes âgées de Dunfermline m'ont raconté des histoires sur mon grand-père. Voici l'une d'entre elles :
Une nuit de Hogmanay, une vieille épouse, un personnage bien connu dans le village, surprise par un visage déguisé qui se présentait soudainement à la fenêtre, leva les yeux et après un moment de pause s'exclama : "Oh, c'est juste cet idiot d'Andra Carnegie". Elle avait raison ; mon grand-père, à soixante-quinze ans, était en train d'effrayer ses amies vieilles dames, déguisées comme d'autres jeunes qui s'amusent.
Je pense que ma nature optimiste, ma capacité à me débarrasser des problèmes et à rire de la vie, en faisant "de tous mes canards des cygnes", comme le disent mes amis, doit avoir été héritée de ce vieux et charmant grand-père masqué dont je suis fière de porter le nom. Un tempérament enjoué vaut plus que la fortune. Les jeunes doivent savoir qu'on peut la cultiver, que l'esprit, comme le corps, peut passer de l'ombre au soleil. Alors, faisons-le. Riez des problèmes si possible, et on y arrive généralement si l'on est un tant soit peu philosophe, à condition que le reproche ne vienne pas de sa propre faute. Cela reste toujours. Il est impossible de se débarrasser de ces "taches maudites". Le juge intérieur siège à la cour suprême et ne peut jamais être trompé. D'où la grande règle de vie que donne Burns :
"Tu ne crains que ton propre opprobre."
Cette devise adoptée tôt dans la vie m'a plus apporté que tous les sermons que j'ai entendus, et je n'en ai pas entendu beaucoup, même si je peux admettre une certaine ressemblance avec mon vieil ami Baillie Walker dans mes années de maturité. Interrogé par son médecin sur son sommeil, il répondit qu'il était loin d'être satisfaisant, qu'il était très éveillé, ajoutant avec un clin d'œil : "Mais j'ai le droit à un petit somme à la kirk de temps en temps."
Du côté de ma mère, le grand-père était encore plus marqué, car mon grand-père Thomas Morrison était un ami de William Cobbett, un collaborateur de son "Register", et entretenait une correspondance constante avec lui. Au moment où j'écris ces lignes, à Dunfermline, des hommes âgés qui ont connu le grand-père Morrison parlent de lui comme de l'un des meilleurs orateurs et des hommes les plus capables qu'ils aient connus. Il était l'éditeur de "The Precursor", une petite édition, pourrait-on dire, du "Register" de Cobbett, et on pense qu'il a été le premier journal radical d'Écosse. J'ai lu certains de ses écrits et, compte tenu de l'importance accordée aujourd'hui à l'enseignement technique, je pense que le plus remarquable d'entre eux est un pamphlet qu'il a publié il y a environ soixante-dix ans, intitulé "Head-ication versus Hand-ication". Il insiste sur l'importance de cette dernière d'une manière qui ferait honneur au plus ardent défenseur de l'enseignement technique d'aujourd'hui. Il se termine par ces mots : "Je remercie Dieu d'avoir appris dans ma jeunesse à fabriquer et à réparer des chaussures". Cobbett l'a publié dans le "Register" en 1833, en faisant la remarque suivante : "L'une des communications les plus précieuses jamais publiées dans le "Register" sur ce sujet est celle de notre estimé ami et correspondant en Écosse, Thomas Morrison, qui figure dans ce numéro". Il semble donc que mes propensions à la gribouille soient héritées des deux côtés, car les Carnegie étaient aussi des lecteurs et des penseurs.
Mon grand-père Morrison était un orateur né, un politicien passionné et le chef de l'aile avancée du parti radical dans le district - une position que son fils, mon oncle Bailie Morrison, a occupée en tant que son successeur. Plus d'un Écossais bien connu en Amérique est venu me voir pour serrer la main du "petit-fils de Thomas Morrison". M. Farmer, président de la Cleveland and Pittsburgh Railroad Company, m'a dit un jour : "Je dois tout ce que j'ai de savoir et de culture à l'influence de votre grand-père" ; et Ebenezer Henderson, auteur de la remarquable histoire de Dunfermline, a déclaré qu'il devait en grande partie son avancement dans la vie au fait qu'il était entré au service de mon grand-père lorsqu'il était enfant.
Je n'ai pas traversé la vie sans recevoir quelques compliments, mais je pense qu'aucun compliment ne m'a jamais fait autant plaisir que celui-ci, écrit par un journaliste de Glasgow, qui avait assisté à un discours sur le Home Rule en Amérique que j'avais prononcé à Saint Andrew's Hall. Le correspondant écrivait que l'on parlait alors beaucoup en Écosse de moi et de ma famille, et en particulier de mon grand-père Thomas Morrison, et il poursuivait en disant : "Jugez de ma surprise lorsque j'ai trouvé dans le petit-fils sur l'estrade, dans ses manières, ses gestes et son apparence, un parfait fac-similé du Thomas Morrison d'autrefois".
Ma surprenante ressemblance avec mon grand-père, que je ne me souviens pas d'avoir jamais vu, ne peut être mise en doute, car je me souviens bien, lors de mon premier retour à Dunfermline dans ma vingt-septième année, alors que j'étais assis sur un sofa avec mon oncle Bailie Morrison, que ses grands yeux noirs se remplirent de larmes. Il ne pouvait pas parler et s'est précipité hors de la pièce, bouleversé. Il revint un peu plus tard et expliqua que quelque chose en moi lui faisait penser de temps en temps à son père, qui disparaissait instantanément mais revenait par intervalles. Il s'agissait d'un geste, mais il n'a pas pu en déterminer la nature exacte. Ma mère remarquait continuellement en moi certaines des particularités de mon grand-père. La doctrine des tendances héréditaires est prouvée chaque jour et chaque heure, mais combien subtile est la loi qui transmet le geste, quelque chose comme au-delà du corps matériel. J'étais profondément impressionné.
Mon grand-père Morrison a épousé Miss Hodge, d'Edimbourg, une dame instruite, bien élevée et bien placée, qui est morte alors que la famille était encore jeune. À cette époque, il était en bonne situation, marchand de cuir et tanneur à Dunfermline ; mais la paix qui suivit la bataille de Waterloo l'entraîna dans la ruine, comme des milliers d'autres ; ainsi, alors que mon oncle Bailie, le fils aîné, avait été élevé dans ce qu'on pourrait appeler le luxe, car il avait un poney à monter, les plus jeunes membres de la famille connurent des jours plus difficiles.
La deuxième fille, Margaret, était ma mère, dont je ne peux me permettre de parler longuement. Elle a hérité de sa mère la dignité, le raffinement et l'air de la dame cultivée. Peut-être pourrai-je un jour parler au monde de cette héroïne, mais j'en doute. J'estime qu'elle est sacrée pour moi et qu'il n'appartient pas aux autres de la connaître. Personne ne pourra jamais la connaître vraiment - je suis le seul à l'avoir fait. Après la mort précoce de mon père, elle était toute à moi. La dédicace de mon premier livre raconte l'histoire. C'était : "A mon héroïne préférée, ma mère."
Fortuné dans mes ancêtres, je l'étais suprêmement dans mon lieu de naissance. Le lieu de naissance est très important, car différents environnements et traditions attirent et stimulent différentes tendances latentes chez l'enfant. Ruskin observe avec sincérité que chaque garçon brillant d'Edimbourg est influencé par la vue du château. Il en est de même pour l'enfant de Dunfermline, par sa noble abbaye, la Westminster d'Écosse, fondée au début du XIe siècle (1070) par Malcolm Canmore et sa reine Margaret, la sainte patronne de l'Écosse. Les ruines du grand monastère et du palais où sont nés les rois sont encore debout, et là aussi se trouve Pittencrieff Glen, qui englobe le sanctuaire de la reine Margaret et les ruines de la tour du roi Malcolm, par laquelle commence la vieille ballade de "Sir Patrick Spens" :
"Le roi est assis dans la tour de Dunfermline, buvant le vin rouge bluid."
Le tombeau de Bruce se trouve au centre de l'abbaye, celui de Sainte Margaret est tout proche, et de nombreux membres de la famille royale dorment tout autour. Heureux, en effet, l'enfant qui voit pour la première fois la lumière dans cette ville romantique, qui occupe un terrain élevé à trois miles au nord du Firth of Forth, surplombant la mer, avec Édimbourg en vue au sud, et au nord les sommets des Ochils clairement en vue. Tout rappelle encore le puissant passé où Dunfermline était la capitale de l'Écosse, tant sur le plan national que religieux.
L'enfant qui a le privilège de se développer dans un tel environnement absorbe la poésie et le romantisme avec l'air qu'il respire, assimile l'histoire et la tradition en regardant autour de lui. Ces lieux deviennent pour lui le monde réel de l'enfance - l'idéal est le réel omniprésent. Le réel est encore à venir lorsque, plus tard dans sa vie, il est lancé dans le monde quotidien de la dure réalité. Même à ce moment-là, et jusqu'à son dernier jour, les premières impressions demeurent, parfois pour de brèves périodes, disparaissant parfois, mais seulement apparemment chassées ou supprimées. Elles se lèvent et reviennent sans cesse sur le devant de la scène pour exercer leur influence, élever sa pensée et colorer sa vie. Aucun enfant brillant de Dunfermline ne peut échapper à l'influence de l'abbaye, du palais et du Glen. Ceux-ci le touchent et enflamment l'étincelle latente en lui, faisant de lui quelque chose de différent et au-delà de ce que, moins heureusement né, il serait devenu. C'est dans ces conditions inspirantes que mes parents étaient également nés, d'où, je n'en doute pas, la puissance de l'esprit romantique et poétique qui les imprégnait tous deux.
Lorsque mon père a réussi dans le domaine du tissage, nous avons quitté Moodie Street pour une maison beaucoup plus spacieuse dans Reid's Park. Les quatre ou cinq métiers à tisser de mon père occupaient l'étage inférieur ; nous résidions dans l'étage supérieur, auquel on accédait, selon un mode courant dans les vieilles maisons écossaises, par un escalier extérieur partant du trottoir. C'est ici que commencent mes souvenirs les plus anciens et, curieusement, la première trace de ma mémoire me ramène au jour où j'ai vu une petite carte de l'Amérique. Elle était sur des rouleaux et faisait environ 60 cm de côté. Sur celle-ci, mon père, ma mère, mon oncle William et ma tante Aitken cherchaient Pittsburgh et indiquaient le lac Érié et le Niagara. Peu après, mon oncle et ma tante Aitken se sont embarqués pour la terre promise.
À cette époque, je me souviens que mon cousin-frère, George Lauder ("Dod"), et moi-même étions profondément impressionnés par le grand danger qui nous menaçait, car un drapeau anarchique était caché dans la mansarde. Il avait été peint pour être porté, et je crois qu'il a été porté par mon père, ou mon oncle, ou un autre bon radical de notre famille, dans une procession pendant l'agitation de la Corn Law. Il y avait eu des émeutes dans la ville et une troupe de cavalerie était cantonnée dans le Guildhall. Mes grands-pères et mes oncles des deux côtés, et mon père, avaient été les premiers à prendre la parole lors des réunions, et tout le cercle familial était en effervescence.
Je me souviens comme si c'était hier d'avoir été réveillé pendant la nuit par un coup frappé à la fenêtre de derrière par des hommes qui étaient venus informer mes parents que mon oncle, Bailie Morrison, avait été jeté en prison parce qu'il avait osé tenir une réunion qui avait été interdite. Le shérif, avec l'aide des soldats, l'avait arrêté à quelques kilomètres de la ville où la réunion avait eu lieu et l'avait amené dans la ville pendant la nuit, suivi par une immense foule de gens.
On craignait de sérieux ennuis, car la populace menaçait de le secourir, et, comme nous l'avons appris par la suite, le prévôt de la ville l'avait incité à s'avancer vers une fenêtre donnant sur la High Street et à prier les gens de se retirer. Ce qu'il fit, en disant : "S'il y a un ami de la bonne cause ici ce soir, qu'il croise les bras". C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, après une pause, il a dit : "Maintenant, partez en paix !" Mon oncle, comme toute notre famille, était un homme de morale et fort pour l'obéissance à la loi, mais radical jusqu'au bout et un admirateur intense de la République américaine.
On peut imaginer, alors que tout cela se passait en public, combien étaient amères les paroles qui passaient de l'un à l'autre en privé. Les dénonciations du gouvernement monarchique et aristocratique, du privilège sous toutes ses formes, la grandeur du système républicain, la supériorité de l'Amérique, une terre peuplée par notre propre race, une maison pour les libres dans laquelle le privilège de chaque citoyen était le droit de chaque homme - tels étaient les thèmes passionnants sur lesquels j'ai été élevé. Enfant, j'aurais pu tuer un roi, un duc ou un seigneur, et considérer leur mort comme un service rendu à l'État et donc un acte héroïque.
L'influence des premières associations de l'enfance est telle qu'il a fallu longtemps avant que je puisse me faire confiance pour parler respectueusement d'une classe ou d'une personne privilégiée qui ne s'était pas distinguée d'une manière ou d'une autre et qui n'avait donc pas gagné le droit au respect public. Il y avait toujours le ricanement derrière le simple pedigree - "il n'est rien, il n'a rien fait, ce n'est qu'un accident, une fraude qui se pavane dans des plumes empruntées ; tout ce qu'il a à son compte, c'est le hasard de la naissance ; la partie la plus fructueuse de sa famille, comme pour la pomme de terre, se trouve sous terre". Je me demandais comment des hommes intelligents pouvaient vivre là où un autre être humain était né avec un privilège qui n'était pas aussi son droit de naissance. Je ne me lassais pas de citer les seuls mots qui donnaient une juste mesure à mon indignation :
"Il y avait autrefois un Brutus qui aurait supporté le diable éternel pour garder son état à Rome".
Aussi facilement qu'un roi."
Mais les rois étaient des rois, pas de simples ombres. Tout cela était hérité, bien sûr. Je ne faisais que répéter ce que j'entendais à la maison.
Dunfermline a longtemps été réputée comme étant peut-être la ville la plus radicale du Royaume, même si je sais que Paisley a des prétentions. Cela est d'autant plus honorable pour la cause du radicalisme qu'à l'époque dont je parle, la population de Dunfermline était en grande partie composée d'hommes qui étaient de petits fabricants, chacun possédant son ou ses propres métiers à tisser. Ils n'avaient pas d'horaires réguliers, leur travail se faisait à la pièce. Ils se procuraient les toiles auprès des grands fabricants et le tissage se faisait à la maison.
C'était une époque d'intense excitation politique, et on voyait fréquemment dans toute la ville, peu après le repas de midi, de petits groupes d'hommes portant leur tablier et discutant d'affaires d'État. Les noms de Hume, Cobden et Bright étaient sur toutes les lèvres. J'étais souvent attiré, petit comme je l'étais, par ces cercles et j'écoutais attentivement la conversation, qui était totalement unilatérale. La conclusion généralement acceptée était qu'il devait y avoir un changement. Des clubs ont été formés parmi les habitants de la ville et les journaux de Londres ont été souscrits. Les principaux éditoriaux étaient lus chaque soir aux gens, étrangement, depuis l'une des chaires de la ville. Mon oncle, Bailie Morrison, était souvent le lecteur et, comme les articles étaient commentés par lui et par d'autres après avoir été lus, les réunions étaient assez passionnantes.
Ces réunions politiques étaient fréquentes et, comme on pouvait s'y attendre, j'étais aussi profondément intéressé que n'importe quel membre de la famille et j'ai assisté à de nombreuses réunions. L'un de mes oncles ou mon père était généralement entendu. Je me souviens qu'un soir, mon père a pris la parole lors d'une grande réunion en plein air dans les Pends. Je m'étais glissé sous les jambes des auditeurs, et à un applaudissement plus fort que tous les autres, je n'ai pu retenir mon enthousiasme. Levant les yeux vers l'homme sous les jambes duquel j'avais trouvé refuge, je lui dis que c'était mon père qui parlait. Il me souleva sur son épaule et m'y maintint.
Lors d'une autre réunion, mon père m'a emmené écouter John Bright, qui a parlé en faveur de J.B. Smith comme candidat libéral pour les Burghs de Stirling. J'ai fait la critique à la maison que M. Bright ne parlait pas correctement, car il disait "men" alors qu'il voulait dire "maan". Il ne donnait pas le large a auquel nous étions habitués en Écosse. Il n'est pas étonnant que, élevé dans un tel environnement, je sois devenu un jeune républicain violent dont la devise était "mort aux privilèges". A cette époque, je ne savais pas ce que signifiait le mot "privilège", mais mon père le savait.
L'une des meilleures histoires de mon oncle Lauder concernait ce même J.B. Smith, l'ami de John Bright, qui se présentait au Parlement à Dunfermline. L'oncle était membre de son comité et tout allait bien jusqu'à ce qu'il soit proclamé que Smith était un "Unitawrian". Le district a été placardé avec l'enquête : Voudriez-vous voter pour un "Unitawrian" ? C'était sérieux. Le président du comité de Smith dans le village de Cairney Hill, un forgeron, a déclaré qu'il ne voterait jamais. L'oncle s'est rendu sur place pour lui faire des remontrances. Ils se sont rencontrés à la taverne du village autour d'un verre :
"Mec, je ne peux pas voter pour un Unitawrian", a dit le président.
"Mais," dit mon oncle, "Maitland [le candidat adverse] est un Trinitawrian." "Bon sang ; c'est waur", fut la réponse.
Et le forgeron a voté à droite. Smith a gagné par une petite majorité.
Le passage du métier à tisser manuel au métier à tisser à vapeur a été désastreux pour notre famille. Mon père ne se rendait pas compte de la révolution imminente et se débattait dans l'ancien système. Ses métiers à tisser perdirent beaucoup de leur valeur, et il fallut que cette force qui n'a jamais failli dans les situations d'urgence - ma mère - se manifeste et s'efforce de réparer la fortune familiale. Elle ouvrit une petite boutique dans Moodie Street et contribua aux revenus qui, bien que minces, suffisaient néanmoins à l'époque à nous maintenir dans le confort et la "respectabilité".
Je me souviens que peu après, j'ai commencé à apprendre ce que signifiait la pauvreté. Des jours terribles arrivaient lorsque mon père apportait la dernière de ses toiles au grand fabricant, et je voyais ma mère attendre anxieusement son retour pour savoir si une nouvelle toile allait être obtenue ou si une période d'oisiveté nous attendait. Je me suis alors mis à penser que mon père, bien que n'étant ni "abject, ni méchant, ni vil", comme le dit Burns, avait néanmoins dû faire face à des difficultés.
"Supplie un frère de la terre de lui donner la permission de travailler."
Et c'est là que j'ai décidé de remédier à cela quand je serais un homme. Nous n'étions cependant pas réduits à la pauvreté par rapport à beaucoup de nos voisins. Je ne sais pas jusqu'à quelles privations ma mère n'aurait pas été prête à aller pour voir ses deux garçons porter de grands cols blancs et être habillés avec soin.
Dans un moment d'imprudence, mes parents avaient promis que je ne serais jamais envoyé à l'école avant d'avoir demandé la permission d'y aller. J'ai appris par la suite que cette promesse leur causait beaucoup de soucis, car en grandissant, je ne montrais aucune disposition à le demander. On demanda au maître d'école, M. Robert Martin, de s'intéresser à moi et on l'incita à le faire. Un jour, il m'a emmené en excursion avec quelques-uns de mes camarades qui fréquentaient l'école, et mes parents ont éprouvé un grand soulagement lorsqu'un jour peu après, je suis venu demander la permission d'aller à l'école de M. Martin. Je n'ai pas besoin de dire que la permission a été dûment accordée. J'étais alors entré dans ma huitième année, ce qui, d'après mon expérience, est assez tôt pour qu'un enfant commence à aller à l'école.
L'école était un vrai plaisir pour moi, et si quelque chose m'empêchait d'y aller, j'étais malheureux. Cela arrivait de temps en temps, car ma tâche matinale était d'aller chercher de l'eau au puits situé au bout de Moodie Street. L'approvisionnement était insuffisant et irrégulier. Parfois, il n'était pas autorisé à fonctionner avant la fin de la matinée et une vingtaine de vieilles femmes étaient assises autour, le tour de chacune ayant été assuré pendant la nuit en plaçant un bidon sans valeur dans la file. Comme on pouvait s'y attendre, cela a donné lieu à de nombreuses disputes au cours desquelles je ne me laissais pas abattre, même par ces vieilles dames vénérables. J'ai gagné la réputation d'être "un petit gars génial". C'est probablement de cette manière que j'ai développé cette tendance à l'argumentation, ou peut-être à la combativité, qui m'est toujours restée.
Dans l'exercice de ces fonctions, j'étais souvent en retard à l'école, mais le maître, connaissant la cause, pardonnait ces écarts. Dans le même ordre d'idées, je peux mentionner que j'avais souvent des courses à faire au magasin après l'école, de sorte qu'en jetant un regard sur ma vie, j'ai la satisfaction de sentir que j'ai été utile à mes parents, même à l'âge de dix ans. Peu de temps après, les comptes des différentes personnes qui s'occupaient du magasin m'ont été confiés, de sorte que j'ai été familiarisé, dans une certaine mesure, avec les affaires commerciales dès mon enfance.
Il y avait cependant une cause de misère dans mon expérience scolaire. Les garçons me surnommaient " le chouchou de Martin ", et me criaient parfois cette épithète redoutable lorsque je passais dans la rue. Je ne savais pas tout ce que cela signifiait, mais cela me semblait être un terme de la plus grande opprobre, et je sais que cela m'a empêché de répondre aussi librement que je l'aurais fait à cet excellent professeur, mon seul maître d'école, envers qui j'ai une dette de gratitude que je regrette de n'avoir jamais eu l'occasion de faire plus que reconnaître avant sa mort.
Je peux mentionner ici un homme dont l'influence sur moi ne peut être surestimée, mon oncle Lauder, le père de George Lauder. Mon père devait constamment travailler dans l'atelier de tissage et n'avait guère de loisirs à me consacrer pendant la journée. Mon oncle, qui était commerçant dans la High Street, n'avait pas cette contrainte. Notez le lieu, car il s'agissait de l'aristocratie des commerçants, et il y avait des degrés élevés et variés d'aristocratie même parmi les commerçants de Dunfermline. Profondément affecté par la mort de ma tante Seaton, survenue au début de ma scolarité, il a trouvé son principal réconfort dans la compagnie de son fils unique, George, et de moi-même. Il possédait un don extraordinaire pour s'occuper des enfants et nous a appris beaucoup de choses. Je me souviens notamment de la façon dont il nous enseignait l'histoire britannique en imaginant chacun des monarques à une certaine place sur les murs de la pièce en train d'accomplir l'acte pour lequel il était connu. Ainsi, pour moi, le roi Jean est assis à ce jour au-dessus de la cheminée, signant la Magna Charta, et la reine Victoria est au dos de la porte avec ses enfants sur les genoux.
On peut considérer comme acquis que l'omission que, des années plus tard, j'ai trouvée dans la salle capitulaire de l'abbaye de Westminster a été entièrement comblée dans notre liste de monarques. Une dalle dans une petite chapelle de Westminster dit que le corps d'Oliver Cromwell a été enlevé de là. Dans la liste des monarques que j'ai apprise sur les genoux de mon oncle, le grand monarque républicain apparaît en écrivant son message au pape de Rome, informant Sa Sainteté que "s'il ne cessait pas de persécuter les protestants, le tonnerre des canons de la Grande-Bretagne se ferait entendre au Vatican." Il est inutile de dire que l'estimation que nous avons faite de Cromwell était qu'il les valait "a' thegither".
C'est de mon oncle que j'ai appris tout ce que je sais sur l'histoire de l'Écosse.
de Wallace, Bruce et Burns, de l'histoire de Blind Harry, de Scott, Ramsey, Tannahill, Hogg et Fergusson. Je peux vraiment dire, avec les mots de Burns, qu'il y avait alors et qu'il s'est créé en moi une veine de préjugés (ou de patriotisme) écossais qui ne cessera d'exister qu'avec la vie. Wallace, bien sûr, était notre héros. Tout ce qui était héroïque était centré sur lui. Triste fut le jour où un méchant grand garçon de l'école me dit que l'Angleterre était bien plus grande que l'Ecosse. Je suis allé voir l'oncle, qui avait le remède.
"Pas du tout, Naig ; si l'Écosse était roulée à plat comme l'Angleterre, l'Écosse serait la plus grande, mais auriez-vous les Highlands roulés à plat ?".
Oh, jamais ! Il y avait du baume en Galilée pour le jeune patriote blessé. Plus tard, la plus grande population d'Angleterre m'a été imposée, et je suis retourné chez mon oncle.
"Oui, Naig, sept contre un, mais il y avait plus que cette cote contre nous à Bannockburn." Et de nouveau, la joie m'envahit - la joie qu'il y ait eu plus d'Anglais là-bas, car la gloire était plus grande.
C'est une sorte de commentaire sur la vérité selon laquelle la guerre engendre la guerre, que chaque bataille sème les graines de futures batailles, et que les nations deviennent ainsi des ennemis traditionnels. L'expérience des garçons américains est celle des Écossais. Ils grandissent en lisant les histoires de Washington et de Valley Forge, de Hessois engagés pour tuer des Américains, et ils en viennent à détester le nom même d'Anglais. C'est ce que j'ai vécu avec mes neveux américains. L'Ecosse était bien, mais l'Angleterre qui avait combattu l'Ecosse était le mauvais partenaire. Ce n'est que lorsqu'ils sont devenus des hommes que les préjugés ont été éradiqués, et même aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent subsister.
L'oncle Lauder m'a raconté depuis qu'il faisait souvent entrer des gens dans la pièce en leur assurant qu'il pouvait faire pleurer "Dod" (George Lauder) et moi, rire, ou fermer nos petits poings prêts à se battre - bref, jouer sur toutes nos humeurs par l'influence de la poésie et de la chanson. La trahison de Wallace était sa carte maîtresse qui ne manquait jamais de faire sangloter nos petits cœurs, une dépression complète étant le résultat invariable. Il avait beau raconter cette histoire, elle ne perdait jamais de sa force. Sans doute recevait-il de temps en temps de nouveaux embellissements. Les histoires de mon oncle n'ont jamais voulu "le chapeau et le bâton" que Scott leur a donnés. Quelle merveilleuse influence peut avoir un héros sur les enfants !
J'ai passé de nombreuses heures et soirées dans la High Street avec mon oncle et "Dod", et c'est ainsi qu'a commencé une alliance fraternelle de toute une vie entre ce dernier et moi. "Dod" et "Naig", nous avons toujours été dans la famille. Je n'ai pas pu dire "George" dans mon enfance et il n'a pas pu obtenir plus que "Naig" de Carnegie, et il y a toujours eu "Dod" et "Naig" chez nous. Aucun autre nom n'aurait de sens.
Il y avait deux routes pour retourner de la maison de mon oncle dans la High Street à ma maison dans Moodie Street au pied de la ville, l'une longeant le sinistre cimetière de l'Abbaye des morts, où il n'y avait pas de lumière, et l'autre longeant les rues éclairées en passant par la Porte de Mai. Quand il me fallait rentrer chez moi, mon oncle, avec un malin plaisir, me demandait de quel côté j'allais. En pensant à ce que ferait Wallace, je répondais toujours que je passais par l'Abbaye. J'ai la satisfaction de croire que jamais, pas même en une seule occasion, je n'ai cédé à la tentation de prendre l'autre tournant et de suivre les lampes au croisement de la porte de Mai. J'ai souvent traversé ce cimetière et l'arc sombre de l'abbaye le cœur serré. Essayant de siffler et de garder mon courage, j'avançais péniblement dans l'obscurité, me remettant dans toutes les situations d'urgence à la pensée de ce que Wallace aurait fait s'il avait rencontré un ennemi, naturel ou surnaturel.
Le roi Robert the Bruce n'a jamais été jugé par mon cousin ou moi-même dans notre enfance. Il nous suffisait qu'il soit un roi alors que Wallace était l'homme du peuple. Sir John Graham était notre second. L'intensité du patriotisme d'un garçon écossais, élevé comme je l'ai été, constitue une véritable force dans sa vie jusqu'à la fin. Si l'on étudiait la source de mon stock de cet article primordial - le courage - je suis sûr que l'analyse finale montrerait qu'il est fondé sur Wallace, le héros de l'Écosse. C'est une tour de force pour un garçon d'avoir un héros.
Cela m'a fait de la peine de découvrir, lorsque j'ai atteint l'Amérique, qu'il y avait un autre pays qui prétendait avoir quelque chose dont on pouvait être fier. Qu'était un pays sans Wallace, Bruce et Burns ? Je retrouve chez l'Écossais d'aujourd'hui, qui n'a jamais voyagé, quelque chose de ce sentiment. Il reste à des années plus mûres et à des connaissances plus étendues à nous dire que chaque nation a ses héros, ses romans, ses traditions et ses réalisations ; et tandis que le véritable Écossais ne trouvera pas de raison, dans les années à venir, de revoir à la baisse l'estimation qu'il a faite de son propre pays et de sa position même parmi les plus grandes nations de la terre, il trouvera amplement de quoi élever son opinion des autres nations parce qu'elles ont toutes beaucoup de raisons d'être fières - assez pour inciter leurs fils à agir de manière à ne pas déshonorer le pays qui leur a donné naissance.
Il a fallu des années avant que je puisse sentir que cette nouvelle terre pouvait être autre chose qu'une résidence temporaire. Mon cœur était en Écosse. Je ressemblais au petit garçon du principal Peterson qui, lorsqu'il était au Canada, en réponse à une question, disait qu'il aimait le Canada "très bien pour une visite, mais qu'il ne pourrait jamais vivre si loin des restes de Bruce et de Wallace".
CHAPITRE II - DUNFERMLINE ET LES ÉTATS-UNIS
Mon bon oncle Lauder accordait à juste titre une grande valeur à la récitation dans l'éducation, et nombreux étaient les centimes que Dod et moi recevions pour cela. Dans nos petites redingotes ou chemises, les manches retroussées, les casques de papier et les visages noircis, avec des lattes en guise d'épées, mon cousin et moi étions constamment en train de réciter Norval et Glenalvon, Roderick Dhu et James Fitz-James à nos camarades de classe et souvent aux personnes plus âgées.
Je me souviens très bien que, dans le célèbre dialogue entre Norval et Glenalvon, nous avions quelques scrupules à répéter la phrase : "et faux comme l'enfer". Au début, nous avons fait une légère toux sur le mot répréhensible, ce qui a toujours créé de l'amusement parmi les spectateurs. Ce fut un grand jour pour nous lorsque mon oncle nous persuada que nous pouvions dire "enfer" sans jurer. Je crains que nous l'ayons pratiqué très souvent. Je jouais toujours le rôle de Glenalvon et je faisais une grande bouchée du mot. Il avait pour moi la merveilleuse fascination attribuée au fruit défendu. Je comprends bien l'histoire de Marjory Fleming, qui, croisée un matin lorsque Walter Scott l'appela pour lui demander comment elle allait, répondit :
"Je suis très fâché ce matin, M. Scott. J'ai envie de dire 'zut', mais je ne peux pas."
Par la suite, l'expression de ce mot effrayant était un point important. Les ministres pouvaient dire "damnation" en chaire sans pécher, et nous aussi, nous avions toute latitude pour réciter "enfer". Un autre passage a fait une profonde impression. Dans le combat entre Norval et Glenalvon, Norval dit : "Quand nous nous disputons à nouveau, notre combat est mortel." En utilisant ces mots dans un article écrit pour la "North American Review" en 1897, mon oncle est tombé dessus et s'est immédiatement assis et m'a écrit de Dunfermline qu'il savait où j'avais trouvé ces mots. Il était le seul homme vivant à le savoir.
Mon pouvoir de mémorisation a dû être considérablement renforcé par le mode d'enseignement adopté par mon oncle. Je ne peux pas nommer un moyen plus important pour aider les jeunes gens que de les encourager à mémoriser leurs morceaux préférés et à les réciter souvent. Tout ce qui me plaisait, je pouvais l'apprendre avec une rapidité qui surprenait les amis partiels. Je pouvais mémoriser n'importe quoi, que cela me plaise ou non, mais si cela ne m'impressionnait pas fortement, cela passait en quelques heures.
L'une des épreuves de ma vie de garçon à l'école de Dunfermline était de mémoriser deux doubles versets des Psaumes que je devais réciter quotidiennement. J'avais l'intention de ne pas regarder le psaume avant de partir pour l'école. Ce n'était pas plus de cinq ou six minutes de marche lente, mais je pouvais facilement maîtriser la tâche dans ce laps de temps, et, comme le psaume était la première leçon, j'étais préparé et je passais l'épreuve avec succès. Si on m'avait demandé de répéter le psaume trente minutes plus tard, la tentative se serait soldée, je le crains, par un échec désastreux.
Le premier penny que j'ai gagné ou reçu d'une personne en dehors du cercle familial fut celui de mon instituteur, M. Martin, pour avoir répété devant l'école le poème de Burns, "Man was made to Mourn". En écrivant ceci, je me souviens que plus tard, lors d'un dîner avec M. John Morley à Londres, la conversation a porté sur la vie de Wordsworth, et M. Morley a dit qu'il avait cherché dans son Burns le poème sur la "vieillesse", tant vanté par ce dernier, qu'il n'avait pas pu trouver sous ce titre. J'ai eu le plaisir de lui en répéter une partie. Il s'est empressé de me remettre un second penny. Ah, aussi grand que soit Morley, il n'était pas mon maître d'école, M. Martin - le premier "grand" homme que j'ai connu. Il était vraiment grand pour moi. Mais un héros, c'est sûrement "l'honnête John" Morley.
En matière de religion, nous n'étions pas trop gênés. Alors que les autres garçons et filles de l'école étaient obligés d'apprendre le catéchisme court, Dod et moi, par un arrangement dont je n'ai jamais bien compris les détails, étions absous. Tous les membres de notre famille, Morrison et Lauders, étaient avancés dans leurs opinions théologiques comme dans leurs opinions politiques, et avaient des objections au catéchisme, je n'en doute pas. Nous n'avions pas un seul presbytérien orthodoxe dans notre cercle familial. Mon père, mon oncle et ma tante Aitken, mon oncle Lauder, et aussi mon oncle Carnegie, s'étaient éloignés des principes du calvinisme. Plus tard, la plupart d'entre eux ont trouvé refuge pour un temps dans les doctrines de Swedenborg. Ma mère a toujours été réticente aux sujets religieux. Elle ne m'en a jamais parlé et n'allait pas à l'église, car elle n'avait pas de domestique à cette époque et faisait tous les travaux ménagers, y compris la préparation de notre dîner du dimanche. Grande lectrice, toujours, Channing l'unitarien était à l'époque sa joie particulière. Elle était une merveille !
Pendant mon enfance, l'atmosphère qui m'entourait était dans un état de violente perturbation dans les questions théologiques aussi bien que politiques. Parallèlement aux idées les plus avancées qui étaient agitées dans le monde politique - la mort du privilège, l'égalité du citoyen, le républicanisme - j'entendais de nombreuses disputes sur des sujets théologiques dont l'enfant impressionnable s'imprégnait dans une mesure tout à fait impensable pour ses aînés. Je me souviens bien que les doctrines sévères du calvinisme étaient pour moi un terrible cauchemar, mais cet état d'esprit s'est vite dissipé, grâce aux influences dont j'ai parlé. J'ai grandi en gardant précieusement en moi le fait que mon père s'était levé et avait quitté l'Église presbytérienne un jour où le ministre prêchait la doctrine de la damnation des enfants. C'était peu de temps après que j'aie fait mon apparition.
Père n'a pas pu le supporter et a dit : "Si telle est votre religion et tel est votre Dieu, je cherche une meilleure religion et un Dieu plus noble." Il quitta l'Église presbytérienne pour ne plus jamais y revenir, mais il ne cessa de fréquenter diverses autres églises. Je l'ai vu entrer dans le placard chaque matin pour prier et cela m'a impressionné. C'était vraiment un saint et il est toujours resté pieux. Toutes les sectes devenaient pour lui des agences du bien. Il avait découvert que les théologies étaient nombreuses, mais que la religion était une. J'étais tout à fait convaincu que mon père savait mieux que le pasteur, qui ne représentait pas le Père céleste, mais le cruel vengeur de l'Ancien Testament - un "Tortionnaire éternel" comme Andrew D. White se risque à l'appeler dans son autobiographie. Heureusement, cette conception de l'Inconnu appartient maintenant en grande partie au passé.
L'un des principaux plaisirs de mon enfance a été l'élevage de pigeons et de lapins. Je suis reconnaissant chaque fois que je pense à la peine que mon père a prise pour construire une maison convenable pour ces animaux de compagnie. Notre maison devenait le quartier général de mes jeunes compagnons. Ma mère voyait toujours dans les influences domestiques le meilleur moyen de garder ses deux garçons dans le droit chemin. Elle avait l'habitude de dire que le premier pas dans cette direction était de rendre la maison agréable ; et il n'y avait rien qu'elle et mon père ne fassent pas pour nous faire plaisir, ainsi qu'aux enfants des voisins qui nous entouraient.
Ma première entreprise commerciale a été de m'assurer les services de mes compagnons pour une saison en tant qu'employeur, la compensation étant que les jeunes lapins, lorsqu'ils arriveraient, devraient porter leur nom. Le samedi férié était généralement consacré par mon troupeau à la collecte de nourriture pour les lapins. Ma conscience me reproche aujourd'hui, en regardant en arrière, quand je pense au marché difficile que j'ai conclu avec mes jeunes camarades de jeu, dont beaucoup étaient heureux de cueillir avec moi des pissenlits et du trèfle pendant toute une saison, à condition d'obtenir cette unique récompense - le plus mauvais rendement jamais obtenu par le travail. Hélas ! qu'avais-je d'autre à leur offrir ? Pas un centime.
Je garde précieusement le souvenir de ce plan comme la première preuve du pouvoir d'organisation sur le développement duquel repose mon succès matériel dans la vie - un succès qui ne doit pas être attribué à ce que j'ai su ou fait moi-même, mais à la faculté de connaître et de choisir d'autres personnes qui savaient mieux que moi.
C'est une connaissance précieuse à posséder pour tout homme. Je ne comprenais pas les machines à vapeur, mais j'essayais de comprendre cette pièce de mécanisme beaucoup plus compliquée qu'est l'homme. Lors d'une halte dans une petite auberge des Highlands au cours de notre voyage en 1898, un gentleman s'avança et se présenta. Il s'agissait de M. MacIntosh, le grand fabricant de meubles d'Écosse - un excellent personnage, comme je l'ai découvert par la suite. Il a dit qu'il s'était aventuré à se faire connaître parce qu'il était l'un des garçons qui avaient ramassé, et parfois il craignait de "convoyer", du gibier pour les lapins, et qu'il en avait "un qui portait son nom". Vous pouvez imaginer à quel point j'étais heureux de le rencontrer - le seul des garçons lapins que j'ai rencontré dans la vie après la mort. J'espère garder son amitié jusqu'à la fin et le voir souvent. Alors que je lis ce manuscrit aujourd'hui, le 1er décembre 1913, j'ai reçu une note très précieuse de sa part, rappelant les vieux temps où nous étions garçons ensemble. Il a une réponse à cette heure qui lui réchauffera le cœur comme sa note a réchauffé le mien].
Avec l'introduction et l'amélioration des machines à vapeur, le commerce s'est détérioré de plus en plus à Dunfermline pour les petits fabricants, et finalement une lettre a été écrite aux deux sœurs de ma mère à Pittsburgh déclarant que l'idée que nous allions chez elles était sérieusement envisagée - non pas, comme je me souviens avoir entendu mes parents le dire, pour améliorer leur propre condition, mais pour le bien de leurs deux jeunes fils. Des lettres satisfaisantes ont été reçues en réponse. La décision fut prise de vendre les métiers à tisser et les meubles aux enchères. Et la douce voix de mon père chantait souvent pour ma mère, mon frère et moi :
"À l'Ouest, à l'Ouest, au pays de la liberté, Là où le puissant Missouri descend jusqu'à la mer ; Là où un homme est un homme même s'il doit travailler et où les plus pauvres peuvent récolter les fruits du sol."
Le produit de la vente est très décevant. Les métiers à tisser n'ont presque rien rapporté, et le résultat est que vingt livres de plus ont été nécessaires pour permettre à la famille de payer le passage en Amérique. Permettez-moi d'évoquer ici un acte d'amitié accompli par une compagne de longue date de ma mère - qui attirait toujours des amis solides parce qu'elle était elle-même solide - Mme Henderson, de naissance Ella Ferguson, nom sous lequel elle était connue dans notre famille. Elle se risqua à avancer les vingt livres nécessaires, mes oncles Lauder et Morrison garantissant le remboursement. L'oncle Lauder a également prêté son aide et ses conseils, gérant tous les détails pour nous, et le 17 mai 1848, nous avons quitté Dunfermline. L'âge de mon père était alors de quarante-trois ans, celui de ma mère de trente-trois ans. J'étais dans ma treizième année, mon frère Tom dans sa cinquième année - un bel enfant aux cheveux blancs et aux yeux noirs brillants, qui attirait partout l'attention.
J'avais quitté l'école pour toujours, à l'exception d'un hiver de cours du soir en Amérique, et plus tard d'un professeur de français de nuit pendant un certain temps, et, chose étrange, d'un élocutionniste de qui j'ai appris à déclamer. Je savais lire, écrire et chiffrer, et j'avais commencé l'étude de l'algèbre et du latin. Une lettre écrite à mon oncle Lauder pendant le voyage, et qui m'a été rendue depuis, montre que j'étais alors un meilleur écrivain que maintenant. J'avais lutté avec la grammaire anglaise, et je savais aussi peu de ce qu'elle était censée enseigner que les enfants le font habituellement. J'avais peu lu, sauf sur Wallace, Bruce et Burns, mais je connaissais par cœur de nombreux poèmes familiers. J'ajouterais à cela les contes de fées de mon enfance, et surtout les "Mille et une nuits", qui m'ont transporté dans un nouveau monde. J'étais au pays des rêves lorsque je dévorais ces histoires.
Le matin du jour où nous sommes partis de notre chère Dunfermline, dans l'omnibus qui circulait sur le chemin de fer à charbon vers Charleston, je me souviens que je suis resté debout, les yeux pleins de larmes, à regarder par la fenêtre jusqu'à ce que Dunfermline disparaisse de la vue, la dernière structure à disparaître étant la vieille abbaye grandiose et sacrée. Pendant mes quatorze premières années d'absence, je pensais presque chaque jour, comme ce matin-là, "Quand est-ce que je te reverrai ?". Rares étaient les jours où je ne voyais pas dans mon esprit les lettres talismaniques sur la tour de l'abbaye : "King Robert The Bruce". Tous mes souvenirs d'enfance, tout ce que je savais du pays des fées, tournaient autour de la vieille abbaye et de sa cloche de couvre-feu, qui sonnait tous les soirs à huit heures et qui était le signal pour moi de courir me coucher avant qu'elle ne s'arrête. J'ai fait référence à cette cloche dans mon "American Four-in-Hand in Britain" en passant devant l'abbaye et je peux aussi bien la citer maintenant :
Alors que nous descendions les Pends, je me tenais sur le siège avant de la voiture avec le prévôt Walls, lorsque j'ai entendu le premier coup de cloche de l'abbaye, sonné en l'honneur de ma mère et de moi-même. Mes genoux se sont dérobés sous moi, les larmes ont jailli sans que je m'en rende compte, et je me suis retourné pour dire au prévôt que je devais céder. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Heureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de foule devant nous à une certaine distance. J'ai eu le temps de reprendre le contrôle de la situation et, me mordant les lèvres jusqu'à ce qu'elles saignent, je me suis murmuré : " Peu importe, gardez votre sang-froid, vous devez continuer " ; mais jamais un son ne parviendra à mes oreilles sur terre, ni n'entrera aussi profondément dans mon âme, un son qui me hantera et me subjuguera par sa puissance douce, gracieuse et fondante comme celui-là.
À la sonnerie du couvre-feu, j'avais été couché dans mon petit lit pour dormir du sommeil de l'innocence enfantine. Le père et la mère, tantôt l'un, tantôt l'autre, m'avaient dit, alors qu'ils se penchaient affectueusement sur moi nuit après nuit, ce que cette cloche disait en sonnant. Beaucoup de bons mots m'ont été dits par cette cloche à travers leurs traductions. Il n'y a pas eu une seule mauvaise action que j'ai commise au cours de la journée et que cette voix, tirée de tout ce que je savais du ciel et du grand Père qui s'y trouve, ne m'a pas expliquée avec gentillesse avant de m'endormir, en prononçant les mots si clairement que je savais que la puissance qui l'animait avait tout vu et n'était pas en colère, jamais en colère, jamais, mais tellement, tellement désolée. Aujourd'hui encore, cette cloche n'est pas muette quand j'entends sa voix. Elle a toujours son message, et maintenant elle a sonné pour accueillir à nouveau la mère et le fils exilés sous sa précieuse protection.
Le monde n'a pas le pouvoir de concevoir, et encore moins de nous accorder, une récompense telle que celle que la cloche de l'Abbaye a donnée lorsqu'elle a sonné en notre honneur. Mais mon frère Tom aurait dû être là aussi ; c'est la pensée qui m'est venue. Lui aussi commençait à connaître les merveilles de cette cloche avant que nous ne soyons partis vers le nouveau pays.
Rousseau souhaitait mourir au son d'une douce musique. Si je pouvais choisir mon accompagnement, je pourrais souhaiter passer dans l'obscurité de l'au-delà avec le tintement de la cloche de l'abbaye qui résonne à mes oreilles, me racontant la course qui a été faite, et m'appelant, comme elle avait appelé le petit enfant aux cheveux blancs, pour la dernière fois... ...pour dormir.
J'ai reçu de nombreuses lettres de lecteurs parlant de ce passage de mon livre, certains allant jusqu'à dire qu'ils avaient versé des larmes en lisant. Ce passage venait du cœur et c'est peut-être pour cela qu'il a atteint le cœur des autres.
On nous a fait traverser à la rame dans un petit bateau pour rejoindre le vapeur d'Édimbourg dans le Firth of Forth. Alors que l'on s'apprêtait à me faire passer de la barque au bateau à vapeur, je me suis précipité vers l'oncle Lauder et me suis accroché à son cou en criant : "Je ne peux pas te quitter ! Je ne peux pas te quitter !" Je fus arraché à lui par un gentil marin qui me souleva sur le pont du bateau à vapeur. Lors de ma visite de retour à Dunfermline, ce cher vieil homme, lorsqu'il est venu me voir, m'a dit que c'était la séparation la plus triste à laquelle il ait jamais assisté.
Nous sommes partis du Broomielaw de Glasgow dans le voilier de 800 tonnes Wiscasset. Pendant les sept semaines du voyage, j'ai appris à bien connaître les marins, j'ai appris le nom des cordages et j'ai pu demander aux passagers de répondre à l'appel du maître d'équipage, car le navire étant en sous-effectif, l'aide des passagers était requise de toute urgence. En conséquence, j'ai été invité par les marins à participer, le dimanche, à la seule friandise du mess des marins, le plum duff. J'ai quitté le navire avec un regret sincère.
L'arrivée à New York fut déconcertante. On m'avait emmené voir la Reine à Édimbourg, mais c'était là l'étendue de mes voyages avant d'émigrer. Nous n'avons pas eu le temps de voir Glasgow avant d'embarquer. New York était la première grande ruche d'industrie humaine parmi les habitants de laquelle je m'étais mêlé, et l'agitation et l'excitation qui y régnaient me submergeaient. L'incident de notre séjour à New York qui m'a le plus marqué s'est produit alors que je me promenais dans Bowling Green à Castle Garden. J'ai été prise dans les bras de l'un des marins du Wiscasset, Robert Barryman, qui était habillé à la manière des Jackashore, avec une veste bleue et un pantalon blanc. Je l'ai trouvé le plus bel homme que j'aie jamais vu.
Il me conduisit à une buvette et commanda un verre de salsepareille pour moi, que je bus avec autant de délectation que si c'était le nectar des dieux. À ce jour, rien de ce que j'ai vu ne rivalise avec l'image qui reste dans mon esprit de la beauté du récipient en laiton hautement orné d'où le nectar a jailli. Souvent, en passant devant le même endroit, je vois le stand de salsepareille de la vieille femme, et je m'étonne de ce qu'est devenu le cher vieux marin. J'ai essayé de le retrouver, mais en vain, en espérant que s'il était retrouvé, il pourrait jouir d'un âge mûr et qu'il serait en mon pouvoir d'ajouter au plaisir de ses années de déclin. Il était mon Tom Bowling idéal, et lorsque cette belle vieille chanson est chantée, je vois toujours comme la "forme de la beauté virile" mon cher vieil ami Barryman. Hélas ! avant cela, il est parti dans les airs. Eh bien, par sa gentillesse pendant le voyage, il a fait d'un garçon son ami dévoué et son admirateur.
Nous ne connaissions que M. et Mme Sloane à New York - les parents des célèbres John, Willie et Henry Sloane. Mme Sloane (Euphemia Douglas) était la compagne de ma mère dans son enfance à Dunfermline. M. Sloane et mon père avaient été collègues tisserands. Nous leur avons rendu visite et avons été chaleureusement accueillis. Ce fut un véritable plaisir lorsque Willie, son fils, m'a acheté en 1900 un terrain en face de notre résidence de New York pour ses deux filles mariées, de sorte que nos enfants de la troisième génération sont devenus des camarades de jeu comme l'étaient nos mères en Écosse.
Mon père a été incité par des agents d'émigration de New York à emprunter le canal Érié en passant par Buffalo et le lac Érié jusqu'à Cleveland, puis à descendre le canal jusqu'à Beaver - un voyage qui durait alors trois semaines et qui se fait aujourd'hui en dix heures par chemin de fer. Il n'y avait alors aucune communication ferroviaire avec Pittsburgh, ni d'ailleurs avec aucune ville de l'Ouest. Le chemin de fer Érié était en construction et nous avons vu des équipes d'hommes à l'œuvre pendant notre voyage. Rien ne manque à la jeunesse, et je repense à mes trois semaines comme passager sur le bateau du canal avec un plaisir non feint. Tout ce qui était désagréable dans mon expérience s'est depuis longtemps effacé de mes souvenirs, à l'exception de la nuit où nous avons été obligés de rester sur le bateau à quai de Beaver en attendant le bateau à vapeur qui devait nous faire remonter l'Ohio jusqu'à Pittsburgh. Ce fut notre premier contact avec le moustique dans toute sa férocité. Ma mère a tellement souffert que le matin, elle pouvait à peine voir. Nous étions tous effrayés, mais je ne me souviens pas que même la misère piquante de cette nuit m'ait empêché de dormir profondément. Je pouvais toujours dormir, sans jamais connaître "l'horrible nuit, l'enfant de l'enfer".
Nos amis de Pittsburgh attendaient impatiemment de nos nouvelles, et leur accueil chaleureux et affectueux nous a fait oublier tous nos problèmes. Nous nous sommes installés avec eux à Allegheny City. Un frère de mon oncle Hogan avait construit un petit atelier de tissage à l'extrémité arrière d'un terrain dans Rebecca Street. Il y avait deux pièces au deuxième étage, et c'est dans ces pièces (gratuites, car elles appartenaient à ma tante Aitken) que mes parents ont commencé à habiter. Mon oncle a rapidement abandonné le tissage et mon père a pris sa place et a commencé à fabriquer des nappes, qu'il devait non seulement tisser, mais aussi, en tant que commerçant, parcourir et vendre, car il n'y avait pas de revendeurs pour les prendre en quantité. Il était obligé de les commercialiser lui-même, en les vendant de porte en porte. Les bénéfices étaient extrêmement maigres.
Comme d'habitude, ma mère est venue à la rescousse. Rien ne pouvait l'arrêter. Dans sa jeunesse, elle avait appris à lier les chaussures dans l'entreprise de son père pour de l'argent de poche, et l'habileté ainsi acquise était maintenant mise à profit pour le bien de la famille. M. Phipps, père de mon ami et partenaire M. Henry Phipps, était, comme mon grand-père, un maître cordonnier. Il était notre voisin à Allegheny City. Nous lui demandions du travail et, en plus de s'occuper de ses tâches ménagères - car, bien sûr, nous n'avions pas de domestique - cette femme merveilleuse, ma mère, gagnait quatre dollars par semaine en liant des chaussures. À minuit, on la trouvait souvent au travail. Dans les intervalles de la journée et de la soirée, lorsque les soins ménagers le permettaient et que mon jeune frère était assis à ses genoux pour enfiler des aiguilles et cirer le fil pour elle, elle lui récitait, comme elle l'avait fait pour moi, les joyaux de la minstrelsy écossaise qu'elle semblait avoir par cœur, ou lui racontait des histoires qui ne manquaient pas de contenir une morale.
C'est là que les enfants de la pauvreté honnête ont le plus précieux de tous les avantages sur ceux de la richesse. La mère, la nourrice, la cuisinière, la gouvernante, l'institutrice, la sainte, tout en un ; le père, l'exemple, le guide, le conseiller, l'ami ! C'est ainsi que nous avons été élevés, mon frère et moi. Qu'a l'enfant d'un millionnaire ou d'un noble qui compte comparé à un tel héritage ?
Ma mère était une femme très occupée, mais tout son travail n'empêchait pas ses voisins de la reconnaître rapidement comme une femme sage et gentille à qui ils pouvaient demander conseil ou de l'aide en cas de problème. Beaucoup m'ont raconté ce que ma mère avait fait pour eux. Il en fut de même par la suite, partout où nous résidions ; riches et pauvres venaient lui confier leurs épreuves et trouvaient en elle de bons conseils. Elle dominait ses voisins partout où elle allait.
CHAPITRE III - PIT DU TRAVAIL ET DE PIT DU TRAVAIL
La grande question était maintenant de savoir ce que l'on pouvait trouver à faire pour moi. Je venais de terminer ma treizième année et j'avais hâte de me mettre au travail pour aider la famille à prendre un bon départ dans ce nouveau pays. La perspective du manque était devenue pour moi un effrayant cauchemar. À cette époque, mes pensées étaient centrées sur la détermination de gagner et d'économiser suffisamment d'argent pour produire trois cents dollars par an, soit vingt-cinq dollars par mois, ce qui, selon moi, était la somme requise pour nous permettre de ne pas dépendre des autres. Tout ce qui était nécessaire était très bon marché à cette époque.
Le frère de mon oncle Hogan demandait souvent ce que mes parents comptaient faire de moi, et un jour, il s'est produit la scène la plus tragique de toutes celles dont j'ai été témoin. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il a dit à ma mère, avec les meilleures intentions du monde, que j'étais un garçon intelligent et capable d'apprendre ; et il croyait que si on m'équipait d'un panier avec des bibelots à vendre, je pourrais les colporter sur les quais et gagner une somme considérable. Je n'avais jamais su jusqu'alors ce que signifiait une femme enragée. Ma mère était assise en train de coudre à ce moment-là, mais elle s'est levée d'un bond, les mains tendues, et les lui a serrées au visage.
"Quoi ! Mon fils un colporteur et aller parmi les hommes rudes sur les quais ! Je préférerais le jeter dans la rivière Allegheny. Laissez-moi", cria-t-elle en montrant la porte, et M. Hogan partit.