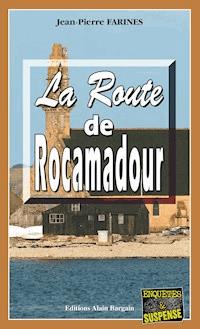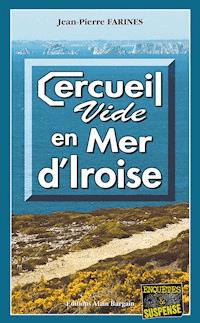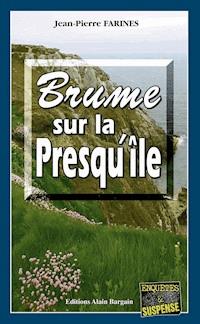
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tome 1
- Sprache: Französisch
La presqu'île de Crozon est le décor d'une sombre affaire.
« - C'est une affaire très délicate monsieur Toirac. Laissez la police faire son travail. »
Des ombres sur la presqu'île ! En venant à Camaret, Jean-Gabriel Toirac n'imaginait pas un instant qu'en évoquant la mémoire d'un grand poète, il allait réveiller d'autres ombres beaucoup plus inquiétantes et mettre sa propre vie en danger. C'est à une véritable enquête policière qu'il se trouve mêlé pour venir en aide à une belle étrangère et la protéger d'un assassin qui veut la faire disparaître.
Un thriller captivant sur les terres bretonnes !
EXTRAIT
Sa chambre était rose et aussi désordonnée que celle de Jean-Gabriel était bien rangée. Elle avait étalé un peu partout le contenu de ses bagages et semblait tout à fait à l’aise en invitant quelqu’un à entrer dans ce bazar charmant. Il sentit un mélange de parfum et de fumée mentholée.
— Tu veux boire quelque chose ? J’ai du whisky.
Elle avait dit ça avec de la gourmandise dans la voix et il se demanda si toutes les jeunes Anglaises buvaient très tôt du whisky. Sans plus de scrupules cependant, il accepta, dut aller dans sa chambre chercher son verre à dents, en profita pour regarder sa tête dans le miroir de la salle de bain. Il était encore bouleversé mais ça ne se voyait pas sur son visage. Il revint très vite et ils s’assirent, lui sur une chaise, elle sur son lit. Comme autrefois dans les salons des précieuses, mais ce soir la précieuse était en jeans et buvait du Knockando dans un verre à dents. Accessoirement, elle était aussi en passe d’être assassinée.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton
. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Pierre Farines vit en Auvergne et en Allemagne. Poète, éditeur d’une revue de poésie et homme de théâtre, il est aussi amoureux de la presqu’île de Crozon.
Brume sur la Presqu'île est son premier roman policier.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tous les personnages de ce roman et leurs noms sont imaginaires, sauf l’hôtel Vauban dont je remercie les propriétaires qui m’ont permis de situer une partie de l’action dans leur établissement et dont j’apprécie depuis très longtemps l’accueil et l’amitié.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Maryse,Laurence,et Sonja.
I
La porte s’ouvrait facilement. La jeune fille rousse hésita. Elle en avait assez d’attendre, énervée, ça se voyait dans ses yeux violets. Les derniers éclats du soleil caressaient la maison et les arbres tout autour. Les taillis plutôt, poussés à la diable, avec le temps, et vivifiés par l’air marin. Une lumière paisible et, tout près, les soupirs des vagues qui roulaient doucement les galets. Elle entra, pour se distraire, mais avec l’étrange sentiment de faire quelque chose qui ne se fait pas. Surtout peut-être pour une Anglaise. Les beaux reflets cuivrés s’éteignirent dans ses cheveux. La maison était inhabitée depuis longtemps et une odeur de bois pourri, de moisissure, de plâtre humide parut remuer avec le courant d’air produit par la porte ouverte. Il faisait froid à l’intérieur où le soleil n’entrait jamais. C’était une lourde bâtisse, trapue, bien accrochée à la roche, sans doute réparée plusieurs fois, rachetée et revendue, comme en témoignaient les volets, toujours fermés, déjà abîmés par les embruns mais relativement récents. Les graffiti sur les murs, les carreaux brisés aux fenêtres et le verre pilé sur le sol, les détritus de toutes sortes et ce remugle prouvaient assez que ceux qui entraient ici, parfois, utilisaient l’endroit comme poubelle, ou pire encore.
Et cependant la jeune fille éprouvait la désagréable impression “d’entrer chez quelqu’un”. Cette maison lui parut très ancienne, le linteau de pierre en accolade au-dessus de la porte d’entrée et l’épaisseur des murs le prouvaient. Même le froid semblait séculaire. « Comme dans une tombe », se dit-elle, en frissonnant. Elle n’entendait plus les voitures sur la route toute proche. Resserrant autour d’elle les pans de son anorak, elle enfonça les mains dans ses poches. Silence. Et sa propre respiration. La maison était ancienne donc, mais pas assez pourtant pour avoir connu les événements passés qui l’intéressaient. Plusieurs pièces. Cela avait dû être une demeure plus cossue que les maisonnettes du pays. Elle dominait toute la baie et la plage de galets mais on n’entendait pas les vagues. Seulement un silence froid – et l’obscurité chargée d’humidité.
La jolie Anglaise rousse traversa la première pièce et entra dans une autre. Sous ses pieds, craquaient des gravats et tout ce qu’elle préférait ne pas imaginer. La curiosité la poussait à continuer bien qu’elle ne vît pratiquement plus rien. « Je reviendrai demain », se dit-elle, prête à ressortir, quand elle fut attirée, dans l’ombre, par une masse noire étalée dans un coin. Elle se pencha pour essayer de mieux voir. Montait aussi une autre odeur, métallique, écœurante, qu’elle se refusait à identifier mais qu’elle avait reconnue d’instinct, avant de savoir. Elle chercha, dans sa poche, son paquet de cigarettes qu’elle n’était pas très sûre d’avoir emporté et, à l’intérieur du paquet, son briquet. L’envie soudaine de sortir de là, de retrouver la lumière, luttait contre l’attrait de quelque chose d’horrible qu’elle pressentait, puis la fascination. La flamme orange éclaira le coin de la pièce en même temps que le corps étendu sur le sol. Elle hésitait à comprendre. Un corps étendu sur le dos et qui dormait… Ces mains tendues vers elle, comme pour la saisir ou la repousser… et cette étrange tête ronde. Tentée de toucher malgré tout, tant l’impression était déconcertante, elle tendit la main et la retira aussitôt. Ce n’était pas une tête mais une pierre énorme. Un galet gros comme une tête, sous lequel du sang pas encore coagulé formait une mare sombre qui se mélangeait aux ordures étalées sur le sol. Elle se mit à trembler violemment et se retint de hurler. Émit un gémissement, comme une plainte. Le briquet s’éteignit quand elle fit demi-tour pour s’enfuir et elle ne put retenir son hurlement, cette fois, en heurtant quelqu’un qui était là, tout près, derrière elle.
Repoussant de toutes ses forces la silhouette noire découpée sur la clarté déclinante qui entrait par la porte, elle se retrouva dehors sans savoir comment et se mit à courir sur le chemin en pente vers la mer.
Ses chevilles se tordaient dans les galets mais elle courait vers la lumière du couchant, trop effrayée pour réfléchir, pour penser qu’elle s’éloignait ainsi du chemin par où elle était venue, de la route où elle aurait pu trouver du secours. Seulement courir entre les rochers. Arriver sur la grève, au pied de la falaise juste en dessous de la maison. Puis les lourdes enjambées, derrière elle, de quelqu’un qui jurait en trébuchant dans les pierres. Elle obliqua brusquement sur sa gauche. Ici et là, ses pieds s’enfonçaient dans du sable. La falaise formait une arche et, au-dessous, elle devina l’entrée d’une grotte. Comprenant enfin que la plage était un cul-de-sac n’offrant aucune chance d’échapper à son poursuivant, elle profita des quelques secondes d’avance qui lui restaient pour se jeter dans l’ombre de la voûte rocheuse et s’arrêter là, prête à s’évanouir de terreur.
L’autre passa devant l’entrée sans l’avoir vue et continua sa course. A nouveau, elle ne voyait rien et, à tâtons, s’enfonça dans l’obscurité. Des blocs énormes détachés de la roche lui barraient le chemin. Elle se glissa entre eux, en se cognant douloureusement les genoux et les mains. Le sol s’élevait mais elle réussit à se caler entre un rocher et ce qui semblait être le plafond de la grotte. Dehors les pas revenaient. Immobile contre la pierre, maîtrisant ses sanglots avec ses poings tandis que les larmes ruisselaient sur son visage, elle parvint à se retenir de crier. Une ombre grandit, se découpa sur le jour finissant.
— Putain de salope ! Tu vas pas m’échapper comme ça.
Une voix dure, éraillée, terrifiante.
La jolie rousse replia ses longues jambes, se serra plus encore dans le faible espace entre la paroi et les roches effondrées. L’homme s’approchait toujours puis il s’immobilisa, tâtant les pierres autour de lui.
— J’sais que t’es là. C’est pas la peine de te cacher.
Si proche qu’elle l’entendait respirer, il se tut, immobile maintenant.
Il attendait, écoutait, retenait sa respiration pour entendre. Puis haletait à nouveau lourdement. Elle distinguait, dans l’air humide, l’odeur d’alcool de son haleine.
— Bon Dieu ! C’est sûr que j’t’aurai.
Le froid de la pierre traversait ses vêtements et l’envahissait en même temps que la terreur qui la faisait trembler. Comment ne l’entendait-il pas ?
— J’suis sûr que t’es là, salope. Je t’entends.
De rage, il lança dans sa direction une lourde pierre qui rebondit en produisant une minuscule étincelle, l’effleura. Elle faillit crier, se retint encore de justesse. Son cri resta muet, c’était comme dans les cauchemars d’enfant et elle allait se réveiller. Mais l’ombre restait là bien qu’elle se confondît de plus en plus avec la nuit minérale de la grotte. Alors elle commença à retrouver des bribes de pensée, comprit que ce n’était pas vrai, qu’il ne l’entendait pas et risquait de moins en moins de la voir. Sans quoi il serait déjà venu la chercher… Essayer d’attendre encore. Il bluffait. S’il avait eu des allumettes ou un briquet, il aurait fait de la lumière depuis longtemps et l’aurait trouvée. Il hésitait maintenant, elle le sentait.
— Bon Dieu de merde, j’sais pas par où, mais elle a filé cette garce !
Il fit encore un pas dans l’obscurité. Elle perçut ses mains frôlant la roche, ses pieds qui faisaient rouler les galets, puis elle comprit qu’il doutait, se décourageait enfin. S’éloignait maladroitement, à tâtons. Maintenant, elle luttait contre l’envie de s’enfuir aussitôt et de courir sur le chemin. Mais il l’aurait entendue et vite rattrapée. Il fallait attendre. Attendre autant qu’elle le pourrait. Être sûre qu’il ne s’éloignait pas seulement par ruse, pour la faire sortir de sa cachette. Qu’il avait bel et bien renoncé, croyait l’avoir perdue. Elle resta longtemps. Jusqu’à être certaine qu’il n’était plus devant la grotte. Jusqu’à être transie. Alors elle bougea lentement, osa avancer une main, puis un pied et, pas à pas, sans déplacer une seule pierre, elle se rapprocha de l’arche rocheuse qui marquait l’entrée de la grotte et se dessinait à peine maintenant sur le ciel et la mer confondus dans l’obscurité. Elle reprenait conscience du rythme continu des vagues sur la grève. Comme une respiration paisible qui berçait sa terreur doucement. La protégeait. Personne n’aurait pu l’entendre marcher.
En face, de l’autre côté de la baie, les lumières de Camaret scintillaient sur l’eau calme. Et ici une houle tranquille, régulière, ourlait le rivage d’une écume légèrement phosphorescente qui reculait en murmurant entre les galets. La ville lui paraissait très loin mais, retrouvant un peu plus de sa lucidité elle s’avança hors de la grotte, prête à entendre courir à tout instant. Un peu plus haut, un moteur s’emballait rageusement. Une voiture s’éloigna. Elle devina qu’elle était seule. L’ombre des grands rochers se découpait sur le ciel. Elle revoyait le cadavre au visage écrasé sous une pierre, les mains aux ongles cassés qui avaient voulu se défendre. Les détails lui revenaient et elle se mit à pleurer en montant vers la route. Si son agresseur était revenu à ce moment-là, elle n’aurait même pas eu la volonté de s’enfuir. Incapable de reprendre le chemin côtier qui l’aurait obligée à passer devant la maison, sans chercher à réprimer ses sanglots, la jeune fille marchait dans la nuit, titubait au milieu de la chaussée à peine plus claire que les haies des bas-côtés. Elle se confiait à cette obscurité où elle n’avait plus la prudence ni même la force d’imaginer que quelqu’un pourrait encore la surprendre. Maintenant une voiture arrivait derrière elle, s’arrêtait. Elle entendit une portière s’ouvrir, des pas qui couraient. Elle resta figée, les bras ballants, fixant son ombre sur l’asphalte, dans le faisceau des phares.
II
Jean-Gabriel Toirac se réveilla dans sa chambre, au deuxième étage de l’hôtel “Vauban”. L’hôtel tire son nom du quai au bord duquel il est bâti et de la célèbre tour dont s’enorgueillit Camaret, depuis le XVIIe siècle. La lumière du soleil de février passait à travers les fentes des volets et il entendait, en bas, les vaguelettes paisibles qui léchaient les galets du port. Depuis trois jours, il n’avait pas beaucoup travaillé et il avait plutôt bien dormi, c’est-à-dire pas trop fait de cauchemars. En émergeant du sommeil, il se demandait s’il travaillerait beaucoup plus ce jour-là. « L’iode. C’est l’iode qui fait ça, ça dope et puis après vient le coup de pompe et c’est là qu’on récupère. » Ça le rassurait de le penser et surtout de n’avoir pas fait de cauchemars. La mer en hiver aussi. C’était un vieux rêve d’enfant pas encore émoussé malgré tous les voyages.
Les mains sous la tête, il regardait au plafond les silhouettes que projetait un rayon de soleil reflété par l’eau. « Le principe de la chambre noire. » Il était comme ça, il fallait toujours qu’il explique tout. Ça le fatiguait d’être comme ça, mais surtout ça fatiguait les autres parfois. Un travers d’universitaire.
Quand même, ce petit miracle, une image d’un monde extérieur se formait ici comme un regard d’une autre dimension. Quelques rares passants, quelques voitures défilaient, ainsi dessinés seulement par la lumière, en noir et blanc sur le plafond. Il n’avait pas envie de se lever, comme si ces fantômes lui suffisaient. Moins pénibles que la réalité.
Finalement, il poussa ses volets. Le port, rempli à ras bord par la marée haute, semblait presque désert malgré quelques bateaux de plaisance aux ailes repliées, immobiles, collés sur un miroir au-dessus de leurs reflets. Sur les collines d’en face, les colonnes de nuages noirs et d’un gris presque bleu s’élevaient comme des fumées dans le ciel pâle. Le vent les poussait vers l’intérieur des terres. Une belle lumière pour les peintres. Jean-Gabriel pensa à Saint-Pol-Roux, à ses amis artistes qui étaient venus ici, tous attirés par cette même lumière transparente et magique. Ça lui rappela aussi qu’il était ici pour travailler. Parfois il regrettait, peut-être aurait-il dû se consacrer à l’écriture. Au lieu de ça, il avait préféré étudier celle des autres. Pour gagner sa vie, nourrir sa famille, c’était l’excuse qu’il se donnait au nom de la raison. Ou bien était-ce par faiblesse ? De toute façon, maintenant… Il échappa à cette idée. D’abord déjeuner, pensa-t-il. C’était souvent que la vigueur de son corps lui servait ainsi de bon sens. Il se rappela que le déjeuner de l’hôtel était bon et copieux et cela l’aida à entamer sa toilette. Il étira son mètre quatre-vingts que la fatigue tassait un peu ces derniers temps et commença à raser sa barbe déjà noire de deux ou trois jours.
Quand il descendit au bar, il remarqua à peine une voiture bleu marine de la gendarmerie stationnée de l’autre côté du quai. Deux athlétiques gendarmes, leur képi sous le bras, buvaient un café en discutant avec le patron.
— Inutile de la réveiller, Léo. Ça peut attendre. Nous repasserons dans une heure. D’ici là peut-être…
Sans finir sa phrase, le brigadier coiffa son képi et sortit, suivi aussitôt de son adjoint.
— Et merci pour le café !
Tandis que la voiture démarrait, Léo s’approcha de Jean-Gabriel.
— Alors, bien dormi ?
— Parfaitement merci, je peux déjeuner ?
— Bien sûr !
Il fit quelques pas vers le comptoir puis revint avec son plateau vide sous le bras.
— Vous n’avez rien entendu hier soir ?
— Non, pourquoi ?
— Vers onze heures, quand la demoiselle anglaise est rentrée…
— Rien du tout. Qu’est-ce que j’aurais dû entendre ?
— Non rien ! On a toujours peur que nos clients soient dérangés, il repartait, soupirait, revenait vers le comptoir. Mais là… là, je crois qu’on peut le dire. De toutes façons, vous avez vu les gendarmes. La pauvre ! Elle était dans un état ! Ce sont eux qui l’ont ramenée ici. Anne-Marie a dû lui donner des cachets pour qu’elle dorme.
— Qu’est-ce qui lui est arrivé ?
— Ben, elle a découvert un cadavre. Dans une maison, près d’ici, là, en face, à Trez Rouz.
Avec un air désolé, il montrait les falaises de l’autre côté de la baie, au-delà de la tour Vauban.
— Un cadavre ? Mais c’est une maison inhabitée, je suppose ? Je veux dire hors saison.
— Non. Abandonnée. Oh, elle a été achetée et revendue plusieurs fois. Une fois à des Hollandais, puis à des Anglais, la dernière fois à des Parisiens. C’est toujours pareil – il poussa un gros soupir – ils viennent d’abord en touristes, le pays leur plaît, alors ils achètent un peu n’importe quoi. Et quand ils ont passé leurs vacances deux ou trois années de suite à faire des travaux et à passer la tondeuse, ils commencent à trouver que c’est loin ou bien ils n’ont plus de sous. Alors ils revendent.
Jean-Gabriel regarda dans la direction que lui montrait Léo, là où, un quart d’heure avant, il admirait l’empilement des nuages.
— Et c’est quelqu’un d’ici ?
— On n’en sait rien encore. Il paraît qu’il était tellement défiguré qu’il était méconnaissable.
— Oh ! Quel choc elle a dû avoir !
— Pauvre petite ! Surtout qu’il y avait quelqu’un d’autre… L’assassin sûrement, il l’a poursuivie, menacée ! Elle était morte de peur. C’est malheureux quand même ! Heureusement, elle a réussi à s’échapper, quelqu’un l’a vue, juste à temps, qui courait au milieu de la route et après ça, elle a appelé les gendarmes de la première cabine téléphonique qu’elle a trouvée. Ils sont allés la chercher et ils l’ont ramenée ici après l’avoir interrogée. Elle n’a pas dû leur dire grand-chose, elle est restée dans leur voiture, elle ne voulait pas revenir sur les lieux, ça se comprend, dans l’état où elle était. Bon, je bavarde, mais vous devez avoir faim, qu’est-ce que je vous sers ? Du café, du thé ?
— Thé, avec un peu de lait.
Tout en préparant le thé, Léo se penchait vers la porte de la cuisine, criant pour couvrir le chuintement du percolateur :
— Un petit-déjeuner, Anne-Marie !
Et il racontait ce qu’il savait. Avant de la ramener ici, les gendarmes étaient retournés à Trez Rouz bien sûr et, là où elle le leur avait indiqué, ils avaient trouvé le cadavre d’un inconnu. Pas encore identifié, “comme je vous disais”, parce que son visage avait été écrasé avec une grosse pierre. Pas de papiers, naturellement, on n’a pas toujours ses papiers sur soi, ou alors on les a volés.
— Et la jeune fille ?
— Ben, elle dort encore à cette heure-ci.
Quelqu’un poussait la porte du bar.
— Alors Léo, t’as les gendarmes soir et matin à ce qu’il paraît ?
Un homme, en ciré de marin et pantalon rouge brique délavé, s’asseyait à une table et dépliait le journal. Il se mit à lire puis lança sans lever la tête :
— Un petit café, léger, s’il te plaît.
— Comme d’habitude quoi !
L’autre baissa son journal.
— Et pourquoi ils sont nerveux comme ça, les bleus ?
— Tu sais pas encore ?
Anne-Marie passait la tête à la porte de la cuisine.
— Tu ferais mieux de tenir ta langue. Quel bavard celui-là !
— Mais Jean-Baptiste dira rien. Je le connais. Pas vrai, Jean-Baptiste ?
— Tu parles, il est aussi bavard que toi, et c’est pas peu dire.
Et Léo racontait à nouveau la soirée de la veille. Jean-Baptiste réagissait à son tour par des « oh ! » des « non ! » des « c’est pas possible ! » Puis se pencha sur son journal après un dernier « c’est malheureux quand même. » Pendant ce temps, Anne-Marie apportait le plateau du petit-déjeuner. Jean-Gabriel connaissait la jeune fille en question depuis deux jours. Quand il avait expliqué à Léo qu’il venait à Camaret pour faire des recherches sur Saint-Pol-Roux, celui-ci lui avait tout de suite dit qu’il y avait dans l’hôtel une autre personne qui faisait des recherches justement, mais elle c’étaient des recherches d’histoire, s’il avait bien compris. Et quand la demoiselle était rentrée à l’hôtel, il les avait immédiatement présentés l’un à l’autre. C’était une jeune fille ravissante, rousse, un visage au modelé très ferme mais non dépourvu de douceur, avec une très jolie bouche et des yeux bleu sombre, pratiquement violets. A vrai dire, Jean-Gabriel avait beaucoup pensé à elle depuis. Elle parlait parfaitement français, avec un accent presque imperceptible. Nancy était d’une famille en partie française et avait fait des études d’histoire pour s’intéresser tout naturellement au pays de ses ancêtres. Jean-Gabriel en était précisément là de ses réflexions quand il vit la jeune Anglaise sortir de l’hôtel pour entrer au bar. Elle hésita un instant puis gagna une table proche de la sienne, suivie par les regards des trois hommes.
— Ça va mieux ? s’inquiéta Léo, vous avez pu dormir ?
Elle répondit d’une légère inclinaison de tête. Jean-Gabriel la salua. Elle était complètement différente de la belle fille de la veille. Les traits tirés, les yeux cernés. Elle semblait n’avoir pas dormi et son regard inquiet se posait tour à tour sur chacun des trois hommes. Jean-Gabriel se dit qu’elle avait l’air d’une enfant qui essaie de sortir d’un cauchemar. Juste après, il jugea cette idée très naïve et son imagination, romanesque et même un peu ridicule. Puis Anne-Marie entra dans la salle et s’approcha de Nancy.
— Vous voulez déjeuner ? Il faut prendre des forces. Vous devriez venir avec moi dans la cuisine proposa-t-elle, regardant les hommes comme pour leur signifier d’être plus discrets. Allez, venez, vous serez plus tranquille.
En même temps, elle la prit par la main et la jeune Anglaise se laissa conduire sans un mot. Eux se sentirent vaguement frustrés mais n’osèrent rien dire. Léo alla pousser la porte de la cuisine, peut-être simplement pour manifester qu’il n’était pas tout à fait exclu, et maître chez lui après tout.
— Dis-lui tout de même que les gendarmes sont venus…
Il referma puis se ravisa et poussa la porte à nouveau pour ajouter :
— Et qu’ils vont revenir.
Jean-Gabriel n’entendit pas la réponse. Lui aussi aurait aimé en savoir davantage. Il se versa une deuxième tasse de thé au lait. A l’anglaise justement, le lait et le sucre d’abord, puis le thé par-dessus, qu’il but très chaud, à petites gorgées, en regardant le mouvement des bateaux qui se balançaient légèrement près des pontons au milieu du port. Ça c’étaient les vacances, boire son thé en regardant le mouvement des bateaux qui se balançaient… Par-dessus, on voyait au loin la falaise où Léo lui avait désigné une maison. Il n’avait pas très bien vu. Jean-Baptiste replia son journal et se leva.
— Salut Léo, à plus tard.
Il posa quelques pièces qui tintèrent sur le comptoir.
— Tiens, revoilà les gendarmes !
Léo encaissa la monnaie
— Salut Jean-Baptiste.
La voiture bleu marine s’arrêta en face, au bord du quai. Les deux hommes entrèrent.
— Alors on peut la voir ?
Léo fit un signe vers la cuisine et appela Anne-Marie. La porte s’ouvrit.
— Ah, c’est vous ! Elle est là, elle vient de déjeuner. Ne la maltraitez pas trop, la pauvre !
Et Nancy parut presque aussitôt. Une des deux armoires à glace qui avait un galon de plus que l’autre s’inclina et dit, à mi-voix comme pour s’excuser :
— Vous voulez bien nous suivre ? Ce ne sera pas très long. Mais nous avons évidemment besoin de connaître tous les détails que vous pouvez vous rappeler.
Elle paraissait petite entre les deux policiers, tous les deux blonds avec des cheveux très courts et tous les deux encombrés de leur carrure. Visiblement intimidés par cette jolie fille qu’ils avaient un peu l’air de kidnapper, ils saluèrent en portant la main à leur képi et ouvrirent la porte de verre. En passant, Nancy regarda Jean-Gabriel. Il lui adressa un sourire qu’il voulait le plus encourageant possible. Elle sortit, suivie du brigadier qui répétait : « Ce ne sera pas long. » Ils traversèrent le quai et la firent monter à l’arrière de la voiture. Un reflet dans la vitre la dissimulait et Jean-Gabriel ne la voyait plus. Ils allaient démarrer quand un homme poussa la porte du bar, la tête tournée pour regarder les gendarmes s’éloigner, aller jusqu’au parking, au bout du quai, puis faire demi-tour et repasser devant la vitrine avant de disparaître. Jean-Gabriel aperçut la silhouette de la jeune fille pendant une seconde. Elle lui sembla très seule sur la banquette arrière. Une nouvelle fois, il fit taire son imagination.
— Eh bien ! Cette fois, tout Camaret sera au courant avant midi, murmurait Anne-Marie, en regardant la porte grande ouverte, tandis que l’homme qui entrait saluait bruyamment.
— Qu’est-ce qui se passe donc chez toi, Léo ? T’as des ennuis sérieux, on dirait ?
— Ça te ferait plaisir, ma parole ! Ferme donc la porte pour commencer, tu nous fais geler ! lança Anne-Marie.
C’était un grand gaillard en caban et casquette. Il regarda encore dans la direction où la voiture s’était éloignée puis posa ses mains énormes et rouges sur le comptoir.
— Donne-moi un petit blanc – son regard brillait de curiosité. Alors, dis-moi un peu ce que faisaient les gendarmes au Vauban ?
Deux autres clients entraient qui entendirent la fin de la phrase. Anne-Marie soupira et Jean-Gabriel sortit en se demandant comment Léo allait pouvoir répondre à toutes les questions.
III
C’était comme un jour de vacances. Depuis un peu plus d’un an, il n’aimait pas penser aux vacances parce que ça lui rappelait trop ses filles. Mais il y pensa quand même, juste un instant, et cela suffit pour lui faire mal. A cette heure-ci, elles devaient dormir. Et leur mère aussi. Le jour n’était pas encore levé à Baltimore. C’était si loin, Baltimore… Il n’arrivait pas à se les représenter. Il s’appliqua à penser au soleil, un soleil de février, déjà tiède, qui lui chauffait agréablement le dos à travers ses vêtements. Il montait une rue en forte pente et eut la surprise de trouver, près d’un cèdre, une stèle surmontée d’un buste, dédiée à Saint-Pol-Roux. Le poète n’était donc pas complètement oublié. Un peu plus haut, en passant devant un collège aux structures massives de granite rose, il se sentit heureux en voyant que les enfants étaient à l’école. Depuis son enfance, il goûtait un plaisir intact chaque fois qu’il lui arrivait de se promener alors que les autres étaient en classe et rêvaient peut-être de liberté en voyant passer, par les fenêtres, ceux qui étaient dehors, comme lui. Réconcilié, momentanément, avec lui-même, il continua son chemin. Un peu plus loin, comme un sourire encourageant, des camélias fleurissaient déjà dans un jardin abrité des vents les plus froids.
La rue s’ouvrait sur le plateau, au-dessus de la ville. Dominait les toitures bleues d’ardoises. Puis, sur sa droite s’arrondissait un vaste cercle de mégalithes, et, au-delà, comme Léo le lui avait indiqué, les ruines du manoir de Saint-Pol-Roux se détachaient sur le ciel clair. En s’approchant, il remarqua sur sa gauche une vague guérite de briques grossièrement rafistolée avec du ciment où quelqu’un avait écrit avec du charbon de bois : « Manoir de Coecilian ». C’était comme un cri de dérision, un ricanement triste. Quelques pas plus loin se dressaient les restes, à la fois orgueilleux et misérables, d’une bâtisse presque totalement écroulée. Des tours décapitées, éventrées et quelques pans de murs cimentés eux aussi à la hâte pour qu’ils ne tombent pas sur les touristes. « Ça ne durera pas, lui avait dit Léo. Ça va être rasé un jour ou l’autre, pour éviter les accidents. » Jean-Gabriel fit le tour de ces tas de pierres et de gravats, étonné par tant d’indifférence à l’égard du vieux poète. Il ramassa un morceau de céramique, essayant d’imaginer à quel intérieur, à quelle intimité il avait pu appartenir soixante ans plus tôt. Le laissa retomber avec le sentiment désabusé que la poésie n’intéresse plus personne. Se dit aussitôt que ce n’était pas vrai non plus et, tournant le dos à cette ruine désolée, il s’avança un peu plus loin.
Ce n’était pas, à cet endroit, une falaise mais une pente de sable assez douce où de grandes herbes se courbaient au vent du large. Ici le soleil était moins chaud et une forte bise soufflait en rafales. Au bas de la pente, couturée de palissades de bois pour retenir le sable et protéger la maigre végétation, une plage magnifique s’étalait en un vaste croissant dont la couleur, avec la fuite des nuages et les caprices de la lumière, variait du gris rose au doré. Le tout enfermé entre deux promontoires rocheux que l’océan venait battre à grands coups sourds en gerbes d’écume éclatante. Des rouleaux impressionnants s’écrasaient sur le sable et le vent apportait leur vacarme. C’était un lieu imposant, peut-être trop même. Les ruines du manoir dressées entre la terre et le ciel, les mégalithes d’un côté et l’océan de l’autre semblaient témoigner de forces divines ou titanesques qui les auraient broyées. Comme un défi et un combat dont ne restaient que les dépouilles solitaires, effrayantes. « C’est prométhéen », se dit-il. Que pourrait-il rapporter de ce spectacle ? Peut-être rien ou simplement cette impression-là qui en disait beaucoup sur l’inspiration, sur l’aspiration surhumaine aussi du poète. « Oui c’est aussi grand que ça. » Ce serait à inscrire dans ses notes en rentrant.
Les rouleaux éblouissants qui explosaient sur le sable lui donnèrent l’envie brutale de descendre vers cette plage. Il fit quelques pas et se retourna. Les tours fracassées se détachaient sur le ciel noir à l’est, sous les nuages que le soleil éclairait de côté. Il y avait bien là une rencontre. Une si violente splendeur qu’avec le vent et les embruns Jean-Gabriel frissonna. Le vacarme de l’océan, amplifié par les rafales, jouait un opéra perpétuel et démesuré, même en l’absence de tout regard, dans un décor aux couleurs grises, vertes, noires et or. Ivre d’une allégresse inattendue et qu’il n’avait pas connue depuis longtemps, il dévala en courant un sentier à peine tracé jusqu’à un escalier de bois qui descendait dans les galets. Au-delà, la plage était vierge, marquée seulement par les palmes minuscules des oiseaux marins, striée de baves blanchâtres laissées par l’écume. Des goélands s’envolèrent pour se poser un peu plus loin. Leurs silhouettes légères se reflétaient dans l’eau qui imbibait le sable et le fracas des vagues laissait parfois entendre en contrepoint leurs cris rouillés. Jean-Gabriel se dit qu’il était presque heureux. Mais désormais avec qui partager cette ivresse ? Sa mémoire lui récitait par cœur du Saint-Pol-Roux :
« …Que lourde est la douleur dont ton âme est la proie ! Que légère la joie dont ton cœur est la fleur !
Pourtant, tu dois passer le temps de cette abeille à cette louve jusqu’à ce que vide soit ta vie comme une outre pressée longtemps par le soleil…1 »
C’était le lieu qui donnait cette force, évidemment ; le poète était resté là pour cette raison.
Mais il commençait à faire vraiment froid dans l’éclaircie finissante. Et ses propres changements d’humeur épuisaient Jean-Gabriel, ils ne cessaient de le mettre en colère contre lui-même. Il décida de penser à la jeune Anglaise, et aussi qu’il était libre et pas pressé. Mais ce n’était pas si facile.
Après un dernier regard aux lambeaux de ciel noir que le vent précipitait vers la plage, il eut envie de rentrer. Là-bas, on devait discuter ferme à propos de la jeune fille et de sa macabre découverte. Il imaginait le bar avec ses murs tapissés de photos de voiliers, les hommes bruyants dans cette chaleur. C’était visiblement le rendez-vous de tous les “voileux” du pays et, tandis qu’il tournait le dos et gravissait la pente vers le manoir, poussé par les rafales humides, il calcula qu’elle ne tarderait pas à rentrer à l’hôtel si les gendarmes tenaient leur promesse de ne pas la garder trop longtemps. Elle ne serait peut-être pas mécontente de le voir en arrivant. Même si Léo et Anne-Marie faisaient de leur mieux pour la rassurer, tous ces inconnus trop curieux d’en savoir davantage la mettaient évidemment mal à l’aise. Était-il lui-même un peu plus rassurant ? Il voulait le croire et aussi que les quelques paroles qu’ils avaient déjà échangées les rapprochaient un peu, à peine mais suffisamment pour qu’il pût lui venir en aide. Parce qu’il connaissait désormais la solitude, il souhaitait lui être d’un quelconque secours et s’avoua à mi-voix que c’était aussi pour lui-même qu’il espérait la secourir. Être celui sur qui elle allait pouvoir compter parmi les autres, quelque chose de la providence dans sa présence… Comique ! Et après tout pourquoi pas ? Aurait-Il été aussi empressé si elle avait été moins belle ? Peut-être pas mais… Il jura intérieurement, marcha un peu plus vite et feignit de ne pas remarquer toutes ces questions qui ricanaient dans son subconscient.
Le vent le portait, sifflait dans les tours du manoir de Coecilian, il arriva presque en courant en haut du sentier. Pensa à ce fils du poète, mort pendant la Grande Guerre, dont la demeure portait le nom. Et le lieu lui parut encore plus marqué de tous les stigmates des souffrances terrestres. Il y avait bien là quelque chose à comprendre, une énigme, mais de celles, gravées dans le temps par des forces qui dépassent l’homme, où peut-être, il aurait fallu deviner quelque avertissement. Il pressa le pas parce que le terrain redescendait tandis que, sur la gauche, la rue qui commençait longeait un village de vacances fermé. Ça ressemblait à un ancien camp militaire dont les baraquements auraient été rénovés. Il tourna bientôt dans une rue, abritée du souffle du large, où le froid semblait moins vif. Tandis qu’il marchait maintenant vers le port, il vit le ciel se dégager soudain en une nouvelle et éblouissante éclaircie. Il se hâtait parce qu’il avait du mal à se réchauffer… et parce qu’il espérait quand même, confusément, dans sa solitude…
En arrivant sur le quai Vauban, il ralentit le pas. Les mâts des voiliers presque immobiles, le ciel limpide sur les eaux calmes et surtout l’absence de la voiture des gendarmes le rassurèrent à demi. Il se vit crispé et inquiet, se demanda pourquoi, quand il n’avait rien d’autre à faire ici qu’un travail agréable et prendre quelques jours de vacances en dégustant, si toutefois c’était possible en hiver, un peu de cuisine du pays. Il révisa mentalement : poissons du jour divers et variés, huîtres, crabe, peut-être même un homard etc. Pas de quoi s’inquiéter outre mesure. Respirer lentement, se détendre en laissant se dénouer les épaules et ouvrir sans précipitation la porte du bar. Il ne se sentit vraiment soulagé qu’en voyant la salle presque vide. Nancy n’était pas rentrée. Nancy, c’était plutôt américain qu’anglais, bof… Il repensa à Baltimore, bien sûr. Commanda un grand café et s’assit derrière la vitre, bien décidé à être là quand la jeune fille arriverait. Ni le chuintement du percolateur ni le café que Léo posait devant lui ne parvinrent à le distraire. Il guettait, à l’autre bout du quai, là où s’élevait la route de Crozon, l’arrivée de la voiture bleu marine des gendarmes. Debout derrière lui, les mains dans les poches, Léo veillait aussi. Sans s’être dit un seul mot, ils partageaient la même inquiétude. Ils restèrent silencieux un long moment. Jean-Gabriel buvait lentement son café. Léo servit deux ou trois clients puis revint se poster derrière la baie vitrée. Ils reprirent leur attente pendant que Radio Nostalgie débitait ses vieux succès en sourdine. Quelques rares voitures passaient sur le quai presque désert. Soudain, Léo rompit le silence :
— Pourquoi vous intéressez-vous à Saint-Pol-Roux ? Il n’est pas très connu en dehors d’ici…
« …Que lourde est la douleur dont ton âme est la proie ! Que légère la joie… » Ce poème dans la tête.
— Parce que j’aime la poésie, s’entendit répondre Jean-Gabriel qui trouva aussitôt cette réponse d’une platitude désolante. Et parce que c’est un grand poète trop mal connu. Il y a très peu de travaux concernant son œuvre. D’ailleurs, on dirait qu’il n’intéresse pas grand monde ici non plus. J’ai vu le manoir, ou ce qu’il en reste… Il n’a jamais été question de le restaurer ? De le protéger au moins ?
Léo eut un haussement d’épaules désabusé.
— Si. On en a bien parlé, il y a quelques années, et puis ils ont pensé que ça ne serait pas rentable sans doute…
— Et rien n’a été fait ?
— Rien. Comme d’habitude. Tout ce qui restait d’intéressant a été racheté par la ville de Châteaulin. Il y a même une exposition, paraît-il – il fit un geste vague comme si cela lui importait mais que désormais ça ne le concernait plus. Ils sont peut-être plus malins à Châteaulin. Il y a eu une exposition aussi à la tour Vauban avec, on nous a dit, quelques documents intéressants. Vous savez, moi je n’y connais rien. C’est la grosse tour, là-bas. Au bout du Sillon. Mais j’ai déjà dû vous le dire.
La tour pyramidale vers l’entrée du port était presque noyée dans les nuages déjà revenus. L’éclaircie
n’avait pas duré longtemps et des nuées basses couraient au-dessus de la ville et de la baie. La pluie arrivait sur la mer à grandes enjambées grises.
— Tiens ! Voilà “l’Abeille Flandre”. Le temps va encore se gâter.
— Qu’est-ce que c’est ?
— L’Abeille ? C’est le plus puissant remorqueur d’Europe, dit Léo, aussi fier que si le navire lui avait appartenu. Il vient de Brest et s’amarre dans la baie chaque fois qu’il fait mauvais, pour pouvoir intervenir plus vite quand c’est nécessaire.
On voyait les superstructures d’un gros bâtiment par-dessus le mur du Sillon. Tous feux allumés, il restait immobile sous le grain qui fouettait maintenant les quais et les toitures. Jean-Gabriel avait fini son café. « …tu dois passer le temps de cette abeille à cette louve… » Avec cette averse, si la jeune fille revenait maintenant, elle éviterait peut-être les curieux. Ce fut ce qui se produisit. Il aimait bien la pluie.
— Tiens, les voilà.
Léo, toujours les mains dans les poches, montrait d’un mouvement du menton la voiture des gendarmes de Crozon. Ceux-ci longèrent le port, s’arrêtèrent devant l’hôtel et, sans quitter son siège, l’un d’eux fit descendre sa vitre.
— On vous la ramène, on sera sûrement obligés de revenir.
Il disait ça à l’adresse de Léo, un peu pour s’excuser, comme s’il se fût agi de sa fille. Nancy ouvrit sa portière et traversa le quai en courant pour se mettre à l’abri.
Il y avait des perles de pluie dans les boucles rousses, nota Jean-Gabriel. Léo lui tenait la porte largement ouverte. C’était comme la vie qui reprenait pour eux trois.
— Alors, ça ne s’est pas trop mal passé ?
Anne-Marie qui devait attendre aussi, s’empressa auprès de la jeune fille. Mais celle-ci semblait avoir déjà repris courage.
— Très bien. Ils ont été très gentils. Je boirais bien quelque chose de fort quand même.
Elle souriait, encore timidement, s’assit à la table voisine de celle de Jean-Gabriel – c’était tout à fait naturel puisqu’ils étaient à ce moment-là les seuls clients du bar – et but d’un trait un petit verre de calvados. Elle eut soudain les joues un peu plus rouges. Léo et Anne-Marie riaient, soulagés de la voir un peu ragaillardie.
— Eh bien, c’est mieux comme ça ! soupirait Léo. On n’aime pas bien voir nos clients dans la peine.
Puis, se tournant vers Jean-Gabriel, il ajouta :
— C’est l’hiver, vous êtes nos deux seuls clients dans l’hôtel, on peut prendre un peu plus soin de vous.
Il y avait une chaleur sincère dans sa voix et Jean-Gabriel le trouvait de plus en plus sympathique. Il s’inquiétait encore :
— Où est-ce que vous allez déjeuner ? Il est tard et il n’y a pas grand-chose d’ouvert à cette saison.
— J’ai vu un snack en passant. Elle prononçait snack à l’anglaise, un peu avec le nez, et c’était charmant. On peut peut-être y aller, non ?
Elle regardait Jean-Gabriel comme si, après ce que venait de dire Léo, elle comprenait qu’il l’avait attendue et qu’il était devenu tout naturel qu’ils aillent déjeuner ensemble. Jean-Gabriel accepta l’invitation sans hésiter et se leva aussitôt. Elle sourit à nouveau, plus franchement, voulut sans doute justifier sa propre audace et murmura juste pour lui :
— Excusez-moi. Je crois que j’aurai moins peur si je suis pas seule…
Et elle ajouta, comme pour elle-même :
— J’ai encore peur, et je suis sûre qu’il va me chercher.
Lui se demanda pourquoi elle s’excusait. Et il savait maintenant qu’il n’avait pas besoin de chercher un quelconque prétexte pour y aller.
1 La rose et les épines du chemin - Éditions Rougerie.
IV
— Les gendarmes vous ont dit qui était l’homme que vous avez trouvé… mort ?
En le disant, il mesura soudain l’énormité du propos et la violence tragique de ce qu’elle avait, elle, vraiment vécu. Jusque-là, c’était un peu abstrait mais…
— Ils veulent pas le dire. Peut-être qu’ils savent pas encore. Il était méconnaissable elle frissonna. J’aimerais mieux parler d’autre chose.
— Pardonnez-moi.
Ils restèrent silencieux quelques instants. Ils étaient au “Pirate”, assis devant la cheminée qui flambait, au fond d’une salle toute en longueur. Une chatte et un énorme berger allemand dormaient l’un contre l’autre devant le feu. Par la porte vitrée, à l’autre bout de la salle, on voyait un chalutier désarmé, aux hublots bordés de rouge, qui se soulevait lentement et redescendait au rythme de la houle presque imperceptible traversant le port. Respiration artificielle pour un bateau mourant. Des nuées basses, poussées par le vent, masquaient par intermittences la chapelle d’en face et la grosse tour Vauban. De l’ombre qui ne les atteignait pas.
— Tu fais une thèse sur Saint-Pol-Roux ?
— Oui, vous connaissez ?
— Un tout petit peu. Moi je fais une thèse sur Trez Rouz. C’est drôle, ça rime presque.
— C’est vrai. Il faut prononcer le “z” de Rouz.
Toujours cette manie de tout expliquer ! Il se traita mentalement de tous les noms.
— C’est rare de rencontrer quelqu’un qui connaisse, si peu que ce soit, Saint-Pol-Roux. Surtout une… Anglaise.
Il avait même failli dire “une étrangère” et s’était retenu juste à temps.
— Tu sais, en réalité, je connaissais pas, mais je t’ai entendu en parler hier, à l’hôtel. Elle riait et il se sentait de plus en plus maladroit. Et pourquoi il t’intéresse ?
C’était la deuxième fois qu’on lui posait la question et il ne savait pas trop quoi dire pour ne pas paraître pédant. Il trouva une formule pompeuse à souhait.
— Parce qu’il élève le débat.
— Oh ! Qu’est-ce que ça veut dire ?
— Il écoutait… Il savait écouter.
— Quoi ? Il écoutait quoi ?
— Tout. La vie. Les gens. Le silence. Ça donne une poésie étrange et grandiose, avec des accords de sons très originaux, de quelqu’un qui écoute et qui entend ce que les autres n’entendent pas – pour ne pas paraître pédant, c’était réussi. Il savait agir aussi. Il a dépensé sa fortune pour aider les gens d’ici.
— Il voulait seulement qu’on l’aime.
— Sûrement. Mais ça n’enlève rien, si ?
Elle ne répondait pas, semblait peu convaincue. Peut-être parce qu’il n’avait pas su trouver les mots qu’il fallait. Elle changea de sujet.
— C’est ton vrai nom Toirac ?
— Oui, pourquoi ?
— Ça fait pas vrai.
Il sourit.
— C’est le nom d’un village du Lot.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Une belle rivière du Sud.
— Et alors ?
— La famille de ma mère était de là-bas. D’un village où mon arrière-grand-mère était institutrice. Il y a déjà presque un siècle. Elle faisait la classe dans un château féodal mal chauffé où mes ancêtres ont combattu les vôtres pendant la guerre de Cent Ans.
— On se dit pas “tu”, en France ?
— Si, on dit “tu” à ses amis… alors… tu as raison, la guerre de Cent Ans est finie depuis longtemps, nous pouvons donc nous dire tu.
Elle sourit à nouveau, sa bouche était délicieuse.
— C’est beau l’histoire de ta grand-mère.
— De mon arrière-grand-mère.
— Oh pardon ! Tu l’as connue ?
— Non, je sais seulement l’histoire et je connais le village.
— Et aussi le château féodal ?
— Oui, il est très beau. Il possède des archives qui confirment qu’une salle du château a effectivement servi de salle de classe. Il y a même les noms des institutrices et, parmi ces noms, figure bien celui de mon arrière-grand-mère.
— Toirac ?
— Non, je t’ai dit que c’était mon arrière-grand-mère maternelle.
Il était fier de tout cela comme d’un titre de noblesse et ça pouvait se comprendre.
En tout cas, Nancy avait l’air impressionnée et c’était toujours ça.
La patronne qui s’était excusée de n’avoir pas grand-chose en cette saison, leur apporta quand même des steaks et des frites avec de la bière. Puis elle partit s’asseoir près de la porte, à l’autre bout du comptoir. La chatte, réveillée, sauta sur la chaise à côté de Nancy. Elle tendit le cou vers le fumet des assiettes puis entreprit une soigneuse toilette pendant qu’ils commençaient à manger.
— C’est quoi Trez Rouz ?
C’était à lui de poser des questions. Elle resta un instant immobile avec sa fourchette en l’air.
— C’est une plage, de l’autre côté de la baie – elle hésita un instant encore, elle devait penser à nouveau à ce qu’elle y avait vécu la veille. C’est aussi un endroit où nos ancêtres se sont fait la guerre.
— Il y en a beaucoup comme ça. C’était aussi pendant la guerre de Cent Ans ?
— Non, cette fois, c’était au XVIIe siècle. Au temps du Roi Soleil et de Monsieur de Vauban. Cet endroit s’appelle aussi “La Mort Anglaise” – elle sourit – j’aurais dû me méfier, non ? Ça s’appelle comme ça parce que mes ancêtres se sont fait massacrer par les tiens en voulant débarquer à tout prix. Trez Rouz, ça veut dire Terre Rouge parce que la plage était rouge de leur sang, disent les Bretons, ou peut-être, c’était à cause de leurs uniformes. En réalité, je crois que c’est parce qu’il y a là de l’oxyde de fer, mais les gens préfèrent toujours quand il y a du sang.
Il la regardait tandis qu’elle parlait. Elle avait réellement une très jolie bouche. Elle se tut et frissonna à nouveau avant d’ajouter :
— C’est sans doute un endroit maudit.
Elle s’expliqua, bien qu’elle sût qu’il avait déjà compris. Elle avait maintenant besoin d’en parler, de se débarrasser des images qui la poursuivaient :
— C’est là que j’ai trouvé le… mort, hier soir. J’avais rendez-vous, par l’intermédiaire de mon prof, avec un historien de la région. J’imaginais pas…