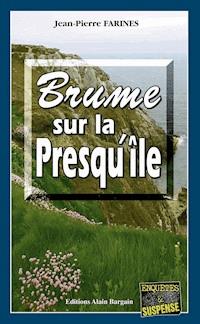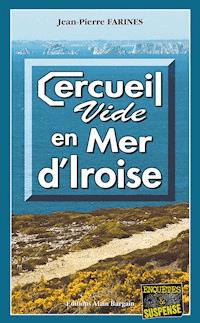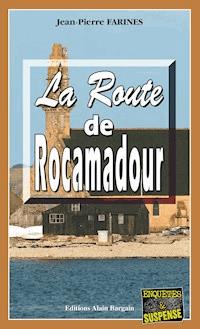
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tome 2
- Sprache: Französisch
Double intrigue en Dordogne.
Elle courut sur le sable, fourra en vrac ses vêtements dans son sac et, toujours en bikini, rejoignit en hâte sa voiture. Là, elle verrouilla les portières en même temps qu'elle pensait que c'était stupide et inutile et que ses yeux affolés vérifiaient tout autour que personne ne l'avait suivie. Elle se répétait : Ça recommence ! Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ça recommence ?
Qui poursuit Nancy White qu'il devait normalement retrouver à Camaret, pendant que J.G. Toirac est appelé dans le Quercy, non loin de Rocamadour, pour tenter de démêler une affaire criminelle ?
Après Brume sur la Presqu'île, Jean-Pierre Farines nous propose son nouveau roman policier passionnant !
EXTRAIT
Elle entra dans le parking de l’hôtel où la petite Peugeot se glissa entre deux grosses voitures : une belge et une allemande. Et, enfin, elle se sentit arrivée. Avec un grand sourire, Anne-Marie s’approchait d’elle.
— Bonjour Nancy. Alors pas trop fatiguée ? La traversée a été bonne ? Je suis contente de vous revoir. Vous voulez que je vous aide à monter vos bagages ?
— Je veux bien, merci. Naturellement, j'ai beaucoup trop de choses, je pourrai pas tout porter. Je veux dire, je mettrai sûrement pas tout ce que j’ai emporté…
— Bah, c’est toujours comme ça. Alors vous avez fait bon voyage ?
— Toute votre famille va bien ?
C’était Léo qui posait la dernière question comme il venait à leur rencontre. Elle l’embrassa aussi. Il empoigna la plus grosse des deux valises et gravit les escaliers, suivi des deux femmes avec le reste des bagages. Nancy reconnaissait l’atmosphère feutrée de l’hôtel empreinte d’un parfum léger de lavande. Et elle se rappelait avoir monté ces étages avec JG quand tous les deux tremblaient de peur et de froid. De désir aussi. Elle revoyait des images qui se précisèrent encore quand Léo ouvrit la porte de la chambre.
— Voilà, vous êtes chez vous…
Elle rougit en acquiesçant. La dernière fois, ils avaient deux chambres au lieu d’une mais se rejoignaient dans celle-ci. Maintenant, il n'y avait plus aucune ambiguïté.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Pierre Farines vit en Auvergne et en Allemagne. Poète, éditeur d'une revue de poésie et homme de théâtre, il est aussi amoureux de la presqu'île de Crozon.
La route de Rocamadour est son deuxième roman policier.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Marie Delbreil
et à Maryse,
à Laurence,
à Sonja
toujours.
REMERCIEMENTS
Les personnages de ce roman sont imaginaires mais les lieux existent bel et bien. Je tiens à remercier Pierre Wagner-Autesserre qui m’a aimablement autorisé à situer une partie importante de l’action dans son château de Larroque-Toirac. Et à redire mon amitié pour Noël, Marie-Claude, Yves, Joël, et tous les “Cormorans”…
I
Firmin Lacombe sortit sur le pas de sa porte en faisant claquer sur ses épaules les bretelles de son pantalon. Il s’était levé, comme d’habitude, avec le soleil, ou presque, parce qu’il aimait cette heure fraîche où des écharpes de brouillard s’étirent encore sur les méandres paresseux de la rivière, en bas, dans la vallée. Il avait pris aussi l’habitude, pour laquelle sa femme le rabrouait régulièrement, d’aller pisser sous les arbres, à côté de la maison, en contemplant le paysage paisible, immobile comme une carte postale. Quand Lucienne rouspétait « quand même, tu vois bien que c’est pas convenable », il répondait seulement « tu parles, à cette heure, y a personne » et il continuait ainsi tous les matins à abreuver les roses trémières qui ne s’en portaient finalement pas plus mal.
Ce matin-là cependant, son attention fut d’abord attirée par un large envol d’hirondelles, en même temps qu’un bref éclat de soleil, qui avait dû se refléter dans une fenêtre du château, parcourait les feuillages des chênes verts plus loin sur la falaise. Il eut aussitôt le réflexe de se cacher, mais la curiosité l’emporta et, se reboutonnant en hâte, il observa ce qui se passait là-haut.
Presque au sommet de la tour la plus élevée, une petite fenêtre à meneaux s’était ouverte en effet et une scène étrange se déroulait. Quelqu’un s’efforçait de faire passer par l’étroite ouverture carrée une chose que le père Lacombe prit d’abord pour un vieux matelas ou quelque autre objet gonflable qui lui parut blanc verdâtre. On aurait dit quelque chose de répugnant comme un gros ver sortant d’un fruit, mais finalement il pensa bien reconnaître un mannequin. Il y avait de belles armures là-haut, dans les salles, que l’on astiquait probablement très tôt le matin afin de les rendre plus étincelantes pour les premiers visiteurs. Et l’on avait dû, pour le coup, remplacer ce jour-là un mannequin fatigué. Le père Lacombe trouva que, tout de même, c’était une curieuse manière de faire le ménage mais ne s’en inquiéta pas outre mesure. Après tout, ça ne le regardait pas, et on voit des choses tellement bizarres. Finalement, il vit l’objet s’extraire tout à fait. Et tomber. Comme une grosse poupée qui sembla se désarticuler en heurtant plusieurs fois la muraille avant de rester accrochée, coincée entre la roche, au pied de la tour, et les branches des premiers arbres « Hé bé miladiou ! C’est sûr qu’ils vont s’amuser pour le récupérer ! C’est une blague ou bien quoi ? » Il n’avait rien entendu mais, en haut, la fenêtre se refermait renvoyant dans les arbres de la falaise un nouvel éclat doré.
Firmin rentra chez lui où se répandait l’odeur du café que sa femme venait tout juste de préparer. Il chercha d’abord dans le tiroir du buffet son appareil auditif qu’il installa tranquillement tandis qu’il s’asseyait à la longue table de la cuisine et il appela :
— Lucienne !
— Oui ! Eh bé, crie pas comme ça, je suis pas sourde, moi !
Il cherchait ses mots pour décrire la scène à laquelle il venait d’assister quand il se dit que, tout compte fait, il valait bien mieux se taire que de s’attirer encore quelque remarque désagréable sur ses “vilaines manies” etc. Il se versa un grand bol de café.
— Non, rien, je voulais dire que je vais aller voir le tabac.
— Eh bé oui, dit-elle seulement tandis qu’elle préparait à son tour son petit-déjeuner. Il but son café lentement, sans plus rien dire, en mangeant une tranche de pain qu’il avait d’abord tartinée d’une moitié de cabécou. Et réglant son appareil qui sifflait désagréablement, il ressortit bientôt, traversa la rue et grimpa dans sa camionnette sans penser davantage à regarder vers le château. Il chercha son paquet de cigarettes dans le vide-poches, alluma une Gauloise, puis, desserrant seulement le frein à main, il prit la descente, brinquebalant à travers le village, en roue libre pour ne pas réveiller le voisinage.
II
« Walk on the wild side… » Elle s’arrêta à Sizun, en plein centre du bourg, sur un large parking encore à moitié désert. Elle soupira profondément, de soulagement parce qu’elle était presque arrivée, se laissa aller contre le dossier, alluma une cigarette mentholée et resta encore un moment assise dans la voiture pour écouter la fin de la chanson de Lou Reed. Puis elle éteignit l’autoradio. Nancy était heureuse de retrouver la Bretagne malgré toutes les épreuves qu’elle y avait vécues quelques mois plus tôt. Heureuse tout simplement parce qu’il faisait beau et parce que c’était là qu’elle avait rencontré Jean-Gabriel Toirac, même si sa liaison avec lui était loin d’être simple. Elle était heureuse aussi parce qu’elle retrouvait sous ce beau soleil matinal le pays de sa grand-mère paternelle. Marie, sa Mamy, qui lui avait si souvent parlé du pays de son enfance, surtout depuis les événements du mois de février qui avait libéré la vieille dame d’un silence forcé. Silence de plusieurs dizaines d’années pendant lesquelles elle et son mari avaient dû disparaître et changer d’identité pour survivre.1
Marie lui avait recommandé encore la veille, juste avant qu’elle embarque pour la France, de s’arrêter à Sizun pour visiter l’enclos paroissial dont elle avait gardé un souvenir plein de reconnaissance et de tendresse. Marie White, née Lanval, toute une histoire. Elle n’avait pas revu sa Bretagne natale depuis la Seconde Guerre mondiale et prenait un plaisir plein de nostalgie à en parler avec sa petite-fille. Marie aimait aussi beaucoup Jean-Gabriel qui le lui rendait bien, et elle s’étonnait toujours d’entendre Nancy l’appeler JG. « S’il t’appelait « N » qu’est-ce que tu dirais ? Nancy riait et taquinait sa grand-mère en lui expliquant que JG c’est bien plus court et plus pratique. À quoi Marie répondait invariablement :
— Vous êtes donc si pressés ?
Nancy éteignit sa cigarette et l’écrasa dans le cendrier avant de quitter la voiture pour faire quelques pas sur la place. S’orienter dans le village était très facile, et elle renoua aussitôt le fil de ses pensées. Elle adorait sa Mamy qui était restée très jolie malgré son âge. Elle l’aimait encore davantage depuis qu’elle connaissait la véritable histoire de sa rencontre avec un soldat allemand, Willy, son mari depuis 1945, et de leur amour qui avait résisté aux épreuves de la guerre et aux longues années écoulées depuis. Marie lui avait raconté comment ils s’étaient cachés, à Sizun précisément, en 1944, chez des amis de la Résistance, en attendant que la paix revenue leur permît de s’embarquer pour l’Angleterre. Là, ils avaient refait leur vie, comme on dit. Ils s’étaient installés à York où les bombardements avaient détruit toutes les archives. Et ainsi, ils avaient pu assez facilement se faire une nouvelle identité. Willy Weiss était devenu Willy White et lui avait aussitôt demandé sa main, mais ça, c’était une autre histoire.
Nancy visitait donc ce matin-là l’enclos paroissial parce que Marie lui avait avoué que, par deux fois, là et dans la chapelle de Rocamadour, à Camaret, elle avait fait le vœu de revenir en pèlerinage après la guerre. Pour lors, ce vœu était resté un rêve, Willy ne voulait pas risquer de se heurter à des haines tenaces. De vieilles rancunes à peine oubliées. Il ignorait quelle forme prendrait le danger mais il gardait au fond de lui comme une idée fixe, la certitude que le risque restait réel malgré le temps écoulé. Les événements de l’hiver dernier lui avaient donné amplement raison et Marie se reprochait amèrement depuis d’avoir failli provoquer la mort de sa petite-fille « Mais tu as rencontré Jean-Gabriel », disait-elle comme pour se faire pardonner, « Tu vois comme l’Histoire se répète. » Et en quelques semaines, Nancy en avait appris davantage sur ses grands-parents que pendant tout le reste de ses vingt-six années. Marie était intarissable, sans doute parce qu’elle avait dû garder si longtemps le silence sur sa jeunesse et son enfance dont elle n’avait, jusque-là, presque rien dit. Maintenant, elle se rattrapait avec une joie communicative. Ne se privait pas d’interrompre Nancy dans son travail les après-midi pour boire le thé et lui parler de ses parents. De ses premières années à Brest. Des dimanches quand elle avait seize ans où on prenait le bateau en famille pour aller à Quélern, puis à la plage de Trez Rouz pour pique-niquer. Et il y avait parfois des sorties avec les gens du syndicat, ses parents levaient le poing et on chantait tous en chœur.
— Ma mère me faisait lever le poing aussi. Elle était institutrice comme mon père, et comme moi plus tard, mais tout ça tu le sais bien, je radote.
Marie riait. Nancy s’étonnait d’entendre sa grand-mère parler encore avec tant d’enthousiasme de ces années trente et en particulier des pique-niques sur le sable de Trez Rouz où elle-même, soixante-dix ans plus tard, avait bien failli mourir assassinée. Elle comprenait mieux cependant pourquoi la vieille dame s’était si fort intéressée à la thèse d’Histoire de sa petite-fille sur leur ancêtre anglais qui avait débarqué là en 1694. Évidemment, tout cela se superposait, s’embrouillait un peu parfois. L’Histoire bégayait. Marie riait encore, puis redevenait soudain plus grave en évoquant ses parents disparus, à la fin de la guerre, dans les bombardements de Brest, avant même d’avoir pu rencontrer Willy et de l’avoir accepté : « C’était difficile d’aimer un soldat allemand à cette époque. Mais je suis sûre, ma chérie, qu’ils l’auraient aimé si seulement ils l’avaient connu. » Son regard se noyait de larmes où se reflétaient les images du passé, sa voix tremblait un peu. « Tu te rends compte, les parents de Willy sont morts sous les bombes à Hambourg, et les miens, presque au même moment… Parfois, on dirait bien qu’il y a une force là-haut qui décide de tout ça. » Alors Nancy s’étonnait que l’on puisse avoir levé le poing pendant le Front Populaire et croire encore à une volonté d’en haut. Mais elle parlait d’autre chose. Promettait d’aller visiter l’enclos paroissial à Sizun où elle penserait très fort à sa Mamy. Et elle l’embrassait.
Maintenant, elle était là, recueillie devant le calvaire. Sous les voûtes fraîches, elle pensait à ses grands-parents. À elle-même et à JG aussi, se demandant quel était leur avenir à tous deux. Il était si tendre, mais si compliqué, incapable encore de penser à sa femme et ses filles sans culpabiliser.
Elle regarda l’heure et vit qu’elle devait maintenant se dépêcher un peu.
Elle était partie de Roscoff tôt le matin, après avoir débarqué du bateau qui l’avait amenée d’Angleterre dans la nuit.
La traversée avait été parfaitement calme. La nuit splendide, où on croisait des navires dans tous les sens. D’immenses pétroliers et quelques paquebots illuminés comme des buildings.
À Roscoff, elle avait trouvé la voiture de location qui l’attendait. Une belle petite Peugeot rouge, un peu voyante à son goût, mais qu’elle avait pris plaisir à conduire sur les routes étroites à travers les Monts d’Arrée.
Elle ressortit de l’enclos paroissial avec une dernière pensée attendrie pour ses grands-parents et rejoignit sa voiture sur le parking voisin. Le soleil était déjà très haut. Elle fit glisser le toit ouvrant, ravie de pouvoir profiter du ciel bleu, et démarra en direction du Faou qu’elle avait déjà repéré sur sa carte quand elle avait décidé d’éviter l’autoroute. Tout allait bien, mais une légère appréhension s’installait en elle tandis qu’elle se rapprochait de la presqu’île de Crozon. Il était déjà dix heures.
1 Lire Brume sur la Presqu’île, même collection, mêmes éditions.
III
À la même heure, Jean-Gabriel Toirac venait de se lever. Il était en vacances et cette perspective ne suffisait pas à lui ôter l’angoisse avec laquelle il s’était réveillé. Depuis qu’ils s’étaient séparés, sa femme et surtout ses filles lui manquaient. Il ignorait toujours quand leurs situations respectives allaient se stabiliser, quand il pourrait les revoir. Il le désirait et il en avait peur en même temps. Presque tous les matins avaient ce goût d’inquiétude et de remords. Il pensa à Nancy qu’il devait rejoindre le lendemain et une partie de son malaise se dissipa. Elle devait être en route pour Camaret. Il regarda sa montre et calcula qu’elle avait dû quitter le bateau depuis deux ou trois heures déjà. Il l’appellerait quand il serait sûr qu’elle était arrivée à l’hôtel Vauban. En attendant, il allait préparer son petit-déjeuner. Sa table était encombrée de courrier auquel il devait absolument répondre dans la journée avant de l’expédier à la dernière levée. Il partirait comme convenu le lendemain, le plus tôt possible.
L’image de Nancy qui se forma dans sa pensée le fit sourire enfin et il imagina avec plaisir, et déjà une sorte de gourmandise, le moment où ils allaient se retrouver. Il vit ses yeux et sa silhouette et considéra qu’il avait quand même beaucoup de chance. Il se disait cela chaque fois qu’il pensait à elle, et c’était souvent. Une vague de désir le parcourait. Puis à nouveau les questions l’emportaient. Il se raisonna : « Vingt-quatre heures, encore un peu de patience… » Il avait parlé tout haut et, cependant qu’il versait de l’eau bouillante sur le thé, il se revit chez Nancy, à York, tandis qu’ils prenaient ensemble leur breakfast.
Elle habitait un petit appartement qui sentait toujours un peu la cigarette mentholée, près de chez ses parents et de Willy qui vivaient tous dans la même grande bâtisse dont le rez-de-chaussée était occupé par la maison d’édition que Willy White avait fondée après la guerre et que son fils dirigeait maintenant. Une belle famille, équilibrée, joyeuse. Ce qui avait presque toujours manqué à JG. C’était devenu, dans son psychisme, une zone d’ombre où il n’aimait pas s’aventurer.
Il se versa un peu de lait et du thé qu’il but presque bouillant, en circulant d’une pièce à l’autre. Depuis le départ de Julia, il habitait au deuxième étage d’un petit immeuble, pas loin de Clermont-Ferrand, un trois-pièces envahi par les livres et qu’il devrait sûrement quitter pour un plus grand si Nancy décidait de venir s’installer avec lui. Pour l’heure, et d’un commun accord lui semblait-il, ils n’avaient pas encore osé aborder ensemble cette question. À nouveau, il se la représenta et se surprit à penser qu’il ne l’avait encore jamais vue en bikini. Cette idée le fit sourire derechef, sur quoi il alla chercher son slip de bain pour être sûr de ne pas l’oublier. Sa valise béante gisait depuis deux jours sur le canapé du salon, déjà à moitié remplie. Il y jeta le slip et se dirigea vers la cuisine pour commencer à traiter ce qui restait de son courrier, en continuant à boire son thé.
Parce que l’image de Nancy ne le quittait pas, il pensa aussi à Marie Lanval qu’il avait vue à York où les White l’avaient invitée après l’affaire de Trez Rouz. Dans son imagination, elle était restée jusqu’alors la jeune fille très belle dont il avait lu l’histoire dans les lettres de guerre de Willy Weiss. Puis elle avait disparu. Et tandis que tout le monde la croyait morte, elle était devenue Marie White, la grand-mère de Nancy. Jean-Gabriel avait eu peur, avant de la rencontrer, de voir avec tristesse disparaître l’image idéalisée de l’héroïne qu’il gardait en mémoire. Mais il avait, avec bonheur, découvert une dame, âgée évidemment, mais élégante, gracieuse, mince, coquette aussi, avec un sourire si jeune qu’il l’avait aimée aussitôt. Marie n’était pourtant pas tout à fait comme il l’avait imaginée. Très jolie, ainsi que la lui avaient décrite tous ceux de Camaret qui l’avaient connue, elle avait gardé, malgré les années, une finesse et une grâce étonnantes. Cependant, elle était un tout autre personnage que la femme fragile qu’il s’attendait à rencontrer. Elle était toujours très féminine mais les épreuves n’avaient fait que forger plus solidement son caractère. Avec sa fragilité apparente, elle était restée une femme de conviction, aux idées progressistes, que son goût pour la poésie n’avait fait que renforcer. Il pensait à elle presque aussi souvent qu’il pensait à Nancy et se disait avec plaisir que la petite-fille serait sans doute un jour comme la grand-mère dont elle avait les yeux.
À onze heures trente, il se refit du thé. Il avait presque fini son courrier tout en faisant la liste de tout ce qu’il ne voulait pas oublier. La veille, quand il avait téléphoné à Camaret, à l’hôtel Vauban, c’était Léo qui lui avait répondu que tout était prêt pour les accueillir, lui et Nancy, leur chambre était bien réservée, pas d’inquiétude à avoir. En écoutant la voix amicale de Léo, il avait eu l’impression de se retrouver au bar de l’hôtel, de voir le ciel matinal et d’entendre les cris éraillés des goélands. Puis il avait réalisé qu’il ne connaissait Camaret qu’en hiver et que l’image qu’il s’en faisait n’était pas de saison. Léo l’avait aussitôt rassuré : « Il fait très beau, presque trop chaud et la météo est parfaite. Pas idéale pour la voile, il n’y a pas beaucoup de vent, mais tous les plaisanciers sont en mer. Haute pression pour au moins une semaine. » JG revint sur terre et se remit à son courrier. L’envie de se baigner avec Nancy, de la serrer presque nue dans l’eau contre lui, de goûter le sel sur ses lèvres, il était très amoureux… Impossible de se concentrer sur ce qu’il écrivait dans ces conditions. Il se leva et empila encore quelques vêtements dans sa valise. Sans pouvoir préciser pourquoi, il s’aperçut qu’il était très inquiet.
IV
À onze heures trente, Firmin Lacombe, un mégot éteint et brun de salive aux lèvres, remontait la ruelle qui zigzague à travers le bourg, en regardant la haute silhouette du château. Il faisait déjà très chaud et il avait soif mais il était plutôt content, le tabac serait beau cette année, plus beau sans doute que l’année passée où les orages avaient gâté une bonne partie des plants. En se rappelant soudain, sans raison bien définie, la scène étrange du matin, il regarda la fenêtre en haut de la tour. Rien de particulier, la fenêtre était fermée comme la plupart du temps. Il gara la camionnette et, tandis qu’il claquait la portière dans un grand bruit de ferraille, il jeta un coup d’œil au pied de la paroi où il avait vu tomber le mannequin. Étonné et un peu mécontent, il maugréa en jetant son mégot
« Eh bé miladiou, il est encore là celui-là ! » Il s’approcha du rocher, écartant les branches d’arbres. « J’espère qu’ils vont pas le laisser là. C’est quand même pas à moi de… » Il s’interrompit soudain en voyant la tête renversée qui le regardait fixement avec des yeux exorbités. Lentement, Firmin se tordit le cou pour mieux voir en face le visage tuméfié. Alors, il commença à reculer sans pouvoir détacher son regard du cadavre.
Persuadé d’abord de faire un cauchemar, il voulut appeler sa femme, trébucha comme un homme ivre et faillit tomber en se retournant vers sa maison, mais aucun son ne sortit de ses lèvres jusqu’à ce qu’il se mît à crier : « Lucienne ! Ho ! Lucienne, viens voir par ici, vite ! » Elle dévalait presque aussitôt les marches du perron, accourait en pensant d’abord qu’il avait peut-être un malaise « Eh bé quoi ? Qu’est-ce que tu as à crier comme ça ? Tu m’as fait peur ! » Puis elle vit la main tendue de son mari qui tremblait en lui montrant quelque chose. Elle se retourna, hésitant à comprendre quand elle écarta une branche pour mieux voir et se trouva nez à nez ou presque avec un corps désarticulé, complètement nu. Elle remarqua alors, sur un bras qui se tendait vers elle, une profonde blessure aux lèvres livides. Et comme elle tirait convulsivement sur la branche qu’elle ne parvenait plus à lâcher, le cadavre d’un homme glissa lentement et tomba à ses pieds avec un bruit mou. Une main glacée se posa sur sa jambe. Elle s’évanouit sans un cri.
V
Nancy arriva à Camaret un peu avant midi et elle aurait bien voulu s’arrêter en haut de la rue des Quatre vents pour admirer la baie, la tour Vauban et la chapelle de Rocamadour sous le soleil, mais elle eut à peine le temps de ralentir que le conducteur du camping-car qui la suivait klaxonnait en se rapprochant dangereusement. Elle leva donc le pied de la pédale de frein et descendit vers le port qu’elle n’avait encore jamais vu aussi encombré. Dans l’eau, par les bateaux, et plus encore, de tous côtés sur les quais, par les piétons en short qui fourmillaient sans but apparent et traversaient la chaussée n’importe où, sans rien regarder. Les automobilistes s’arrêtaient, sans prévenir et en double file, pour admirer le point de vue ou pour attendre une place où se garer. Ce n’était plus le port à moitié désert qu’elle avait connu en hiver mais une station touristique envahie par une nuée de voitures de toutes nationalités. Avec un petit pincement de jalousie, elle se dit qu’elle le regrettait presque. Comme si cette foule de vacanciers lui volait quelque chose de cette ville qu’elle connaissait autrement, avec qui elle se sentait désormais des liens profonds et privilégiés comme on peut en avoir avec quelqu’un qu’on a appris à aimer dans l’épreuve.
Elle longea les quais et le port de plaisance, jetant un coup d’œil rapide à la succession multicolore des vitrines qu’elle avait vues fermées en février et qui offraient maintenant tout au long du trottoir des étalages de souvenirs et de vêtements de plage devant lesquels se bousculaient les curieux. En ralentissant devant le Vauban, elle vit, par les grandes baies largement ouvertes, Léo derrière le bar de l’hôtel, il avait eu le temps de la reconnaître et lui faisait signe de faire le tour du pâté de maisons pour entrer dans le parking. Aux tables de la terrasse, on buvait déjà l’apéritif en exhibant des bras et des jambes nus, plus ou moins bronzés ou carrément écarlates. Elle continua sur le quai du Styvel, contournant les hôtels et les restaurants déjà surpeuplés, slalomant entre les baigneurs affamés qui remontaient de la plage de Corréjou. Un jeune type en bermuda, avec une planche à voile qu’il tenait à bout de bras au-dessus de sa tête, traversa juste devant son capot et lui décocha un grand sourire et un clin d’œil. Elle allait protester mais elle eut envie de rire soudain. L’inquiétude l’avait quittée et laissait place au désir de s’étendre au soleil à son tour, de nager, de dormir, de retrouver son amant, de le caresser et de faire l’amour.
Elle entra dans le parking de l’hôtel où la petite Peugeot se glissa entre deux grosses voitures : une belge et une allemande. Et, enfin, elle se sentit arrivée. Avec un grand sourire, Anne-Marie s’approchait d’elle.
— Bonjour Nancy. Alors pas trop fatiguée ? La traversée a été bonne ? Je suis contente de vous revoir. Vous voulez que je vous aide à monter vos bagages ?
— Je veux bien, merci. Naturellement, j’ai beaucoup trop de choses, je pourrai pas tout porter. Je veux dire, je mettrai sûrement pas tout ce que j’ai emporté…
— Bah, c’est toujours comme ça. Alors vous avez fait bon voyage ?
— Toute votre famille va bien ?
C’était Léo qui posait la dernière question comme il venait à leur rencontre. Elle l’embrassa aussi. Il empoigna la plus grosse des deux valises et gravit les escaliers, suivi des deux femmes avec le reste des bagages. Nancy reconnaissait l’atmosphère feutrée de l’hôtel empreinte d’un parfum léger de lavande. Et elle se rappelait avoir monté ces étages avec JG quand tous les deux tremblaient de peur et de froid. De désir aussi. Elle revoyait des images qui se précisèrent encore quand Léo ouvrit la porte de la chambre.
— Voilà, vous êtes chez vous…
Elle rougit en acquiesçant. La dernière fois, ils avaient deux chambres au lieu d’une mais se rejoignaient dans celle-ci. Maintenant, il n’y avait plus aucune ambiguïté.
— Alors on vous laisse vous installer, à tout à l’heure…
Et ils refermèrent la porte. Un peu étourdie, elle s’assit sur le lit pour un instant, le temps de tout regarder, de tout reconnaître. Elle avait vaguement sommeil mais pas envie de dormir. C’était cet état légèrement nauséeux, ce mélange de fatigue et d’inquiétude après l’excitation du voyage où l’on ne sait plus très bien ce que l’on veut vraiment. Puis elle ouvrit la fenêtre et contempla le port aussi lumineux aujourd’hui qu’elle l’avait trouvé sombre et inquiétant sous la pluie de février. La rumeur incessante des passants. Les cris des mouettes. Un goéland perché sur un lampadaire, juste de l’autre côté du quai et guettant les terrasses d’où les touristes attablés lui jetaient quelques miettes de temps à autre. Tournant la tête, il la fixa un instant de son œil rond puis se laissa descendre sur la chaussée pour attraper un morceau de sandwich. Elle s’aperçut qu’elle avait faim mais pas non plus le courage d’aller quelque part toute seule. Elle aurait voulu que JG soit déjà là. Elle se dit qu’il fallait faire un effort, profiter quand même de tant de lumière.
Au bar, Léo lui demanda si rien ne lui manquait, et comme elle hésitait entre un vrai repas et un simple casse-croûte, quelque part sur le port, il lui suggéra d’aller manger une crêpe à l’autre bout du quai : « Au Rocamadour, c’est facile à trouver, là-bas sur la place de la Poste. » Il lui montrait d’un geste l’autre bout de la ville. Elle sortit, encore un peu étrangère à l’agitation bourdonnante des passants qui allaient déjà à la plage ou en revenaient enfin et se hâtaient vers les restaurants. Elle éprouva encore un instant une sorte de nostalgie de l’hiver et de ses ciels tourmentés. Puis le long du port, elle marcha au bord de l’eau. S’arrêta un moment pour se calmer en observant le manège d’un cormoran qui plongeait soudain et réapparaissait à la surface de l’eau vingt ou trente mètres plus loin. Elle s’aperçut qu’elle avait oublié son portable et décida de continuer quand même son chemin. Si JG l’appelait, il laisserait un message. L’inquiétude irraisonnée qui l’avait envahie le matin revenait, elle l’attribua à la faim et au voyage.
En passant devant La Grand Voile elle vit que le restaurant était fermé. En travaux. Dommage. On aurait dit que le passé la fuyait, que tout ce qu’elle avait pensé retrouver avait disparu. Deux minutes plus tôt, elle s’était arrêtée devant Le Pirate fermé aussi. La ville changeait. En se dirigeant vers la crêperie que Léo lui avait recommandée, elle regretta la disparition de ces deux endroits où elle avait passé des moments si intenses avec Jean-Gabriel. Elle se rappelait en particulier la gentillesse de la patronne à La Grand Voile. Puis elle vit l’enseigne du Rocamadour et, après une dernière hésitation, parce qu’elle était seule, elle poussa quand même la porte et affronta les regards. Un peu perdue, elle avisa une petite table juste derrière la porte, contre la baie vitrée, d’où elle voyait le port à travers son propre reflet. Elle s’assit et un garçon un peu timide vint presque aussitôt lui porter le menu. Il rougit sous son bronzage comme elle levait les yeux sur lui. Elle le gratifia d’un sourire et, perdant presque l’usage de la parole, il s’éloigna entre les tables à peu près toutes occupées.
Quelques minutes plus tard, elle dévorait une première crêpe, puis calculant qu’elle n’avait rien mangé depuis le breakfast sur le ferry, elle estima qu’il lui en faudrait au moins deux autres pour se sentir mieux. Juste en face, les bateaux étaient parfaitement immobiles dans le soleil, posés sur une eau vert émeraude, lisse comme le ciel était lisse, et sans autre mouvement que celui des oiseaux. Au-delà du bassin, la chapelle de Rocamadour dressait son clocher mince comme une aiguille et partiellement détruit. Elle connaissait bien la légende, naïve comme une image enfantine, du boulet de canon anglais que la Vierge outragée de la chapelle avait renvoyé sur le vaisseau insolent, le coulant aussi sec… Bof ! Elle sourit toute seule de son jeu de mots involontaire. Et, tandis qu’elle se remémorait ses travaux d’Histoire sur la bataille de 1694 et sa thèse qui avançait doucement, elle retrouvait ses esprits au fur et à mesure qu’elle puisait des forces dans un verre de cidre et une troisième crêpe, au citron celle-là. Elle pensa à Mamy qui serait si heureuse de se retrouver à cette place et de contempler ce vivant tableau. Puis décidant d’aller à la chapelle dans l’après-midi, ou peut-être le lendemain, elle demanda l’addition et paya son repas au garçon rougissant. Elle ferait d’abord un détour par la Maison de la Presse pour essayer de trouver un livre expliquant précisément ce nom qui sonnait à la fois comme un cri d’amour et comme un cri de guerre : Rocamadour.
VI
Pierre Marceau était bien ennuyé. Puisqu’il habitait à Larroque, c’était lui qu’on avait appelé en premier et il était revenu aussitôt de la gendarmerie de Figeac. Il s’était donc retrouvé assez vite sur les lieux, suivi de très près par les spécialistes des services scientifiques.
Considérant par contre que les vivants doivent avoir la priorité sur les morts, le médecin, qui était loin à cause de ses visites, était arrivé nettement plus tard. Lequel médecin, toujours en vertu du même principe, s’était d’abord occupé de Lucienne Lacombe, allongée sur son lit dans la pénombre de sa chambre aux volets mi-clos. La malheureuse récupérait plutôt mal de l’émotion que lui avait causée la découverte du cadavre. « Vous vous rendez compte, Docteur », gémissait-elle, « il m’a attrapée par la jambe ! Avec sa main glacée ! Et même qu’il était tout nu ! Mais c’est la mort qui m’a attrapée ! » « Mais non, Lucienne, mais non, les morts n’attrapent pas les vivants, c’est le contraire qui arrive. Quant à celui-là, il va bien falloir trouver qui c’est qui l’a attrapé… » Et avant de s’occuper du corps martyrisé, le docteur Malbec avait réconforté la pauvre femme en lui conseillant d’aller, pour commencer, boire une bonne rasade de vin de noix. « Vous en avez sûrement en réserve dans votre buffet. Après ça, je vous ferai une ordonnance. » « Oui, oui » avait répondu pour elle son mari, « et té, je vais en prendre un verre avec elle, ça va nous rebiscouler. » Et Firmin avait tout de suite voulu servir sa Lucienne en se disant qu’il y a quand même, il faut bien le reconnaître, des médecins nettement plus compétents que d’autres.
Remettant ses lunettes qu’il portait attachées par un lacet autour de son cou, Malbec avait ensuite examiné le cadavre et aussitôt marmonné qu’il n’était évidemment pas question de permis d’inhumer. Puis, comme il regardait les entailles profondes aux poignets et aux chevilles, il avait conclu que la victime n’avait pas pu se faire ça toute seule, ni en tombant de la tour. Donc l’homme avait d’abord été saigné à blanc, l’expression pouvant surprendre puisque le corps était d’un bleu presque verdâtre là où les contusions occasionnées par la chute n’avaient pas arraché la peau. Donc, et c’était la deuxième conclusion, celui qui avait fait ça n’avait pas pu accomplir sa besogne sur place. À moins que ce ne soit quelqu’un du château, mais on sentait bien que Malbec ne pouvait pas le croire. Du reste, ce serait certainement facile à vérifier, vider un homme de son sang laisse forcément des traces abondantes, souvent même un peu partout, et de surcroît particulièrement difficiles à faire disparaître. De plus, la victime était un homme d’au moins un mètre quatre-vingts et plutôt corpulent. Celui qui l’avait transporté ne pouvait être qu’un costaud. L’heure de la mort remontait approximativement à la veille au soir ou dans l’après-midi. C’est-à-dire une douzaine d’heures environ avant que le père Lacombe ait observé la défenestration. Malbec consignait ses conclusions, il ne pouvait pas en dire plus dans ces conditions. Ce serait donc maintenant au médecin légiste de Toulouse d’examiner le supplicié et d’en apprendre davantage aux enquêteurs.
Pierre Marceau regardait travailler le médecin et il était décidément bien ennuyé. Il appartenait quant à lui à cette génération de gendarmes qui n’avaient pas forcément une véritable vocation pour ce métier mais s’y étaient engagés surtout parce que c’était un des rares secteurs où l’on embauchait régulièrement. Comme il n’était pas bête, il avait franchi assez rapidement les échelons en essayant de se considérer avant tout comme gardien de la paix. Puis, logique avec lui-même, il s’était porté volontaire pour la police de proximité dans les quartiers difficiles. Ainsi avait-il passé les premières années de sa carrière à essayer de communiquer avec les jeunes sauvageons des banlieues de la capitale. Puis, au moment où la politique de l’État s’orientait vers le tout répressif, Pierre Marceau avait été assez heureux pour obtenir sa mutation et revenir dans sa région d’origine. Certains de ses supérieurs le jugeaient sans doute un peu trop mou, mais il faisait son possible pour maintenir l’ordre en restant, autant qu’il le pouvait, proche des gens. Cela lui était d’autant plus facile désormais qu’il connaissait presque tout le monde, en particulier dans le secteur de Larroque. Là, il avait sa maison et il était allé à l’école en même temps que Casa et JG, ses deux copains du même âge que lui. Il était donc très ennuyé et ne cessait depuis une heure de se le répéter parce qu’il allait devoir traquer un criminel qui se dissimulait sans doute parmi une population qu’il aimait bien.
VII
Lorsque Jean-Gabriel eut fini son courrier, il était un peu plus de quatorze heures. Il posa les enveloppes sur la table de la cuisine. Des factures accumulées et quelques lettres, retardées par les cours et les corrections, à des directeurs de revues et différents spécialistes des poètes du vingtième siècle. Il se proposa de bricoler un casse-croûte avec ce qui restait dans le frigo avant de le dégivrer et il avait trouvé juste de quoi faire une omelette quand le téléphone sonna. Sans doute Nancy… Il décrocha et continua à battre les œufs qu’il venait de casser tout en gardant le combiné serré entre son oreille et son épaule. Il dit un « allô » qu’il estima, mais trop tard, un peu trop tendre comme il entendait une puissante voix d’homme fortement marquée d’accent du Midi et qui lui parut très énervée.
— JG ? C’est Casa.
— Ah salut ! Qu’est-ce qui se passe ? Tu as l’air…
— Il se passe qu’on est dans la merde, voilà ce qui se passe !
JG, soudain inquiet, posa son bol avec ses œufs à moitié battus et alla s’asseoir dans son bureau.
— Attends, Casa, pas si vite, explique-moi, tu as des ennuis ?
— Plutôt oui, on a un mort sur les bras, figure-toi !
— Comment ça, un mort ? Ce n’est pas quelqu’un de ta famille au moins ?
— Non, heureusement !
C’était un drôle de type, Casa. On pouvait se demander si les gens l’appelaient comme ça parce qu’il affectionnait tout particulièrement un apéritif dont le nom commençait par les mêmes syllabes ou parce qu’il avait eu autrefois un petit côté Casanova qui s’était totalement estompé avec les années. En réalité, il s’appelait Casaverde et ses ancêtres étaient piedsnoirs, mais plus personne ne s’en souvenait. Sauf sa mère avec qui il vivait maintenant, et peut-être aussi sa fille de douze ans, Chloé, qui était, depuis toute petite, amoureuse de JG. Les deux hommes se connaissaient depuis presque toujours pour avoir fréquenté la même école, à Larroque, où JG était un élève un peu distrait que Casa, cancre accompli mais qui avait grandi plus vite, avait pris sous sa protection dans la cour de récréation. Ils avaient joué ensemble dans les mêmes ruisseaux ou sur les collines du Causse, exploré les mêmes grottes, partagé aussi pas mal de punitions.
— Calme-toi, Casa, s’il te plaît. Explique-moi. Qu’est-ce que c’est que ce mort ? C’est un peu normal qu’il y ait des morts ici ou là. Non ? Et d’abord qui est-ce ?
— Mais c’est ça qu’on sait pas justement !
Casa non plus ne mettait jamais les « ne » dans les négations. C’était bien sa seule ressemblance avec Nancy d’ailleurs.
— Et en quoi ça te concerne, ça nous concerne ?
— Eh mais, justement, on sait pas !
— Calme-toi, je te dis. Et raconte depuis le début, s’il te plaît.
— C’est le père Lacombe, tu sais, Firmin, qui habite juste sous le château. Eh bé, ce matin, il a trouvé un mort. Il était tout nu. Le mort pardi, pas Firmin.
— Mais attends, tu veux dire : un mort, assassiné ?
— Ben oui !
Il y eut un silence, le temps pour JG de mesurer la portée des paroles qu’ils venaient d’échanger.
— Oui, bien sûr, c’est embêtant. Mais, dis-moi, pourquoi ça te bouleverse comme ça ? Ça n’a rien de réjouissant mais quand même…
— Mais parce qu’on va tous avoir des emmerdements, c’est plus que certain ! La police est déjà là et ils interrogent tout le monde. Même moi ils m’ont interrogé, alors…
— Mais tu n’as rien à voir avec ça, n’est-ce pas ?
— Bien sûr que non, mais tu sais, la police… Ils ont vite fait de te soupçonner. Et moi, avec l’auberge, il faut comprendre, c’est pas bon pour l’image de marque. Tu devrais venir, JG.
— Moi ? Mais pour quoi faire ?
— Eh bé, je sais pas trop, mais pour nous aider quoi ! C’est bien toi qui as découvert le coupable dans cette affaire en Bretagne…2
— Mais non, voyons ! Je t’ai déjà dit que je n’ai rien découvert du tout.
— C’est pas ce que disaient les journaux à ce moment-là.
— Allons, tu sais bien comment sont les journalistes. En réalité, je n’ai rien fait. Je t’assure. C’est une pure coïncidence qui m’a fait découvrir un coupable…
— Ah, tu vois !
— Non, Casa, s’il te plaît, ne va pas imaginer n’importe quoi parce que ça t’arrange. Je n’ai pas fait une enquête, je n’ai rien d’un détective. Le hasard, tu comprends ? C’est le hasard qui m’a mis le nez sur la vérité dans une histoire à laquelle je me suis trouvé mêlé par hasard, un point c’est tout.
— Ouais, tu dis ça, n’empêche que j’aimerais bien que tu viennes, tu es plus malin que moi, et moi je peux rien faire. Je suis coincé par le boulot. Tu nous aiderais. Tu vas pas dire non, pour une fois qu’on a besoin de toi !
— Mais puisque je te dis que… Et puis je dois partir demain matin, en Bretagne justement. Nancy m’attend et…
— Ah, elle s’appelle Nancy ? Tu nous l’as même pas présentée, alors…
— Casa, je t’en prie, ne sois pas de mauvaise foi, je n’en ai pas encore eu le temps, c’est tout, et tu sais très bien qu’elle s’appelle Nancy.
— Eh bé, alors viens avec elle, comme ça, c’est encore plus simple.
— Mais elle m’attend en Bretagne. Tu peux comprendre ça au moins, c’est tout à l’opposé.
— Alors tu nous laisses tomber ? On est dans les pires ennuis et tu nous laisses tomber, pour aller à la mer ?
— Tu n’as pas le droit de dire ça, voyons, c’est enfantin. Bon, je vais réfléchir. Laisse-moi au moins le temps de réfléchir, tu veux bien ?
— Oui, mais alors réfléchis vite, parce que, ici en attendant, ça va vraiment mal.
— Et ce mort personne ne sait qui c’est ? Personne ne le connaît ?
— Té, tu vois que ça t’intéresse ! Non, personne le sait. Même la police le sait pas. Viens, JG, s’il te plaît !
— Je te rappelle dans une heure.
— Merci JG, ah, j’étais sûr…
— Hé ! Je n’ai pas dit que je venais ! Seulement que je te rappelle.
— C’est pareil, je suis sûr que tu vas venir. Je te connais, JG, mieux que tu crois.
— Arrête, s’il te plaît ! À tout à l’heure…
Jean-Gabriel coupa la communication et retourna dans la cuisine où l’attendait son omelette. Machinalement, il reprit le bol et finit de la préparer.
Profondément troublé par l’étonnante conversation qu’il venait d’avoir, il mangea debout avec un morceau de pain de la veille et finit ce repas bâclé par une pomme.
Il n’avait plus faim, les propos de Casa lui avaient coupé l’appétit, et, en même temps qu’il faisait la vaisselle, il tâchait d’envisager tous les aspects de la situation. Les questions se bousculaient. Qui pouvait bien être ce mort ? Quelqu’un de Larroque, qu’il connaissait peut-être ? Et dans un cas semblable aurait-il lui-même appelé un ami ? Et qu’aurait-il pensé s’il s’était heurté à un refus ? Une chose était certaine, s’il avait crié au secours, Casa serait arrivé sans attendre. Il fallait d’abord appeler Nancy.
2 Lire Brume sur la Presqu’île, même collection, mêmes éditions.
VIII
Nancy marchait dans les rues de Camaret, il était un peu plus de quinze heures. À la Maison de la Presse, sur la place Saint-Thomas, elle s’était soudain rappelé que c’était là que ses grands-parents paternels s’étaient rencontrés, lui en uniforme de l’armée allemande et elle, jeune institutrice sympathisante du défunt Front Populaire. Évidemment, la librairie n’était plus du tout la même ; pourtant, il lui avait semblé les voir un instant, tous les deux bouleversés par cette rencontre tellement inattendue. Puis la vision s’était effacée, elle était revenue sur terre. En fouillant dans les rayons, elle avait trouvé un petit fascicule d’une quinzaine de pages qu’elle avait aussitôt feuilleté. C’était une Histoire de Camaret dont tout un chapitre était consacré à la chapelle de Rocamadour. Elle demanda s’il existait d’autres documents expliquant la parenté avec Rocamadour en Quercy. Comme on lui répondait que non, elle jugea que cela suffirait pour le moment et décida de remettre au lendemain sa visite à la chapelle, quand elle aurait eu le temps de consulter ce livre. Elle se dépêcha de payer parce qu’un grand type en costume noir, sans doute un représentant, qu’elle ne prit pas le temps de détailler, attendait juste derrière elle.
Il faisait très chaud sur la place, devant la librairie, et, au lieu de rejoindre le port en plein soleil, elle choisit de passer dans les ruelles en longeant les maisons au plus près, comme faisaient à cette heure presque tous les passants qui cherchaient un peu d’ombre. Elle avait entendu plusieurs personnes se plaindre de la chaleur et s’amusait de constater que les Bretons, quoiqu’ils affirment le contraire, n’aiment jamais autant leur Bretagne qu’avec son crachin et ses averses entrecoupées de ciel bleu. Elle-même était presque sûre de préférer les ciels des tableaux de Boudin à ceux, trop éclatants, des cartes postales.
Elle s’était changée en arrivant le matin, mais quelque chose d’encore plus léger que son tee-shirt lui aurait fait plaisir. Elle arriva sur le quai où la faible brise de mer passée sur la marée descendante rafraîchissait à peine l’haleine brûlante qui montait des pavés surchauffés. Au Vauban, le bar était vide, tout le monde ayant choisi la terrasse pour déguster une glace ou un café, à l’ombre plus que tiède du grand store en toile bleue. La jeune fille qui faisait le service lui proposa en souriant une table à l’intérieur.
— Il n’y a plus de place dehors.
— Je vois. Léo et Anne-Marie sont pas là ?
— À cette heure, ils se reposent un moment. Ils se lèvent à cinq heures tous les matins, ça fait des journées très longues. Vous êtes Nancy, n’est-ce pas ?
— Oui, comment vous savez ? Ils vous ont dit ?
— Non, enfin, je savais que vous alliez venir. Vous êtes presque une célébrité ici.
— J’aurais préféré pas du tout, mais j’espère qu’on va oublier bien vite qui je suis. Et vous ?
— Moi, c’est Anaïs. Vous voulez boire quelque chose ? Ou une glace ?
— Un café seulement, je crois que je vais aller me baigner après. En fait, j’en ai même très envie.
Elle était contente de parler à quelqu’un et Anaïs était gracieuse. Nancy la vit préparer le café dans le reniflement du percolateur qu’elle se rappela aussitôt. Elle se revit à la même place en hiver. Tout était soigneusement fermé alors. Il pleuvait sur les baies vitrées et, terrorisée, elle se tassait sur sa chaise comme pour éviter des coups. Elle n’avait pas encore fait la connaissance de JG, à peine si elle avait remarqué ce grand garçon brun, plutôt pas mal, qui lui avait fait un gentil sourire. Anaïs l’interrompit dans sa rêverie en posant une tasse sur sa table.
— Voilà le café.
Elle remercia et se détendit. Une vague de tendresse la fit sourire aussi en pensant à Jean-Gabriel. Mais pourquoi ne l’appelait-il pas ?
— Vous voulez vous baigner où ?
— Oh pardon, je rêvais. Là, à côté, pourquoi ?
— À Corréjou ? Moi, je n’aime pas beaucoup, il y a tellement de monde. La marée descend, mais c’est encore très serré. Remarquez que ça ne me regarde pas.
— Si, c’est sympa. Et vous, où allez-vous ?
— Je vais à Veryach, Bien sûr, c’est un peu plus loin, mais c’est plus joli. Si vous avez le temps…
— Et la grande plage ? À côté, là où il y a les grottes ? Celle qui est magnifique.
— Penn-Hat ?
— Juste en dessous des ruines du manoir de Saint-Pol-Roux.
— Oui, ça s’appelle Penn-Hat. C’est un peu dangereux, il y a des courants. Je ne suis pas très courageuse dans l’eau et là, il y a tous les ans des gens qui se noient. Mais à Veryach, c’est joli aussi et la plage est sans danger.
Anaïs lui expliqua l’itinéraire qui lui parut très simple et Nancy monta dans sa chambre pour se changer. Nue, elle s’étira en se regardant quelques secondes dans le miroir. Se dit qu’elle était vraiment très blanche et mit dans son sac de plage un flacon de crème solaire. Puis elle enfila son bikini et un petit chemisier à bretelles d’un bleu sombre tirant sur le violet comme ses yeux. Elle passa ses mains sur ses épaules et ses hanches, pensa aux mains de JG et posa son portable dans son sac. Son pantacourt blanc dessinait le galbe de ses cuisses, c’était joli, décida-t-elle. Elle regarda le lit. Demain, ils allaient se retrouver et faire l’amour. Presque six semaines de chasteté depuis qu’il était reparti après quelques jours ensemble, chez elle, en Angleterre… Elle sourit à ce souvenir.
Par la fenêtre ouverte montait la rumeur de la rue. Piétinement des passants, conversations à la terrasse, éclats de rire, et toujours quelques coups de klaxons impatients. Au-delà de la tour Vauban, juste en face, sous le ciel impassible, elle regarda la grève de Trez Rouz et pensa encore à Marie qui était jeune fille alors, une bonne soixantaine d’années plus tôt… elle se demanda vaguement pourquoi ces souvenirs remontaient soudain en foule. Mais c’était bien normal en revenant sur les mêmes lieux, et puis elle était fatiguée, sans doute plus accessible aux émotions. Elle avait sommeil. Presque le vertige en regardant les remous de la foule. Le goéland, revenu sur le lampadaire, juste en face, la réveilla complètement par son battement d’ailes. Il la regardait. Elle quitta sa fenêtre, prit son sac et sortit rejoindre sa voiture en pensant qu’il fallait la ramener le lendemain matin à l’agence de location.
Les explications d’Anaïs étaient claires ; dix minutes plus tard, Nancy descendait vers la plage de Veryach par l’étroite route sous les immenses pins parasols. Elle eut la chance de trouver tout de suite une place où se garer, face à l’océan dont les vagues dessinaient une anse d’écume éclatante et régulière. Les Tas de Pois, le nom de ces trois grands rochers sur la droite lui revint en mémoire. Sur la gauche, les falaises sinuaient au-dessus du rivage et des promeneurs parcouraient le sentier de douaniers. Une baraque en bois toute simple abritait un petit restaurant où les baigneurs en maillot de bain s’étalaient sous des parasols. Descendant les marches qui conduisaient à la plage, elle s’assura de n’avoir pas oublié son livre sur Rocamadour et Camaret. Ni son portable. Toujours aucun appel de JG et elle commençait à s’inquiéter, même si elle se reprochait d’être aussi nerveuse depuis le matin. Marcher sur le sable fin lui fit plaisir cependant. L’envie de se baigner aussitôt le disputait à la tentation de faire une sieste alors que la marée, presque basse maintenant, libérait un immense croissant, éblouissant de soleil, où trouver de la place pour étaler sa serviette. L’océan respirait doucement d’un souffle régulier et lointain. Tout près du rivage, quelques voiliers amarrés se balançaient à peine sur une houle imperceptible. Des baigneurs sautaient dans les vagues en criant. Des enfants glissaient sur l’eau, sur des planches minuscules. Une plage de Bretagne en été.