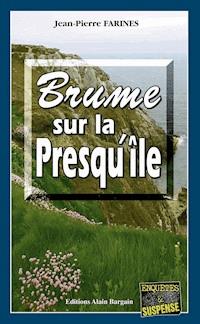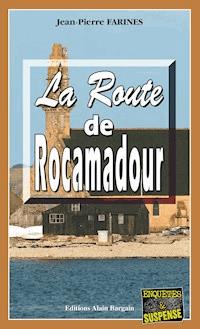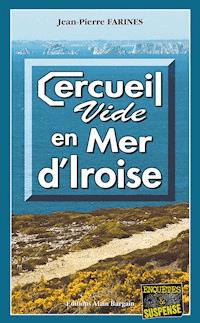
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un pacte qui n'a pas que des bons côtés...
La femme s’était penchée sur leur table, comme une ombre surgie de nulle part dans ce paisible début de soirée.
— Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Toirac ?
— Euh… oui en effet, pourquoi ?
Oui, pourquoi ? Pourquoi avoir accepté ce “contrat” ? Et pourquoi depuis ces impressions désagréables d’être suivi, épié ?
Jean-Gabriel Toirac se demandait s’il avait les nerfs malades, s’il imaginait cette présence, à certains moments, jusque dans sa maison. Mais alors pourquoi ces agressions et ces morts inattendues ? Maintenant, il avait peur…
Un polar sur les côtes bretonnes qui vous laissera le souffle coupé !
EXTRAIT
Une pièce de théâtre. Des notes, des scènes partiellement rédigées et reliées entre elles par des phrases plus ou moins claires parce que celui qui les avait écrites avait suivi sa propre pensée et n’avait évidemment pas imaginé qu’un autre, un jour, beaucoup plus tard, s’aviserait de reprendre son travail pour le continuer. Le tout écrit en très bon français cependant, avec même ici et là des trouvailles qui laissaient entrevoir un esprit imaginatif, réellement ouvert à l’humour et à la poésie. Mais, faute de pouvoir parler avec l’auteur, il devenait chaque jour plus difficile de se mettre à sa place, de s’identifier à lui. Et l’ensemble demeurait désespérément confus, de plus en plus même au fur et à mesure que Jean-Gabriel cherchait à se glisser dans ce scénario pour en rassembler les fils, en compléter les blancs, en deviner les intentions. Tout ce qu’il avait lui-même rajouté semblait rompre le rythme du texte qui se refusait à lui. Ce jour-là, la tâche lui semblait plus que jamais rebutante, et finalement impossible. Son attention vagabondait, se dispersait aux moindres prétextes. Le temps passait à ne rien faire que regarder le spectacle de la ville et l’activité ralentie du port.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Pierre Farines vit en Auvergne et en Allemagne. Poète, éditeur d'une revue de poésie et homme de théâtre, il est aussi amoureux de la presqu'île de Crozon. C'est son deuxième roman policier.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Debout derrière la baie vitrée encore embuée par la fraîcheur matinale, il suivait du regard les nuages noirs, poussés vers l’est au-dessus de la presqu’île par la brise du large. Les beaux nuages qui dessinaient un arc de cercle parfait tandis que le soleil d’octobre jouait sur l’anse verte, sur l’eau bleu foncé dans le port, sur les silhouettes des bateaux blancs finement ciselées. Comme une photo de calendrier. Jean-Gabriel Toirac s’était levé tôt pour travailler mais ce matin, son attention était ailleurs et il se surprit plusieurs fois à rêver, son regard allant se poser malgré lui sur l’emplacement, vers la sortie du port, où naguère était amarrée la Madrugada1. Il en faisait fréquemment des cauchemars. Plus de dix-huit mois s’étaient écoulés depuis l’explosion qui avait failli coûter la vie à Nancy et à toute sa famille. À lui aussi par la même occasion. Déjà un an et demi et les blessures physiques, mais plus encore psychologiques, n’en finissaient pas de se refermer. Fatigué, il avait du mal ces derniers jours à se tenir vraiment droit et s’obligeait à remuer sa grande carcasse bien qu’il n’en eût pas la moindre envie.
Il revint se mettre au travail en se mouchant énergiquement parce que depuis presque une semaine il était enrhumé et n’arrêtait pas de renifler. Tout allait de travers, c’était ainsi qu’il le voyait. Il s’assit à la table dont il avait fait son “bureau”. Les guillemets s’imposaient car ce bureau n’était ni plus ni moins qu’une vieille table de cuisine en bois, recouverte d’une toile cirée vieux rouge pour en cacher les éraflures, qu’il avait tirée jusque-là et sur laquelle s’étalaient en bataille des documents et des stylos. Et évidemment le manuscrit sur lequel il s’efforçait vainement de travailler. Il soupira en regardant les feuilles griffonnées de la veille qu’il froissa avant de les jeter dans la corbeille à papier.
Juste à côté du bureau, face à la porte-fenêtre, il avait également disposé une tablette ergonomique, pour son ordinateur portable et un clavier. Il travaillait le moins possible sans cette installation qui lui évitait d’avoir trop vite mal dans le dos. « Se tenir droit », avait vivement recommandé le médecin, pour ne pas provoquer les fréquentes douleurs musculaires consécutives au vol plané que lui avait values l’explosion avant de retomber contre un arbre beaucoup plus solide que lui.
Ça se calmait lentement et les crises s’espaçaient, il en était certain, mais toutes ces dernières nuits il s’était réveillé avec des contractions et des courbatures dues au moins autant à la peur encore tapie dans son subconscient qu’à la fatigue physique. Alors il se soignait tout en restant persuadé que le vélo et la natation lui faisaient plus de bien que les antalgiques qu’il prenait très irrégulièrement.
Il se redressa et tenta de fixer son attention sur le manuscrit qu’il relisait pour la énième fois. Un vieux classeur à glissières, au format depuis longtemps périmé où s’étalait, sur la couverture, d’un vert délavé par le temps, la marque Héraklès avec l’image du héros antique un genou en terre et pointant son arc vers le ciel sur une cible connue de lui seul, vraisemblablement les horribles oiseaux du lac Stymphale. Des oiseaux de cauchemar, comme le phénix. Un vieux classeur, ouvert à ce moment-là, et, sur les feuilles jaunies qui en sortaient, le texte qu’il commençait à connaître par cœur, y compris les blancs et les ratures. Un manuscrit incomplet, c’est-à-dire la photocopie d’un manuscrit, des fragments séparés ici et là par des vides sur lesquels il aurait dû travailler puisqu’il s’était levé avec cette intention et qu’il était payé pour ça. Mais depuis plusieurs jours, le projet semblait lui échapper, s’éloigner de plus en plus dans un flou insaisissable et décourageant.
Une pièce de théâtre. Des notes, des scènes partiellement rédigées et reliées entre elles par des phrases plus ou moins claires parce que celui qui les avait écrites avait suivi sa propre pensée et n’avait évidemment pas imaginé qu’un autre, un jour, beaucoup plus tard, s’aviserait de reprendre son travail pour le continuer. Le tout écrit en très bon français cependant, avec même ici et là des trouvailles qui laissaient entrevoir un esprit imaginatif, réellement ouvert à l’humour et à la poésie. Mais, faute de pouvoir parler avec l’auteur, il devenait chaque jour plus difficile de se mettre à sa place, de s’identifier à lui. Et l’ensemble demeurait désespérément confus, de plus en plus même au fur et à mesure que Jean-Gabriel cherchait à se glisser dans ce scénario pour en rassembler les fils, en compléter les blancs, en deviner les intentions. Tout ce qu’il avait lui-même rajouté semblait rompre le rythme du texte qui se refusait à lui. Ce jour-là, la tâche lui semblait plus que jamais rebutante, et finalement impossible. Son attention vagabondait, se dispersait aux moindres prétextes. Le temps passait à ne rien faire que regarder le spectacle de la ville et l’activité ralentie du port.
Le soleil et ses reflets, jouant sur la surface miroitante de l’eau, entraient maintenant dans le salon, projetant des ombres et des éclats de lumière sur les murs et le plafond. C’était une pièce fort agréable qu’on avait agrandie et modernisée en abattant la mince cloison qui la séparait autrefois de la petite cuisine. Le tout meublé avec sobriété, deux fauteuils et une table basse, et éclairé par quelques tableaux riches en couleurs, des originaux signés Le Rohellec et Morinay. Une pièce à vivre, comme disent les architectes, d’autant plus agréable que la porte-fenêtre donnant sur un balcon s’ouvrait largement sur le ciel, les falaises audessus de la ville encore colorées par la bruyère, le port, le Sillon filant tout droit jusqu’à la chapelle de Rocamadour et la tour Vauban surveillant toute la baie.
— C’est bien beau mais il faut que je m’y mette.
Il alluma l’ordinateur et se leva pour aller se préparer un café bien serré pendant que le programme s’initialisait. Il avait pris froid l’avant-veille en allant se baigner à Veryach malgré la température automnale et l’eau déjà très fraîche. Quinze degrés, il aimait ça et nageait chaque jour, au moins quelques minutes, vigoureusement pour mieux se réchauffer. Cette fois pourtant, le vent était glacé quand il était sorti de l’eau, il n’avait pas réussi à se réchauffer et à éviter le rhume. Son manque d’entrain venait au moins en partie de là. La petite machine à café commença à se racler la gorge, comme si elle s’était enrhumée elle aussi, par solidarité. Il revint vers l’ordinateur pour entrer dans la messagerie, retourna chercher le mug qui entretemps s’était rempli. Autrefois il aurait dit la tasse. « Le mug ! Voilà ce que c’est, pensa-t-il en reniflant, de partager sa vie avec une Anglaise. »
Il but une première gorgée qui lui ébouillanta les papilles, en regardant l’écran où s’affichait un seul nouveau message qu’il ouvrit aussitôt. C’était un rituel bien établi entre lui et Nancy quand ils n’étaient pas ensemble sous le même toit. Un petit bonjour par courriel le matin et, chaque soir, une conversation de vive voix devant la webcam. Le message était bref : « Salut JG. As-tu bien dormi sans moi dans ton grand lit ? Moi j’aime pas être seule. I kiss you. Love. Nancy. » Elle l’appelait JG plutôt que Jean-Gabriel, comme la plupart de ses proches et se fichait éperdument de ses fautes de français, très peu nombreuses à vrai dire mais obstinément répétées comme cette absence de « ne » dans ses phrases négatives.
Il resta un moment à fantasmer. Quelques images érotiques traversèrent la pièce en 3D, Nancy en très petite tenue, c’est-à-dire pas de tenue du tout, qui passait devant lui en riant et en esquissant un pas de danse. Et aussi ses yeux violets, tout près et encore agrandis par le plaisir. Il arrêta le film et rédigea une réponse : « J’ai bien dormi mais tu me manques etc. »
En réalité il avait passé une très mauvaise nuit et rêvé que quelqu’un était entré dans la maison, qui l’avait poursuivi en le menaçant, quelqu’un dont la respiration rauque faisait penser à un animal… Il avait effacé le reste en se réveillant. Il continua néanmoins à converser par écrit sur le ton joyeux qui était la note dominante de leur complicité amoureuse et que les événements n’avaient fait que renforcer. C’était du moins ce qu’il s’efforçait de croire. Puis, le message expédié, il revint aux choses sérieuses en soupirant bruyamment parce que ça lui semblait beaucoup moins sérieux justement. Rapidement il parcourut les notes qu’il avait déjà enregistrées avant d’éteindre l’ordinateur et de revenir à la contemplation du manuscrit en sirotant le café qui commençait à refroidir.
Et aussitôt, comme chaque fois qu’il se mettait au travail, l’inquiétude ressurgit. À nouveau il se laissa distraire par le spectacle des nuages qui avançaient au-dessus de la baie et obscurcissaient maintenant le ciel. L’éclaircie avait été de courte durée, dehors comme dans sa tête. Il ne se sentait pas du tout en forme, oui, mais il savait obscurément pourquoi. Le rhume était une chose et les blessures du passé en étaient une autre, mais ces jours-ci avait lieu la rentrée universitaire et cette pensée, qu’il essayait vainement de repousser au second plan, ravivait quantité de questions embarrassantes.
De plus en plus chaque jour, il craignait d’avoir fait une erreur, pour ne pas dire une folie et Nancy n’en parlait plus, ce qui expliquait peut-être la brièveté de ses messages, alors que pendant les mois récemment écoulés elle ne lui avait pas caché sa façon de penser. Elle jugeait carrément stupide la décision de JG de prendre une année sabbatique pour pouvoir finir sa thèse sur Saint-Pol-Roux, sur place, ici, à Camaret. Parce que, elle en demeurait persuadée, la thèse n’était au fond qu’un beau prétexte, et il savait qu’elle avait raison. Ce qui avait motivé cette décision n’était pas totalement étranger à la volonté de passer une année entière à Camaret, d’y respirer pendant plusieurs saisons l’atmosphère de la presqu’île où le Magnifique2 avait écrit la majeure partie de son œuvre. Mais la vérité, dissimulée sous les faux-fuyants qu’il avait savamment entretenus, était bien différente. Et depuis quelques jours, parce que la difficulté devenait plus évidente de remplir son contrat, les véritables raisons de son choix lui apparaissaient plus clairement. Impitoyablement. Cependant au tout début, rien ne l’avait inquiété.
Les vraies raisons de cette fuite, s’il était sincère avec lui-même, il savait très bien les formuler maintenant, c’étaient le désir de changement, la grande fatigue dont ils n’étaient pas encore remis ni l’un ni l’autre et, dans la perspective de la rentrée, la lassitude face à un métier d’enseignant dont les conditions n’en finissaient pas de se dégrader. Plus secrètement encore il devinait en lui un attrait puissant, malsain selon Nancy, pour les énigmes. Une tentation sournoise et de plus en plus forte de jouer les profileurs. Et c’était excitant parce que Jean-Gabriel Toirac avait un trait de caractère bien particulier, lui qui doutait si facilement de lui-même voulait toujours savoir, comprendre, expliquer. Voulait des certitudes. Un travers d’universitaire, se disait-il dans ces moments-là comme si c’était une excuse alors que, cette fois précisément, il fuyait l’Université. Les affaires auxquelles il s’était trouvé mêlé, jusque-là malgré lui, l’avaient amené à croire qu’il possédait peut-être une capacité d’intuition particulière, lui permettant de flairer des indices là où d’autres ne devinaient rien. Et il s’accusait de vanité mais en même temps, il ne comprenait plus très bien l’intérêt de ce manuscrit. Qu’est-ce qui l’avait retenu ? Qu’avait-il remarqué ou seulement pressenti qui l’avait secrètement troublé au plus profond de lui-même ? Comme un signal encore invisible d’une secrète détresse, le choix avait fini par s’imposer. Il s’était vu prendre des décisions contestables et s’engager avec détermination dans ce qui ressemblait de plus en plus à un piège.
Et malgré toutes ces réserves et ces hésitations, il continuait à croire qu’il faut rester attentif à ce niveau de la pensée qui travaille à notre insu, qu’il est juste de faire attention à ces avertissements secrets, même si le plus souvent ils demeurent pour toujours indéchiffrables. Cela pouvait se comprendre aussi bien dans les deux sens. Pour et contre lui-même.
Le soleil était revenu sur la ville et le port. Il finit son café, maintenant tout à fait froid, en se reprochant de se poser comme d’habitude beaucoup trop de questions. Mais après tout il était fait comme ça et peut-être y avait-il quand même dans son entêtement comme dans ce texte inachevé quelque chose, d’incompréhensible encore, mais d’assez puissant et singulier pour avoir retenu son attention. Sinon pourquoi vouloir à tout prix achever le manuscrit d’un mort ?
1 Lire Le phénix est mort à Camaret, même collection, même éditeur.
2 Surnom donné à Saint-Pol-Roux.
II
Fin juillet 2001, c’est-à-dire à peu près un an et demi plus tôt, ils sortaient de l’hôpital et avaient pris, Nancy et lui, quelques semaines pour se reposer à Camaret, à l’Hôtel Vauban. C’était juste après la mort du Phénix, à ce moment-là, on en parlait encore un peu partout dans la presse et dans les salons. Eux tentaient d’exorciser ensemble les démons qui les avaient quelque temps poursuivis menaçant de les posséder. Ils s’étaient bien promis de ne plus se laisser prendre aux obscures malédictions d’un passé qui n’était pas vraiment le leur. Élucidée et définitivement classée par la police, l’affaire qui avait un moment menacé toute la famille de Nancy laissait désormais ouvertes devant eux les perspectives d’un avenir paisible, plein de promesses agréables. Un mois s’était écoulé, Nancy n’allait plus tarder à repartir en Angleterre où l’appelaient sa famille et son travail. C’est à ce moment-là précisément que cette femme était venue les voir.
Une drôle de bonne femme à vrai dire. À la silhouette trapue, pas très grande et assez mal fagotée, c’est-à-dire plus exactement vêtue de fringues coûteuses qui n’allaient pas ensemble ou, simplement, ne lui allaient pas du tout et la faisaient paraître plus grosse qu’elle n’était. Vingt kilos de trop aurait-on dit, et un visage dont JG avait d’abord attribué la rougeur à l’é-motion ou peut-être à l’abus d’alcool ou de tabac, ou les trois, parce qu’elle parlait avec une voix de rogomme et ponctuait ses phrases de raclements de gorge. Une drôle de bonne femme donc. Ainsi leur était-elle apparue à la terrasse du Vauban où ils prenaient un verre, sur le quai du Styvel, par une fin d’après-midi encore ensoleillée qui sentait déjà un peu les langueurs de la fin du mois d’août. Par grappes pittoresques, les touristes déambulaient paresseusement sur le Sillon, jusqu’à la chapelle de Rocamadour, et flânaient sur le port en promenant des enfants et des chiens à peine plus gros que des rats, prenant des quantités de photos dont, aussitôt rentrés chez eux, ils fatigueraient leurs familles et leurs amis. L’air était léger, la lumière magnifique, transparente comme aux plus beaux jours des peintres impressionnistes qui avaient un siècle plus tôt fréquenté Camaret. Puis la femme s’était penchée sur leur table, comme une ombre soudaine, surgie de nulle part dans ce paisible début de soirée.
— Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Toirac ?
— Euh… oui en effet, pourquoi ?
Sur son bras, Jean-Gabriel avait senti la main de Nancy qui se crispait, voulait l’avertir d’une menace encore invisible et sur le point de se matérialiser.
— Excusez-moi, avait répété la femme, hum… je ne voudrais pas vous déranger. Pourriez-vous m’accorder quelques minutes, ce ne sera pas long. Enfin… hum… je ne crois pas.
Cette promesse embarrassée ne pouvait être qu’innocente bien que JG pensât que ce genre de propos signifie exactement le contraire de ce qu’il prétend. Il pensa aussi qu’ils étaient devenus, lui et Nancy, beaucoup trop sensibles au moindre événement un peu inattendu, réagissant trop souvent par des peurs irrationnelles et tout à fait disproportionnées avec leurs causes.
D’un geste il indiqua, en face d’eux, le fauteuil qui tournait le dos à la circulation. L’étrange femme s’y installa aussitôt, tandis que fébrilement elle extrayait d’un vaste sac de plage en toile de jute, une enveloppe kraft grand format qu’elle posa entre eux sur la table.
Un physique de chauffeur routier, se dit encore Jean-Gabriel avec une pointe de cruauté, en même temps qu’il se reprochait ces pensées peu charitables et remarquait les yeux, très beaux, légèrement maquillés, d’un noir profond et pleins d’une étrange douceur, qui contrastaient avec des manières presque viriles et une apparente rudesse.
Il se demanda un instant s’ils n’avaient pas tout simplement affaire à une folle.
— Bon… hum… Voilà. Pardonnez-moi, je ne sais pas trop par où je dois commencer.
Et sans autre préambule, sans même avoir songé à se présenter, elle s’était lancée dans des explications. Un récit, d’abord décousu et à peine compréhensible, qui s’était fait plus précis à mesure qu’elle entrait dans ses souvenirs et gardait jalousement une main aux ongles délicatement vernis sur la mystérieuse enveloppe que pour finir elle avait poussée vers Jean-Gabriel.
— C’est l’original, avait-elle alors précisé en extrayant de son enveloppe un vieux classeur qu’elle manipulait avec délicatesse, peut-être avec amour, comme une relique infiniment précieuse, presque sacrée. C’est… le manuscrit de Vincent… hum – et à ce moment-là c’était l’émotion qui enrouait sa voix – voilà, c’est-à-dire qu’il est incomplet. Il l’a écrit… hum… quand il était en Algérie. C’est un scénario, enfin vous verrez, c’est le texte, enfin une partie seulement, d’une comédie. C’est-à-dire la plus grande partie. Enfin, je crois.
Jean-Gabriel et Nancy écoutaient, soudain très attentifs au récit et davantage encore aux intonations tandis que le passé resurgissait devant eux dans les yeux et la voix de la femme. Encouragée par leur silence, elle continuait :
— Il me l’a envoyé par la poste…
— D’Algérie ?
Elle regarda JG comme si la question l’étonnait.
— Oui, c’est bien ça, je parle de la guerre d’Algérie. Il était soldat là-bas. J’ai reçu la lettre, je m’en souviens parfaitement, c’était juste quelques semaines avant qu’il soit libéré. Les accords d’Evian venaient de mettre fin à la guerre d’Algérie, vous comprenez ? Les accords d’Evian ont précipité sa libération et en plus, parce qu’il n’avait pas fait de prison, il avait eu droit à quinze jours de perme libérable, pour bonne conduite. C’est comme ça qu’on disait. Ça paraît très loin, mais pour moi c’est comme si c’était hier…
— Vous buvez quelque chose ?
La serveuse se penchait sur eux avec son plateau. Ils ne l’avaient pas vue venir parce qu’ils étaient maintenant tous les deux curieux d’en savoir davantage.
— Pardon ? Ah oui. Un muscat, avec un glaçon… hum… oui, je disais qu’il avait eu droit à une permission libérable. C’est-à-dire qu’il allait rentrer un peu plus tôt que prévu. Quinze jours peut-être. C’était bien parce que j’étais enceinte. Et puis…
Pendant une minute qui leur avait paru interminable parce qu’ils se sentaient subitement très gênés, elle s’était retirée dans un silence douloureux, le temps de refouler ses larmes, en se tournant sur le côté, et de renouer le fil de ses pensées.
— …donc, Vincent, je ne sais plus si j’ai dit que c’était déjà mon mari à ce moment-là, Vincent s’est embarqué avec tous les autres à Alger. Sur un vieux rafiot qui s’appelait le Charles Plumier, un tas de tôles qui faisait eau de tous les côtés et qui mettait deux fois plus de temps que les autres transports de troupe pour faire la traversée – elle se rappelait bien la description qu’on lui en avait faite depuis, et elle disait ça sur un ton particulièrement méprisant que la suite suffisait à expliquer – un vieux rafiot, oui, il n’est jamais arrivé à Marseille.
Un autre silence, seulement troublé un instant par la réapparition de la serveuse posant sur la table le verre de muscat où tintait doucement un glaçon. Un instant, elle regarda la femme, avec un soupçon de curiosité, presque de méfiance elle aussi, et laissa la note sous le pied du verre avant de s’éclipser.
— Les accords d’Evian, c’était il y a presque quarante ans ?
JG essayait pour lui-même qui n’était même pas né, et à plus forte raison pour Nancy, de situer les événements, de rassembler les fragments disparates du récit.
— En mars 62, oui. Vincent aurait dû revenir en mai. Et puis…
— Qu’est-ce que ça veut dire, intervint Nancy, qu’il est jamais arrivé à Marseille ? Ils ont fait naufrage ?
Apparemment étonnée de n’être pas mieux comprise, la femme posa un instant son regard sur Nancy puis les regarda tous les deux plus attentivement comme si elle ne les avait pas vraiment vus jusqu’à ce moment. Ce n’était sûrement pas quelqu’un d’un caractère facile et il y avait un soupçon d’impatience dans sa voix quand elle expliqua à nouveau :
— Non, cette saloperie de bateau aurait bien pu faire naufrage, c’est vrai mais ce n’est pas du tout ça. Vincent s’est embarqué normalement, le soir à Alger, et ils ont quitté le port à la tombée de la nuit, ça on en est tout à fait sûr parce que plusieurs de ses copains en ont témoigné. Mais après, plus personne ne l’a revu pendant le reste de la traversée.
JG, sentait croître en lui l’intérêt pour leur interlocutrice en même temps que la curiosité pour son histoire, il demanda à son tour :
— Et c’est tout ? On ne disparaît pas aussi facilement, si ? Il n’y a pas eu d’enquête ? Pas d’explication ?
À nouveau, les ongles de Nancy se crispaient sur son bras parce que, à lui seul, le mot « enquête », réveillait des souvenirs pénibles et suffisait à mettre ses nerfs à fleur de peau.
— Oui, bien sûr il y a eu une enquête. Enfin, ils ont appelé ça comme ça mais on ne me fera pas croire… Une enquête bâclée de l’Armée de l’Air et de la police maritime. Vous savez, à l’époque, c’était juste après la guerre d’Indochine et aussi la guerre mondiale qui n’était pas si loin, alors après toutes ces années de conflits, on ne voulait même pas appeler la guerre d’Algérie par son nom, il fallait dire la « pacification » – encore du mépris dans la voix. À l’époque, la disparition d’un soldat du contingent ne révoltait plus grand monde. C’était devenu comme un fait divers ou presque. Avec à peine un article de quelques lignes dans les journaux de la région où le garçon était connu. Maintenant, quand un militaire se fait tuer en Irak ou en Afghanistan ou ailleurs, la presse et la télévision en font leurs gros titres. On déplace le président de la République. À ce moment-là on n’y faisait plus vraiment attention. Sauf dans l’entourage du gamin évidemment. Et en plus Vincent ce n’était même pas un mort. Seulement un disparu, alors…
Elle trempa le bout de ses lèvres dans son verre de muscat, en but quelques gouttes comme pour mieux ravaler l’amertume qui empoisonnait son cœur et ses propos. Elle reprit :
— Oui, ça étonne maintenant, mais à ce moment-là, ça semblait presque normal. Après tout, les soldats étaient faits pour ça. On a fait un semblant d’enquête, oui, et on a dit que lui et ses copains avaient un peu trop arrosé la quille, je veux dire leur libération. Et puis on a conclu très vite qu’ils avaient dû chahuter, comme faisaient toujours les soldats libérables. Il serait tombé à l’eau en pleine nuit… Mais pas de témoin, donc pas de preuve de sa mort… Je trouve ça bizarre quand même, ils étaient forcément plusieurs à s’amuser. Je n’ai jamais cru à cette explication. C’est tout juste si depuis, un tribunal a prononcé un jugement de présomption de décès. Pour ce que j’en avais à faire !
— Mais personne ne l’avait revu ? C’est bien ce que vous avez dit ?
— Oui.
Elle hochait vigoureusement la tête en répondant à JG. C’était ce qu’elle avait dit en effet, mais ce n’était pas le plus étonnant d’après elle. En fait, elle ne croyait pas à la version officielle, principalement parce que Vincent ne buvait jamais. Même pour une telle circonstance. Il avait horreur de ça, c’est tout. Dans les fêtes il se tenait toujours à l’écart de ceux qui se saoulaient, ça le dégoûtait de voir les gens perdre leur dignité. C’est ce qu’il disait quand on lui reprochait de n’être pas marrant. Il était comme ça. Et en plus là-bas, beaucoup étaient morts avant lui dans des accidents stupides. À peu près autant que d’autres s’étaient fait tuer au cours d’opérations militaires. Voilà ce que lui avait expliqué, un peu plus d’un an après les faits, le gendarme de l’Armée de l’Air qui l’avait reçue pour lui communiquer les résultats de “l’enquête”. Mais, même en admettant que Vincent ait un peu trop bu pour une fois, comment expliquer la disparition de son paquetage et de sa valise, comment croire que personne n’ait rien remarqué parmi ses copains ou parmi l’équipage ?
À nouveau, elle se retira dans un silence peuplé d’ombres qu’elle était seule à reconnaître. Puis elle les dévisagea longuement tous les deux, avec l’air étonné de quelqu’un qui revenait de très loin et ne savait plus très bien qui ils étaient. Enfin elle baissa les yeux et s’excusa une fois encore :
— Pardonnez-moi. Je suis stupide, je ne voulais surtout pas vous casser les pieds avec mes jérémiades – elle montrait à nouveau le classeur sur lequel sa main était restée posée depuis qu’elle l’avait mis sur la table – non, je voulais seulement vous demander si vous voudriez bien lire cette pièce de théâtre, c’est une comédie, et… hum… peut-être même… enfin peut-être même pourriez-vous la finir… oui, finir de l’écrire, c’est ça. Je veux dire pour qu’elle soit publiable si vous estimez que c’est possible…
Le soir tombait sur la terrasse où ils étaient seuls maintenant. Par-dessus les toits, le soleil éclairait encore pour un moment le haut de la colline d’en face. Plus de promeneurs, ils avaient fui vers les hôtels ou les restaurants, et les quelques voitures qui circulaient autour du port avaient allumé leurs codes. Dans la lumière électrique qui descendait de la vitrine derrière eux, JG regardait le classeur en même temps que cette main fine et soignée posée dessus, jolie, comme les yeux noirs, et qui semblait démentir à elle seule tout le reste de l’apparence de cette femme, concentrer toute sa féminité. Il resta sans voix un moment, désarçonné par l’étrangeté de ce qu’elle venait de lui proposer, puis demanda :
— Attendez ! Finir ce travail à sa place ? Mais pourquoi me demander ça à moi ? Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que c’est. Je ne saurais pas… Je n’ai jamais fait ce genre de travail. Qu’est-ce qui vous fait supposer…
— Oh, c’est juste que j’ai lu plusieurs articles sur vous deux, le mois dernier. J’ai beaucoup hésité mais on a écrit à plusieurs reprises que, vous particulièrement, elle regardait maintenant JG dans les yeux, vous travaillez sur Saint-Pol-Roux, sur la poésie, vous êtes un littéraire et, si j’ai bien compris, aussi un profileur.
Elle disait ça avec un respect plutôt naïf mais son regard laissait entrevoir que secrètement elle espérait beaucoup plus que ce qu’elle demandait. Au fond une sorte de miracle. Comme de ressusciter un mort, pourquoi pas ? Alors JG l’avait interrompue. Non, il n’était rien de tout cela. Vraiment pas. Juste un prof de lettres très ordinaire qui écrivait pour l’heure une thèse sur Saint-Pol-Roux et que des événements absolument imprévisibles avaient déjà trop perturbé dans son travail. À ce moment, la rentrée universitaire pouvait paraître lointaine, mais il avait encore beaucoup de recherches et de préparations en perspective. Même s’il voulait, il n’aurait pas le temps, non, vraiment pas… Et Nancy hochait la tête, approuvant avec force les propos de Jean-Gabriel.
Cependant, la femme avait du caractère, savait ce qu’elle voulait et n’en démordait pas. Demeurait en face d’eux, les yeux baissés à nouveau, puis les fixant soudain d’un regard limpide, encore plus dérangeant, et qui semblait maintenant les supplier, dire : nous étions comme vous. Et pour échapper à ce regard, parce qu’elle réveillait, très loin au fond de lui des souvenirs de ses parents, parce qu’il sentait bien que l’histoire de ce couple n’était pas la leur, qu’il n’avait pas de raison de culpabiliser, JG avait fini par lui opposer un refus catégorique et plutôt sec. Ils étaient encore très fatigués tous les deux, ils avaient besoin de se reposer, de panser leurs blessures avant de se remettre au travail. Nancy approuvait encore énergiquement, insistait à son tour jusqu’à ce que cette femme qu’ils ne connaissaient même pas renonce enfin avec un air infiniment malheureux. Nancy l’avait dit beaucoup plus tard, c’était à ce moment précis qu’elle avait jugé nécessaire de se méfier de cette comédienne qui savait parfaitement ce qu’elle voulait en dépit de ses allures de victime.
Pour finir, Jean-Gabriel n’avait même pas voulu écouter les propositions qu’elle avait pensé lui faire.
Elle avait encore insisté cependant, parlé d’un contrat qui aurait pu l’intéresser, avant de partir enfin en disant qu’elle lui ferait passer, à tout hasard et pour le cas, on ne sait jamais, où il changerait d’avis, une photocopie du texte. L’original, avait-elle ajouté en remettant dans son sac l’enveloppe contenant le classeur et en s’en allant, elle ne pouvait pas le lui laisser, elle ne voulait pas s’en séparer, au moins pas avant de connaître sa décision définitive. Il verrait lui-même, un de ces jours peut-être. Puis, après quelques pas pour traverser la chaussée, elle était revenue en arrière pour préciser que maintenant s’ils voulaient la revoir, ils pouvaient toujours lui téléphoner ou demander “La Langouste”. Sur cette dernière phrase particulièrement énigmatique et sans laisser un numéro où l’appeler, elle les avait laissés là, tous les deux énervés et perplexes. Ses talons avaient claqué sur les planches de la promenade de l’autre côté du quai, au-dessus de l’eau, et elle s’était éloignée comme une ombre de plus en plus petite parmi les derniers passants, avant de disparaître dans la lumière déclinante.
III
Octobre 2002, donc un peu moins d’une année et demie s’était déjà écoulée depuis cette rencontre à la terrasse du Vauban. Et Jean-Gabriel habitait ici maintenant dans l’impasse en haut de la rue du Gouin. Provisoirement, affirmait-il pour lui-même chaque fois qu’il revenait à y penser. Provisoirement, peut-être, mais elle s’était montrée plus obstinée que lui et il avait fini par accepter le contrat que cette femme lui proposait. Au début il n’y croyait même pas. Le mot “contrat” à lui tout seul l’indisposait parce qu’il sonnait étrangement faux, avec des sous-entendus sulfureux, mais la proposition était pour le moins alléchante et ne cessait depuis de l’étonner : le logement gratuit dans une maison qu’elle possédait (celle-là même qu’il occupait depuis le mois de juillet). Le logement et en plus, pour son travail d’écriture, un salaire, c’était le mot qu’elle avait employé en parlant le plus sérieusement du monde, un salaire équivalent à son traitement de professeur de lettres à l’IUT de Clermont-Ferrand. Elle avait même ajouté, cette fois avec un demi-sourire, cette phrase qui se voulait empreinte d’humour : « Je ne peux pas faire mieux, ce sera donc votre salaire mais sans les cotisations pour la retraite et tout le bazar, naturellement. Ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. »
Depuis il avait eu largement le temps de comprendre que, malgré cette dernière affirmation, elle était en réalité particulièrement douée pour la comptabilité et toutes ses ficelles. Il n’avait rien trouvé cependant qui lui parût illégal dans leur arrangement. Pour le fisc, il aurait le temps de s’en occuper plus tard, quand il ferait sa déclaration de revenus, mais elle le lui avait déconseillé en riant de sa naïveté.
Quant à la maison, si extérieurement, par son architecture, elle était très ordinaire, elle était en revanche idéalement placée. C’est ce qu’avait tout de suite pensé JG lorsque, quelque mois plus tôt, il l’avait visitée pour la première fois, avec Nancy qui avait dû en convenir. Bâtie au milieu d’un tout petit terrain, sur le versant sud-ouest de l’anse de Camaret, cette modeste villa aux normes déjà anciennes dominait une bonne partie de la ville et du port, et recevait dès le petit matin les premiers rayons du soleil levant. Sur l’autre façade, bien calée entre les arbres et les autres propriétés du quartier, elle était proche de la rue et d’habitations de la même époque, mais bien abritée des regards du voisinage.
JG avait été aussitôt enthousiasmé. Nancy beaucoup moins, sans qu’elle parvînt à exprimer clairement pourquoi, sinon qu’il lui semblait invraisemblable de dépenser des sommes pareilles juste pour compléter un texte. Une fois de plus, il avait attribué cette réticence aux traumatismes récemment subis et avait répondu par des arguments pas forcément très convaincants mais auxquels elle avait quand même fini par céder. À ce moment-là, Jean-Gabriel était persuadé d’avoir beaucoup de chance et de bénéficier enfin de manière inattendue d’un juste retour des choses. C’était le côté positif des sombres affaires dans lesquelles il avait été entraîné sans l’avoir vu venir. Enfin, se disait-il, il reprenait le dessus et pouvait contrôler sa vie, choisir une direction qui lui convenait. Depuis ce moment, Nancy et lui avaient passé ici ensemble, durant l’été dernier, des heures infiniment agréables à se lever tard, marcher, se baigner, faire de longues balades en VTT, lire… et tout ce dont sa mémoire conservait des images d’autant plus troublantes qu’ils ne s’étaient pas revus, autrement que sur Skype, depuis maintenant plus de six semaines.
Il revint sur terre et, penché à nouveau sur son travail, passa une journée de plus vissé sur sa chaise à écrire, sans presque lever la tête sauf pour boire du café et manger un sandwich accompagné d’une bière, tout en essayant de recoller les morceaux du manuscrit. Mécontent par-dessus le marché de ce qu’il écrivait, il rouspétait à voix haute parce que ça sonnait mal, ça restait lourd, artificiel au possible et qu’il aurait fallu une fois de plus tout recommencer. « Et merde ! » Il capitula enfin un peu après dix-sept heures, déchira ses brouillons qui rejoignirent dans la corbeille, déjà pleine de papiers froissés, les brouillons de la veille et éteignit l’ordinateur.
Il laissa tout en plan pour aller faire un tour vers la plage de Pen Hat. Pas très loin puisque la rue où se situait la maison rejoignait à deux cents mètres le sentier côtier menant vers la pointe du Gouin. Voir la mer, marcher, respirer en dénouant la fatigue, avec juste l’immensité devant soi, les gigantesques nuages naviguant vers l’est et le bruit sourd des vagues déferlant sur le littoral en contrebas. Un rythme à la mesure de l’océan, imperturbable depuis le fond des âges et qui ramenait en lui un silence où la hâte, les émotions, la nervosité se défaisaient comme sous une caresse. Un monde plus réel, où il se sentait plus présent. « Voir la mer », il se rappelait cette expression depuis sa toute petite enfance. On allait voir la mer. C’était cela, précisément, le luxe qu’il entendait s’offrir en contrepartie de son travail, mais les mêmes questions revenaient très vite le harceler sous des formes nouvelles. Vincent Le Goff, le jeune disparu, venait-il parfois sur cette plage ? Aimait-il cet endroit ? Forcément, comment ne pas l’aimer ? Aimait-il écouter les vagues, les regarder longuement rouler, étaler sur le sable leurs éventails argentés ? Aimait-il nager comme lui, même dans l’eau froide ? Il regarda le Lion, ce rocher un peu surnaturel, comme presque tout ici, tapi sur la surface de l’océan comme un félin prêt à bondir. La légende voulait que Divine Saint-Pol-Roux, la fille du poète, allât nager chaque jour jusque-là. Poésie, légendes…
Ne pas essayer de se représenter Vincent Le Goff mais voir autant que possible ce qu’il voyait, regarder dans la même direction que lui. On ne se connaît pas en se regardant dans un miroir. Il fallait prendre le temps de le rencontrer, de le reconnaître parmi les fantômes évoqués par Marie-Jeanne, sa femme. Approcher doucement cette ombre, entendre sa voix à peine audible à travers son écriture, et s’ouvrir à ce qui restait vivant de ce jeune garçon. Resté jeune pour toujours alors qu’il aurait eu à peu près soixante ans maintenant, ou peut-être un peu plus. JG pensa encore à ses parents à lui qui auraient eu le même âge et dont le souvenir s’interposait, que savait-il encore de son père et sa mère ?
Comprendre aussi, mais c’était beaucoup plus facile, ce décalage dans la manière de penser des deux générations et dans le style lui-même. On n’écrit plus comme il y a quarante ans, il y faut plus de rythme pour captiver un public toujours plus impatient et en même temps moins attentif. Réveiller l’attention du lecteur, pas si facile. Qu’est-ce qui avait poussé Vincent à écrire ?
Il voulut rentrer chez lui en empruntant le sentier côtier. Malgré la marche et le grand air, il restait absorbé dans ses réflexions et comme il longeait le bord de la falaise, il entendit soudain derrière son dos les jappements d’un chien qui grondait en se rapprochant à toute vitesse. Il se retourna. Aucune présence alentour cependant, de quelque promeneur ou de quiconque susceptible de rappeler le molosse qui fonçait sur lui en roulant dans sa gueule écumante des grognements furieux. Pas question de se mesurer avec cet animal, mais à quelques mètres de là s’ouvrait l’entrée d’un bunker en béton. Ruine lépreuse et bariolée de tags du Mur de l’Atlantique. JG préféra se jeter à l’intérieur et dévaler l’escalier encombré de détritus et de gravats.
Dedans, deux ou trois mètres plus bas, c’était encore pire, l’abri avait dû servir de toilettes d’urgence à tous les promeneurs de la saison. L’odeur renfermée était puissante, corsée, insupportable, et plus que l’obscurité, ce fut sans doute ce qui arrêta le chien. Son flair, probablement mis en défaut par cette agression olfactive, il gémit plusieurs fois douloureusement en haut de l’escalier où les effluves assaillaient son odorat, masquant la piste de Jean-Gabriel qui attendit longtemps avant de se risquer à bouger pour jeter un coup d’œil à l’extérieur.
Le couloir où il s’était aventuré menait vers une large salle dévastée par les bombes. Une crémaillère circulaire, qui avait dû supporter un énorme canon, et des ferrailles tordues et rouillées restaient scellées dans le béton depuis la débâcle allemande de 1944. Marchant avec précaution, JG se rapprocha de cette ouverture par où autrefois la batterie tirait au loin directement sur les navires croisant dans le goulet de Brest. En face, dans le soleil déclinant, se dressait le phare du Minou. Ironie des noms propres selon les situations. Comme un mauvais rêve, le chien semblait n’avoir jamais existé. JG sortit enfin du bunker et, furieux, nettoya sommairement ses chaussures dans les herbes du chemin.
D’un seul coup, il avait oublié toutes les autres questions et rouspétait maintenant contre les gens irresponsables qui laissent divaguer des animaux dangereux.
Revenu devant chez lui, il était plus calme déjà et il s’aperçut, en cherchant à manœuvrer la clef dans la serrure, qu’il avait oublié de fermer en s’en allant. À ce moment-là, il ne s’en émut pas plus qu’il ne fallait, ce n’était pas la première fois et il était content de rentrer. Il était parti énervé par cette journée et encore obnubilé par des questions dont les réponses trop vagues soulevaient de nouvelles interrogations tout aussi énervantes. Il revenait avec d’autres questions. Il laissa en bas ses chaussures souillées et, sans allumer aucune lampe parce que la rougeur du couchant éclairait encore suffisamment l’escalier, il monta et traversa le salon avant de s’approcher de la porte-fenêtre pour regarder la baie sur laquelle tombait doucement la nuit. Il se revoyait dans cette même lumière crépusculaire quand la femme les avait quittés, Nancy et lui, sans même avoir pensé à se présenter tant elle semblait alors intimidée. De cela aussi il doutait maintenant tandis qu’il observait les jeux d’ombres qui se mouvaient sur le port d’où provenait une vague odeur de varech. C’était sans doute une redoutable comédienne “La Langouste”, pas si facile à intimider qu’on aurait pu le croire. Et beaucoup plus tard, parce qu’il prenait quand même sa défense, Nancy s’était énervée : « Mais qu’est-ce que tu lui trouves à cette bonne femme ? » À ce moment-là, il s’était demandé avec un rien de fatuité si elle n’était pas simplement jalouse.
Les phares des voitures, les lampadaires sur le Sillon, les feux des bateaux qui se hâtaient de rejoindre leur mouillage, tirant derrière eux les rides de l’eau où se superposaient les reflets rouges et noirs du ciel et les éclairages de la ville. De ce spectacle non plus, il ne se lassait jamais, pas plus que de cette émotion renouvelée à l’infini. Cette jubilation à vivre tout près des rivages aux limites extrêmes de la terre. Cela, évidemment, avait pesé lourd dans sa décision. Pourtant, comme chaque fois qu’il se perdait dans la contemplation de ce tableau magnifique, il se demandait en même temps si Nancy n’avait pas raison, s’il ne s’était pas laissé prendre à quelque piège, laissé séduire en effet par quelque fantasmagorie qui l’entraînait toujours un peu plus loin de lui-même. Loin de cet homme sensé, raisonnable et pragmatique, que, malgré les épreuves et les déceptions, il s’était imaginé être. Il avait presque envie de rire en mesurant les illusions qu’il avait entretenues jusquelà sur lui-même. Oui, c’était drôle, mais tout le monde n’est-il pas un peu comme ça ? Nancy lui semblait tellement plus raisonnable que lui malgré sa jeunesse, c’est peut-être aussi ce qu’on pense toujours des femmes, et il l’aimait également pour ce côté réfléchi. Elle était toujours très belle, encore plus, avec cette gravité, dans le regard et dans la voix, acquise dans la souffrance où elle avait laissé un peu de ses naïvetés de jeune fille. Ils étaient l’un comme l’autre très amoureux et Jean-Gabriel n’aurait voulu à aucun prix la décevoir. Mais il n’était plus possible désormais de revenir en arrière.
Tandis que la passe et le port se noyaient dans l’obscurité, les reflets du soleil couchant rougeoyaient encore pour quelques minutes sur les hauteurs vert foncé des falaises d’en face, inventaient des contrastes et des mélanges de couleurs, des nuances brun rouge quasi miraculeuses pour découper délicatement chaque détail, chaque nervure de la roche où s’accrochaient des tapis de bruyère. Déjà, les plages recouvertes par la marée s’enfonçaient dans la nuit, dessinées seulement par leurs minces liserés d’écume. Les nuages, bas et noirs comme de l’anthracite, roulaient sur la baie depuis le nord-ouest et engloutirent lentement les derniers moments du spectacle. Le décor s’éteignit pour ce soir sous les premières gouttes de pluie frappant doucement les carreaux.
Il était vraiment fatigué, avec l’impression énervante et tenace de n’avoir encore pas avancé. La journée avait le même goût un peu amer que les jours précé-dents. Il alluma sa lampe de bureau, ce fut comme un signal que quelqu’un aurait attendu, le téléphone sonna à cet instant précis. Le temps de le chercher dans la poche de son vêtement qu’il venait de poser sur un fauteuil et il répondit : « Oui, allô ? » Silence. Seulement un très léger bourdonnement comme lorsque quelqu’un, quelque part, écoute et ne dit rien. « Allô ? » Après une minute interminable, ce fut lui qui mit fin à la communication, jeta, comme s’il lui brûlait les doigts, le portable sur le fauteuil et resta un long moment immobile, essayant d’échapper à la main glacée qui lui serrait soudain l’estomac. Il se répétait seulement : ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible puisqu’il est mort. En même temps, il entendait la voix diabolique qui affirmait en ricanant : « Vous allez tous mourir mais moi je vais revenir, je vais renaître demain. » Le Phénix ressortait du néant !
Impossible ! Et pourtant… De toutes ses forces, sa raison s’insurgeait contre cette idée, en même temps que se hérissaient tous les poils de son corps. Il avait froid et l’impression angoissante de planer dans l’obscurité. Au prix d’un violent effort sur lui-même, il parvint à revenir sur ses deux pieds dans cette pièce où pendant un instant, il lui avait semblé qu’il n’était plus seul. Il réfléchissait à toute vitesse, à voix haute pour ne plus entendre l’autre voix. Ce n’était pas possible en effet puisque le Phénix s’était suicidé un an et demi plus tôt en avalant une capsule de cyanure, personne ne peut s’en remettre. Et ce bref moment de panique était une séquelle parmi beaucoup d’autres d’un traumatisme encore trop récent. Une erreur de numéro tout bêtement. Il faut toujours s’en tenir à la solution la plus simple. Il regarda encore le téléphone éteint tandis que retombait cette vague d’émotion. La maison était parfaitement silencieuse.
Parmi les documents posés devant lui, s’étalait une photographie en noir et blanc, à bordure blanche dentelée, une copie évidemment, que La Langouste lui avait fait parvenir un an plus tôt, quand il était encore chez lui, à Clermont-Ferrand. « Vincent et moi en 1959 », avait-elle inscrit au dos sans préciser davantage. Quand il avait vu cette photo prise pendant la dernière permission de Vincent juste avant qu’il ne reparte pour l’Algérie, Jean-Gabriel avait hésité à reconnaître, sinon par la forme des yeux sombres très légèrement étirés vers les tempes, la femme vieillie rencontrée à la terrasse du Vauban, dans cette jeune fille radieuse, mince et jolie, que serrait amoureusement contre lui un jeune homme souriant de bonheur lui aussi et au regard déjà un peu lointain. Jusqu’où ce regard portait-il déjà ?
C’était lors d’un baptême ou d’un mariage qui n’était pas le leur car ils étaient tous deux vêtus comme pour assister à une cérémonie mais elle n’était pas en robe de mariée. On pouvait voir plusieurs personnes au deuxième plan, des gens beaucoup plus âgés. Tous l’air un peu rigide et guindé dans leurs costumes sombres, classiques et démodés, la famille certainement. Un monde disparu depuis longtemps en tout cas. Et un couple visiblement heureux à ce moment-là. Vincent allait être bientôt libéré, il savait, même si ce n’était pas encore visible qu’il allait être papa, il était plein d’énergie et de joie de vivre, sans doute aussi soulagé de rentrer enfin d’Algérie. Il avait en plus un projet littéraire déjà avancé qui le portait vers une vie intéressante, et comme un miroir qui se brise, tout s’était soudain transformé en cauchemar de manière incompréhensible.
JG reposa la photo et se leva de sa table de travail, l’humeur encore assombrie par le souvenir de son propre mariage et de son récent divorce, s’efforçant vainement tandis qu’il se préparait à manger, de penser à des choses un peu plus amusantes. Il faisait nuit noire maintenant et la lampe de bureau se reflétait dans la porte-fenêtre, éclairant la pièce indirectement.
Il lui restait du pain rassis dans une corbeille et, dans le frigo, un morceau de fromage. Il décapsula une bière et s’assit à nouveau devant son bureau en buvant à la bouteille. Cette fois, en attendant l’heure où Nancy devait l’appeler, il ouvrit un volume des poèmes de Saint-Pol-Roux, c’était dans Tablettes où il retrouva, sans vraiment la chercher, une citation de quelques lignes qu’il avait déjà soulignée et retenue pour sa thèse et qu’il avait égarée depuis. Ça lui semblait dire très bien l’ambiguïté de sa situation par rapport à Vincent et en particulier la difficulté de se substituer à un autre, ne serait-ce qu’en pensée. Être le nègre de quelqu’un est forcément une aventure qui comporte des risques et peut peut-être mener à ne plus très bien savoir se reconnaître soi-même. À vouloir se mettre à la place de Vincent, n’était-ce pas en fait Vincent qui se glissait à sa place ?
« Tous les hommes, je les considère comme soit mes reflets, soit mes ombres ; le revers de cet orgueil serait que chacun d’eux me prît pour un de ses reflets ou pour une de ses ombres. »1
La poésie lui vint en aide comme souvent pour retrouver son calme. Les mêmes sources que Saint-Pol-Roux, se dit-il, la poésie et l’océan. En toute modestie évidemment. Il finit sa bière et travailla encore une heure.
1 Saint-Pol-Roux, Tablettes, éditions Rougerie.
IV
Juillet 2001, ce fameux soir où tout avait commencé. Dès le début, quand la femme était repartie, Nancy avait farouchement combattu l’idée de contrat : « j’aime pas du tout ça », avait-elle répété plusieurs fois avec un air buté que soulignait son imperceptible accent anglais, en même temps qu’elle soufflait dans l’air du soir la fumée d’une de ses cigarettes mentholées. Plus tard, alors même que Jean-Gabriel avait jusque-là clairement affirmé, comme s’il essayait encore de s’en convaincre lui-même, qu’il n’avait pas du tout l’intention de donner suite à ce projet, elle s’était énervée à plusieurs reprises, ce qui ne lui arrivait pratiquement jamais en temps normal. Avait-elle déjà compris qu’il allait se laisser prendre ?
— Ça peut pas être un contrat. Qu’est-ce que ça veut dire ? Tu te rends compte, Toirac ? Tu vois bien que tu aurais aucune garantie, que c’est pas clair. Tu dois faire attention où tu mets les pieds.
Elle s’était opposée à lui comme jamais depuis qu’ils se connaissaient et il avait eu peur, un soir où la discussion semblait vouloir tourner à l’aigre, qu’elle ne lui en veuille suffisamment pour envisager une rupture. Mais il lisait la peur dans ses yeux assombris par la colère, comme des pervenches bleu foncé. Et par la suite, bien plus tard au cours des mois suivants, comme il avait finalement changé d’avis, il avait dû faire preuve de beaucoup de diplomatie, de persuasion et même de tendresse pour parvenir à la convaincre au bout du compte de l’intérêt pour lui de ce qui lui était proposé.
“La Langouste”, ce soir d’été, les avait donc plantés là, à la terrasse du Vauban, et ils étaient restés tous les deux quelques minutes à discuter et à s’interroger au sujet de cette femme étrange. Qui était-elle ? Elle avait disparu aussi vite qu’elle était arrivée. Puis Léo, le patron de l’hôtel et du bar, avec qui ils avaient noué une solide relation d’amitié au cours des deux dernières années, était venu les rejoindre et s’asseoir à leur table un moment.
— La Langouste ? Ah oui, bien sûr, tous les anciens la connaissent par ici. Oui, elle était pratiquement la patronne d’une société de pêche autrefois. C’était même un cas bien particulier. Elle ne naviguait pas, c’est clair, mais elle s’occupait de la gestion à terre. On appelait ça le “capitaine d’armement”. Je n’en sais pas beaucoup plus à vrai dire. Pourquoi cette question ?
— Oh, rien de bien important sans doute… Nancy était intervenue aussitôt et c’était la première fois qu’elle tutoyait Léo :
— Au contraire, c’est très important. Figure-toi, elle voudrait que Jean-Gabriel travaille pour elle. Elle veut lui proposer un contrat et lui, il a l’air de trouver ça normal.
Elle écrasa dans un cendrier sa cigarette qu’elle n’avait pas fumée, et d’un haussement d’épaules accompagné d’une moue dédaigneuse, elle soulignait en même temps l’absurdité de ce terme selon elle.
— Ah bon ? Elle veut vous embaucher comme pêcheur ou comme mousse peut-être. Attention, elle aime bien les beaux garçons.
Au contraire de Nancy, il y avait une note joyeuse dans la voix de Léo, comme s’il peinait à imaginer Jean-Gabriel lavant le pont d’un bateau de pêche.
— Non, pas comme mousse, comme nègre.
Il fallut quand même s’expliquer un peu plus et Léo interrompit la conversation pour proposer un petit casse-croûte dans l’arrière-salle du bar, avec sa femme Anne-Marie. Ils rentrèrent et Léo referma derrière eux les grandes baies vitrées parce qu’il commençait à faire frais.
— Tu sais quoi, Marie ? La Langouste, elle voudrait que Jean-Gabriel travaille pour elle.
— Comment ça ? Sur un bateau ? Qu’est-ce qui lui prend à celle-là ? Elle ne va pas bien.
— C’est ce que j’ai pensé aussi.
JG dut reprendre ses explications depuis le début :
— Elle aimerait que je travaille sur un manuscrit inachevé. Une pièce de théâtre écrite par son fiancé, non son mari, qui a disparu. Enfin c’est ce que j’ai cru comprendre.
Et à nouveau, Léo s’étonnait :
— Vincent Le Goff ? Oui, c’était bien son mari. Mais c’est drôlement vieux cette histoire. Ça remonte à quand ? Quarante ans au moins. C’est bien ça, Marie ?
— Oui, à quelque chose près. Il est mort en Algérie, enfin c’est probable, et tout à la fin de la guerre si je ne me trompe pas. C’était désolant. Je m’en souviens bien, j’étais encore gamine mais… c’était un très beau garçon.
— Et tu savais qu’il écrivait, toi ?
— Non, je n’en avais aucune idée, dit Anne-Marie en quittant la pièce avec, en équilibre sur un plateau, des piles cliquetantes de tasses et de soucoupes qu’elle venait d’extraire du lave-vaisselle.
— Il écrivait du théâtre, précisait à nouveau Jean-Gabriel. Il avait commencé…
— Et pourquoi alors elle a attendu si longtemps pour y penser ? C’est bizarre. Vous trouvez pas ?
C’était Nancy dont la voix inquiète posait cette question.
— Ça, je ne pourrais pas dire mais c’est vrai que ça n’a pas l’air de l’avoir beaucoup préoccupée pendant toutes ces années.
Anne-Marie qui revenait à l’instant dans la pièce et s’asseyait à côté de Léo, intervint :
— Qu’est-ce que tu en sais ? Non mais, il n’y a rien à faire, c’est comme ça les hommes. On ne peut pas savoir si elle pensait à lui ou non. Bien sûr qu’elle ne risquait pas de venir t’en parler. Et moi je pense que si, elle pensait à lui mais elle est la seule qui pourrait le dire maintenant. En tous les cas, elle est toujours seule. Il y a des gens qui ne montrent pas leur chagrin, figure-toi, contrairement à d’autres qui n’arrêtent pas de se plaindre.
Léo préféra ignorer ce dernier sous-entendu.
— C’est vrai, tu as raison, elle est toujours seule, mais je voulais juste dire que… je ne pensais pas qu’elle était restée attachée comme ça au souvenir de Vincent, voilà. Et puis…
— Et puis quoi ?
— Oh, arrête, tu sais bien ce que je veux dire. Elle est seule si on veut mais elle a plutôt bien vécu depuis qu’on la connaît. Non ?
— Bien vécu… Eh bien non, je ne sais pas ce que tu veux dire, non. Je sais seulement qu’elle a élevé son fils toute seule, tu sembles oublier ça. Ils étaient mariés depuis quelques mois et elle était déjà enceinte quand Vincent a disparu.
— Ah, mais écoute, ce n’est un secret pour personne, elle a aussi collectionné les hommes.
— Ah voilà ! Ben oui, elle a couché avec des hommes, elle en avait sans doute besoin. Et qu’est-ce que ça peut bien te faire ? Le seul qui aurait eu le droit de s’en plaindre c’est Vincent justement, et il n’est plus là, alors… Elle a bien assez souffert comme ça, allez !
Nancy et Jean-Gabriel écoutaient, se lançaient de temps à autre des coups d’œil amusés malgré la gravité du propos. Léo se défendait pied à pied mais n’en continuait pas moins :
— Bon, c’est vrai. Évidemment ça m’est bien égal. Elle a eu beaucoup d’hommes et aussi beaucoup d’argent. Elle en a parfaitement le droit, je ne discute pas, mais de là à vouloir embaucher Jean-Gabriel comme… comme nègre… Et puis tu te rends compte de ce que ça va lui coûter ?
— Mais tu n’en sais rien.
— C’est vrai, je n’en sais rien mais… Elle vous a dit comment elle avait l’intention de vous payer ? Il faut quand même bien qu’elle vous paye. Remarquez que, je ne sais pas ce qu’elle a l’intention de faire, mais il est vrai qu’elle a dû gagner une vraie fortune.
Léo s’était tourné maintenant vers Nancy qui demanda :
— Et comment elle a gagné tout ça ?
— Ben, la pêche à la langouste tout simplement. Elle est arrivée juste au bon moment, c’est-à-dire quand ça marchait le mieux. Elle n’a jamais embarqué comme marin pêcheur évidemment mais, comme je vous disais tout à l’heure, c’était elle qui gérait la société de son beau-père. Et elle s’y entendait drôlement bien, ça tout le monde pourra vous le dire.
— C’est vrai, ajoutait Anne-Marie, elle était bien connue pour être très compétente et aussi, il faut le dire, Léo, parce que c’est important après tout ce que tu as laissé entendre, elle était connue pour son honnêteté. Ce n’est pas tout le monde.
Puis Léo avait poursuivi son récit. De fil en aiguille il paraissait en savoir beaucoup plus qu’il ne l’avait affirmé d’abord. Elle s’appelait donc Marie-Jeanne Le Goff et les pêcheurs l’avaient surnommée “La Langouste”, oui, c’était affectueux, parce qu’elle était en effet respectée pour son honnêteté. Au retour des campagnes en Mauritanie, les gains étaient toujours répartis rigoureusement et équitablement selon les règles de la corporation. C’était très important parce que les gains étaient alors considérables. Les hommes appréciaient Marie-Jeanne, en particulier parce qu’ils avaient confiance en elle, mais beaucoup, au début, n’étaient pas non plus indifférents au fait qu’elle était jolie et ils la courtisaient plus ou moins discrètement.
Et puis, par la suite, elle avait su placer l’argent intelligemment. Leur société de pêche avait trois bateaux, la Tyrrhénienne, l’Entreprenante et la Marie-Jeanne, du nom de sa marraine qui entre-temps était devenue la patronne quand le père de Vincent était mort d’avoir trop travaillé, d’avoir perdu son fils et sans doute aussi d’avoir trop bu pour supporter le tout. À la fin de sa vie, il avait trouvé en sa belle-fille un soutien inespéré, surtout quand la faillite des langoustiers avait mis un terme aux campagnes de pêche. Marie-Jeanne était à peu près la seule qui avait alors réussi à sauver une petite fortune que d’autres, pour leur compte, avaient très vite dilapidée.
— Et elle, d’où venait-elle, demanda JG, d’une famille de pêcheurs aussi ?
— Oh, pas du tout. Ils étaient même de deux mondes carrément différents – Anne Marie racontait à son tour – c’est un vrai roman. Ils s’étaient mariés quelques mois plus tôt pendant une permission de Vincent. Pas bien longtemps avant sa disparition. Mais elle, elle avait fait des études, un bac commercial, je crois, tandis que Vincent était fils de marin pêcheur et destiné à devenir marin pêcheur lui-même.
— Et alors comment est-elle devenue patronne ? C’est plutôt lui qui aurait dû, non ?
Anne-Marie ignora l’interruption et continua son récit entrecoupé de « c’est ça » et de « oui, c’est exact » que Léo plaçait ici et là.
— En fait, Vincent n’était pas du tout fait pour ce métier, et son père… comment s’appelait-il, Léo ?
— Il s’appelait Jean, ou Yves peut-être. Je ne sais plus trop.
— Oui, c’était Jean, je crois. Jean Le Goff, c’est bien ça. C’était un très bon patron en mer, sur un bateau de pêche. Un très bon marin aussi, qui savait naviguer par gros temps et commander un équipage, mais une fois à terre, il n’était pas bien doué pour s’occuper des comptes et de la gestion d’une affaire. Il était veuf depuis quelques années et, tout seul avec ses trois bateaux et l’argent qu’ils ont gagné à l’époque, il était dépassé. C’est du moins ce qui s’est dit. Alors ça s’est fait tout naturellement, c’est Marie-Jeanne qui a pris les choses en main. Je crois que c’était mieux pour tout le monde et que Jean s’en est vite rendu compte. Et tous les autres aussi.
— Et Vincent alors ?
Léo prit à nouveau la parole. JG regardait les cartes postales de quantité de clients de l’hôtel qui tapissaient les murs de la pièce et témoignaient aussi de bien des années de travail. Les gens d’ici étaient comme ça, c’était important à savoir. En même temps il restait attentif à ce qui se racontait. Par la suite il n’oublia jamais ce moment ni cette atmosphère. C’était peut-être ce soir-là, dans cette cuisine où ils se sentaient bien tous les quatre ensemble, que ce regard sur le passé, malgré tout ce qu’il put dire plus tard à Nancy, l’avait déjà décidé à accepter l’offre de Marie-Jeanne Le Goff.