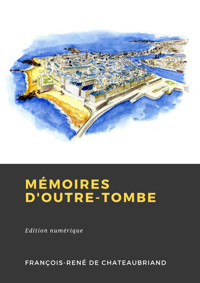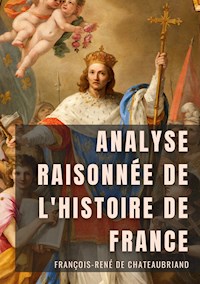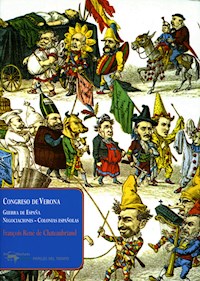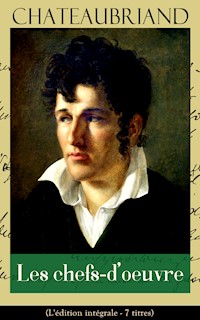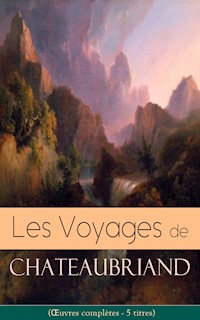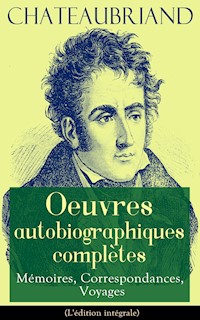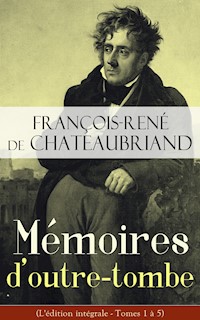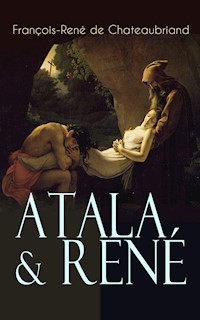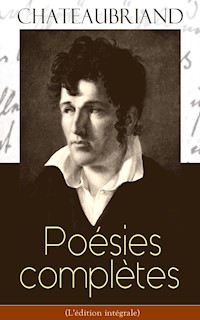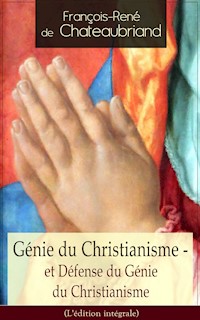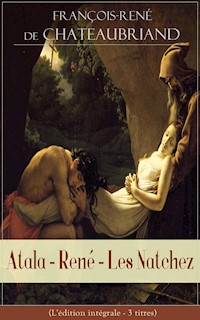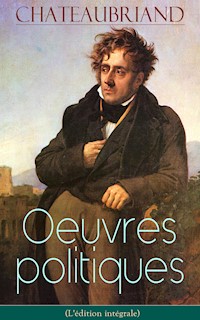
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre numérique présente "Chateaubriand: Oeuvres politiques (L'édition intégrale)" avec une table des matières dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement conçue pour votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé soigneusement. François-René, vicomte de Chateaubriand (1768 - 1848) est un écrivain et homme politique français. Il est considéré comme l'un des précurseurs du romantisme français et l'un des grands noms de la littérature française. Table des matières: De la liberté de la presse Politique, opinions et discours Réflexions politiques Politique documents généraux Polémique Mélanges politiques De la monarchie selon la charte De Buonaparte et des Bourbons De la Vendée Congrès de Vérone; Guerre d'Espagne de 1823; Colonies Espagnoles Analyse raisonnée de l'histoire de France Notices Nécrologiques Biographie: Chateaubriand (De L'académie Française par Jules Lemaître)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Chateaubriand: Oeuvres politiques
(L'édition intégrale)
Table des matières
De la liberté de la presse
Table des matières
Préface de l’édition de 1828
Si l’on réunit aux écrits ci-après ce que j’ai dit de la liberté de la presse dans La Monarchie selon la Charte, dans mes anciens Discours et Opinions, et jusque dans ma Polémique, on sera forcé de convenir qu’aucun homme n’a plus souvent et plus constamment que moi réclamé la liberté sur laquelle repose le gouvernement constitutionnel. J’ai quelque droit à m’en regarder comme un des fondateurs parmi nous, car je ne l’ai trahie dans aucun temps. Je l’ai demandée dans les premiers jours de la restauration, je l’ai voulue à Gand O comme à Paris; prêchée par un royaliste, elle cessait d’être suspecte à des yeux qui s’en effrayaient, à des esprits qui n’en voulaient pas, à un parti qui ne l’aimait guère. Que ce parti la répudie de nouveau aujourd’hui, cela peut être; mais il ne la détruira plus. Quand je n’aurais rendu que ce service à mon pays, je n’aurais pas été tout à fait inutile dans mon passage sur la terre.
La liberté de la presse a été presque l’unique affaire de ma vie politique; j’y ai sacrifié tout ce que je pouvais y sacrifier: temps, travail ou repos. J’ai toujours considéré cette liberté comme une constitution entière; les infractions à la Charte m’ont paru peu de chose tant que nous conservions la faculté d’écrire. Si la Charte était perdue, la liberté de la presse la retrouverait et nous la rendrait; si la censure existait, c’est en vain qu’il y aurait une Charte. N’allons pas chicaner sur le plus ou moins de perfection de la loi qu’on doit soumettre aux chambres: elle abolit, dit-on, la censure: eh bien, tout est là. C’est par la liberté de la presse que les droits des citoyens sont conservés, que justice est faite à chacun selon son mérite; c’est la liberté de la presse, quoi qu’on en puisse dire, qui à l’époque de la société où nous vivons est le plus ferme appui du trône et de l’autel. Charles X nous délivra de la censure en prenant la couronne; pour affermir cette couronne, il ne veut pas même que les ministres à venir trouvent dans la loi un moyen de violer la plus vitale de nos libertés O. Cette noble et salutaire résolution doit rendre tous les coeurs profondément reconnaissants; elle suffirait seule pour immortaliser le règne d’un prince aussi loyal que généreux.
Si donc le gouvernement se détermine, comme il y a lieu de le croire, à apporter une loi pour l’abolition de la censure facultative, pour la suppression de la poursuite en tendance et pour l’établissement des journaux sans autorisation préalable, je verrai s’accomplir ce que je n’ai cessé de solliciter depuis quatorze ans.
Sous l’empire, j’ai cherché, par le Génie du Christianisme, à contribuer au rétablissement des principes religieux; lors de la restauration, j’ai promulgué dans La Monarchie selon la Charte les vérités qui doivent désormais servir de fondement à notre croyance politique. J’ose quelquefois me flatter que ce double effort n’a pas été vain, puisque les doctrines que j’ai déduites ont été peu à peu adoptées: descendues dans la nation, elles sont remontées au pouvoir. Les obstacles que j’avais signalés dans les hommes et dans les choses ont été graduellement écartés; mes prévisions funestes, réalisées comme mes espérances, ont montré qu’en mal et en bien je ne m’étais pas tout à fait trompé sur les caractères, les préjugés, les passions et les vertus de l’ancienne et de la nouvelle France. Ainsi mon rôle, comme défenseur de nos libertés publiques, touche à son terme; la censure va disparaître pour toujours; un triomphe fécond en résultats heureux se trouve placé au bout de ma carrière constitutionnelle; je n’en réclame pas les palmes; tulit alter honores: peu importe; il ne s’agit pas de moi, mais de la France.
Toutefois un retour sur le passé me sera-t-il un moment permis? Que de haines et de calomnies entassées sur ma tête depuis quatorze années, pour en venir à faire ce qui m’a attiré ces haines et ces calomnies! S’évanouiront-elles? Je le souhaite plus que je ne l’espère; on m’en voudra peut-être en secret d’avoir eu raison si longtemps contre des autorités successives. D’un autre côté, de quelle prospérité nous jouirions aujourd’hui si dès le point de départ on eût marché dans les voies de la Charte comme je ne cessais d’y inviter! Mais apparemment qu’il en est des vérités comme des fruits: ceux-ci ne tombent que quand ils sont mûrs.
Mille cris s’élevèrent lorsque j’entrai une dernière fois dans les rangs de l’opposition; on aurait trouvé plus prudent et plus sage que j’eusse attendu à l’écart et en silence l’occasion de me glisser de nouveau au ministère. Sans doute, comme calcul d’ambition personnelle, cela eût valu beaucoup mieux; mais les libertés publiques, que deviendraient-elles si chacun pour les défendre ne consultait que son intérêt? Dans une monarchie représentative, les convenances des salons et la politique des courtisans sont-elles admissibles? Que celui qui ne peut rien quand il est tombé se taise; qu’il se mette en embuscade dans une antichambre et qu’il guette le pouvoir au passage pour le reprendre par une intrigue, à la bonne heure; mais que celui dont la voix a été quelquefois entendue avec bienveillance se range parmi les muets, rien de plus absurde dans un gouvernement constitutionnel. N’est-il pas clair aujourd’hui que j’ai suivi la vraie route pour arriver à ce qui me paraissait être le bien de mon pays?
De la censure
que l’on vient d’établir en vertu de l’article 4 de la loi du 17 mars 1822
Avertissement de la première édition
La censure n’a pas permis qu’on annonçât cette brochure dans les journaux; cependant le titre de ce petit écrit n’a rien de séditieux: De la censure que l’on vient d’établir. Y a-t-il là quelque chose contre le roi et la loi? Ce titre même fait-il connaître si l’auteur de l’ouvrage est pour ou contre la censure? Quel instinct dans les censeurs! quelle merveilleuse sagacité! Mais je ne dis pas tout: mon nom est imprimé en tête de la brochure! Pourrait-on croire que nous en soyons là sous le ministère de MM. Corbière et de Villèle?
Avertissement de la deuxième édition
Le public a enlevé la première édition de cette brochure plus rapidement encore que je ne l’ai écrite, bien que la censure n’ait pas permis de l’annoncer, et qu’à la poste on ait refusé d’expédier les exemplaires destinés aux départements. Cela ne prouve rien pour le mérite de l’ouvrage, mais cela montre à quel point l’opinion s’est prononcée en faveur des tribunaux, avec quelle ardeur elle réclame les libertés publiques et repousse le système ministériel.
J’ai à peine eu le temps de faire disparaître quelques incorrections de style, échappées à ce que je pourrais appeler une improvisation écrite. J’ai ajouté peu de chose au texte, mais je veux consigner ici un nouveau fait de la censure actuelle.
La censure avait mutilé dans le Journal des Débats un article relatif à Mgr le duc d’Orléans; elle a été plus rigoureuse envers Le Constitutionnel, qui s’est avisé de parler de Mgr le duc d’Angoulême.
La chose m’avait paru si improbable que pour le croire j’ai voulu voir l’article supprimé, supposant qu’il y avait au moins à cette témérité censoriale une ombre, une apparence de prétexte. On en va juger; voici l’article:
« Nous publions avec un vrai plaisir l’avis suivant, qui nous est adressé du cabinet de S. A. R. le duc d’Angoulême:
« Messieurs les membres de la Société royale des Prisons sont invités à se trouver jeudi, 19 de ce mois, à une heure, à la séance de la Société, présidée par Son Altesse Royale, et qui se réunira chez Monseigneur. »
« Puissent tous les abus qui sont si malheureusement enracinés dans le régime des prisons, et qui excitent depuis si longtemps la sollicitude de tous les vrais amis de l’humanité et de la religion, être connus du prince! Puisse l’administration, docile à sa voix, réformer des scandales affligeants pour toutes les âmes sensibles! Puisse-t-elle purifier le séjour infect où tant de victimes diverses sont si malheureusement confondues! Ce que nous désirons surtout, c’est que l’intéressant ouvrage que vient de publier M. Appert soit mis sous les yeux du prince, et qu’on ne lui cache aucun de ceux qui sont de nature à l’éclairer sur un objet si digne de sa bienfaisance et de son humanité. »
Il ne s’agit pas des doctrines du Constitutionnel, qui sous tant de rapports ne sont pas les miennes; cette feuille d’ailleurs m’épargne trop peu pour qu’on puisse me soupçonner d’avoir un grand penchant pour elle; mais il s’agit de la raison, de la bonne foi, de l’équité des principes. Y a-t-il rien dans l’article précité qui ait pu mériter la colère des rogneurs de phrases? Il ne sera donc plus permis de parler d’humanité, ni même de religion, car le mot se trouve dans l’article: ainsi le nom d’un prince restaurateur de notre armée, ce nom que l’Europe respecte, que la France a inscrit dans les fastes de sa gloire, est rayé par quelques censeurs obscurs dans un bureau de police! Il est vrai que ce prince, tout chrétien qu’il est, est soupçonné d’aimer la Charte; il est vrai qu’en Espagne tous les partis ont trouvé un abri derrière son épée; qu’il a prêché la concorde au milieu des divisions, qu’il a réprimé les écarts de la liberté comme les fantaisies de l’arbitraire, qu’il s’est opposé aux réactions et aux vengeances, qu’il n’a pas souffert que des proscriptions déshonorassent ses armes et que les bûchers de l’inquisition devinssent les autels élevés à ses victoires.
Paris, le 20 août 1824.
Avertissement de la troisième édition
Je voulais laisser passer cette troisième édition sans un nouvel avertissement. J’avais vu, il est vrai, dans un journal une espèce d’amende honorable, une explication par laquelle un écrivain officieux prétendait prouver que ses maîtres, en établissant la censure, n’avaient pas voulu attaquer les tribunaux: ce misérable désaveu d’un fait patent ne peut inspirer que de la pitié.
Je n’aurais donc pas songé à grossir ce petit ouvrage de quelques lignes, si un autre article, d’une tout autre gravité, n’avait attiré mon attention.
Lorsque j’ai dit que les ministres seraient obligés, pour prolonger leur existence politique, de pousser leurs systèmes jusqu’aux dernières conséquences; lorsque j’ai demandé quel serait le parti qu’ils prendraient en cas d’opposition de la part des chambres législatives, je n’ai rien exagéré, et l’on ne m’a pas fait attendre longtemps la réponse à mes questions.
Un article inséré dans Le Drapeau blanc a été répété par L’Etoile: la censure, en le laissant passer dans d’autres journaux, a achevé de lui donner un caractère semi-officiel: il mérite la peine d’être transcrit et commenté; le voici:
« Les conseils généraux de département s’assemblent; appelés par la loi fondamentale à donner leur avis sur tout ce qui intéresse la prospérité du commerce et de l’agriculture, vue à la vérité d’une manière locale, il ne leur est pas interdit pour cela de traiter les plus hautes considérations législatives lorsqu’elles se rattachent aux besoins particuliers des subdivisions territoriales. Ne sont-ce pas les cahiers des conseils généraux qui les premiers ont indiqué la nécessité d’une loi sur la voirie vicinale et qui ont posé le principe de la double prestation? Les modifications apportées aux tarifs de l’enregistrement n’avaient-elles pas été invoquées par les mêmes organes? La plupart des grandes améliorations n’ont-elles pas pris leur source dans ces assemblées qui, par la manière dont elles ont été composées depuis la restauration, offrent toutes les garanties désirables de dévouement, de sagesse, de lumières, d’indépendance et de bonne foi?
« Aux yeux du gouvernement, comme pour tous les hommes éclairés, les vrais organes de l’opinion publique sont les conseillers choisis par le roi sous le titre de pairs et ceux envoyés devers lui par la nation sous le nom de députés. Mais dans une circonstance aussi où l’une des chambres a cru devoir rejeter ce qu’une autre avait adopté, où même celle qui a voté négativement a offert un partage à peu près égal d’opinions, où enfin le rejet n’a été qu’une sorte de plus ample informé, il nous paraît non seulement convenable, mais encore de toute justice, que le ministère accueille ce que les conseils d’arrondissement et de département croiront devoir exprimer au sujet de la loi des rentes. Ces conseils, composés de propriétaires, de négociants, de magistrats, enfin de ce que nos provinces ont de plus honorable, ne peuvent que jeter une grande lumière sur un objet qui touche aussi essentiellement à la fortune publique. C’est sous de tels auspices que la grande question débattue pendant la dernière session pourra se représenter, forte d’un assentiment presque unanime; ou bien, si elle est proscrite dans le sein de ces assemblées, le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient. »
Examinons cette pièce curieuse.
Comparer d’abord les conseils généraux d’aujourd’hui aux bailliages, aux sénéchaussées d’autrefois, aux anciennes communes des villes et des campagnes, à tout ce qui formait le régime municipal de la France, c’est une étrange ignorance ou une bizarre aberration d’esprit.
Quand on nous parle de cahiers des conseils généraux, ne s’aperçoit-on pas de la confusion des mots, des idées et des doctrines qui se trouve dans cette seule phrase? Des cahiers! Il y a donc des mandataires? Sont-ce les membres des conseils généraux qui sont les mandataires du peuple, lequel pourtant ne les a pas nommés? Sont-ce les députés qui doivent être regardés comme les mandataires des conseils généraux, quoiqu’ils ne soient pas élus par ces conseils? Enfin, seraient-ce les ministres qui se trouveraient chargés des pleins pouvoirs de ces conseils? Et néanmoins tous les jours, à la tribune le ministère s’élève contre le système des mandataires, et soutient qu’il n’y a point de représentants. Quelle tour de Babel! Je ne parle pas des députés, dont on ne fait plus que des conseillers de la couronne: singuliers conseillers qui peuvent voter ou refuser l’impôt, mettre les ministres en accusation, etc.! On voit bien où tout cela tend, et où l’on en veut venir. Mais, sans trop nous arrêter, tâchons de trouver ce qui sort des ténèbres de l’article.
Ce qui en sort, c’est la loi sur la réduction des rentes. Tout ce galimatias est pour nous dire qu’on n’a point abandonné l’ancien projet; que les cent trente boules noires de la chambre des députés, que la majorité des vingt-trois voix contre la loi dans la chambre des pairs, que les nombreux écrits publiés contre cette loi, que l’opinion presque générale des hommes instruits dans la matière, n’ont pu ébranler l’obstination d’un ministre; qu’on se tienne pour averti qu’un seul homme en France a le privilège d’avoir toujours raison.
Et comment un esprit si sûr de son fait semble-t-il avoir besoin de se faire appuyer? On nous parle des voeux que les conseils généraux pourront émettre: mais lorsque les chambres ont rejeté ou qu’une des chambres a refusé l’adoption d’une loi, à quel titre les conseils généraux interviendraient-ils? Aurait-on le dessein de les faire sortir du cercle de leurs attributions? Voudrait-on créer dans l’état un nouveau pouvoir politique? Aurait-on déjà quelques inquiétudes sur la disposition de la chambre élective, et pour la rendre favorable à la loi renouvelée, le ministère viendrait-il présenter cette loi non plus comme son ouvrage, mais comme le voeu des départements? La sagesse des conseils généraux nous rassure; mais l’imprudence des hommes qui pourraient agir sur eux nous effraye.
On a souvent fait entendre dans les discussions de la loi que si Paris repoussait le projet, les départements le désiraient, bien qu’on ait cent fois prouvé que cette réduction de la rente, loin de faire refluer les capitaux dans les provinces, les attirerait à Paris. Est-ce l’oeuvre d’un bon Français de chercher à rappeler, dans des articles censurés, la prétendue différence d’intérêts que l’on suppose faussement devoir exister entre Paris et le reste de la France?
Venons au dernier paragraphe de l’article:
« Ces conseils (les conseils généraux), composés de propriétaires, de négociants, de magistrats, enfin de ce que nos provinces ont de plus honorable, ne peuvent que jeter une grande lumière sur un objet qui touche aussi essentiellement à la fortune publique. C’est sous de tels auspices que la grande question débattue pendant la dernière session pourra se présenter, forte d’un assentiment presque unanime; ou bien, si elle est proscrite dans le sein de ces assemblées, le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient. »
Qu’est-ce que cela signifie?
Cela veut-il dire que si les conseils généraux sont d’avis du projet de loi, on le présentera de nouveau aux chambres, sans égard au changement d’opinion qui pourrait être survenu dans la chambre élective, sans considération pour le vote négatif de la chambre héréditaire? Mais les chambres, tout en respectant l’opinion des conseils généraux, ont une volonté; elles écoutent leurs consciences, elles consultent leurs lumières, et ne règlent point le vote d’après des délibérations étrangères à leurs séances.
On nous fait entrevoir que les conseils généraux pourraient bien être unanimes dans leur opinion. Aurait-on fait menacer de destitution les membres de ces conseils qui occupent des places dans le gouvernement, s’ils n’opinaient pas pour la loi des rentes? M. le ministre de l’intérieur nous a fait connaître ses principes sur la liberté des votes; et comme les membres des conseils généraux sont révocables, il ne peut manquer d’avoir action sur des corps qu’il peut faire composer, décomposer et recomposer, selon l’inspiration de son patriotisme.
Mais si les conseils généraux sont d’un avis, et les chambres d’un autre, comment arrivera-t-il, selon la phrase ministérielle, que le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient? Qu’entendon par là, et de quelle manière mettra-t-on fin à cette incertitude?
Comment y sera-t-on encore autorisé si la grande question débattue pendant la dernière session est proscrite dans le sein de ces assemblées, c’est-à-dire dans le sein des conseils généraux, en supposant que l’on parle français? Ou ces phrases sont de purs non-sens, ou elles renferment une menace. Quand on considère tout ce que l’on a déjà entrepris contre nos libertés, on est trop disposé à penser que le ministère tenterait les choses les plus étranges plutôt que d’abandonner son système. Un pareil article n’a pu être publié que sous le régime de la censure; il n’a d’importance que parce que les journaux sont censurés; autrement la liberté de la presse périodique en aurait fait bonne justice.
Puisque ma voix est encore entendue malgré ce qu’on fait pour l’étouffer, sentinelle vigilante, je ne cesserai d’avertir du danger. Je suis loin d’être tranquille sur nos institutions: non que je croie que les mains qui les menacent soient capables de les renverser; mais elles peuvent faire beaucoup de mal au trône et à la patrie, parce que le mal est une chose facile, à l’usage des intelligences communes: le bien seul, qui vient de Dieu, a besoin des talents qui viennent du ciel pour être mis en oeuvre.
Paris, 26 août 1824.
De la censure que l’on vient d’établir
Dans la séance de la chambre des pairs du 13 mars 1823, je disais, en répondant à un orateur:
« Un noble baron a présenté pour résultat de l’expédition d’Espagne la France envahie, toutes nos libertés détruites. Quant à l’invasion de la France et à la perte de nos libertés publiques, une chose servira du moins à me consoler: c’est qu’elles n’auront jamais lieu tandis que moi et mes collègues serons ministres. Le noble baron qui professe avec talent des sentiments généreux me pardonnera cette assertion: elle sort de la conscience d’un Français. »
Ces paroles et l’établissement de la censure expliquent assez les raisons pour lesquelles j’ai cessé d’être ministre et les causes du traitement que j’ai éprouvé de mes collègues. Je les avais associés à mes sentiments; ils les renient aujourd’hui. Il a donc fallu qu’ils se séparassent de moi, quand ils ont médité de suspendre la plus importante de nos libertés.
Laissons ma personne: parlons de la France.
Je ne répéterai pas ce que j’ai dit cent fois à la tribune dans mes discours, ce que j’ai imprimé cent fois dans mes ouvrages: point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse.
Avec la censure des journaux, la monarchie constitutionnelle devient ou beaucoup plus faible ou beaucoup plus violente que la monarchie absolue: c’est une languissante machine ou une machine désordonnée, qui s’arrête par l’embrouillement des roues ou se brise par l’énergie de son mouvement. Je ne dis rien de ce commerce de mensonges qui s’établit au profit de quelques hommes dans les feuilles sans liberté, et des diverses espèces de turpitudes, suite inévitable de la censure.
Pourquoi m’étendrais-je sur tout cela? Il s’agit bien de principes! On n’en est pas à ces niaiseries. On reconnaît sans doute qu’on a dépensé en vain des sommes considérables pour s’emparer de l’opinion des journaux: il faut donc achever par la violence ce qu’on avait commencé par la corruption. On prend l’entêtement pour du caractère, l’irritation de l’amour-propre pour de la grandeur d’esprit, sans songer que l’homme le plus débile peut dans un accès de fièvre mettre le feu à sa maison. Cet état de démence est-il une preuve de force?
L’article 4 de la loi du 17 mars 1822 est ainsi conçu:
« Si dans l’intervalle des sessions des chambres des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d’une ordonnance du roi, délibérée en conseil et contresignée par trois ministres. »
Je me demande si le cas prévu par la loi est arrivé. Des armées étrangères sont-elles à nos portes? Quelque complot dans l’intérieur a-t-il éclaté? La fortune publique est-elle ébranlée? Le ciel a-t-il déchaîné quelques-uns de ses fléaux sur la France? Le trône est-il menacé? Un de nos princes chéris est-il tombé sous le fer d’un nouveau Louvel? Non! heureusement non!
Qu’est-il donc advenu? Que le ministère a fait des fautes; qu’il a perdu la majorité dans la chambre des pairs; qu’il s’est vu mettre en scène devant les tribunaux, pour avoir été mêlé à de honteuses négociations dont le but était d’acheter des opinions; qu’il a gâté la plupart des résultats de l’expédition d’Espagne; qu’il s’est séparé des royalistes; en un mot, qu’il paraît peu capable, et qu’on le lui dit. Voilà les circonstances graves qui l’obligent à nous ravir la liberté fondamentale des institutions que nous devons à la sagesse du roi! Si les circonstances étaient graves, il les aurait faites: c’est donc contre lui-même qu’il aurait établi la censure.
L’expédition d’Espagne a été commencée, poursuivie, achevée en présence de la liberté de la presse: une fausse nouvelle pouvait compromettre l’existence de Mgr le duc d’Angoulême et le salut de son armée; elle pouvait occasionner la chute des fonds publics, exciter des troubles dans quelques départements, faire faire un mouvement aux puissances de l’Europe: ces circonstances n’étaient pas assez graves pour motiver la suppression de la liberté de la presse périodique. Mais on ose dire la vérité à des ministres; le Français, né moqueur, se permet quelquefois de rire de ses ministres: vite la censure, ou la France est perdue! Quelle pitié!
Il ne manquait au couronnement de l’oeuvre que la raison alléguée pour l’établissement de la censure. On aurait pu avoir recours aux lieux communs contre la liberté de la presse, parler de ses excès, de ses dangers, en affectant de la confondre avec la licence. On aurait pu dire que les lois actuelles de répression ne suffisent pas, bien qu’elles soient extrêmement dures, bien qu’elles aient obligé par le fait tous les journaux à se renfermer dans de justes limites. Ce n’est pas cela: on ne se plaint pas des journaux, on se plaint des tribunaux! La censure est nécessaire parce que de vrais, de dignes magistrats ont défendu la liberté de la presse, parce qu’ils ont rendu un arrêt dans l’intégrité de leur conscience et l’indépendance de leur caractère, parce qu’ils ont admis pour les journaux une existence de droit, indépendante de leur existence de fait. Et le moyen du droit paraît peu pertinent sous la monarchie légitime, après le fait de la révolution après le fait des Cent Jours! Un ministre de la justice s’expose à blâmer par sa signature la sentence d’un tribunal! il se prononce indirectement contre la chose jugée! Quel exemple donné aux peuples! Trois ministres osent mettre, pour ainsi dire, en accusation devant l’opinion publique les deux premières cours du royaume, la cour de cassation, la cour royale et le tribunal de première instance; car ces trois tribunaux ont prononcé tous trois dans la même cause! On attaque ainsi le monde judiciaire tout entier, depuis le sommet jusqu’à la base: même le ministère public à la cour de cassation a opiné dans le sens de l’arrêt de cette cour.
Tous les ministres étaient-ils présents au conseil lorsque cette dangereuse résolution a été prise? Si l’un d’eux était absent, comme on le dit, il doit bien se repentir d’avoir été privé de l’honneur de se retirer.
Les cours de justice, direz-vous, se sont trompées! Qui vous le prouve? Etes-vous plus sages, plus éclairés qu’elles? Y a-t-il eu à peu près partage égal des voix entre les magistrats dans ces cours? Je n’en sais rien. On assure toutefois que la cour de cassation, dont le savoir est si connu, a prononcé à la presque unanimité dans l’affaire de L’Aristarque.
Mais la résurrection de ce journal allait faire renaître plusieurs autres journaux. Pourquoi pas, s’ils ont réellement le droit de reparaître? Pourquoi la loi, pourquoi la justice, ne seraient-elles pas égales pour tous? Les faits ne sont pas même exacts: il est douteux qu’il y ait d’autres journaux dans le cas précis de L’Aristarque.
N’existe-t-il pas, d’ailleurs, une loi redoutable qui a suffi pour réprimer les excès de la presse? Les tribunaux, dont on blâme la jurisprudence, n’ont-ils pas souvent porté des sentences de condamnation contre des journalistes? Si l’on additionnait les sommes exigées pour les amendes, les jours, les mois et les années fixés pour les emprisonnements, on trouverait un total de peines qui satisferait les esprits les plus sévères. La rigueur que les magistrats ont déployée dans leurs premiers jugements prouve que la douceur de leurs derniers arrêts est l’oeuvre de la plus impartiale justice.
Et pouvaient-ils, par exemple, sans se déshonorer, ces magistrats, ne pas juger comme ils ont jugé dans l’affaire de La Quotidienne? Pourquoi le ministère ne s’est-il pas opposé à ce que cette cause, où il jouait un rôle, fût portée devant les cours de justice? Inconcevable imprévoyance! car on ne doit pas supposer qu’on se fît illusion sur des choses honteuses ou sur la conscience des juges.
On dit que la jurisprudence des cours fournit un moyen d’éluder la suspension, la suppression des journaux. Ainsi, ce n’était pas la répression des délits qu’on cherchait; c’était la suspension, la suppression des journaux, c’est-à-dire la suppression de la liberté de la presse périodique. Votre secret vous échappe. Voilà ce que vous voyez dans la loi; voilà comme vous comprenez le gouvernement constitutionnel. Nous savions déjà ce que vous en pensiez; nous avions lu votre brochure.
La justice est le pain du peuple: il en est affamé, surtout en France. Les corps politiques avaient depuis longtemps disparu dans ce pays; ils avaient été remplacés par les corps judiciaires, leurs contemporains, et presque leurs devanciers. Nos cours souveraines se rattachaient par les liens de la civilisation, par les besoins de la société, par la tradition de la sagesse des âges, par l’étude des codes de l’antiquité, se rattachaient, dis-je, au berceau du monde. La nation, vivement frappée des vertus de nos magistrats, s’était accoutumée à les aimer comme l’ordre, à les respecter comme la loi vivante. Les Harlay, les Lamoignon, les Molé, les Seguier, dominent encore nos souvenirs: nous les voyons toujours protecteurs comme le trône, incorruptibles comme la religion, sévères comme la liberté, probes comme l’honneur, dont ils étaient les appuis, les défenseurs et les organes.
Et ce sont les successeurs de ces magistrats immortels que des hommes d’un jour osent attaquer? Des hommes soumis à toutes les chances de la fortune, des hommes qui rentreront demain dans leur néant si la faveur royale se retire; ces hommes viennent gourmander des juges inamovibles qui parcourent honorablement une carrière fermée à toute ambition et consacrée aux plus pénibles travaux!
Vous vous tenez pour offensés lorsque les chambres n’accueillent pas vos lois; vous vous irritez quand les tribunaux jugent d’après leurs lumières. Vous ne voulez donc rien dans l’Etat que votre volonté, que vous seuls, que vos personnes?
Mais si vous parveniez à ébranler chez les peuples la confiance qu’ils doivent avoir dans leurs juges; si vous déclariez, comme vous le faites réellement, que la jurisprudence des tribunaux est dangereuse sur un point, n’en résulte-t-il pas qu’elle peut l’être sur d’autres? Dites-nous alors que deviendrait la société où vous auriez semé de pareils soupçons, vous autorité, vous pouvoir ministériel? Tous les jours ces tribunaux prononcent sur la fortune et la vie des citoyens: vous m’exposez donc à soupçonner tous les jours qu’un bien a peut-être été injustement ravi, qu’un innocent a peut-être péri sur l’échafaud?
Imprudents, qui ne voyez pas le désordre que vous jetez dans les esprits par de pareils actes! Et quelle est votre valeur morale pour condamner d’un trait de plume des cours entières, pour substituer vos ignorances ministérielles à la science des magistrats qui tiennent de l’auteur de toute justice la balance pour peser, le glaive pour punir?
Pourquoi tant d’humeur contre L’Aristarque? Serait-ce qu’il a pour propriétaires trois députés de l’opposition? Le ministère est plus riche que cela: n’a-t-il pas pour lui tous ces journaux achetés sur la place, plus ou moins cher, selon la hausse ou la baisse du prix des consciences?
Mais est-il permis à des ministres de n’avoir pas étudié les lois qu’ils sont chargés de faire exécuter? S’ils s’étaient un peu plus occupés de celles qui doivent réprimer les délits de la presse, ils auraient vu que la censure n’y était placée qu’éventuellement pour un cas si rare, pour un cas si grave, que dans tous les cas ordinaires l’exercice de cette censure rendait impraticables quelques articles de ces mêmes lois: tant il avait été loin de la pensée du législateur de faire de cette censure l’ordre commun, le droit coutumier!
Aux termes de l’article 2 de la loi du 25 mars 1822, j’ai le droit de répondre à tout ce qu’on peut me dire dans un journal; mais si le censeur a permis l’attaque et s’il ne permet pas la défense, s’il trouva dans ma réponse quelque chose qui mérite d’être marqué du signe de sa proscription, de son encre rouge, voilà donc un article de la loi qui ne sera pas exécuté? Que ferai-je? Poursuivrai-je l’éditeur responsable? L’éditeur me renverra au censeur, et le censeur au gouvernement. Je ne puis mettre un ministre en cause que par un arrêté du conseil d’Etat. Il résulte de tout cela que je suis calomnié sans pouvoir confondre la calomnie, que la loi est violée, que je ne puis avoir recours aux tribunaux, lesquels eux-mêmes se trouvent paralysés par l’exercice d’un pouvoir extra-légal en matière judiciaire.
Le fait de la censure est par lui-même destructif de tout gouvernement constitutionnel. Mais outre le fond, il y a la forme; et la forme est quelque chose entre gens bien élevés, quoiqu’on sache que nous n’y tenons pas beaucoup.
Comme on a été vite, on n’avait pas le temps de nommer une commission, et comme une vérité pouvait échapper dans vingt-quatre heures, au grand péril de la monarchie, il a fallu envoyer provisoirement à la police tous les journaux pris en flagrant délit de liberté.
Jugez quel malheur si on les avait laissés écrire un seul mot contre la mesure de la censure! Ils ont donc été mystérieusement censurés à l’hôtel de la direction de la police: une main invisible, peut-être celle d’un valet de chambre, Caton inconnu, a mutilé le soir la pensée du maître qu’il avait servi le matin, et cela pour la plus grande sûreté des ministres. On ignorera à jamais comment était provisoirement composé ce Saint-Office d’espions, chargé de décider de l’orthodoxie des doctrines constitutionnelles.
Mais encore ici les choses sont-elles légales?
L’article 1er du Code Civil porte:
« Les lois seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation pourra en être connue.
« La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale un jour après celui de la promulgation. »
Or, les journaux ont reçu l’ordre de se soumettre à la censure douze heures seulement après la publication de l’ordonnance dans Le Moniteur.
Et ce censeur qui a signé les premières censures était-il légalement connu lorsqu’il a exercé ses fonctions? L’ordonnance qui le nommait avait-elle été communiquée aux journalistes?
Tout cela est très attaquable devant les tribunaux: et il n’est pas permis lorsqu’on est ministre, et surtout lorsqu’on a appartenu à des corps judiciaires, de se montrer aussi despote, aussi ignorant.
Une commission est maintenant ordonnée, sous la présidence du directeur de la police, à l’honneur des lumières et des lettres. On avait été jusqu’à dire que des hommes choisis dans les deux chambres législatives composeraient le conseil de censure. Nous eussions plaint la faiblesse de ces hommes honorables: les pairs et les députés sont faits pour être les gardiens et non les geôliers des libertés publiques.
La censure, depuis la restauration, n’a sauvé personne: tous les anciens ministres qui ont voulu l’établir ont péri; et pourtant ils avaient une sorte d’excuse: ils étaient plus près de l’événement des Cent Jours; il y avait des troubles et des conspirations dans l’Etat: le duc de Berry avait succombé.
De plus, ces ministres avaient une certaine force; ils appartenaient à un parti; ils ne s’étaient pas mis en guerre avec toute la société; ils ne s’étaient pas élevés contre l’autorité des tribunaux. On connaissait moins le gouvernement représentatif, et par cette raison il était plus facile de s’en écarter.
Le ministère actuel ne peut argumenter ni d’une grande catastrophe ni de l’ignorance des principes de la Charte, mis aujourd’hui à la portée de tous. Il est sans puissance, car il lui a plu de s’isoler de toutes les opinions. Il a renié ses propres doctrines, et aujourd’hui qu’il établit la censure, pourrait-il relire sans rougir les discours qu’il prononçait contre la même censure à la tribune? Sorti des rangs royalistes, il a cessé d’être royaliste. Il n’a pas mieux traité l’antique honneur que la liberté nouvelle: il s’est placé entre deux Frances, dans une troisième France, composée des déserteurs des deux autres et qui ne durera pas plus que lui.
Pour vivre, il sera forcé de pousser ses systèmes à leurs dernières conséquences. C’est une vérité triviale qu’une erreur en entraîne une autre. Une vérité moins connue, c’est que le ministère se trompe sur deux qualités de force; il prend la force physique pour la force morale: or, dans la société, la première détruit, la seconde édifie.
Voyez l’enchaînement des choses:
On veut acheter des journaux; on n’y réussit pas complètement. S’arrête-t-on? ce qui valait mieux. Non: il faut aller devant les tribunaux, où l’on est condamné.
On apporte une loi relative à la fortune publique; elle est rejetée. S’arrête-t-on? ce qui était incontestablement plus sage. Avec de la modération tout pouvait encore se réparer. L’irritation de la vanité l’emporte: on cherche des victimes, on frappe au hasard, sans s’inquiéter des résultats, sans prévoir l’effet de cette violence sur l’opinion.
L’opinion se prononce. S’arrête-t-on? Non: il faut une nouvelle violence, il faut la censure.
Que le ministère trouve maintenant d’autres résistances, comme il en trouvera indubitablement, il sera contraint de devenir persécuteur. Quand il aura destitué ses adversaires, comblé de faveurs ses créatures, il n’aura rien fait; il faudra qu’il trouve un moyen d’empêcher les écrits périodiques de paraître, de modifier la jurisprudence des tribunaux, puisqu’il s’en plaint; de ces tribunaux si puissants aujourd’hui par l’injure même qu’on leur a faite, si populaires en devenant les défenseurs de nos libertés.
Qu’imaginera le ministère pour ces cours de justice, dans le cas où elles continuent, comme elles le feront, à maintenir leur doctrine indépendante? Ces cours sont établies par des lois; sans doute on ne songe pas à violer ces lois, et le temps des jugements par commission est passé.
Et à l’égard des chambres, quel parti prendra-t-on? Comment viendrait-on leur déclarer qu’on a établi la censure, n’ayant d’autre raison à leur donner que celle dont on a eu l’inconcevable naïveté de nous faire part? Oserait-on leur dire: « Nous avons supprimé la liberté de la presse périodique, parce que les magistrats ont rendu un arrêt qu’ils avaient le droit de rendre? »
On fera des pairs, soit; mais ces pairs seront-ils soumis aux caprices des ministres? Cette première magistrature n’est-elle pas aussi indépendante que l’autre? Ces nouveaux pairs viendraient-ils prendre leur siège uniquement pour approuver la censure ou voter la loi des rentes renouvelée? Je ne vous dis pas que ces créations multipliées dans un intérêt personnel tueraient à la longue l’institution de la pairie; mais songez au moins à votre chute, que précipitent tant de mesures funestes.
Et la chambre des députés, qu’en fera-t-on? Cette chambre excellente n’a besoin que d’un peu d’expérience; elle peut revenir formidable pour les ministres: en demandera-t-on la dissolution? Voyez où cela mène, et frémissez; car je veux bien supposer que vous n’avez pas vu tout cela, que vous aimez encore votre patrie.
La censure, considérée dans ses rapports avec l’état de notre société et de nos institutions, ne peut convenir à personne. Tout au plus charmera-t-elle l’antichambre et les valets qui daigneront nous transmettre dans leurs journaux les ordres de leurs maîtres. Eux seuls jouiront de la liberté, parce qu’on est sûr de leur servitude. Un journal du soir a déjà des privilèges: on lui accorde la faveur, qu’on refuse à d’autres, de partir par la poste du jour où il paraît. Si l’on veut prendre quelques nouvelles dans ce journal, on ne le peut pas sans les avoir envoyées à la censure, quoiqu’il faille bien supposer que ces nouvelles aient déjà passé sous les yeux du censeur. Mais l’on permet à l’un ce que l’on ne permet pas à l’autre: ce qui est légal dans L’Etoile deviendrait illégal dans les Débats ou La Quotidienne, dans Le Constitutionnel ou Le Courrier. L’impudence de ces petites tyrannies s’explique pourtant: la puissance n’a rien de blessant quand elle marche avec le génie; elle en est, pour ainsi dire, une qualité naturelle; mais quand la médiocrité arrive aux premières places, le pouvoir qui l’accompagne a toute l’insolence d’un parvenu.
La liberté que l’on veut comprimer échappera aux mains débiles qui essayeront de la retenir; elle leur échappe déjà. Voilà les blancs O revenus dans les journaux; vous verrez qu’il faudra sévir contre les blancs: le délit des pages blanches serait singulier à porter devant les tribunaux! Les vexations aux messageries et à la poste ne réussiront pas davantage; quand l’opinion a pris son parti, rien ne l’arrête. La capitale, les provinces, vont être inondées de brochures. Le silence même deviendra une attaque, et le ministère sera accusé par la chose qu’on ne lui dira pas. Eh, grand Dieu! en étions-nous là à l’ouverture de la session?
Lorsque Bonaparte pouvait faire fusiller en vingt-quatre heures un écrivain, on conçoit qu’il y avait répression. La terreur aussi était répressive; mais le ministère, qui le craint?
Ceux qui bravaient si fièrement l’opinion, pourquoi fuient-ils devant elle? Pourquoi cette censure, si ce n’est la peur de cette opinion qu’ils affectent de mépriser?
Je ne sais si l’on est frappé comme moi; mais il me semble que tout ce que je vois est inexplicable, que cela tient à une espèce de folie. Je conçois des actes, tout bizarres qu’ils puissent être, lorsqu’ils tendent au même but, lorsqu’ils doivent amener un résultat dans l’intérêt de ceux qui les font; mais il m’est impossible de concevoir des hommes qui veulent se sauver et qui font évidemment ce qui les perdra. À quoi bon, je le demande, ces inutiles violences dont nous sommes les témoins depuis quelques mois, cette agitation au milieu du repos, cette soif de la dictature ministérielle quand personne ne dispute le pouvoir? Pourquoi corrompre les journaux, et ensuite les enchaîner lorsque la victoire d’un héritier du trône et la prospérité de la France avaient détruit toutes les oppositions révolutionnaires? Ce que le roi avait annoncé en ouvrant la session de 1823, la Providence l’avait permis, et l’armée l’avait fait. Qui ne sentait le sol de la patrie raffermi sous ses pas? Qui ne jouissait de voir la France remonter à son rang parmi les puissances de l’Europe?
Quelque chose d’inconnu vient nous enlever soudain nos plus douces espérances. Nous rétrogradons tout à coup de huit années; nous nous replaçons au commencement de la restauration; nous nous armons de nouveau contre les libertés publiques; nous revenons à la censure, en aggravant le mal par un acte sans précédent à l’égard des tribunaux. Nous imitons une conduite que nous avons stigmatisée; nous faisons des circulaires pour les élections: il nous faudrait des pairs pour briser une majorité; nous repoussons les royalistes, et cependant nous nous disons royalistes. Tout allait au pouvoir ministériel; tout s’en retire: il reste isolé, en butte à mille ennemis, supporté seulement par une opinion qu’il dicte, par des journaux qu’il paye et des flatteurs qu’il méprise.
Quelquefois on serait tenté de croire, pour s’expliquer des choses inexplicables, ce que disent des esprits chagrins, savoir, que des sociétés mystérieuses poussent à la destruction de l’ordre établi. Et que mettrait-on à sa place? L’arbitraire ministériel, le joug de quelques commis? Et c’est avec cela qu’on prétendrait mener la France, contrarier le mouvement de la société et du siècle!
Non, cela ne serait pas possible; mais en repoussant ces craintes, il reste toujours celles qu’inspirent les fautes dont nous sommes les témoins et les victimes. En exagérant tout, en forçant tout, en abusant de tout, en gâtant d’avance les institutions, en compromettant les choses les plus sacrées, on détruit pour l’avenir tout moyen de gouvernement, on fatigue les caractères les plus forts, on dégoûte les honnêtes gens, et entre un despotisme impossible et une liberté impraticable, on se retranche dans cette indifférence politique qui amène la mort de la société, comme l’indifférence religieuse conduit au néant.
Qui produit tant de mal? Quel génie funeste, mais puissant, a maîtrisé la fortune de la patrie? Ce n’est point un génie: rien de plus triste que ce qui nous arrive: c’est le triomphe d’un je ne sais quoi indéfinissable, le succès de petits savoir-faire réunis. Deux hommes se collent au pouvoir; et pour y rester deux jours de plus ils jouent la longue destinée de la France contre leur avenir d’un moment: voilà tout.
Il faut sortir promptement de la route où l’on s’est jeté, si l’on ne veut arriver à un abîme. On peut disposer de soi, on peut se perdre si on le juge convenable; mais on ne doit jamais compromettre son pays: or, le ministère ébranle par son système la monarchie légitime: peu importent ses intentions, elles ne répareront pas ses actes.
Le remède est facile si la maladie est prise à temps; en la laissant aller, elle deviendra incurable. Je ne puis développer toute ma pensée dans ce petit écrit, rapide ouvrage de quelques heures, que je publie à la hâte pour l’intérêt de la circonstance. Il m’est dur, déjà avancé dans ma carrière, de rentrer dans les combats qui ont consumé ma vie; mais pair de France, mais investi d’une magistrature, je n’ai pu voir périr une liberté publique, je n’ai pu voir attaquer les tribunaux sans élever la voix, sans prêter mon secours, tout faible qu’il puisse être à nos institutions menacées. Que le trône de notre sage monarque reste inébranlable! que la France soit heureuse et libre! Et quant à ma destinée, comme il plaira à Dieu.
De l’abolition de la censure
Je comptais publier quelques autres écrits faisant suite à ma brochure contre la censure; brochure que cette même censure n’avait pas permis d’annoncer dans les journaux. Combien je me trouve heureux de voir les armes brisées dans ma main, de changer mes remontrances, importunes aux ministres, en cantiques de louanges pour le roi!
Nous devions tout attendre du principe de la vieille monarchie, de cet honneur assis sur le trône avec Charles X: notre espérance n’a point été vaine. La censure est abolie: l’honneur nous rend la liberté!
Puisse-t-il être récompensé du bonheur dont il nous fait jouir, notre excellent monarque! Mettons aussi nos voeux aux pieds du dauphin, dont nous reconnaissons et la puissante influence et les sentiments généreux: c’est toujours le prince libérateur!
La Charte est ce qu’il nous fallait; la Charte est ce que nous pouvions avoir de meilleur au moment de la restauration. Une fois admise, il se faut bien persuader qu’elle est inexécutable avec la censure: il y a plus, la censure mêlée à la Charte produirait tôt ou tard une révolution. Voici pourquoi:
Le gouvernement représentatif sans la liberté de la presse est le pire de tous: mieux vaudrait le divan de Constantinople. Lâche moquerie de ce qu’il y a de plus sacré parmi les hommes, ce gouvernement n’est alors qu’un gouvernement traître, qui vous appelle à la liberté pour vous perdre et qui fait de cette liberté un moyen terrible d’oppression.
Supposez, ce qui n’est pas impossible, qu’un ministère parvienne à corrompre les chambres législatives: ces deux énormes machines broieront tout dans leur mouvement, attirant sous leurs roues et vos enfants et vos fortunes. Et ne pensez pas qu’il faille un ministère de génie pour s’emparer ainsi des chambres: il ne faut que le silence de la presse et la corruption que ce silence amène.
Dans l’ancienne monarchie absolue, les corps privilégiés et la haute magistrature arrêtaient et pouvaient renverser un ministère dangereux. Avez-vous ces ressources dans la monarchie représentative? Si la presse se tait, qui fera justice d’un ministère appuyé sur la majorité des deux chambres? Il opprimera également et le roi, et les tribunaux, et la nation; sous le régime de la censure, il y a deux manières de vous perdre: il peut, selon le penchant de son système, vous entraîner à la démocratie ou au despotisme.
Avec la liberté de la presse, ce péril n’existe pas: cette liberté forme en dehors une opinion nationale, qui remet bientôt les choses dans l’ordre. Si cette liberté avait existé sous nos premières assemblées, Louis XVI n’aurait pas péri; mais alors les écrivains révolutionnaires parlaient seuls, et on envoyait à l’échafaud les écrivains royalistes. J’ai lu, il est vrai, dans une brochure en réponse à la mienne, que Sélim, Mustapha et Tippoo-Saëb étaient tombés victimes de la liberté de la presse: à cela je ne sais que répondre.
La liberté de la presse est donc le seul contrepoids des inconvénients du gouvernement représentatif; car ce gouvernement a ses imperfections comme tous les autres. Par la liberté de la presse il faut entendre ici la liberté de la presse périodique, puisqu’il est prouvé que quand les journaux sont enchaînés, la presse est dépouillée de cette influence de tous les moments qui lui est nécessaire pour éclairer. Elle n’a jamais fait de mal à la probité et au talent; elle n’est redoutable qu’aux médiocrités et aux mauvaises consciences: or, on ne voit pas trop pourquoi celles-ci exigeraient des ménagements et quel droit exclusif elles auraient à la conduite de l’Etat.
Cette nécessité de la liberté de la presse est d’autant plus grande parmi nous que nous commençons la carrière constitutionnelle, que nous n’avons point encore d’existences sociales très décidées, qu’il y a encore beaucoup de chercheurs de fortune et que les ministres arrivent encore un peu au hasard. Il faut donc surveiller de près, pour le salut de la couronne, les hommes inconnus qui pourraient surgir au pouvoir par un mouvement non encore régularisé.
On dit que la censure est favorable aux écrivains, qu’elle les décharge de la responsabilité, qu’elle les met à l’abri d’une loi sévère. Est-ce de l’intérêt particulier des écrivains qu’il s’agit, relativement à la liberté de la presse dans l’ordre politique? Cette liberté doit être considérée dans cet ordre par rapport aux intérêts généraux, par rapport aux citoyens, par rapport à la société tout entière: c’est une liberté qui assure toutes les autres dans les gouvernements constitutionnels. Quand donc vous venez nous entretenir d’ouvrages et d’auteurs, vous confondez la littérature et la politique, la critique et la censure, et vous ne comprenez pas un mot de la chose dont vous parlez.
D’autres, soulevés contre la manière brutale dont on exerçait la censure, n’en admettaient pas moins le principe; ils auraient établi seulement une oppression douce et tempérée. On avait mis la liberté de la presse au carcan; ils ne voulaient que l’étrangler avec un cordon de soie.
D’autres, cherchant des motifs à la censure, et n’en trouvant pas de raisonnables, prétendaient qu’ayant peut-être à examiner à la session prochaine les moyens propres à cicatriser les dernières plaies de l’Etat, la censure serait nécessaire pour empêcher la voix des passions étrangères de se mêler à la discussion de la tribune.
Et moi je demanderai comment on pourrait agiter de telles questions sans la liberté de la presse: faut-il se cacher pour être juste? Votre cause ne deviendrait-elle pas suspecte, ne calomnierait-on pas vos intentions, si vous croyiez devoir traiter dans l’ombre et comme à huis clos des affaires qui sont de la France entière! Ouvrez, au contraire, toutes les portes; appelez le public comme un grand jury à la connaissance du procès: vous verrez si nous rougirons de plaider la cause de la fidélité malheureuse, nous qui parlons franchement de liberté sans que ce mot nous blesse la bouche. Et depuis quand la religion et la justice auraient-elles cessé d’être les deux bases de la véritable liberté? Soyons francs sur les principes de la Charte, et nous pourrons réclamer, sans qu’on nous suppose d’arrière-pensée, ce que l’ordre moral et religieux exige impérieusement d’une société qui veut vivre.
Le dernier essai que l’on vient de faire a heureusement prouvé qu’il n’était plus possible d’établir la censure parmi nous; nous avons fait de tels progrès dans les institutions constitutionnelles que les censeurs même n’ont pas osé se nommer. D’un bout de la France à l’autre, toutes les opinions ont réclamé la liberté de la presse; par la raison qu’on en avait joui paisiblement deux années et qu’il était démontré, d’après l’expérience tentée pendant la guerre d’Espagne, que cette liberté, ne nuisant à rien, était propre à tout: c’était un droit acquis dont on ne sentait pas le prix tandis qu’on le possédait, mais dont on a connu la valeur aussitôt qu’on l’a perdu.
Désormais nos institutions sont à l’abri: nous allons marcher d’un pas ferme dans des routes battues. Dix années ont amené de grands changements dans les esprits: des préjugés se sont effacés, des haines se sont éteintes; le temps a emporté des hommes, tandis que des générations nouvelles se sont formées sous nos nouvelles institutions. Chacun prend peu à peu sa place, et l’on détourne les yeux d’un passé affligeant pour les porter sur un riant avenir.
L’abolition de la censure a dans ce moment surtout un avantage qu’il est essentiel de signaler. Nous pouvons louer nos princes sans entraves; nous pouvons déclarer notre pensée sans que l’on puisse dire que la manifestation de cette pensée n’est que l’expression des ordres de la police. Il faut que l’Europe sache que tout est vrai dans les sentiments de la France, que les opinions sont unanimes, que les oppositions même se rencontrent au pied du trône pour l’appuyer et le bénir. Louis XVIII étend ses bienfaits sur nous au delà de la vie: il termina la révolution par la Charte; il reprit le pouvoir par la guerre d’Espagne; et sa mort, objet de si justes regrets, a pourtant consolidé la restauration, en mettant un règne entre les temps de l’usurpation et l’avènement de Charles X.
Depuis un mois cette restauration a avancé d’un siècle; la monarchie a fait un pas de géant. Quel triomphe complet de la légitimité et de ce qu’il y a d’excellent dans ce système! Un roi meurt, le premier roi légitime qui s’était assis sur le trône après une révolution de trente années. Ce roi gouverne avec sagesse; mais ceux qui ne comprenaient pas la force de la légitimité, mais les passions comprimées, mais les vanités déçues, mais les ambitions secrètes, mais les intérêts, les jalousies politiques, murmuraient tout bas: « Cet état de choses pourra durer pendant la vie de Louis XVIII; mais vous verrez au changement de règne! »
Eh bien, nous avons vu! nous avons vu un frère succéder à un frère, de même qu’un fils remplace un père dans le plus tranquille héritage. À peine s’aperçoit-on qu’on a changé de souverain. Un des plus grands événements dans les circonstances actuelles s’accomplit avec la plus grande simplicité. Comme dans une succession ordinaire, on lève les scellés: ce n’est rien; ce n’est que la couronne de la France qui passe d’une tête à une autre! ce n’est que le sceptre de saint Louis que Charles X prend au foyer de Louis XVIII!
Entendon parler de quelque réclamation? Où sont les prétendants de la république et de l’empire? Est-il dans le monde une puissance qui ait envie de contester le trône au nouveau roi? A-t-il fallu des hérauts d’armes, des bruits de tambours et de trompettes, des parades et des jongleries; un développement imposant de la force militaire, pour dérober à la foule ébahie ce que le droit d’un usurpateur a de douteux? Nullement. Le roi est mort: Vive le roi! Voilà tout, et chacun vaque à ses affaires, l’esprit libre, le coeur content, sans craindre l’avenir, sans demander: « Qu’arrivera-t-il demain? » Le pouvoir protecteur, la puissance politique n’a point péri, la société est en sûreté, et la succession légitime de la famille royale garantit à chaque famille en particulier sa succession légitime.
Que sont devenues toutes ces allusions, pour le moins téméraires, au sort d’un prince étranger? Où trouver la moindre ressemblance dans les choses, les temps et les souverains? Ces mouvements d’humeur que l’on prenait pour des intuitions de la vérité, pour des enseignements historiques, s’évanouissent devant les faits et les vertus, et jamais les vertus ne furent plus évidentes et les faits plus décisifs.
Si la royauté triomphe, le roi ne triomphe pas moins. Charles X s’est élevé au niveau de sa fortune; il a montré qu’il connaissait les moeurs de son siècle, qu’il prenait la monarchie telle que le temps et les révolutions l’ont faite. Il a dit aux magistrats de continuer à être justes et à prononcer avec impartialité; il a dit aux pairs et aux députés qu’il maintiendrait comme roi la Charte qu’il avait jurée comme sujet, et il a tenu sa parole, et il nous a rendu la plus précieuse de nos libertés; il a dit aux Français de la confession protestante que sa bienfaisance s’étendait également sur tous ses sujets; il a dit aux ministres du culte catholique qu’il protégerait de tout son pouvoir la religion de l’Etat, la religion, fondement de toute société humaine; il a recommandé cette même religion comme base de l’éducation publique. Toutes ces paroles, qui sont de véritables actes politiques, ont enchanté la nation. Charles X peut se vanter d’être aujourd’hui aussi puissant que Louis XIV, d’être obéi avec autant de zèle et de rapidité que le souverain le plus absolu de l’Europe.
Pour savoir où nous en sommes de la monarchie, il faut avoir vu le monarque se rendant à Notre-Dame; tout un grand peuple, malgré l’inclémence du temps, saluant avec transport ce roi à cheval, qui s’avançait lui-même au-devant de ses plus pauvres sujets pour prendre de leurs mains leurs pétitions avec cet air qui n’appartient qu’à lui seul; il faut l’avoir vu au Champ-de-Mars au milieu de la garde nationale, de la garde royale et de trois cent mille spectateurs: jour de puissance et de liberté qui montrait la couronne dans toute sa force et qui rendait à l’opinion ses organes et son indépendance. Un roi est bien placé au milieu de ses soldats quand il départ à ses peuples tout ce qui contribue à la dignité de l’homme! l’épée est pour lui: elle pourrait tout détruire, et il ne s’en sert que pour conserver! Aussi l’enthousiasme n’était pas feint: ce n’étaient pas de ces cris qui expirent sur les lèvres du mendiant payé, chargé sous les tyrans d’exprimer la joie ou plutôt la tristesse publique: c’étaient des cris qui sortent du fond de la poitrine, de cet endroit où bat le coeur avec force, quand il est ému par l’amour et la reconnaissance.
Ceux qui ont connu d’autres temps se rappelaient une fête bien différente au Champ-de-Mars la monarchie finissait alors; aujourd’hui elle recommence. Est-ce bien là le même peuple? Oui, c’est le même; mais le peuple guéri, le peuple désabusé. Il avait cherché la liberté à travers des calamités inouïes, et il n’avait rencontré que la gloire: ses princes légitimes devaient seuls lui donner le bien que des tribuns factieux et un despote militaire lui avaient dérisoirement promis.
Si les bénédictions du peuple, comme il n’en faut pas douter, attirent celles du ciel, elles ont descendu sur la tête du souverain et de la famille royale. Jamais la France n’a été plus heureuse, plus glorieuse et plus libre que dans ce jour mémorable. Mais à la vue de cette famille en deuil au milieu de tant d’allégresse, la pensée se tournait avec attendrissement vers cet autre monarque qui n’est pas encore descendu dans la tombe; l’aspect d’une multitude affranchie de tout esclavage et protégée par de généreuses institutions rappelait encore le souvenir de l’auguste auteur de la Charte. Quel pays que cette France! les villes apportent leurs clefs au lit funèbre de ses généraux et les peuples rendent hommage de leur liberté au cercueil de ses rois!
Lettre à M. le rédacteur du Journal des débats, sur le projet de loi relatif à la police de presse
4 janvier 1827.
Monsieur,