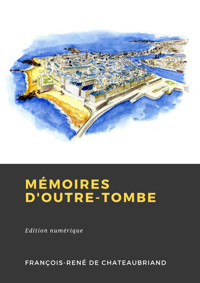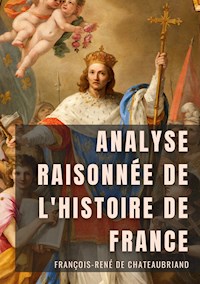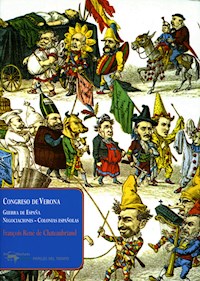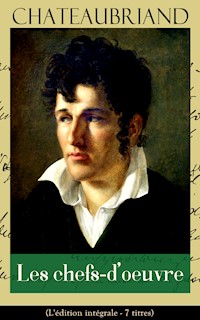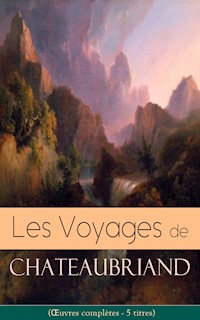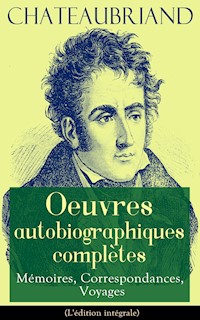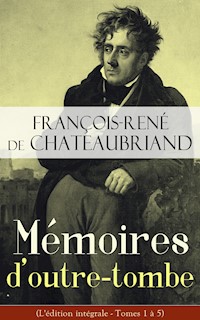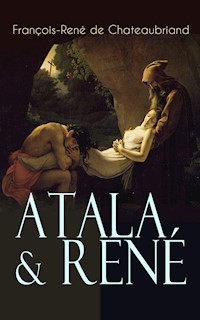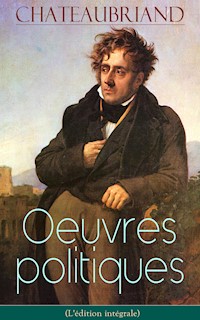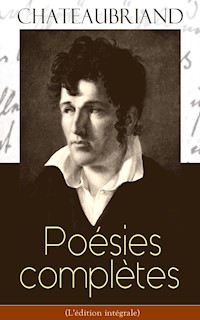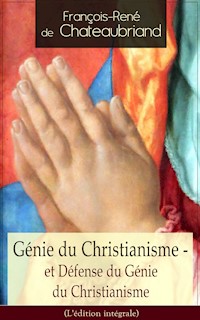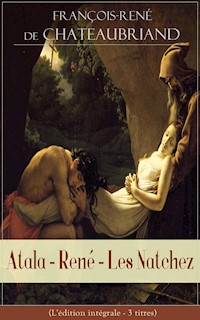Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Correspondance de Chateaubriand avec la marquise de V...
Das E-Book Un dernier amour de René wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, romance, CORRESPONDANCES, Oeuvre épistolaire
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un dernier amour de René
Un dernier amour de RenéPRÉFACE-UN DERNIER AMOUR DE RENÉPROLOGUE – À M. de ChateaubriandCORRESPONDANCE DE CHATEAUBRIAND AVEC LA MARQUISE DE V…I. À M. le vicomte de ChateaubriandII. De M. de ChateaubriandIII. À M. de ChateaubriandIV. De M. de ChateaubriandV. À M. de ChateaubriandVI. De M. de ChateaubriandVII. À M. de ChateaubriandVIII. De M. de ChateaubriandIX. À M. de ChateaubriandX. De M. de ChateaubriandXI. À M. de ChateaubriandXII. De M. de ChateaubriandXIII. À M. de ChateaubriandXIV. De M. de ChateaubriandXV. À M. de ChateaubriandXVI. De M. de ChateaubriandXVII. À M. de ChateaubriandXVIII. De M. de ChateaubriandXIX. À M. de ChateaubriandXX. De M. de ChateaubriandXXI. À M. de ChateaubriandXXII. À M. de ChateaubriandXXIII. De M. de ChateaubriandXXIV. À M. de ChateaubriandXXV. De M. de ChateaubriandXXVI. À M. de ChateaubriandXXVII. De M. de ChateaubriandXXVIII. À M. de ChateaubriandXXIX. À M. de ChateaubriandXXX. De M. de ChateaubriandXXXI. À M. de ChateaubriandXXXII. De M. de ChateaubriandXXXIII. À M. de ChateaubriandXXXIV. De M. de ChateaubriandXXXV. À M. de ChateaubriandXXXVI. De M. de ChateaubriandXXXVII. De M. de ChateaubriandXXXVIII. À M. de ChateaubriandXXXIX. À M. de ChateaubriandXL. De M. de ChateaubriandXLI. À M. de ChateaubriandXLII. De M. de ChateaubriandXLIII. À M. ChateaubriandXLIV. De M. de ChateaubriandXLV. De M. de ChateaubriandXLVI. À M. de ChateaubriandXLVII. De M. de ChateaubriandXLVIII. À M. de ChateaubriandXLIX. À M. de ChateaubriandL. De M. de ChateaubriandLI. De M. de ChateaubriandLII. À M. de ChateaubriandLIII. De M. de ChateaubriandLIV. De M. de ChateaubriandLV. À M. de ChateaubriandLVI. À M. de ChateaubriandLVII. De M. de ChateaubriandLVIII. À M. de ChateaubriandLIX. De M. de ChateaubriandLX. À M. de ChateaubriandLXI. De M. de ChateaubriandLXII. À M. de ChateaubriandLXIII. De M. de ChateaubriandLXIV. À M. de ChateaubriandLXV. De M. de ChateaubriandLXVI. À M. de ChateaubriandLXVII. De M. de ChateaubriandLXVIII. À M. de ChateaubriandLXIX. De M. de ChateaubriandLXX. À M. de ChateaubriandLXXI. De M. de ChateaubriandLXXII. À M. de ChateaubriandLXXIII. Réponse De M. de ChateaubriandLXXIV. À M. de ChateaubriandLXXV. Réponse de M. de ChateaubriandPage de copyrightUn dernier amour de René
François-René de Chateaubriand et Marie-Louise de Vichet
PRÉFACE
Dans un château des environs de Viviers, propriété séculaire de sa famille, demeurait, en l’année 1827, une femme d’une sensibilité délicate et de l’esprit le plus distingué, la marquise de V… Née en 1779, elle avait épousé à quinze ans un gentilhomme du Languedoc, d’excellente maison, lui aussi ; et elle avait eu de lui un fils, son unique enfant. Mais, en 1827, elle demeurait seule dans son château du Vivarais. Son mari, entré dans l’administration sous l’Empire, habitait Toulouse, où il remplissait les fonctions d’inspecteur des douanes. Son fils, officier de chasseurs, avait sa garnison à l’autre bout du royaume. De telle sorte que, dans sa solitude, Mme de V… pouvait entretenir à loisir le culte qu’elle avait voué depuis sa jeunesse à l’auteur du Génie du Christianisme. Elle avait été de celles que l’apparition de ce livre, jadis, avait affolées d’enthousiasme [1] : toujours, depuis lors, elle continuait à être partagée entre son désir de connaître Chateaubriand et la crainte d’importuner celui-ci ou de lui déplaire. Déjà en 1816, profitant d’un séjour à Paris, elle avait écrit à son grand homme ; puis, au dernier moment, elle avait imaginé un prétexte pour se dispenser de le rencontrer. Onze ans plus tard, à propos de quelques mots lus dans le Journal des Débats sur une indisposition de Chateaubriand, elle s’enhardit à lui écrire de nouveau ; et, cette fois, sa lettre fut le point de départ d’une correspondance qui devait durer sans interruption près de deux ans, jusqu’au mois de juin 1829. Au moment où s’ouvrit cette correspondance, Chateaubriand traversait une des périodes les plus tristes et les plus inquiètes de sa vie.
Il avait perdu, peu de mois auparavant, sa vieille amie Mme de Custine. Mme de Chateaubriand, très souffrante elle-même, lui faisait sentir plus vivement que jamais l’incompatibilité naturelle de leurs caractères. Ruiné, dépossédé de toute influence politique, réduit à une opposition hargneuse et rebutante, toujours plus ennuyé des autres et de lui-même à mesure qu’il découvrait davantage son inutilité, René se trouvait dans une disposition morale qui, sans doute, lui rendit plus sensible l’hommage imprévu de la marquise de V… Le fait est qu’il y répondit aussitôt avec une passion extraordinaire, se livrant comme il se livrait à peine à ses plus intimes confidents. C’est ainsi que s’engagea, entre lui et son « inconnue », un véritable petit roman, dont aucun de ses biographes ne paraît avoir soupçonné l’existence, et que, grâce à une pieuse précaution de Mme de V… [2] , nous pouvons aujourd’hui mettre tout entier sous les yeux du public. Disons-le tout de suite : ce qui donne à ce roman un intérêt, un piquant très particulier, c’est que la marquise de V… est restée, presque jusqu’au bout, une « inconnue » pour Chateaubriand. Celui-ci, pendant tout le temps qu’ont duré leurs relations, a ignoré l’âge et la figure de sa correspondante. Il y a eu là un mystère, et, à la suite de ce mystère, un malentendu, qui seuls peuvent faire comprendre la vraie signification des lettres qu’on va lire.
Et le mystère était né du hasard ; et si, peut-être, Mme de V… n’a pas fait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour dissiper le malentendu, nous ne croyons pas que personne, ayant lu ses lettres, trouve jamais le courage de le lui reprocher. Personne n’aura jamais le courage de lui reprocher que, lorsque l’homme qu’elle adorait a enfin daigné s’enquérir d’elle, elle ne lui ait pas nettement déclaré qu’elle n’était pas la jeune femme qu’il semblait supposer. Elle avait alors près de cinquante ans ; elle aurait pu le dire à Chateaubriand, et ne le lui a pas dit ; on sent qu’elle n’a pas eu la force de s’y résigner. Mais, on le sent aussi, elle a cruellement souffert de ce malentendu qu’elle n’osait dissiper. Sans cesse, et de mille façons les plus touchantes du monde, elle s’efforce de suggérer à Chateaubriand qu’elle ne saurait attendre de lui qu’une amitié toute fraternelle. Tantôt elle le gronde de sa familiarité, tantôt elle projette de ne plus lui écrire ; elle va même jusqu’à le prier de se renseigner sur elle auprès d’amis communs. Et le poète s’obstine dans ses illusions, avec une insistance dont on devine que la pauvre femme est à la fois effrayée et ravie. « Votre écriture est toute jeune, lui dit-il, la mienne est vieille comme moi. » Il est certain de retrouver en elle, quand il la verra, « une image de femme qu’il s’est faite depuis sa jeunesse », et qu’il « n’a encore rencontrée nulle part ». Quand elle lui demande de « ne penser à elle que comme à une personne simple et bonne qui l’aime de tout son cœur », il l’accuse de vouloir « commencer une correspondance orageuse ». Et il achète une carte de France, pour y regarder l’endroit où demeure « Marie » ; et il l’invite à venir avec lui à Rome ; et il lui parle des longues années « qui seront pour elle, et non pour lui qui s’en va ».
Mais surtout il veut la voir ; c’est comme le refrain de toutes ses lettres : « Venez à moi !… Il faut que je vous voie ! » Et d’autant plus Mme de V… a peur de se laisser voir. L’affection de Chateaubriand lui est désormais devenue si nécessaire qu’elle s’épouvante à l’idée de la perdre. « Ma vie, lui écrit-elle un jour, s’est passée tout entière à désirer votre affection et à fuir votre présence. » Ou plutôt elle désire de toute son âme la présence de son ami : elle rêve de le rencontrer aux eaux où il doit aller, de l’avoir près d’elle dans son château, de se promener avec lui sous le mail de l’Infirmerie Marie-Thérèse ; mais, dès que l’occasion s’offre à elle de réaliser un de ces rêves, elle hésite, elle ajourne, elle invente un prétexte pour rester « inconnue » quelque temps encore. Que d’angoisses il y a en elle, dont chacune de ses lettres nous apporte l’écho ! Et comme ses lettres nous sont aujourd’hui expressives et touchantes, avec leurs contradictions, leurs alternatives de confiance et de désespoir, avec ce gracieux déploiement d’images et de style par où elle s’efforce de se gagner, dans le cœur de son « maître », une estime assez forte pour pouvoir survivre aux désillusions de l’amour ! « Pourquoi donc, lui demande-t-elle naïvement, pourquoi ne pouvez-vous m’aimer par mes lettres, comme je vous aime par vos livres ? » Mais Chateaubriand s’obstine à ne pas la comprendre. Il ne voit, dans toute cette conduite, qu’un caprice, peut-être une ruse pour piquer davantage sa curiosité. Et, en effet, sa curiosité se pique sans cesse davantage, pendant les premiers mois de la correspondance. Il écrit lettre sur lettre, du ton à la fois le plus tendre et le plus sincère.
Lui dont Mme de Duras disait « qu’il ne répondait jamais rien qui eût rapport à ce qu’on lui écrivait », il n’y a pas dans les lettres de Mme de V… un seul passage où il ne prenne à cœur de répondre. Puis, peu à peu, on sent que sa curiosité commence à se fatiguer. La chute du cabinet Villèle vient de lui rendre l’espoir d’un grand rôle politique : il refuse des offres de ministères, il se fait nommer ambassadeur à Rome : une vie nouvelle s’ouvre devant lui, qui ne lui laisse plus guère de loisirs pour échanger des rêves et des confidences avec une « sœur » qu’il n’a jamais vue. Il continue cependant à solliciter les lettres de son inconnue ; il continue à lui dire : « Il faut que je vous voie ! » Mais il le lui dit avec moins d’impatience ; et sa pauvre « Marie », qui naguère le priait de ne penser à elle que comme à une bonne et simple amie, lui reproche maintenant que ses lettres « aient une sorte de style anonyme, comme si elles ne s’adressaient à personne ! » Hélas ! oui, les dernières lettres de Chateaubriand, plus précieuses peut-être pour nous que les premières par les renseignements historiques qu’elles nous offrent, justifient les reproches et les plaintes de Mme de V… Si intéressantes que soient ces dernières lettres de Chateaubriand, bien plus profondément nous émeuvent les longues et maladroites réponses où l’amie, affolée, s’épuise en efforts inutiles pour retenir une attention qui se détourne d’elle. C’est dans ces réponses que se révèlent à nous, en même temps, tout l’amour de Mme de V… et toute sa souffrance. Et puis nous nous rappelons son âge, la situation particulière où elle se trouve vis-à-vis de l’homme qu’elle aime d’un tel amour : et nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer quel magnifique sujet aurait été, pour un Balzac, ce roman de « l’inconnue » de Chateaubriand.
Enfin, — après combien de luttes, et avec quelle crainte !-Marie se décide à affronter la présence de son ami ; et ainsi s’achève son triste roman. « M. de Chateaubriand est venu me voir le samedi 30 mai et le samedi suivant, 6 juin », écrit-elle, bien des années plus tard, à la dernière page d’un cahier où elle vient de recopier, une fois de plus, toute sa correspondance avec « l’élu de son cœur ». Et celui-ci s’en va aux eaux de Cauterets, où il l’avait maintes fois invitée à l’accompagner ; et elle, pendant les longues années qui lui restent à vivre (elle est morte en 1848, presque en même temps que Chateaubriand), nous ne voyons pas qu’elle tente même la plus timide démarche pour se rappeler au souvenir de celui qui, jadis, jurait « d’aimer pour la vie sa Marie inconnue ». Heureuse est-elle encore d’être morte avant lui, et de n’avoir pas pu lire, dans les Mémoires d’Outre-Tombe, le récit d’une aventure arrivée précisément pendant ce séjour aux eaux de Cauterets ! Voilà qu’en poétisant (il s’amusait à composer une ode) je rencontrai une jeune femme assise au bord du gave. Elle se leva et vint droit à moi. Elle savait, par la rumeur publique, que j’étais à Cauterets. Il se trouva que l’inconnue était une Occitanienne, qui m’écrivait depuis deux ans sans que je l’eusse jamais vue. La mystérieuse anonyme se dévoila : patuit dea. J’allai rendre une visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir qu’elle m’accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut suivre : je fus forcé de la reporter chez elle dans mes bras… J’ai laissé s’effacer l’impression fugitive de ma Clémence Isaure ; la brise de la montagne a bientôt emporté ce caprice d’une fleur ; la spirituelle, déterminée, et charmante étrangère de seize ans m’a su gré de m’être rendu justice : elle est mariée [3] . Ainsi Chateaubriand, pendant les deux années qu’a duré sa correspondance avec Mme de V…, avait une autre « inconnue », à qui peut-être il promettait aussi de « l’aimer pour la vie » ! Peut-être lui avait-il proposé, à elle aussi, de venir le rejoindre à Rome, en même temps qu’il le proposait à « Marie » et à Mme Récamier ? Et peut-être n’est-ce pas simplement le hasard qui la lui a fait rencontrer à Cauterets, « assise au bord du gave » ? Il avait toujours eu le goût de conduire en même temps plusieurs petites intrigues sentimentales, traitant chacune d’elles avec tant de chaleur, et tant de mystère, qu’on pouvait croire qu’il s’y donnait tout entier ; mais parfois le mystère se découvrait, et un pauvre cœur de femme en était déchiré. Heureuse du moins « Marie » de n’avoir pas connu cette souffrance-là ! Oui, — les lettres qu’on va lire le prouvent une fois de plus —, Chateaubriand avait raison de dire que « son amour portait malheur » ; mais nous soupçonnerions volontiers que la faute en était au moins autant à lui-même qu’à la fatalité. Il était fait de telle sorte que, attachant toujours beaucoup plus de prix à ce qu’il n’avait pas qu’à ce qu’il avait, il ne pouvait s’empêcher de le laisser voir. La dureté qu’on lui a reprochée pour les femmes qui ont « agréé sa vie » semble bien avoir consisté surtout en un contraste trop rapide, trop peu dissimulé, entre ses façons d’agir à leur égard avant et après sa victoire sur elles ; et sans doute ses amies l’auraient trouvé moins dur s’il ne les avait pas habituées, d’abord, à toutes les douceurs d’une tendresse, d’une prévenance, d’une sollicitude infinies.
Ses premières lettres à Mme de V… suffiraient pour nous donner une idée de l’art vraiment merveilleux que ce grand artiste savait mettre à la conquête d’un cœur. Tous les mots y sont des caresses ; et leur musique même, tour à tour langoureuse ou pressante, c’est avec un attrait irrésistible qu’elle murmure : « Venez à moi ! » Comme on comprend que, accoutumée à une telle musique, une femme ait pleuré toutes ses larmes avant de se résigner à ne plus l’entendre ! Mais Mme de V… avait l’esprit trop droit et l’âme trop généreuse pour ne pas se rappeler que l’homme par qui elle souffrait était celui aussi qui, durant de longs mois, avait transfiguré sa vie en un rêve enchanté. De la même façon qu’elle avait aimé Chateaubriand avant de le connaître, elle a continué de l’aimer après que la destinée les eut séparés : le soin qu’elle a pris de conserver, de transcrire, d’annoter ses lettres nous montre assez que, jusqu’au bout, elle est restée pieusement fidèle à « l’élu de son cœur ». Et nous, à notre tour, tout en la plaignant, gardons-nous d’êtres injustes ou sévères pour lui ! Par une étrange perversité de notre nature, nous sommes trop souvent tentés de donner tort, d’avance, aux hommes de génie, dans les aventures d’amour où nous les voyons engagés ; nous sentons ces hommes si différents de nous, si supérieurs à nous, que nous ne pouvons nous défendre de vouloir les en punir une fois encore. Et cependant, à y regarder de plus près, il est bien rare que le véritable génie ne s’accompagne pas d’une certaine bonté : d’une bonté faite parfois de détachement, voire d’indifférence, mais répugnant d’instinct à toutes les formes de la bassesse, dont il n’y en a pas de plus basse que de faire souffrir.
Pour ce qui est de Chateaubriand, en particulier, si ses premières lettres à Mme de V… nous le révèlent infiniment habile à tous les artifices de la séduction, les dernières nous apportent un nouveau témoignage de ce qu’il a appelé quelque part, en riant, « sa maudite bonté ». Dès le moment de son départ pour Rome, nous sentons que son « inconnue » ne l’intéresse plus ; nous le sentons, comme elle le sentait elle-même, au « style anonyme » de ses lettres, à mille petites nuances involontaires de froideur et de gêne : mais il n’en continue pas moins de lui écrire, et de la consoler, avec une complaisance d’autant plus touchante qu’on devine davantage l’effort qu’elle lui coûte. Ce n’est pas lui qui, comme le médiocre Adolphe, serait descendu jusqu’à se plaindre d’une femme qu’il aurait cessé d’aimer. Il avait toujours vite fait, malheureusement, de cesser d’aimer, et nombreuses sont les femmes qui en ont souffert ; mais il n’accusait jamais que lui seul de cette fatale et malfaisante mobilité de son cœur. Et personne n’en a souffert autant que lui-même. C’était un de ces enfants gâtés qui ne peuvent résister à la tentation de casser aussitôt les jouets qu’on leur donne, et qui ensuite se désolent de les avoir cassés. Combien de jouets divers il a cassés, ou tout au moins ébréchés, au cours de sa vie, depuis des cœurs de femmes jusqu’à une religion et une royauté ! Et combien, toute sa vie, il s’en est désolé ! Sous les apparences extérieures d’une vanité enfantine, ses Mémoires ne sont, d’un bout à l’autre, que la plainte d’un enfant sur ses jouets brisés. « N’est-ce pas une chose curieuse, écrivait-il en 1826 dans une préface des Martyrs, que je sois aujourd’hui un chrétien douteux et un royaliste suspect ? »
Hélas ! il était vraiment l’un et l’autre, malgré les meilleures intentions du monde ; et, bien qu’il s’en défendît au-dehors, il ne pouvait s’empêcher de le reconnaître, au-dedans de soi, ni de s’en affliger, ni de sentir qu’il allait recommencer le lendemain les fautes qu’il se repentait d’avoir commises la veille. C’était un enfant, un malheureux enfant. À Rome, un soir, pendant une des brillantes réceptions de l’ambassade de France, une dame anglaise, « qu’il ne connaissait ni de nom, ni de visage », s’est approchée de lui, l’a regardé, et lui a dit, en français, mais avec un fort accent de son pays : « Monsieur de Chateaubriand, vous êtes bien malheureux ! » Étonné de « cette manière d’entrer en conversation », l’ambassadeur a demandé à la dame ce qu’elle voulait dire. « Je veux dire que je vous plains ! » lui a-t-elle répondu, après quoi elle a « accroché le bras d’une autre Anglaise, et s’est perdue dans la foule ». Rien de ce qu’on pourra jamais écrire de Chateaubriand n’égalera, en finesse ni en profondeur, le jugement porté sur lui par cette dame inconnue.
T. W
[1]« Je serais embarrassé de raconter avec une modestie convenable comment on se disputait un mot de ma main, comment on ramassait une enveloppe écrite par moi, et comment, avec rougeur, on la cachait, en baissant la tête, sous le voile tombant d’une longue chevelure. » (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe.)
[2]« Quand mes lettres sont faites, je les copie telles qu’elles sont, et les joins aux vôtres. Tout ce que j’ai écrit à vous et de vous m’est ainsi resté. » (Mme de V… à Chateaubriand, lettre du 16 décembre 1828.) On sait que Chateaubriand avait l’habitude de détruire aussitôt toutes les lettres de femmes qu’il recevait.
[3]Mémoires d’Outre-Tombe, IIIe partie, livre XIII. On trouvera, sur cet épisode, des renseignements très curieux dans une étude de M. Victor Giraud (Revue des Deux Mondes, 1er avril 1899).
-UN DERNIER AMOUR DE RENÉ
PROLOGUE – À M. de Chateaubriand
Paris, 15 mars 1816.
Monsieur le Vicomte,
J’ai trouvé chez moi, parmi de vieux papiers négligés, un petit manuscrit dont la lecture m’a vivement intéressée. C’est, à ce qu’il m’a paru, la copie d’une correspondance qu’on avait voulu soustraire aux profanations révolutionnaires, mais qu’on n’avait pu se résoudre à sacrifier tout à fait. L’élégance et la pureté du style de ces lettres, les nobles sentiments dont elles sont remplies, et le tableau consolant et mélancolique qu’offre leur ensemble dans un espace de trente-trois années, me donnèrent le désir de les faire imprimer, en changeant toutefois les noms des lieux et des personnes, par respect pour ces dernières, s’il en existait encore. Je n’ai point de notions là-dessus, parce que j’habite le Vivarais où je suis née, et que je ne connais personne en Bretagne, d’où ces lettres ont été écrites. Une seconde lecture de mon petit manuscrit me fit naître un doute qui changea mon projet. Plusieurs passages de ces lettres dans lesquels se trouve votre nom me firent imaginer que la dame qui les avait écrites pouvait être votre parente. Cette pensée me rendit le manuscrit bien plus précieux, et, quoiqu’il n’y eût point d’apparence que j’eusse jamais l’honneur de vous voir, je résolus de n’en disposer qu’après m’être assurée qu’il n’avait point d’intérêt pour vous. J’aurai donc l’avantage de vous le remettre, si vous désirez le lire. Mais, pour ne pas vous obliger à cette lecture inutilement, voici quelques mots qui vous en dispenseront peut-être : L’auteur de ces lettres se nommait Mme la marquise de P… (le nom est en abrégé dans le cahier), elle habitait Auray, et deux terres dont l’une se nommait Le Lardais, et l’autre Lannouan. Elle avait passé ses premières années à Châteaubriand, et était nièce de M. de La Chalotais. Si à ces renseignements vous reconnaissez en effet, monsieur le vicomte, une personne dont le souvenir vous soit cher, je serai bien heureuse de pouvoir vous en offrir cet intéressant vestige. Vous le recevrez comme un gage des sentiments de respect et de reconnaissance que je vous ai voués avec tous les vrais Français. Veuillez bien en agréer suis partie sur-le-champ pour aller la chercher. Pardonnez-moi, Monsieur le vicomte, de ne vous avoir pas écrit pour vous prévenir de mon absence ! Cette bonne pensée ne m’est pas venue, je suis partie en toute hâte, et préoccupée d’inquiétude et de regret. Ce soir, à mon retour, j’ai trouvé votre carte. Je conclus de votre billet et de votre visite que mon manuscrit vous intéresse, en effet, et je me réjouis de tout mon cœur de pouvoir vous en faire l’hommage. Tous les Français vous offrent celui de leur reconnaissance pour les bons sentiments et les douces émotions qu’ils vous doivent. Ceux que vous avez consolés dans leurs peines peuvent vous en vouer une plus spéciale encore. Votre temps est trop précieux, monsieur le vicomte, pour que j’ose vous demander une seconde visite. Si vous me la destiniez, je voudrais en savoir le moment ? Mais je me bornerai à vous envoyer le manuscrit ; s’il vous intéresse, vous le garderez tout à fait. S’il vous est étranger, ne vous donnez pas la peine de me le renvoyer, je l’enverrai chercher chez vous avant mon départ.
Agréez…
De M. de Chateaubriand, Paris, mardi 19 mars 1816.
Selon toutes les apparences, madame, le manuscrit n’intéresse personne de ma famille. Mais j’ai à vous remercier de votre politesse. Puisque vous voulez bien me le permettre, madame, et me laisser le choix du jour, j’aurai l’honneur de passer chez vous, samedi 29, à midi.
Agréez, madame, je vous en prie, l’hommage de mon respect. de CHATEAUBRIAND.
Note de Mme de V.
— Me trouvant suffisamment remerciée, je voulus épargner à M. de Chateaubriand l’ennui d’une visite sans but, et me punir moi-même d’avoir risqué d’abuser de sa politesse. Je partis de Paris avant le jour qu’il avait fixé pour notre entrevue.
CORRESPONDANCE DE CHATEAUBRIAND AVEC LA MARQUISE DE V…
I. À M. le vicomte de Chateaubriand
Hlle, 14 novembre 1827.
Monsieur le Vicomte,
Depuis que je sais aimer et honorer quelque chose, vous avez tout mon respect et tout mon attachement ; à mesure que votre caractère public s’est développé, ces sentiments se sont fortifiés dans mon cœur, et ils y ont enfin jeté de si profondes racines que je me crois quelques droits à votre bienveillance, parce que, depuis bien des années, les principaux événements de votre vie forment un des plus chers intérêts de la mienne. Depuis que notre ami commun, M. Hyde de Neuville, est revenu des pays étrangers, il m’a donné de vos nouvelles de loin en loin. Mais le voilà trop occupé des élections pour que je puisse en attendre, ni même lui en demander. Cependant, je viens de lire, dans le Journal des Débats du 9 novembre, la lettre que vous avez adressée au rédacteur du courrier. Mes yeux se sont mouillés de larmes en y voyant que « votre santé est altérée par un travail excessif et par les vives inquiétudes que vous cause une autre santé qui vous est plus chère que la vôtre ! » En prenant, monsieur, la liberté de vous écrire et de vous dérober quelques minutes d’un temps toujours si précieux, et dans ce moment si péniblement employé, je serais coupable d’une indiscrète présomption, si le sentiment qui dicte ma lettre n’était pas de ceux qu’il est toujours doux et honorable d’inspirer, et d’accueillir. Vous êtes fait pour en être touché, et j’en suis si persuadée que j’ose vous en demander une preuve. Remettez ma lettre à votre secrétaire, et recommandez-lui de m’adresser, tous les quinze jours, deux lignes en forme de bulletin, qui me tirent d’inquiétude sur votre santé, et sur Mme de Chateaubriand !
Cependant, monsieur, si vous ne jugez pas à propos d’accorder un soin si obligeant à une personne qui vous est étrangère, et qui probablement ne vous verra jamais, je vous prie au moins de juger ma lettre d’après les circonstances qui me sont personnelles et non d’après les règles générales de la bienséance ! Je ne crois cependant pas les enfreindre aujourd’hui ; il me paraît simple de vous demander de vos nouvelles, et juste que vous m’en fassiez donner, car j’ai passé beaucoup d’années, je ne dis pas à vous admirer (l’admiration ne me donnerait aucun droit particulier auprès de vous), mais à vous chérir avec une attention que rien n’a pu détourner. D’ailleurs qui peut mieux que vous justifier une exception, et combien de fois ne devez-vous pas avoir reçu des marques d’attachement de personnes auxquelles le sort, ainsi qu’à moi, a refusé le bien de vous connaître et d’obtenir votre affection ?
Recevez donc avec bienveillance l’assurance du profond attachement que je vous ai voué pour toujours, et celle des vœux que je ne cesse de former pour votre bonheur. j’ai l’honneur d’être avec un tendre respect, monsieur le vicomte, votre très humble servante.
La marquise de V… née d’H. H., 13 novembre 1827,
près La Voulte en Vivarais.
II. De M. de Chateaubriand
Paris, 24 novembre 1827.
Madame la Marquise,