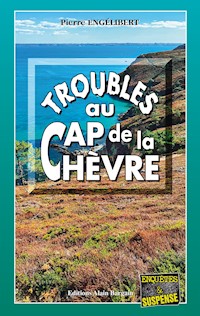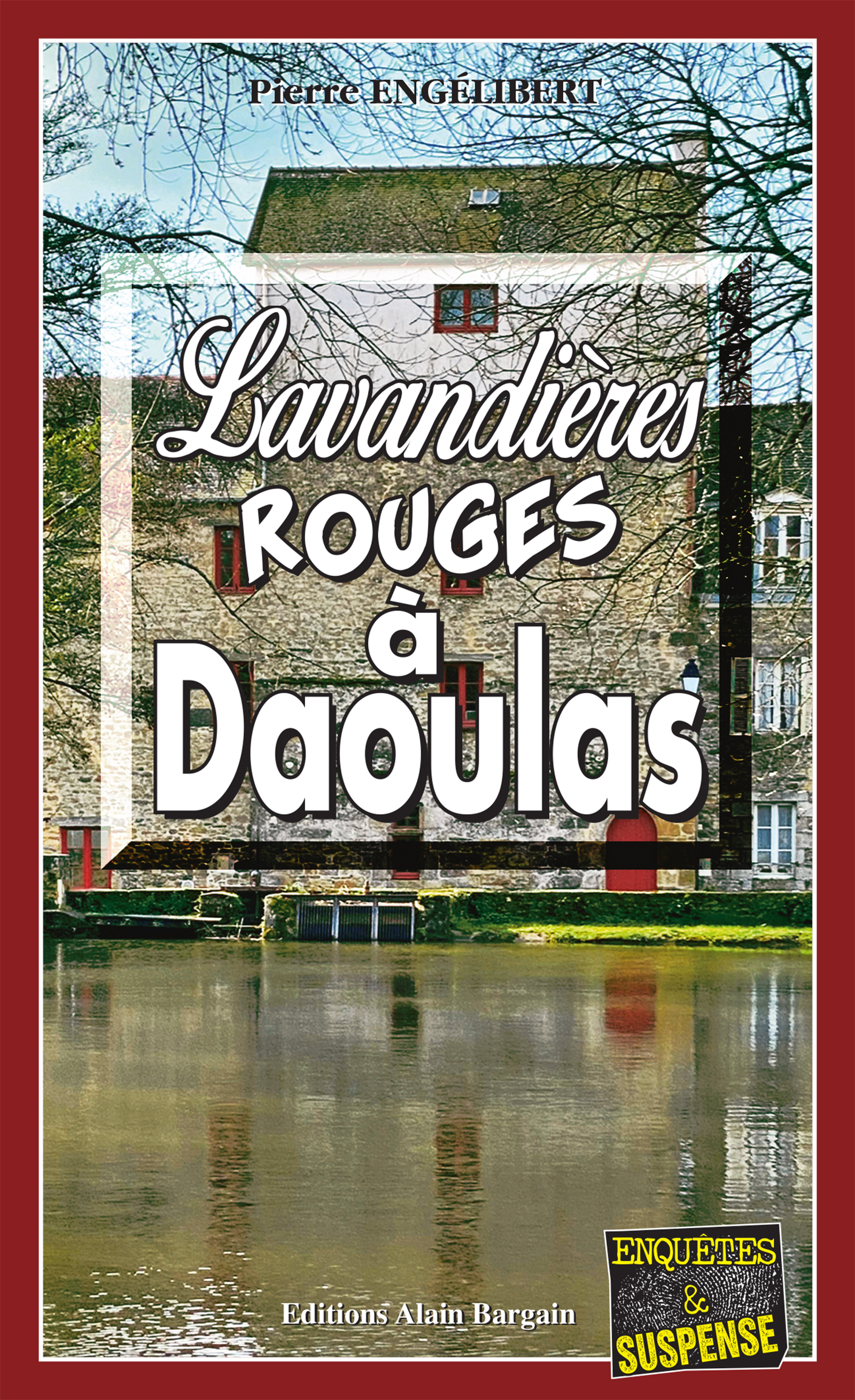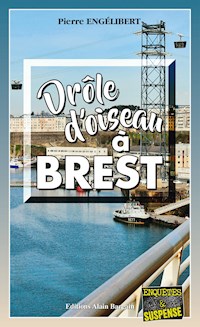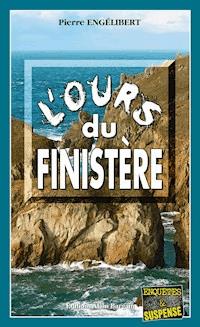Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Enor Berigman
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Que signifie le mystérieux sigle, GLAS, trouvé à proximité d'un cadavre impossible à identifier ?
Le cadavre d'un homme, impossible à identifier, est découvert par deux enfants dans la vallée du Costour, près de Brest. Que signifie le mystérieux sigle, GLAS, trouvé à proximité du corps ? Le meurtre ne fait aucun doute mais seule l'autopsie élucidera les circonstances extraordinaires du décès. Une intuition amène le commissaire Enor Berigman, du SRPJ de Brest, à soupçonner un lien avec la mystérieuse disparition, un mois auparavant, d'un vétérinaire d'Audierne. Avant que la traque d'un tueur particulièrement retors ne donne des résultats, le commissaire Berigman devra puiser dans toutes ses ressources et celles de son équipe pour résoudre cette affaire hors normes.
Le commissaire Enor Berigman devra à nouveau faire l'impossible afin d'élucider des meurtres étranges... Un polar régional captivant en plein cœur de Brest !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Très bon livre , j’adore cet auteur" Philippe BOSCHET, Amazon
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeur des écoles pendant plus de trente ans au Faou, maire honoraire de la ville, Pierre Engélibert a profité de son départ à la retraite pour se remettre à l'écriture. Il est membre du collectif d'auteurs “L'Assassin Habite Dans Le 29”.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Dominique, ma belle-sœur, Cylia et Christelle, mes nièces, qui comprendront pourquoi.
« Nous sommes ce que nous prétendons être, aussi devons-nous être prudents à propos de ce que nous prétendons être. »
Kurt VONNEGUT, Mother night, 1961
À Marc Ronceraille, pour qui
« Il n’est pire imposture que la quête de soi-même. »
Victorien ESPINASSE, Maximes et apophtegmes,Figeac, Éditions des Traversées, 1948
PROLOGUE
Souvenir du 21 avril 1997, Châteaulin
La nuit du 21 au 22 avril 1997 restera gravée à jamais dans ma mémoire comme celle de ma libération, celle de la mort de mon père. Vu de l’extérieur on pourrait se scandaliser de cette pensée malsaine sauf à imaginer le pire. Mais que l’on ne se méprenne pas, il ne m’a jamais touché ou frappé et n’a jamais battu ma mère non plus ! Rien ne peut lui être reproché quant à son comportement envers sa famille. Du moins pas vraiment. Il n’était, je crois, ni pire ni meilleur qu’un autre. Non, sa cruauté était d’une autre nature. De celle, tout aussi grave, qui interroge sur la part d’humanité qui réside en chacun de nous. L’ai-je d’ailleurs eue moi-même, “ce soir-là”, cette étincelle humaine, dévoré que j’étais depuis plusieurs années par une rage grandissante, du haut de mes seize ans ? Ne s’est-elle pas éteinte pendant ces quelques instants fatidiques, soufflée en une seconde ? « La conscience vaut mille témoins », dit le proverbe. Aussi vivrai-je jusqu’à ma mort avec des sentiments ambigus sur ce tournant de ma vie qui couronna des années d’ébrasement du déni qui m’avait jusqu’alors aveuglé ? La progressive déchirure du voile m’avait ouvert les yeux sur la véritable personnalité de ce père, couvant en moi un étouffant cocktail d’émotions haineuses à l’âge qui aurait dû être celui de mes émancipations prêtes à mordre gaiement la vie. Alors non, je ne regrette rien de cette paralysie qui m’a saisi comme un cadeau du destin. Elle a marqué la délivrance de l’enfant trahi que j’étais devenu. Mais j’ignorais alors que les choix de ma vie d’adulte seraient plus tard à ce point déterminés par les agissements coupables de mon géniteur.
Le 21 avril 1997, le président Chirac a commis la faute de dissoudre l’Assemblée nationale pour des raisons électorales, avançant d’un an la date des législatives, convaincu qu’à la date prévue, en 1998, la dégradation inévitable de la situation économique due aux difficultés budgétaires lui ferait perdre les élections. Cette erreur stratégique l’a précipité dans la cohabitation avec l’opposition triomphante.
Quel rapport ? Aucun, car mon père s’en moquait, il détestait Chirac mais guère plus que les autres présidents. Sinon que pour des raisons obscures il voulut alors fêter cela. D’abord en ingurgitant une quantité phénoménale de bières et d’alcool, ce qui n’était pas vraiment extraordinaire pour lui, tous les prétextes étant bons pour s’enfiler une bière, comme il disait. Ensuite en me réquisitionnant vers une heure du matin, faute de pouvoir appeler ses acolytes. Inutile de lui dire qu’il n’était pas en état, il aurait balayé mes objections en rigolant. Ce qui lui importait, c’était qu’il restait de la place dans le vivier et que je vienne l’aider. Il savait pourtant que je n’approuvais pas ce braconnage, c’était un sujet d’engueulades violentes entre nous, et habituellement il ne me demandait jamais de venir. Ce n’était d’ailleurs pas le plus grave de ses actes, loin de là ! Mon dégoût venait surtout du reste. De tous ces oiseaux, ces chats ou même parfois un chien errant qu’il tuait pour le plaisir. Aucun animal, domestique ou non, n’était à l’abri de ses exactions meurtrières, pas plus un crabe sur une plage qu’un escargot dans le jardin. Par pur sadisme et plaisir selon moi, par vengeance affirmait-il sans qu’il en ait jamais expliqué la raison. Ce soir-là, sous le coup d’une improvisation impulsive, il décida d’une nouvelle sortie sans attendre le rendez-vous fixé avec ses complices.
La dernière semaine des vacances de printemps commençait ; absorbé par mon nouveau jeu vidéo dans ma chambre, je n’avais pas envie de sortir alors que je progressais dans ma recherche des cinq tours pour sauver les habitants du village que j’avais transformés en pierre. Mon achat de “Terranigma”, sur Super Nintendo, datait de samedi mais je ne l’avais commencé que ce soir car j’avais préféré continuer ma bataille contre l’armée diabolique de “Mr Bones” sur Saturn ce week-end. C’est peu dire que je n’avais guère envie de sortir ! Surtout pour “cela” ! C’était son problème de s’adonner à ce genre d’activité destructrice dont il savait ce que je pensais.
Mais je l’accompagnai quand même, incapable de lui résister et vaguement inquiet, ce qui m’étonna moi-même. Plus tard, je penserai à une prémonition qui me saisit inconsciemment. En colère, je quittai donc le confort de mon fauteuil, éteignis ma console et le rejoignis dans le garage. Aussitôt qu’il eut pris nasses, tamis et autres ustensiles dans la dépendance et les eut rangés dans le coffre de sa Range Rover, nous partîmes à deux kilomètres de là, sur le bord de l’Aulne. Son emplacement favori était juste un peu en amont de la ville ; on y accédait par un chemin creux carrossable en impasse qui desservait des prairies et s’arrêtait brutalement après avoir longé une haie parallèle au chemin de halage tout près de l’eau. Un étroit passage dans les arbustes permettait l’accès au canal, à quelques mètres. Je me rappelle que la nuit était calme et que l’on n’entendait pas un bruit. Depuis ma plus tendre enfance, j’ai aimé le silence de la nuit, surtout en pleine nature. Se croire seul alors que la vie animale grouille tout autour, secrète, furtive, comme ici près du canal où l’imperceptible murmure de l’eau distille un climat tranquillisant. Nul risque d’une présence humaine à cette heure, même pas un couple d’amoureux qui ne ferait sûrement pas une telle distance pour s’isoler alors que d’excellentes caches existent plus près de la ville, j’en sais quelque chose. Mon père avait toujours su choisir des coins uniques pour attraper en toute discrétion ces alevins d’anguille que l’on appelle civelles.
Je restai dans la voiture le temps qu’il s’affaire sur le bord avant de monter dans son canot. Puis je sortis pour m’approcher afin de lui confirmer que je n’embarquerai pas avec lui. C’est alors que le drame se produisit, sans que je voie quel mauvais geste il avait bien pu faire, sinon qu’il avait dû mal calculer son saut et perdre l’équilibre. Le canal n’est pas très large ni le courant très violent à cet endroit, en cette saison. Mais l’eau est suffisamment profonde pour ne pas avoir envie d’y tomber tout habillé en pleine nuit. C’est pourtant ce qui se passa alors que je ne me trouvais qu’à cinq mètres du bord : d’abord un craquement sourd, celui du bateau, accompagné d’un grand cri précédent l’éclat de la chute dans l’eau. Mais le plus étrange est le silence qui suivit, car je n’entendis plus rien.
Lorsque j’atteignis le canot en courant, l’obscurité m’empêchait de distinguer quoi que ce soit et c’est à l’oreille que j’essayai de repérer le moindre signe de vie, la plus petite agitation en surface. Mais il ne se passa rien. Je scrutai l’eau du bateau, puis courus le long de la berge en suivant le courant et en appelant. Mais en vain. Je n’avais aucune aide extérieure à attendre à cet endroit et les minutes s’égrenaient trop vite, hâtant l’approche du pire.
J’étais un excellent nageur, mais en remontant vers le canot je décidai de ne pas plonger. C’est pourquoi je sais, au plus profond de mon être, que ma réaction, cette nuit-là, ne fut que le simulacre de ma bonne conscience, histoire de me convaincre que j’avais fait tout ce que je pouvais. Mais même si les chances de succès de le retrouver dans l’obscurité étaient quasi nulles, “l’intention” n’y était pas. Alors je parle faussement de paralysie, afin d’affronter le reste de ma vie.
Cet événement fondateur, ancré en moi par la double chaîne de la honte et de la préservation, m’a conduit sur des chemins dont je n’ai pourtant pas à rougir. Je suis fier de ce que j’ai patiemment construit en marge de ma vie professionnelle, que je n’ai bien sûr pas choisie par hasard. Toute psychanalyse est inutile, mes choix de vie sont limpides.
Mais les rivières ne grossissent pas sans être troubles, je n’aurais pas dû l’oublier et j’ai manqué de vigilance.
C’est donc ma faute si j’en suis là, aujourd’hui, en 2020. Je n’ai pas su réagir à temps, mais peut-être est-ce un juste retour des choses, que la créature échappe à son créateur.
I
Mercredi 22 janvier 2020, 13 h 15, Guipavas, vallée du Costour
Le choucas s’approche prudemment du bout de pain humide abandonné sur le bord du chemin. Il tourne d’abord autour, alternant faux demi-tours et coups d’œil méfiants dans toutes les directions. Tout en traçant des cercles concentriques se rapprochant de plus en plus de sa cible, il lève la tête vers les arbres où plusieurs de ses congénères surveillent le moindre de ses mouvements. C’est alors que l’un d’entre eux vient se poser quelques mètres derrière lui. Il lui faut se décider sinon cette proie va lui échapper. Mais il sait que même lorsqu’il l’aura dans son bec ce ne sera pas encore gagné. Pourtant il se décide brusquement, fonce vers le pain qu’il attrape en deux fois et s’envole aussitôt en direction de l’étang, poursuivi instantanément par cinq ou six autres choucas qui lui contestent sa prise en croassant le plus fort possible tout en le serrant au plus près, au risque de voir le quignon tomber à l’eau. Toute cette agitation se déroule sous l’œil impavide d’un héron perché sur une haute branche d’un aulne dressé au bord de l’étang.
À vingt mètres de là, Arthur et Lucas se sont arrêtés de marcher et ont observé le manège du corvidé avant qu’il ne s’élève à coups d’aile énergiques. Levant leurs bâtons comme si c’étaient des épées, ils se mettent à courir en hurlant, s’imaginant mettre en fuite un ennemi fictif. Mais les corvidés sont déjà loin. En cet après-midi très frais à cause du vent d’est mais ensoleillé, du haut de leurs neuf ans, les deux enfants se sont pris au jeu. Pendant vingt secondes leur mission fut de chasser les oiseaux noirs qui protègent les fantômes du château hanté, un peu plus loin, leur véritable objectif qu’ils aperçoivent au bas de la descente au détour d’un coude du chemin. D’après Albert, un voisin, la bâtisse en ruines est une ancienne ferme, mais le grand-père d’Arthur hausse les épaules quand il entend ça. Pour lui, c’était un moulin qui avait été construit il y a bien longtemps à cet endroit, en aval d’un premier à l’entrée du vallon et dont la ruine existe toujours. C’est vrai que plusieurs ruisseaux se rejoignent dans la vallée et contribuent ainsi à maintenir sauvage la coulée verte qui ralliait jadis la mer, aujourd’hui juste interrompue par la voie ferrée et la quatre-voies qui longent la plage du Moulin blanc. Un tunnel permet encore de passer de l’une à l’autre. Les deux enfants n’y connaissent rien, mais ce n’est pas l’idée qu’ils se font d’un moulin.
Dans leur esprit, la ruine, qu’ils connaissent bien, n’est ni une ferme ni un moulin. Aujourd’hui c’est un hôtel manoir hanté qu’il faut nettoyer de ses fantômes, comme dans le jeu “Luigi’s Mansion 3”. Leurs armes sont prêtes : Arthur tient fermement “l’Ectoblast”, l’aspirateur à fantômes dont le “Spectroflash” de Lucas lui signalera la position. En réalité Lucas a emprunté la lampe frontale que son père utilise pour ses entraînements en hiver et Arthur a juste accroché un grand morceau de carton multicolore au bout de son bâton, lui donnant un effet parabole. Pour l’occasion ils ont mis leur pull en laine Super Mario, bleu pour l’un, vert pour l’autre, que la grand-mère d’Arthur leur a tricoté à partir d’un modèle vu sur Internet. Leur casquette de base-ball de même couleur à l’effigie de leur héros préféré a été achetée en ligne. Ainsi équipés, ils se sentent invincibles. C’est Florian, le cousin d’Arthur, qui a plus de vingt ans, qui leur a fait découvrir le personnage de Mario.
Les deux combattants approchent prudemment des vieux murs, déjà prêts au pire. Ils s’efforcent d’être le plus silencieux possible afin de ne pas alerter l’ennemi aux pouvoirs surnaturels. L’ouverture béante d’une porte, qui a disparu depuis longtemps et dont l’espace laissé par les pierres effondrées des murs adjacents dessine comme un sourire de bienvenue, semble les inviter à pénétrer dans l’antre des monstres. Mais ne s’agit-il pas plutôt de la mâchoire affamée d’un abîme dévoreur d’enfants ? Les deux héros se collent de chaque côté de l’entrée contre le mur, à l’affût du moindre bruit suspect pendant de longues secondes. Lucas, plus âgé qu’Arthur de quelques mois et censé être le plus courageux, fait signe avec la main qu’il va se glisser le premier. Il allume sa lampe et fait un pas à l’intérieur, suivi de près par son compagnon, son arme braquée vers cet espace inconnu. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il fasse si sombre. La froide moiteur de l’air, mélangée aux odeurs suffocantes de moisi, ajoute à leur soudaine envie presque incontrôlable de déguerpir au plus vite et de retrouver la clarté de l’air libre.
Mais il se dégage une autre pestilence, puissante, qui domine toutes les autres et envahit aussitôt leur nez et leur gorge. Si tout avait été normal, ils se seraient jetés sur l’énorme araignée noire que le faisceau lumineux éclaire sur une pierre à deux mètres. Leur premier fantôme ! Mais le surnaturel ne se commande pas et lorsque le halo de lumière se déplace légèrement sur la gauche, cherchant l’origine de l’odeur, le monde de l’au-delà surgit brutalement sous la forme concrète d’un corps immobile étendu sur le dos au sol. Pétrifiés un court instant, sous l’emprise d’une terreur absolue, les deux intrépides chasseurs redeviennent instantanément deux jeunes enfants apeurés qui s’enfuient en hurlant, comme s’ils étaient poursuivis par une armée de spectres.
II
16 heures, vallée du Costour
Il a failli rater l’allée de Candy sur sa gauche malgré le petit panneau bilingue indiquant le bois du Costour à l’angle du bar qui fait le coin de la rue. Le commissaire Enor Berigman, de l’antenne de Brest de la Direction interrégionale de police judiciaire de Rennes, prend la toute petite route en impasse qui file d’abord à travers une courte zone pavillonnaire avant de descendre brusquement, presque sous la forme d’un chemin creux, vers l’étroite vallée. De rares maisons isolées bordées d’arbres l’accompagnent jusqu’au bout de la route. Ensuite commence la vallée proprement dite, matérialisée à cet endroit par une barrière en métal qui bloque l’accès des véhicules au chemin carrossable qui s’enfonce devant lui dans la nature. Elle a été ouverte par les équipes des services techniques de la police qui l’ont précédé, ce qui lui évite d’aller sur le parking qu’il aperçoit sur la gauche, de l’autre côté de la ruine qui incarne un drôle de signe de bienvenue. Un de ses collègues en uniforme filtre les allées et venues, il lui fait un signe, s’arrête près de lui et baisse la vitre. L’homme, qu’il ne connaît pas, lui adresse un bref salut et dit :
— Bonjour, Commissaire, vous pouvez y aller, c’est à environ cinq cents mètres d’ici, vous ne pouvez pas le rater.
Bien qu’il ait passé son enfance à Lesneven, un peu au nord, et qu’il habite aujourd’hui à l’ouest de Brest, il n’avait jamais entendu parler de cette vallée, qui descend pourtant jusqu’à la plage et au port de plaisance, presque parallèle au vallon du Stang-Alar, à quelques centaines de mètres à peine. Tous les habitants de la région connaissent ce dernier, puisqu’il abrite l’une des plus importantes collections au monde de plantes en danger d’extinction au sein du conservatoire botanique national et qu’il est l’un des lieux de promenade préférés des Brestois selon la saison. Même si l’on délaisse la visite des grandes serres tropicales, dont l’entrée est payante, la balade fleurie et arborée parmi les étangs, agrémentée d’aires de jeux et de repos et de parcours sportifs, est un intermède relaxant dans un havre de verdure exceptionnel.
Rien de tel dans le vallon du Costour pense-t-il alors qu’il s’engage prudemment sur le large chemin stabilisé. En fait il a devant lui l’état dans lequel devait être le Stang-Alar plusieurs décennies auparavant avant d’être aménagé. Des vallées jumelles, avec la même histoire, que l’homme a exploitées intensivement avant d’en disjoindre l’évolution. L’endroit ne doit être fréquenté que par quelques rares promeneurs locaux et aussi par des adeptes du VTT dont il devine les traces au sol sur les chemins de terre adjacents.
La voix de Buddy Holly l’accompagne sur Valley of Tears, un morceau de Fats Domino, alors qu’il suit un ruisseau bordé par des ajoncs sur sa droite avant que le chemin ne grimpe soudainement parmi les chênes et les châtaigniers dépouillés, lui offrant une vue magnifique sur un lac dont il croit avoir lu qu’il occupait le site d’une carrière qui avait notamment servi à la reconstruction de Brest après-guerre et même jusqu’au-delà des années soixante. Aujourd’hui l’ensemble des étangs du vallon fournit la ville en eau potable. Mais en ce moment précis, il lui est difficile de s’émerveiller devant le site car l’endroit sera bien pour une famille une “vallée des larmes” et son travail sera de trouver qui en est à l’origine. Maigre consolation.
Lorsque le chemin redescend enfin, des voitures garées de façon hasardeuse et un groupe d’hommes qui s’activent auprès d’une ruine en bas lui montrent qu’il arrive. Quelqu’un lui fait signe d’avancer, désignant du bras un emplacement gardé à son intention. Il s’approche lentement et évalue plus précisément le renfoncement qui élargit un peu le chemin et lui permet de se placer perpendiculairement, tout près d’un frêne magnifique. Il sort de la Volvo sans difficulté et se félicite aussitôt d’avoir écouté Denis et mis une tenue chaude mais décontractée quand il voit le fouillis végétal qui enserre la ruine à dix mètres de là. L’endroit est à l’abri du vent mais il ne serait pas surpris qu’un peu de gel escorte le petit matin. Il remarque un érable imposant, de l’autre côté du chemin, comme en renfort du frêne, qui inspire l’idée que les deux arbres sont des sentinelles gardant l’entrée des lieux. Il ne peut s’empêcher de sourire en pensant aux progrès qu’il a accomplis en quelques années dans la reconnaissance des silhouettes des arbres et des noms de fleurs sous l’influence de Mariannig, sa compagne, et de Soizic, l’épouse de son ami le divisionnaire à la retraite François Le Rouzic. Lui qui ne s’intéressait dans sa jeunesse qu’aux animaux, des oiseaux aux tritons des mares, les seuls végétaux qui l’attiraient alors étaient surtout les arbres fruitiers, à condition de pouvoir se servir, et pas toujours de façon très autorisée.
Et plus tard, bien sûr, les champignons, sur lesquels il était devenu presque incollable, du moins pour les comestibles et les toxiques les plus fréquents. Cette connaissance suffisait à son bonheur de ramasseur respectueux de leurs stations, comme on appelle les zones où ils poussent.
Denis Bauzin, promu capitaine en septembre dernier, le rejoint en montrant l’environnement d’un large geste du bras :
— Bonjour, Patron, je n’aurais jamais cru qu’il existait un tel endroit si près du centre-ville de Brest, cette ville m’étonnera toujours !
Denis venait du Val-de-Marne ; c’est la proximité de la mer et sa passion pour la planche à voile qui l’avaient attiré dans la région.
— Non, je ne connaissais pas non plus. Thierry Pouliquen, qui semble un habitué des lieux, m’a dit que l’endroit était riche en faune et en flore. Mais en cette saison, pas moyen de repérer encore les arbustes qui disparaissent en hiver. En arrivant, par exemple, je n’ai pas vu le moindre buddléia, or il y en a dans le secteur.
— L’arbre à papillons ?
— Oui, apparemment, c’est le parfum qui attire les lépidoptères mais je crois qu’il porte mal son surnom. Il est classé plante invasive et Soizic Le Rouzic m’a expliqué que lorsque c’est le seul arbuste d’un petit jardin les papillons ne pondent pas dans son entourage car ses feuilles sont toxiques pour les chenilles. D’une certaine façon il participe plus à leur extinction qu’à leur épanouissement ! Bien, trêve de bavardage ! Alors qu’est-ce qu’on a ?
Les deux hommes passent une tenue de protection que leur tend un technicien sous l’œil vigilant du procédurier qui vérifie que tout se passe bien dans les règles afin de ne pas prêter le flanc plus tard à un éventuel vice de forme soulevé par un avocat vétilleux. Des spécialistes ratissent la zone à l’affût du moindre indice. Les chances sont minces mais c’est un travail indispensable.
Denis répond :
— Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années. Il gisait sur le dos à l’intérieur de la ruine.
— Ce sont des enfants qui l’ont trouvé, c’est bien ça ? Qu’est-ce qu’ils faisaient là ?
— Ils jouaient. Ils habitent dans le lotissement plus haut et ce vallon est leur terrain de jeu. Et vous savez combien les ruines sont attirantes quand on est jeune et qu’on veut jouer aux aventuriers. Si j’ai bien compris, ils reproduisaient un jeu vidéo, une chasse aux fantômes ou quelque chose dans le même goût.
— Eh bien, ils ont été servis, dans le genre faute de goût !
— Oui, on peut le dire ! On les a raccompagnés chez eux, plus exactement chez les parents du jeune Arthur. Les deux familles sont voisines mais j’ai préféré qu’ils restent ensemble si vous voulez les interroger. Ah ! Et puis j’ai appelé la psychologue, Béatrice Cottret, qui doit être déjà sur place.
— Bien, on verra après. Allons examiner la scène de crime, j’ai prévenu le divisionnaire avant de partir, il attend des précisions.
Enor regarde autour de lui une dernière fois avant de pénétrer dans la ruine en contournant un tas de pierres amoncelées là.
Au creux des arbres il fait sombre mais la nuit n’est pas encore tombée. Un groupe électrogène, qui inonde de lumière l’intérieur du vieux bâtiment, a été installé. Le photographe de la police est toujours présent, occupé à immortaliser chaque détail et le moindre détritus suspect, soigneusement numéroté.
— Guylaine Essart n’est pas arrivée ?
— Non, elle a été prévenue en même temps que vous et elle a répondu qu’elle partait sur-le-champ. Peut-être a-t-elle été retardée.
Enor hoche la tête, peu surpris. La procureure de la République de Brest habite un grand appartement dans un immeuble du centre-ville qui donne directement sur le château. Cela faisait plus près des lieux du crime que Toulbroc’h, où il résidait. Elle avait donné naissance à une adorable petite Mariette le 15 septembre dernier, un bon motif pour s’attarder quelques secondes. Guère plus car elle tenait à se rendre immédiatement sur place dès qu’un homicide était signalé. Elle avait repris ses activités dans les tout derniers jours de novembre. Même si la période des fêtes n’est traditionnellement pas très calme, agressions, cambriolages et vols de produits alimentaires de luxe étant toujours plus nombreux peu avant Noël, aucune grosse affaire d’assassinat ne s’était présentée depuis. En observant le cadavre qu’il a sous les yeux, Enor se demande s’ils ne sont pas face à une affaire inhabituelle.
Il fait un signe de tête à Claude Guitton, le chef des services techniques de la police, qui est penché sur des pierres posées non loin du corps. À la recherche de l’arme du crime ? Mais il préfère s’adresser d’abord à Yves Cardic, le légiste, agenouillé sur le sol et dont il distingue le froncement de sourcils qui trahit sa préoccupation. Absorbé par son travail, il n’a même pas levé la tête à son arrivée, offrant une vue plongeante sur ses cheveux blancs couronnant une calvitie de plus en plus avancée.
— Salut, Yves, tu as l’air bien concentré. Un problème ?
Signe que la réponse est positive, Yves ne se redresse pas.
— Ah, Enor, oui je suis intrigué et je n’aime pas ça.
Alors que Cardic ausculte le visage de la victime, Enor relance :
— Et ?
Le légiste émet un grommellement exaspéré, ce qui ne lui ressemble pas, alors que s’approche la procureure, déjà aux aguets devant le murmure confus qu’elle vient d’entendre. Il se lève alors, jette un œil perplexe autour de lui, note la présence de Guylaine Essart sans plus de réaction, puis reprend :
— Je crois qu’il va falloir attendre que le corps soit sur la table d’autopsie pour connaître les causes de la mort. Je ne peux absolument pas me prononcer pour le moment. Je n’ai vu aucune trace de coups ni de blessure par balle ou par tout autre instrument coupant ou tranchant à travers les vêtements. Il est possible que sa veste et son pull aient atténué ou empêché que des traces subsistent, mais la mort ne vient pas d’une violence physique externe, aucune lésion traumatique n’est visible. Le visage et le crâne sont intacts, quoique…
Il s’interrompt.
— Quoique, même si c’est officieux ? insiste Enor, étonné de l’embarras inhabituel du médecin.
Ce dernier tend le bras vers le cadavre, sans répondre.
— Regarde au niveau des yeux.
Enor se penche, imité par Denis et Guylaine Essart. Il ne repère rien d’anormal, ce qui ne lui paraît pas extraordinaire, n’étant pas membre de la faculté de médecine. L’homme est mort depuis plusieurs jours et les yeux sont déjà abîmés, juge-t-il.
Il secoue la tête. Une certaine rougeur ? La procureure et Denis ne bronchent pas, ils ont l’air perdu de ceux qui ne distinguent pas ce qu’on leur présente pourtant comme une évidence. Enor résume la pensée de tous :
— Non, vraiment je ne vois pas. Ce sont les yeux d’un mort, je ne découvre aucune différence avec d’habitude. Un peu rouges peut-être ?
— Oui, mais ce n’est pas significatif. C’est plutôt leur aspect vitreux qui m’interroge, et regarde les paupières inférieures – il passe un doigt sur l’une d’entre elles –, elles sont plissées comme si elles avaient été d’abord soumises à une forte tension puis relâchées brutalement, je n’ai jamais vu ça à ce point-là.
Le commissaire, qui fait totalement confiance au légiste, demande en hésitant, sachant qu’il empiète sur son travail :
— Est-ce que ça pourrait être dû aux conditions de conservation du cadavre à l’intérieur de cette ruine ?
Yves ne se vexe pas, ils se connaissent depuis trop longtemps pour ça. Mais il hausse les épaules :
— Non, absolument pas. J’ai une vague idée, mais elle demande à être étayée.
Comme il ne développe pas plus, Enor préfère insister :
— Pourrait-il s’agir d’une mort naturelle ?
— On ne peut pas l’exclure encore absolument mais, au vu de ce que je vous ai dit et d’un ou deux autres signes dont je ne parle pas tant que je n’ai pas pu observer plus en détail le corps de la victime à l’institut médico-légal, mon expérience m’incite à repousser cette hypothèse.
Enor pose alors la question habituelle :
— Tu as une idée de la date de la mort ?
— Hum, ce n’est pas très aisé non plus, mais je dirais trois ou quatre jours, l’autolyse a commencé, la disparition de la rigidité cadavérique avant les prémices de la décomposition, précise-t-il devant l’air perplexe de ses interlocuteurs.
Guylaine Essart fait un rapide calcul :
— Cela pourrait être samedi ou dimanche, alors ?
Yves fait une petite grimace :
— Oui, plutôt samedi, le froid des derniers jours a pu retarder légèrement le processus, mais guère plus de quelques heures.
— Si c’est ce week-end, on pourra peut-être dénicher quelques témoins, il doit bien y avoir des promeneurs isolés par ici même si ce n’est pas très fréquenté, observe Denis, et la météo ne fait pas reculer non plus les sportifs.
— Ça, c’est votre problème, répond le légiste qui continue d’un ton soudainement plus enjoué, moi, j’en ai un autre maintenant, mais le défi n’est pas pour me déplaire. Enfin un peu de fantaisie dans ce monde d’assassins ! Vous pouvez faire embarquer le corps, j’en ai fini ici. Autopsie demain matin huit heures, ne la manquez pas !
Il s’éloigne sans plus de cérémonie sous l’œil songeur de Guylaine Essart, qui commente sobrement :
— Il est perturbé, il ne nous a même pas gratifiés de sa pointe habituelle d’humour noir.
Mais Enor n’est pas dupe de l’infime pétillement de l’œil qui se camoufle derrière l’air faussement déçu de la procureure. Claude Guitton, accompagné de Bernard Jagu, le technicien principal, s’approche alors du corps et entreprend d’abord de le fouiller. Les poches sont vides : aucun portefeuille, aucun papier n’est extrait, pas même un paquet de mouchoirs. Encore moins un téléphone ou un jeu de clés.
— S’il s’agit bien d’un meurtre, il est clair que l’assassin a voulu retarder l’identification de notre homme, dit Claude.
— Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, observe le commissaire.
— Ah ? fait Bernard Jagu en fronçant les sourcils pendant que Guitton examine les vêtements de la victime.
— Oui, car avec un peu de chance, cela peut signifier que son identité pourrait nous mener directement à son meurtrier ou à son entourage proche.
— Tu as raison car beaucoup d’efforts ont été faits pour nous la dissimuler, reprend Guitton en se redressant, toutes les étiquettes d’habits ont été découpées. Cela risque de ne pas être facile de mettre un nom rapidement sur cet homme. Je veux vous montrer quelque chose d’intrigant, suivez-moi par là !
Il les emmène à l’endroit où il était penché lorsque le commissaire est arrivé et leur montre du doigt le sol :
— Regardez !
Les enquêteurs baissent les yeux et s’avisent que les pierres disposées là, provenant probablement du tas aperçu à l’extérieur, forment un mot dont les lettres mesurent au moins trente bons centimètres : « GLAS. » Impossible de le rater.
— Qu’est-ce que cela signifie ? ne peut s’empêcher de demander Denis.
— Un message pour nous dire que le glas avait sonné pour notre victime ? suggère Claude en haussant les épaules.
— Une sentence, alors ? risque Guylaine Essart.
— N’allons pas trop vite, tempère Enor, ces pierres n’ont peut-être aucun rapport avec le meurtre.
Guitton approuve :
— C’est vrai qu’on a déjà vu plus bizarre mais la présomption du lien est forte. Nous allons transporter ces pierres pour une recherche d’empreintes quand même, sans grand espoir de trouver quoi que ce soit, je vous préviens.
— Tant pis. Rien d’autre ? demande le commissaire.
— Non, rien. L’endroit n’est guère fréquenté, c’est sûr, mais on n’a même pas récolté les habituels détritus qui sont abandonnés parfois dans ce genre d’endroit discret. Et pour le moment je n’ai pas encore le résultat des recherches de mes collègues à l’extérieur.
Guylaine Essart regarde sa montre et soupire, en s’éloignant avec le reste du groupe pour laisser la place aux brancardiers que Guitton a invités à s’approcher :
— Bon, je suis désolée, mais il faut que j’y aille, vous me tenez au courant, Commissaire. Je vous propose de faire un point demain en fin de matinée, aussitôt l’autopsie terminée, d’accord ?
— Oui, je vous appellerai en sortant de l’institut médico-légal.
À la sortie de la ruine, Enor et Denis retrouvent le reste de l’équipe qui attend sur le chemin. Françoise, Aela, Ronan et Thierry, ce dernier venu en renfort, discutent avec un technicien qui semble leur indiquer qu’ils n’ont rien trouvé de notable aux alentours immédiats.
Toutefois la fouille des bosquets avoisinants, élargie, se poursuit.
Le commissaire interpelle Bernard Jagu qui apparaît et le brigadier qui l’avait aidé à se garer un peu plus tôt :
— Il faut bloquer les accès à la vallée des deux côtés, nord et sud, jusqu’à demain soir au moins et prospecter tous les abords du chemin.
Jagu opine de la tête, convaincu de la nécessité de ce travail routinier, même s’il devait s’avérer improductif, mais devant la grimace du brigadier, Enor précise :
— Je sais, c’est une aiguille dans une botte de foin, cela prendra du temps mais nous n’avons pas le choix, il faut en passer par là. Je vous rappelle que nous n’avons pour le moment aucune idée de la nature de l’arme du crime.
Il devait repenser avec des frissons rétrospectifs à cette consigne quelques jours plus tard, lorsque fut identifiée la cause de la mort.
— Ce sera fait, Commissaire, comptez sur nous.
Puis Enor se tourne vers son groupe et informe les derniers arrivés avant de donner ses ordres, toujours les mêmes en début d’investigation sur les lieux d’un homicide :
— Vous avez vu le lotissement en arrivant ? Commencez l’enquête de proximité par là jusqu’au bar qui fait l’angle à l’entrée de la rue, en insistant sur les allées et venues du week-end. Thierry et Ronan, je voudrais que vous vous chargiez du côté sud, c’est-à-dire essentiellement le complexe aquatique du Spadium parc puisque le tunnel débouche au niveau de son parking.
— Il doit y avoir beaucoup d’habitués qui fréquentent ce complexe, on pourrait mettre une affiche au niveau du guichet pour un appel à témoins ? propose Ronan.
— Oui, bonne idée, faites, mais je parierais que notre victime est venue par le nord comme nous-mêmes, dont nous sommes bien plus près. Je n’imagine pas qu’elle ait pu faire une longue balade champêtre avec son assassin, d’autant que d’autres vestiges sont plus près côté sud, à ce qu’on m’a dit.
— C’est exact, confirme Pouliquen, de vieux bâtiments subsistent un peu plus bas, ils datent de l’époque de la poudrerie, en activité dès la fin du XIXe siècle. Notre tueur ne manquait pas d’endroits propices pour faire disparaître quelqu’un mais il ne pouvait pas prévoir les enfants.
— Non, en effet, opine Denis.
— Et toi, Enor, qu’est-ce que tu vas faire ? interroge Françoise, qui est la seule à le tutoyer.
Il ne se formalise pas de la question, qu’il juge naturelle dans le mode de fonctionnement qui est celui qu’il a imprimé à toute son équipe, un mode collectif où chacun rend compte de toutes ses activités afin que tous aient le même niveau d’information. Mais il exerce la pleine responsabilité du groupe d’enquête et assume toutes les prises de décision, c’est son travail de définir la marche à suivre et de rendre seul des comptes à sa hiérarchie en cas de problème. Aussi est-ce naturellement qu’il répond :
— Je vais aller interroger les deux enfants qui ont trouvé le corps, inutile de les faire attendre plus longtemps. Mais auparavant je vais appeler le divisionnaire, même si le butin est plutôt maigre.
III
Jeudi 23 janvier 2020, 8 heures, Brest, institut médico-légal
Enor se présente à l’heure à l’institut, tout près des urgences de l’hôpital de la Cavale Blanche. La veille au soir, l’entretien, plus que l’interrogatoire, avec les deux enfants encore choqués en présence de la psychologue de la police et des parents, n’avait rien donné, comme il fallait s’y attendre. Mais ils avaient donné une indication importante : ils étaient venus jouer dans la ruine le samedi précédent, en milieu de matinée, alors que les parents d’Arthur étaient allés faire les courses. Ils étaient affirmatifs, le corps n’y était pas. Leur témoignage établissait ainsi en amont une première borne précise du jour du crime, du moins si l’on admettait que la victime était encore vivante en entrant dans la ruine. Autant qu’il puisse en juger, les deux garçons lui avaient paru équilibrés et intelligents et ils n’avaient pas eu la tentation d’embellir leur histoire. Peut-être, bien plus tard, la nature des enfants reprenant ses droits et les effets d’un éventuel traumatisme étant atténués, ils enjoliveraient l’épisode auprès des copains, l’épreuve de la réalité étant bien plus valorisante que leurs aventures virtuelles.
Le commissaire ne connaît pas de policier qui goûte le spectacle d’une autopsie mais, en dehors de l’obligation légale, il espère chaque fois que les indices recueillis se révèlent utiles, et pourquoi pas décisifs, pour la suite de l’enquête. D’autant plus lorsque l’identité de la victime est inconnue. Tout élément, état ou antécédents de santé ou autres renseignements sur un mode de vie particulier qui pourrait aider à son identification sera le bienvenu.
L’odeur de formol l’assaille immédiatement, mais comme le cadavre a déjà plusieurs jours, la salle où va se dérouler l’autopsie dispose d’un puissant extracteur d’air et d’un générateur d’odeur, même si des effluves de décomposition flottent malgré tout dans l’air ambiant.
D’autant qu’Enor ne fait pas comme certains collègues qui s’enduisent exagérément de baume à la menthe pour tenir le coup, ce qui parfois accroît plus les nausées qu’il ne les endigue.
Alors qu’Yves Cardic l’accueille, Enor aperçoit Odile, son assistante identificatrice, qui vérifie les différents outils : marteau, scie, scalpels, pinces et clamps de toutes sortes et de toutes tailles. Il sait que pour les utiliser et faire correctement leur travail, s’ils ne veulent pas être envahis par l’émotion, les légistes doivent mentalement s’extraire de toute pensée de proximité humaine avec la victime. Ou alors il vaut mieux changer de métier, ce qui arrive parfois à de jeunes stagiaires qui s’étaient enthousiasmés trop vite pour la médecine légale.
— Enor, compte tenu de l’absence d’identification du corps, j’ai déjà procédé à quelques opérations indispensables afin de gagner du temps : relevé d’empreintes digitales, prélèvements de cheveux pour analyse génétique et radiographie à la recherche de broche, prothèse, pacemaker ou autres indices de fractures anciennes, complétée par une radiographie dentaire qui pourra nous donner une évaluation de son âge au même titre que la radio des os. La denture n’a fait l’objet d’aucune intervention, elle est saine. Pas de plombages, amalgames ou de dents sur pivot qui auraient pu nous fournir de précieuses indications sur les techniques utilisées. Bref, en ce qui concerne tous les points, les résultats sont négatifs ; notre homme était apparemment en bonne santé et bien nourri. Il mesurait 1,78 mètre et pesait 81 kg et, comme tu peux le voir sur la table, il paraît plutôt vigoureux et sportif.
— Quelqu’un en mesure de se défendre en cas d’agression, commente le commissaire, ce qui pourrait renforcer l’idée d’un effet de surprise de la part d’une personne en qui il avait confiance.
— Ne tire pas de conclusion trop hâtive. Bien, on peut commencer.
Yves contrôle l’état de marche de son micro et, après avoir spécifié le type caucasoïde de la victime et les données anthropométriques, il rappelle tout d’abord les circonstances, la date et le lieu de découverte du cadavre ainsi que son environnement et la météo des jours précédents. Il précise qu’il n’y avait aucun désordre des habits. Puis il procède à l’examen extérieur du corps, à la recherche de lésions, fissures, abrasions, cicatrices anciennes ou plaies en commençant par la tête. Mais, à la déception du commissaire, l’exploration des conjonctives ne donne lieu à aucun commentaire éclairant, de même que pour le reste du visage. Le légiste ne remarque rien de notable, le nez et les lèvres sont indemnes de toute blessure et aucune dent n’est cassée comme il le savait déjà. Puis il continue par le tronc, les organes génitaux et la marge anale, mais là encore il ne relève aucun signe particulier tel qu’une trace d’opération chirurgicale ni aucune intervention violente apparente.
Après l’examen des extrémités, doigts et orteils, et le curage des ongles, Enor commence à s’inquiéter devant l’absence d’éléments. Cela pourrait faire l’objet d’une fiche de description inhabituelle sans rien à signaler du tout, ce qui exclut une grande partie de la population, mais ce n’est guère enthousiasmant. Ensuite le légiste commence l’étude des membres supérieurs et c’est au niveau du pli du coude droit que surgit la première bonne nouvelle.
Enor voit Yves qui se penche plus attentivement et murmure, à peine audible :
— Est-ce que ça pourrait être… ?
— Qu’y a-t-il ?
— Je ne suis pas sûr à 100 %, mais j’ai l’impression qu’on dirait bien une trace de piqûre. Il est très facile de passer à côté, c’est même parfois pratiquement indécelable. Je vais prendre quand même quelques clichés, mais je jurerais que c’est bien la marque d’une injection hypodermique.
Le commissaire, qui s’est approché alors qu’Yves fait un commentaire dans son micro, ne distingue rien de précis mais il fait confiance à l’expérience du légiste, d’autant qu’enfin une amorce de piste se dessine. Lorsque c’est fait, l’examen du bras droit ne donnant rien de plus, Yves Cardic s’attaque minutieusement au gauche. Très vite il ne peut retenir une exclamation :
— Ça alors !
Il semble absorbé par deux petites taches rouges sur la face intérieure du bras, à mi-chemin du coude et de l’épaule. Cette fois-ci l’empreinte est bien visible et Enor a un froncement de sourcils :
— On dirait une double piqûre !
Le commissaire n’en dit pas plus car il ne souhaite pas distraire son ami dans l’exercice de son travail qui nécessite, en plus du respect d’une procédure très stricte, une extrême vigilance. Les spéculations de sa part sont superflues, il n’est pas là pour ça. Mais le légiste ne se formalise pas de cette interruption tant il a l’air fasciné par ce qu’il voit.
— Comme tu le dis, mais il ne s’agit pas de piqûres cette fois-ci. Si l’on observe attentivement la zone, on distingue les deux points, entourés à la fois de rougeurs et de décoloration de la peau, et on sent encore un léger gonflement au toucher. Je ne m’avance pas trop en disant que notre mort suspecte va très vite se transformer en homicide volontaire.
— Tu as déjà une hypothèse ?
— Oui, qui demandera à être confirmée par les analyses toxicologiques et histologiques du sang et des viscères, ainsi que des muscles et du cœur en plus des cheveux. L’ouverture du corps va nous en révéler plus mais il faudra que tu patientes un peu avant les premiers résultats de laboratoire.
— Tu peux m’éclairer sur les causes de la mort puisque tu les entrevois déjà ?
Yves détourne les yeux du bras de la victime et marque son hésitation par un pli de la bouche, avant de lâcher :
— Sous toute réserve, car nous sommes loin d’en avoir fini, mais je vais sûrement trouver des indices supplémentaires après l’incision. Et puis je veux d’abord rechercher s’il n’y a pas de zones ecchymotiques sous-cutanées ou intramusculaires, ce qui arrive parfois sans que ce soit visible à l’examen externe mais cela prouve l’agression.
Le reste de la réponse sidère Enor.
IV
Jeudi 23 janvier 2020, 11 heures, Brest, SRPJ
Enor n’en revient toujours pas alors qu’il se dirige vers la grande salle de réunion du SRPJ, il se dit que si Yves a raison cette enquête ne va vraiment pas être ordinaire. Sous le coup de la nouvelle, il avait suivi distraitement le reste de l’autopsie, ce qui était un comble étant donné la nature de l’activité. L’état des muscles et du cœur s’avérait compatible avec l’hypothèse de Cardic, sans la privilégier non plus en raison du temps écoulé depuis la mort de la victime. Le reste des organes avait été soigneusement pesé, évalué, sans que rien de nouveau apparaisse, sinon la confirmation de la bonne santé de l’homme. Mais il se rappellerait longtemps les dernières phrases du légiste :
— Cet homme a été mordu par un serpent et il est mort empoisonné par le venin. C’est pourquoi il va falloir attendre, car la détermination du type de venin, neurotoxique, hémotoxique ou cardiotoxique afin d’identifier l’espèce du reptile n’est possible que dans quelques laboratoires spécialisés qui disposent des capacités d’effectuer des chromatographies gazeuses couplées avec une spectrométrie de masse. Ce sera par contre plus rapide d’avoir une réponse pour le produit injecté au bras droit. Mais cela ne m’étonnerait pas qu’il s’agisse d’un produit anesthésiant et s’il s’agit bien d’une intramusculaire ce pourrait être de la kétamine.
— Tu veux dire qu’on l’aurait endormi afin d’assurer la morsure du serpent ?
— C’est plus simple, non ? Il ne se sera pas débattu. Il suffisait d’avoir une bonne idée du poids de la victime afin de bien calculer la dose nécessaire d’anesthésique qui endort de toute façon pour une durée relativement courte, quinze à vingt-cinq minutes environ habituellement, cette technique est principalement utilisée pour de courtes interventions. Mais l’avantage pour l’assassin est qu’il n’a pas à faire une intraveineuse, qui est plus délicate à réaliser. Là, pas besoin d’être un professionnel de la seringue.
— En tout cas, en raisonnant par l’absurde, la présence de cette injection élimine toute possibilité de suicide, si du moins on imagine que quelqu’un veuille se tuer de cette façon.
— Non, nous ne sommes plus au temps de Cléopâtre, avait répondu Yves avec un grand sourire.
C’est alors qu’il avait repensé d’abord aux enfants qui avaient découvert le corps puis aux policiers chargés de faire des recherches le long du chemin. Et s’ils étaient tombés sur un serpent venimeux inconnu en France ? Agressif ? D’ailleurs, si l’hypothèse était la bonne, était-il possible qu’après l’assassinat le tueur ait tout bonnement relâché l’animal dans la nature ? Quand il repense au paysage de la vallée, Enor se dit qu’il serait pratiquement impossible de débusquer un serpent exotique dont ils ignorent encore tout dans les hectares de fouillis végétal des lieux. Il est évident qu’il va falloir condamner l’accès au Costour et se renseigner auprès de spécialistes, qui ne doivent pas courir les rues dans le Finistère. Mais peut-être le serpent n’a-t-il pas supporté le climat de Brest en janvier et est-il déjà mort quelque part dans les fourrés ?
Il était aussitôt allé voir le divisionnaire pour lui parler de ce problème et lui exposer le résultat de l’autopsie. Peyret, perplexe mais confiant dans le jugement de Cardic, avait aussitôt pris les dispositions pour bloquer l’accès à la vallée et organiser une battue avec l’aide des pompiers. Il n’avait pu trouver un herpétologue expert en serpents exotiques auprès des diverses associations de protection dans le Finistère mais parmi les pompiers se trouvaient des spécialistes des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Il arrivait parfois que des interventions se fassent pour capturer ou récupérer toutes sortes de bestioles insolites, des plus grosses aux plus petites, dont certaines nécessitaient une approche prudente par un professionnel. C’est ce dernier, venu spécialement de Quimper, qui allait diriger la battue programmée à partir de 13 heures et expliquer les conduites de sécurité à respecter, en l’absence de précisions sur l’identité de l’animal recherché.
Quelques instants plus tard Enor entre dans la salle Luc-Magdelain, tout juste précédé par Guylaine Essart. Toute l’équipe, sauf Peyret qui met toujours un point d’honneur qu’Enor juge puéril à arriver le dernier comme pour imprimer le poids de la hiérarchie, est déjà installée et engagée, à ce qu’il comprend, dans une discussion sur la grève du jour contre la réforme des retraites. Il se rappelle que la veille des centaines de personnes avaient organisé dans les rues de la ville une marche aux flambeaux, occasion de se réchauffer et d’entretenir les braises de la colère.
Il s’installe et, en attendant le divisionnaire, il observe ses collègues. Les deux Normands, le commandant Françoise Ridel, originaire de Dieppe, et le jeune lieutenant Ronan Canu, natif d’Isigny-sur-Mer où résident encore ses parents qu’il ne manque pas d’aller voir à chaque occasion, sont côte à côte. Tout près, le capitaine Denis Bauzin griffonne sur son calepin des esquisses de planche à voile, sa passion, tout en écoutant distraitement la conversation. Enor sourit intérieurement en pensant à la plaisanterie régulière de Denis, qui aime parfois s’adresser à Ronan en l’appelant l’Isignais, comme on appelle les habitants de la ville, en insistant sur la dernière syllabe en forme de boutade affectueuse. Mais Ronan est loin d’être niais, parfois un peu naïf ou trop enthousiaste mais pour Enor ce n’est pas un défaut. La capitaine Aela Le Dévéhat, Morbihannaise, de Séné, près de Vannes, se tient à sa droite, songeuse, jouant d’un doigt avec une de ses mèches de cheveux blonds, comme à son habitude. Enfin, à sa gauche siège le brigadier-chef Thierry Pouliquen, Brestois de Brest même, l’expression désignant le centre historique de la ville, comme il aime à le répéter en commençant parfois ses phrases dans son parler « ty zef » par « Brestois que je suis… » Il arrive qu’Enor le taquine en lui demandant si cela ne le gêne pas de venir parfois le midi prendre un sandwich au bar des Yannicks, cette dénomination étant le nom traditionnel des habitants du quartier de Recouvrance, sur la rive droite de la Penfeld, autant dire une autre planète.
Lorsque le divisionnaire, originaire de Lyon et rêvant d’y retourner un jour avant la retraite, entre et s’assied près de la procureure, elle-même native de Gap, dans les Hautes-Alpes, mais qui s’est attachée au Finistère et n’envisage pas d’en partir, ils sont donc huit autour de la table.
En accord avec Peyret, il a jugé très prématuré d’inviter le porte-parole chargé des communications avec la presse, le capitaine Gilbert Ganne, dont les racines sont de Lannion, surnommé double-G pour sa capacité à résister à toutes les pressions et à manier la langue de bois. Il sera toujours temps de l’intégrer si la progression de l’enquête et le harcèlement des médias le justifient, mais pour l’heure on est loin de l’une et de l’autre.
Afin de mettre le divisionnaire et Guylaine Essart au même niveau de connaissance que les autres, Enor entame alors la réunion par la description des lieux du crime tout en retraçant préalablement le passé de poudrerie puis de carrière de pierres de la vallée. En un peu plus d’un siècle, on est passé de la fabrication de coton-poudre c’est-à-dire de nitrate de cellulose, de nitroglycérine et de dynamite à l’exploitation de pierres pour la reconstruction de la ville jusqu’à l’exubérance de l’espace naturel d’aujourd’hui, corridor vert pour de nombreux animaux sauvages.
Sitôt les circonstances de la découverte du corps par les enfants exposées, le commissaire relate ensuite le maigre résultat de leur interrogatoire la veille au soir.
Mais Ronan, dont c’est le travail, se lève pour inscrire au tableau, en regard du nom des deux garçons, la date et l’heure de leur avant-dernière incursion dans la ruine, le samedi matin, une information somme toute précieuse.
— Cela nous donne un terminus post quem, observe la procureure.
— Oui, si le meurtre a bien eu lieu dans la ruine, précise Enor, mais nous n’en avons aucune certitude encore.
— C’est quand même le plus probable, rétorque Peyret, ne serait-ce que parce que l’endroit est suffisamment à l’écart du chemin.
— Il faut alors supposer que la victime a suivi son assassin sans se méfier, de son plein gré, déclare Aela.
Cette dernière réflexion recueille l’assentiment de tous car l’absence de traces de coups visibles sur la tête suggère que l’homme était conscient en pénétrant dans la ruine, même si Enor préfère ne pas fermer complètement la porte à la possibilité de plus d’un agresseur.
Il relance :
— Avant de parler des conclusions officieuses de l’autopsie, faisons d’abord le point sur vos démarches d’hier.
C’est Françoise qui résume :
— Nous sommes passés dans chaque maison du lotissement côté nord en nous focalisant sur la période samedi matin-lundi midi avec surtout le dimanche en point de mire, mais nous n’avons reçu aucun témoignage direct intéressant.
— Direct ? Qu’est-ce que vous voulez dire ? interroge Guylaine Essart, habituée aux subtilités équivoques de certaines phrases au tribunal.
— J’allais y venir, cela concerne le samedi. Les gens qui habitent la dernière maison sur la gauche nous ont déclaré que leur fils avait entendu une voiture se garer sur le parking vers dix-huit heures. Un des amis avec qui il allait passer la soirée était venu le chercher en voiture, c’est en le rejoignant qu’il a perçu, avant qu’il ne s’arrête, un bruit de moteur sur le parking suivi de l’écho de deux portières qu’on referme. C’est pour cela qu’il a pensé que ces gens arrivaient.
— Il ne les a pas vus ? demande Denis.
— Non, il est monté dans la voiture de son copain qui a démarré tout de suite. De toute façon elle était tournée dans l’autre sens, il aurait fallu qu’il se retourne pour apercevoir quelqu’un débouchant de là.
— Donc il n’a pas distingué le véhicule non plus ? énonce Enor, aussi bien comme commentaire que comme question car il n’a aucun espoir.
— Non, mais cela n’aurait pas été possible même s’il s’était retourné car, si tu te souviens de la physionomie des lieux, seule une petite partie du parking est visible depuis la route. S’il s’agit bien de notre assassin…
— Ah oui, au fait, je propose Arès comme nom de code pour notre meurtrier, l’interrompt Enor.
— S’il s’agit donc bien d’Arès, reprend Françoise, j’imagine qu’il se sera garé dans la partie invisible du parking.
— Oui, il faut interroger ces deux ados prioritairement. Vous vous en occupez, Ronan et Denis ?
— Oui, Patron, répondent-ils en chœur.
Mais Françoise fait une petite grimace :
— Pour le conducteur de la voiture, qui s’appelle Julien Le Garrec, pas de problème, il habite Brest, mais le fils, Hervé Le Bihan, suit des études à Quimper, à l’ISUGA, l’école de commerce international avec l’Asie, qui dépend de la CCI. Il a loué un petit appartement en colocation dans la ville et ne rentre que le week-end, et encore pas toujours, c’est pourquoi il n’était pas là hier.
Le divisionnaire intervient :
— Mais vous savez comment les parents sont au courant pour la voiture ?
— Il leur en a parlé le lendemain midi. Ça l’avait étonné parce que la nuit allait tomber à cette heure-là, le soleil se couchait. Alors, que des gens aillent encore se promener à ce moment, et par le froid qu’il faisait, l’a surpris. Mais ce fut une pensée fugitive, juste en montant dans la voiture. Il n’y a repensé que lorsque son père a fait une observation au déjeuner sur la fraîcheur de la nuit et les risques de gel, il a évoqué cette voiture en disant qu’il existe tout de même de drôles de gens.