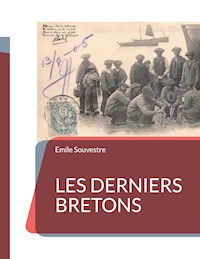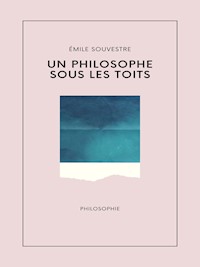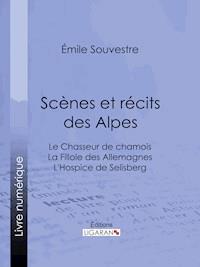Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au nord de l'Ecosse, et non loin des montagnes où la Dee prend sa source, se trouve un village nommé Soumak, qu'entourent de vastes terrains, aujourd'hui incultes pour la plupart. Là vivait, il y a quelques années, un pauvre bossu appelé William Ross, et plus connu sous le nom de William le Laid."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335017243
©Ligaran 2015
Vous avez souvent souhaité de voir réunis en volumes ces courts enseignements, dispersés ailleurs et destinés aux hommes de bonne volonté : écrits pour eux seuls, c’est à eux que je les offre de nouveau sous vos auspices. Puissent-ils y trouver ce que votre bienveillance a cru y voir, ce qu’y cherchait la stoïque et douce amie dont la place reste toujours vide près de nous. En relisant ces récits, vous vous rappellerez, comme moi en les rassemblant, qu’elle aimait l’intention qui les avait inspirés, qu’elle en avait traduit plusieurs dans le doux langage de son Italie et qu’elle attendait avec impatience une publication que ce volume ne commence pas, mais continue.
Le succès qu’elle lui avait prédit est venu ; quand elle n’était plus là pour en jouir, et comme pour nous faire sentir qu’elle ne manquait pas moins à nos joies qu’à nos afflictions !
Cependant, Dieu le sait ! dans ma pensée je l’ai toujours associée à cette réussite ! En Bretagne, j’ai vu, lorsque j’étais enfant, qu’à chaque festin de réjouissance on réservait la part des absents ; j’ai respecté le vieil usage de ma province, et, à chaque éloge, à chaque encouragement, pour la publication que je poursuis, j’ai fait, à l’amie qui n’était plus, sa juste part dans ce festin du cœur.
Accueillez donc ce volume autant comme un souvenir d’elle que comme un souvenir de moi. Emportez-le, cet été, dans votre vallée helvétique et, quand vous irez vous asseoir dans la prairie sous les touffes de saules, parcourez quelques-uns de ces récits jusqu’à ce que les souvenirs éveillés vous interrompent ; alors vous marquerez la page avec une fleur de vos champs, vous refermerez le livre, et, au retour, si pendant une heure de solitude vous songez à le reprendre dans votre petite bibliothèque, la page et la fleur séchée vous rappelleront deux souvenirs pleins d’une triste douceur : celui de la patrie absente et de l’être aimé que nous avons perdu !
ÉMILE SOUVESTRE.
Au nord de l’Écosse, et non loin des montagnes où la Dee prend sa source, se trouve un village nommé Soumak, qu’entourent de vastes terrains, aujourd’hui incultes pour la plupart.
Là vivait, il y a quelques années, un pauvre bossu appelé William Ross, et plus connu sous le nom de William le Laid. Il était maître d’école de Soumak ; mais une douzaine d’enfants à peine suivaient ses leçons ; car les habitants du village méprisaient d’autant plus l’instruction, que William était le seul d’entre eux qui eût étudié. Or, comme la science n’avait pu lui procurer une position élevée, tous en avaient conclu qu’elle était inutile ; et l’on disait à Soumak, en forme de proverbe :
– Cela ne te servira pas plus que les livres de William le Laid.
Cependant ces moqueries n’avaient pu changer les goûts du maître d’école. Sans orgueil et sans ambition, il continuait à étudier, dans le seul but d’élever son intelligence et d’agrandir de plus en plus son âme. Il réussissait d’ailleurs, souvent à faire adopter d’utiles mesures, en poussant d’autres que lui à les conseiller ; et tout ce qui s’était accompli de bien à Soumak depuis, dix ans, était dû à son influence cachée.
Content d’aider ainsi au progrès, il supportait sans se plaindre le mépris qui lui était témoigné. C’était un de ces cœurs pleins de chaleur et de clémence qui, comme le soleil, éclairent tout autour d’eux sans s’inquiéter des injures, et qui trouvent, dans l’accomplissement même du devoir, l’encouragement et la récompense.
Il descendait un jour la colline, en lisant un nouveau Traité d’agriculture reçu de Bervic, lorsqu’il entendit derrière lui un bruit de pas et de voix : c’étaient James Atolf et Edouard Roslee qui regagnaient le village avec Ketty Leans.
Le bossu rougit et se rangea, car il savait que tous trois aimaient à le railler sans pitié ; mais la route était trop étroite pour qu’il pût les éviter. James fut le premier qui l’aperçut.
– Eh ! c’est William le Laid, dit-il avec ce rire insolent que donne la force lorsqu’elle n’est point modérée par la bonté ; il a encore le nez dans son grimoire.
– Je m’étonne toujours qu’un garçon si savant porte un habit si râpé, fit observer Edouard, qui, comme la plupart de ses pareils ne voyait d’autre but à la vie que la richesse.
– Oh ! William est un homme pieux et sans coquetterie, continua la jolie Ketty en penchant la tête d’un air moqueur.
– Je ne donnerais point mon petit doigt pour toute sa science, reprit James ; que ses livres lui apprennent, s’ils le peuvent, à conduire, comme moi une charrue, pendant douze heures.
– Ou à se faire un revenu de trente livres sterling, continua Roslee.
– Ou à se moquer d’une vingtaine d’amoureux, ajouta Ketty.
Le maître d’école sourit.
– Les livres ne me donneront point la force de conduire douze heures votre lourde charrue, James, dit-il doucement au jeune laboureur, seulement ils m’apprendraient à en construire une moins pesante et plus utile ; je vous en donnerai le modèle quand vous le voudrez. Je n’ai point trente livres sterling de revenu, monsieur Roslee ; mais si je les avais, au lieu de les renfermer, je leur ferais rapporter un double intérêt, par des moyens honnêtes et faciles que je puis vous enseigner. Quant à vous, miss Leans, je lisais l’autre jour quelque chose de fort instructif pour les jeunes filles qui se moquent de vingt amoureux.
– Et qu’était-ce donc, s’il vous plaît, William ?
– L’histoire d’un héron qui, après avoir dédaigné d’excellents poissons, se trouve trop heureux de souper avec une grenouille.
Les deux paysans se mirent à rire, et la jeune fille rougit.
– Les livres ne peuvent donner, il est vrai, ni la force, ni la richesse, ni la beauté, continua le bossu ; mais ils peuvent apprendre à se servir de ces dons du ciel. Ignorant, je n’aurais été ni moins faible, ni moins pauvre, ni moins laid, et je serais demeuré inutile. Profitez donc des avantages que Dieu vous a faits en y ajoutant ceux de l’instruction.
James haussa les épaules.
– Je comprends, dit-il ; tu ressembles à ce marchand de vulnéraire venu l’an dernier, et qui vendait, disait-il, un remède à tous les maux. Tu voudrais nous faire acheter ta science, qui se trouverait, en définitive, n’être que de l’eau claire comme celle du charlatan ; mais je tiens que l’étude est chose bonne pour les bossus, qui ne peuvent faire autre chose. Quant à moi, j’en sais assez pour porter une barrique de bière sur mes épaules et abattre un taureau d’une seule main.
– Et moi, je crois pouvoir continuer de toucher mes rentes sans apprendre le latin, reprit Edouard ; je ne vois donc que miss Leans…
– Mille grâces, interrompit celle-ci, on me trouve assez savante telle que je suis ; et, à moins que M. William n’ait à me donner une nouvelle recette pour blanchir les dents ou empeser les fichus, je puis me passer encore de ses leçons.
– Adieu donc, William le Laid, reprit Atolf.
– Adieu, mon pauvre bossu, ajouta Roslee.
– Adieu, magister, dit la jeune coquette.
William salua de la tête, les laissa passer devant lui, et continua à descendre lentement la colline.
Les railleries qu’il venait de subir étaient si ordinaires, qu’il n’y pensa plus dès qu’il cessa de les entendre. Accoutumé à servir de jouet depuis son enfance, il s’était fait une cuirasse de la résignation et de l’étude. Chaque fois qu’un coup venait le frapper, il rentrait sa tête comme la tortue, et attendait que l’ennemi fût parti. Cette force d’inertie l’avait préservé de l’irritation et du désespoir. Ce qu’il avait en lui le consolait, d’ailleurs, de ce qui était au-dehors. Lorsque le froissement des hommes le blessait, il se réfugiait dans ce monde des sentiments et des idées où tout est animé sans emportement, affectueux sans mollesse. Il appelait les intelligences d’élite de toutes les époques et de toutes les nations pour faire cercle autour de son âme ; il les écoutait, il leur répondait, il vivait dans leur intimité. C’étaient là ses consolations et la source où il puisait son courage pour supporter les épreuves de la vie réelle.
Or ces épreuves étaient rudes et fréquentes ; car la grossièreté des habitants de Soumak était passée en proverbe dans tout le pays. Retirés au pied des montagnes, sans communications avec les villes voisines, sans industrie et sans volonté d’en créer, ils étaient demeurés étrangers aux progrès qui s’étaient accomplis depuis deux siècles. Non que la nature eût été pour eux avare de richesses ; leur campagne était fertile, leurs troupeaux nombreux : mais les chemins mêmes manquaient pour faire arriver les produits du canton jusqu’à Eosar et Bervic. Les hauts fonctionnaires chargés par le roi d’Angleterre de l’administration du pays désiraient depuis longtemps faire cesser un tel état de choses ; ils décidèrent enfin que des routes seraient ouvertes.
À peine cette nouvelle fut-elle portée à Soumak que tout le village fut en émoi. Chacun raisonnait sur la nouvelle ordonnance, et la plupart y trouvaient à redire : l’un avait son champ traversé par la route projetée ; l’autre était forcé d’abattre quelques arbres ; un troisième, de déplacer son entrée. Mais ce fut bien autre chose quand Edouard Roslee apprit que chacun devrait contribuer au chemin par son travail ou son argent ! Dès lors il n’y eut plus qu’une opinion ; tout le monde le trouva inutile, nuisible même. On s’assembla en tumulte sur la place boueuse de l’église : Roslee déclara qu’il refuserait ses chevaux pour les charrois ; Atolf, qu’il briserait les os au premier collecteur qui oserait lui demander un schelling ; Ketty elle-même déclara qu’elle ne danserait avec aucun de ceux qui consentiraient à y travailler.
L’aubergiste, de son côté, qui avait le monopole des denrées qu’il allait seul vendre à Bervic, soutenait que si le nouveau chemin se faisait le pays serait ruiné ; le tisserand ne trouverait plus à vendre ses toiles, parce que la ville en fournirait de plus belles ; le mercier aurait la concurrence des colporteurs, l’épicier celle des marchands forains. Avec la nouvelle route il n’y aurait plus de salut pour personne, et autant valait mettre le feu à Soumak.
Pendant ce discours de maître Daniel, ses garçons distribuaient de la bière forte pour aider à la puissance de ses arguments. Aussi l’opposition devint-elle bientôt de la fureur : tous s’écrièrent qu’il fallait s’opposer au projet.
L’exécution ne devait en être définitivement décidée que dans quelques jours : une pétition, adressée au nom de tous les habitants de Soumak, pouvait donc éclairer les hauts lords, et prévenir le malheur que l’on redoutait ; mais William seul était capable de l’écrire. On courut à son école, et Roslee lui expliqua ce que l’on désirait de lui. Le bossu parut stupéfait.
– Quoi ! vous ne voulez point d’une route qui doit enrichir le canton ? s’écria-t-il.
– Nous n’en voulons pas ! répondirent cent voix.
– Mais vous n’y avez point pensé, reprit vivement le maître d’école. Rapprocher les produits du lieu où on les consomme, c’est toujours augmenter leur valeur, et le chemin proposé fait de Soumak un faubourg de Bervic : vous pourrez apporter dans cette ville tout ce que vous donneront vos champs, vos troupeaux, et vendre chaque denrée le double de ce que vous la vendez aujourd’hui.
– C’est faux ! s’écria l’aubergiste courroucé.
– Vous-même, maître Daniel, continua le bossu, vous regagnerez, et au-delà, comme hôtelier, ce que vous aurez perdu comme trafiquant. S’il y a une route, il y aura des voyageurs, et s’il y a des voyageurs vous les logerez. Croyez-moi, loin de réclamer contre le projet, pressez-en l’exécution ; l’impôt que l’on vous demande dans ce but n’est qu’une avance dont vous ne tarderez pas à recouvrer les intérêts.
– Non, s’écria Roslee, je ne veux point de route. Avec une route, il nous arrivera ici des richards, et nous ne serons plus maîtres du pays.
– Sans compter que les garçons de Bervic viendront épouser nos jeunes filles, ajouta Atolf.
– Qu’il arrivera de belles dames qui nous feront paraître laides, murmura Ketty.
– Et que l’on ira acheter de mauvaises marchandises à la ville, s’écria John l’épicier.
– Pas de route ! pas de roule ! répétèrent-ils tous en chœur.
– Nous n’avons point, d’ailleurs, besoin des discours de William le Laid, reprit James ; qu’il nous écrive la pétition, c’est tout ce que nous lui demandons.
– En vérité, je ne le puis, répondit le bossu ; car ce serait m’associer à un acte que je ne dois approuver ni comme être raisonnable, ni comme Anglais, ni comme habitant de Soumak. Cherchez quelqu’un à qui un tel office ne répugne point.
– Tu es le seul qui sois capable de le remplir, fit observer Daniel.
– Je ne le puis ni ne le veux.
– Quoi ! il refuse ? interrompirent quelques voix.
– Il faut le forcer ! répondirent plusieurs autres.
– Qu’il écrive ! qu’il écrive ! s’écrièrent-ils tous à la fois.
Mais la fermeté de William dans ce qu’il croyait bien était inébranlable. Il déclara qu’il n’écrirait point la pétition demandée, et les menaces, les coups même ne purent rien obtenir de lui. Il supporta les mauvais traitements avec cette impassibilité silencieuse que donne l’impuissance, et il fallut y renoncer.
On parla bien de se rendre à la ville pour faire rédiger la pétition par un homme de loi ; Roslee fut même chargé de cette commission : mais il était tard, et l’on dut remettre la chose au lendemain. Le lendemain, le mauvais temps empêcha le fermier de partir ; le jour suivant, ce fut une affaire. Le premier empressement était d’ailleurs passé ; la résistance s’était dépensée en paroles : on causait plus tranquillement du chemin projeté : bref, la pétition ne se fit point, les hauts lords se réunirent, et l’exécution de la route fut décidée.
Les habitants de Soumak virent avec mécontentement les premiers travaux, et il fallut avoir recours aux gens de justice pour obtenir d’eux les corvées auxquelles ils étaient tenus. Mais les explications et les assurances de William finirent par les rendre moins hostiles au chemin nouveau ; ils commencèrent à croire que ses inconvénients pourraient bien être compensés par quelques avantages, et attendirent son achèvement avec une sorte de curiosité.
À peine fut-il ouvert que toutes les prévisions du bossu commencèrent à s’accomplir. Les denrées transportées aux marchés voisins doublèrent de valeur, tandis que le prix des objets fabriqués à la ville baissait d’autant. Ketty put avoir de plus belles étoffes sans dépenser davantage ; James augmenta sa ferme ; Roslee ses troupeaux, et Daniel se vit forcé de bâtir un nouveau corps de logis à son auberge.
Or il y avait près du village une grande bruyère, appartenant à la paroisse, qui pouvait avoir au moins mille acres d’étendue, mais qui, vu son aridité, servait seulement à nourrir quelques moutons ; on l’appelait le Commun. William avait souvent pensé au profit que l’on tirerait de cette friche si l’on pouvait la transformer en prairie ou en terre labourable. Il étudia donc avec soin la nature du sol, sa position, et crut avoir trouvé le moyen de le fertiliser.
Un soir qu’il se trouvait chez Daniel, il en parla à quelques fermiers qui se plaignaient de n’avoir point assez de pâturages pour leurs troupeaux ; mais aux premiers mots tous, se récrièrent.
– Par saint Dunstan ! dit un gros éleveur de bœufs, qui passait pour une forte tête dans le pays depuis qu’il avait fait fortune, il faut que le magister ait l’esprit fait comme son échine ! Tu ne sais donc pas, maître bossu, qu’il faut de l’eau pour les prairies ?
– Pardonnez-moi, monsieur Dunal, dit William avec douceur.
– Et tu n’as jamais remarqué que le Commun était plus sec que la langue d’un chat ?
– Je l’ai remarqué.
– Par quel moyen, alors, comptes-tu en faire un herbage ?
– En y trouvant de l’eau.
– Et où la prendras-tu ?
– Je ferai creuser un puits au nord du Commun.
– Un puits ! s’écria Dunal en éclatant de rire ; tu veux tenir une prairie fraîche avec un puits ?
– Pourquoi non ? interrompit James ; il arrosera chaque pied de trèfle à la main, comme une laitue.
Le bossu était trop accoutumé aux sarcasmes pour s’en offenser ; il sourit lui-même de cette plaisanterie.
– Le puits dont je parle ne ressemble point à ceux que vous connaissez, dit-il, mais aux puits de l’Artois, dont l’eau jaillit hors terre et peut ensuite se distribuer en rigoles comme celle d’un ruisseau.
– Un puits qui jaillit ! s’écrièrent tous les assistants.
– Sur mon âme, il est fou, dit Edouard Roslee.
– Il aura lu cela dans quelque livre, ajouta James.
– Allons, magister, ne nous nous faites pas de contes de fées, reprit Dunal ; je ne suis pas un imbécile, Dieu merci, et j’ai parcouru plus de pays qu’aucun de vous : je connais Inverness, Perth, Stirling, et j’ai vu des vaisseaux de guerre à Aberdeen. Mais pour ce qui est des puits jaillissant, je croirais encore plus facilement ce que vous nous disiez il y a quelque temps de ces grosses boules pleines de fumée avec lesquelles on pouvait s’élever jusqu’aux nuages, et de ces grands bras de fer qui écrivent dans l’air, de manière à porter en cinq minutes une nouvelle d’ici à Londres.
– Et vous auriez raison de croire à toutes ces choses, monsieur Dunal, car toutes existent, reprit William ; mais quant au puits jaillissant, je suis sûr que l’on réussirait à le faire dans le Commun, car j’ai bien examiné le terrain ; et ce serait pour la paroisse un énorme accroissement de revenus. Du reste, vous pouvez consulter l’ingénieur de Bervic : il a vu en France de ces puits, et en a fait creuser lui-même.
Les fermiers haussèrent les épaules.
– Perce ton puits, William le Laid, dit James avec mépris, et je te promets d’y conduire boire mes ânes à raison d’un schelling par tête.
– Et moi reprit Daniel, je te fournirai autant de bière forte qu’il jaillira d’eau de ta fontaine.
Le maître d’école n’insista point. Il savait par expérience que la discussion avec les ignorants n’a d’autre résultat que d’intéresser leur orgueil à leurs préjugés, et il résolut d’attendre une occasion pour revenir sur le même sujet.
Mais, parmi ses auditeurs se trouvait un étranger, arrivé de la veille chez maître Daniel. Il parut frappé des observations du bossu, le prit à part, et lui adressa des questions sur la grande bruyère. William proposa de l’y conduire, et lui expliqua sur les lieux mêmes, les raisons qu’il avait de croire à la réussite d’un puits jaillissant. Elles étaient si claires que l’étranger en parut frappé ; il remercia William et partit. Quelques jours après le maître d’école apprit que la paroisse venait de vendre le Commun à l’étranger, qui n’était autre que milord Rolling, connu pour sa grande fortune et ses grandes exploitations.
Un ingénieur et des ouvriers arrivèrent bientôt de Bervic pour percer le puits dont William avait eu l’idée. Ce fut une grande rumeur dans le pays : la plupart continuaient à se moquer de l’entreprise, et James venait chaque jour s’informer s’il pourrait bientôt amener ses ânes. Mais, que l’on juge de son étonnement lorsqu’en arrivant, un soir, il aperçut, à la place où les ouvriers travaillaient encore la veille, une belle colonne d’eau jaillissante à laquelle on s’empressait de creuser des canaux. Les habitants de Soumak, accourus pour voir la merveille, accueillirent Atolf par des huées, en lui criant que l’abreuvoir était prêt, et d’aller chercher ses ânes ; ce qui fit appeler ensuite le nouveau puits la source aux Anes, nom qui lui est demeuré jusqu’à présent.
Lord Rolling, averti de la réussite, arriva le lendemain avec d’autres ouvriers. La bruyère fut défrichée, des bâtiments s’élevèrent, et la nouvelle ferme fut bientôt couverte de troupeaux et de moissons.
Or, comme nous l’avons déjà dit, le nouveau propriétaire du Commun était riche et habile. Il introduisit dans son exploitation tous les perfectionnements que l’expérience avait sanctionnés, et obtint, par suite, des produits plus parfaits et plus abondants. Les habitants de Soumak s’en aperçurent bientôt à la dépréciation de leurs denrées : ils commencèrent à murmurer contre leur heureux voisin. William leur assura que le seul moyen de soutenir sa concurrence était d’adopter les améliorations qu’il avait adoptées lui-même. Mais c’était toujours le même esprit de routine et d’aveuglement ; ils repoussèrent par des injures les conseils du maître d’école en continuant leurs plaintes stériles contre lord Rolling.
Sur ces entrefaites, celui-ci, qui avait plus d’eau qu’il ne lui en fallait, proposa aux habitants de Soumak de leur en vendre une partie ; mais tous rejetèrent bien loin cette proposition.
– Voilà les riches ? s’écria Roslee, qui se trouvait pauvre depuis qu’il n’était plus le premier fermier de sa paroisse ; ce n’est point assez pour milord de vendre ses bœufs, son blé, son fromage, il veut en faire autant de son eau…
– Comme si elle n’était point à nous plus qu’à lui, ajouta James, puisqu’il l’a trouvée dans un terrain qui nous appartenait.
– Et que l’on n’eût jamais dû vendre, ajouta Daniel.
– Vous avez raison, reprit William, mais on l’a vendu, et maintenant nous devons chercher seulement s’il est avantageux de racheter cette eau.
– Le village s’en est passé jusqu’à ce jour.
– Mais non sans en souffrir, objecta William ; la fontaine où nous allons puiser est éloignée, la route qui y conduit fatigante…
– Pour les bossus, peut-être, interrompit James en riant ; quant à moi, je la monterais en courant, mes deux sceaux chargés.
– Moi, j’y envoie mes garçons, continua James.
– Et moi, je trouve toujours quelqu’un pour porter ma cruche, ajouta la jolie miss Ketty.
– Cependant, hasarda Daniel, une fontaine dans le village serait bien commode…
– Pour les marchands de vin, acheva Dunal.
– Non, reprit William, mais pour les faibles, pour les pauvres, et pour les femmes qui ne trouvent point des gens disposés à porter leur cruche ! Songez, d’ailleurs, qu’en cas d’incendie nous n’aurions nul moyen d’éteindre le feu.
– Sûrement lord Rolling a payé une commission à William le Laid pour appuyer la vente de son eau, dit Roslee.
Le bossu rougit légèrement.
– Vous faites-là une méchante supposition, monsieur Édouard, dit-il.
– Moins méchante que la proposition de ton mylord, s’écria le fermier. N’est-ce pas assez pour lui de nous avoir ruinés en nous fermant tous les marchés. Qu’il aille au diable avec son eau jaillissante ! il n’aura de moi que des malédictions, et pas un schelling.
– Non, s’écrièrent tous les fermiers, pas un schelling.
William baissa tristement la tête.
– Vous écoutez votre passion plutôt que votre avantage, et vous avez tort, dit-il ; peut-être vous repentirez-vous avant qu’il soit peu.
Sa prédiction ne tarda point à s’accomplir.
Une nuit que tout le village dormait paisiblement, le maître d’école se réveilla en sursaut ; une immense clarté illuminait les rideaux de son alcôve. Il s’élança à la fenêtre… la maison placée vis-à-vis de l’école était en feu.
William jeta un cri d’alarme ; mais plusieurs autres habitants venaient également de s’éveiller.
Le bossu s’habilla à la hâte et descendit : il trouva le village entier occupé de combattre l’incendie. Malheureusement le vent s’était élevé ; la flamme, après avoir gagné une seconde maison, en atteignit une troisième, puis la rue entière.
Les habitants poussaient en vain des cris de désespoir en s’agitant à la clarté du village en feu : nul moyen d’arrêter le désastre… l’eau manquait.
Pendant quelques heures, ce fut un spectacle à la fois sublime et terrible. Les femmes s’étaient assises à terre en pleurant et tenant leurs enfants dans leurs bras ; tandis que les hommes, debout, les mains crispées, les yeux secs, regardaient tomber en cendre les restes de ces cabanes que la plupart avaient gagnées par vingt années de sueurs.
Enfin, vers le matin, les derniers toits tombèrent, les dernières flammes s’éteignirent, et de toutes ces demeures, la veille encore bruyantes et joyeuses, il ne resta plus que quelques débris fumants entourés de familles sans abri !…