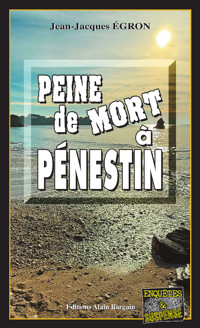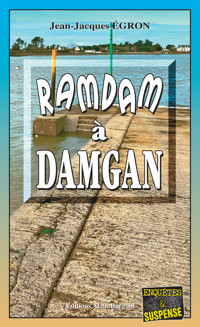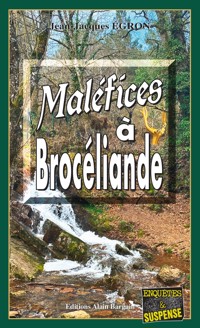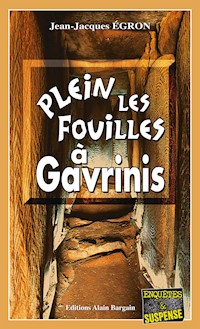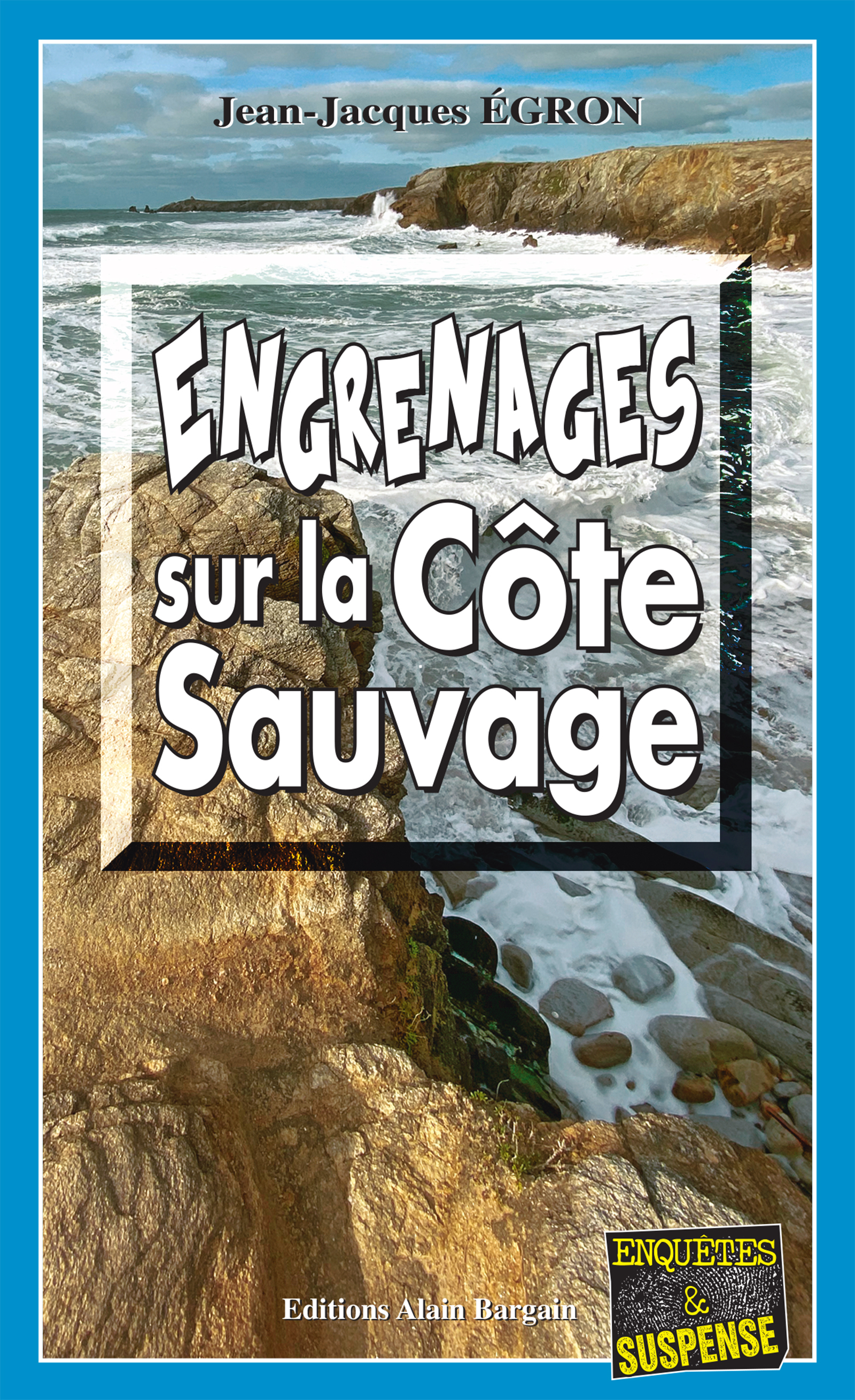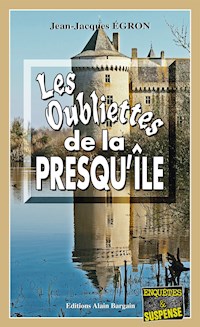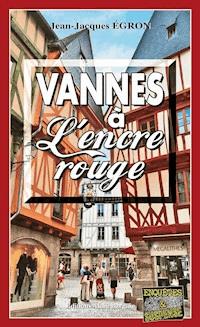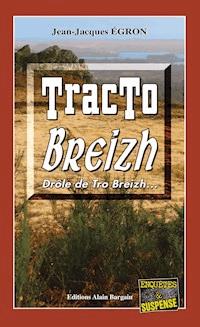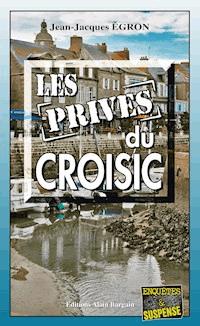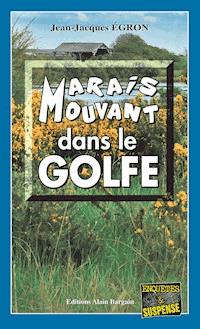Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Rosko
- Sprache: Französisch
Les enquêtes palpitantes du commandant Rosko.
Johnny Rosko, commandant de police, et son équipe tentent d’élucider le rapport entre deux crimes, le premier perpétré à Vannes et le second à Grand-Champ. Cette enquête va conduire Rosko à Lorient où il rencontre Jacques Plank.
Ce dernier a découvert dans le grenier de la maison héritée de ses parents, un manuscrit inachevé d’un certain Brandon Quint. Profitant de son temps libre de nouveau retraité, il est parti sur les traces de cet auteur et s’est installé à Lorient, le temps de son investigation. Ses recherches sur le passé s’avèrent certes riches en rencontres intéressantes mais, bientôt, le mettent en danger.
Une nouvelle affaire pour Rosko ? Ou alors… tous les crimes seraient-ils liés ?
Découvrez le second tome des enquêtes du commandant Rosko, un nouveau polar passionnant au cœur de la Bretagne !
EXTRAIT
— Laura Calmont, 65 ans… une infirmière libérale à la retraite, appréciée de tous ici, où elle a exercé pendant une vingtaine d’années avant de prendre sa retraite. Elle habitait dans le centre-ville, près de la place. Le médecin précise qu’elle est morte d’un seul coup de couteau porté au cœur.
L’adjudant donna d’autres détails que les deux flics engrangèrent. Rosko demanda son avis à Alexandra Cormier, tandis qu’ils perquisitionnaient au domicile, en présence du mari effondré.
— À part le mode opératoire identique, pour l’instant, on ne note pas de points communs entre les deux victimes.
Elle renvoya la question à son chef :
— Tu crois à un tueur en série ?
— Il est trop tôt pour se prononcer, pour l’instant, on n’en est qu’à deux, si j’ose dire. Elle sourit de cet humour premier degré. Le point commun peut être le milieu médical, un aide-soignant à Vannes, une infirmière ici, tu vas t’en occuper. Je veux ton rapport détaillé sur mon bureau dans trois jours.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Paris,
Jean-Jacques Égron a passé son enfance dans le Morbihan. Après des études littéraires, il exerce diverses professions ; il est désormais retraité sur la presqu’île de Rhuys. Il a déjà publié plusieurs romans policiers dont Les Diaboliques de la Côte sauvage chez Liv'Editions.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce roman se déroule en 1979, dans l’ancien Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, désormais désaffecté. Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
- À Josiane pour sa relecture et ses commentaires précis.
- À Bertrand pour son aide précieuse.
I
Johnny Rosko, commandant à la Police Judiciaire de Vannes, menait de nouveau une enquête criminelle. Le parquet, par le biais du procureur de la République avait ouvert une instruction et son équipe avait été chargée de l’enquête.
C’était le deuxième crime, au mode opératoire identique, qui venait d’être commis sur la commune de Grand-champ. Le premier concernait un cadavre retrouvé à Vannes, dans un bosquet de bambous, non loin du Palais des Arts. Il reste à Vannes de ces espaces verts improbables, uniquement remarqués par des yeux exercés ou des habitués des lieux. Il s’agissait d’un homme d’une soixantaine d’années qui avait été poignardé, un seul coup de lame porté au cœur. Selon le médecin légiste, il était mort sur le coup.
Julien Destrac, son fidèle lieutenant, avait commencé l’enquête de voisinage, qui avait mené les policiers dans le centre-ville, dans une maison à colombages, non loin de la cathédrale. Laurent Fertiche assurait les fonctions de diacre et était bien vu, selon les autorités ecclésiastiques interrogées. Il était âgé de soixante-dix ans, veuf depuis cinq ans et il avouait une liaison avec une femme dont le mari occupait une fonction en vue dans l’agglomération. Pour l’instant, il restait discret la concernant.
Pendant une bonne partie de sa carrière, il avait été aide-soignant et les enquêteurs avaient tout juste commencé à retracer son parcours professionnel. Le relevé de son portable, la fadette, indiquait qu’il avait répondu à un rendez-vous en milieu de nuit qui l’avait conduit vers son assassin et vers sa mort. L’appel émanait d’une carte prépayée, donc anonyme, on ne pouvait ainsi connaître l’appelant.
Rosko émit une sorte de borborygme au téléphone, quand la gendarmerie de Grand-champ lui annonça qu’on venait de trouver un nouveau cadavre sur leurs terres et qu’au vu des premières constatations, la mort pouvait intéresser le « collègue policier de Vannes », puisque toutes les forces de l’ordre avaient été alertées sur le premier assassinat.
Alexandra Cormier – La Trompette, nouvelle recrue venant d’arriver sur Vannes – l’accompagnait et ils furent reçus par l’adjudant Leprince de la gendarmerie de Grand-champ. C’était une personne corpulente qui avait peine à parler, le souffle en partie coupé par son obésité. Il connaissait Rosko de réputation et il lui fit des marques d’admiration qui laissèrent le commandant insensible.
— Venez-en aux faits, c’est cela qui m’intéresse.
L’autre cessa toute lècherie et se concentra sur le cadavre. Celui-ci avait été retrouvé à un kilomètre du bourg de Grand-champ, sur la route de Moustoir-Ac, non loin de la maison où avait eu lieu une affaire qui avait défrayé la chronique, mais il fallait se garder de toute conclusion hâtive.
Paul Fétan se lança, impressionné tout de même par l’importance du bonhomme qui se tenait penché sur le corps sans vie.
— Laura Calmont, 65 ans… une infirmière libérale à la retraite, appréciée de tous ici, où elle a exercé pendant une vingtaine d’années avant de prendre sa retraite. Elle habitait dans le centre-ville, près de la place. Le médecin précise qu’elle est morte d’un seul coup de couteau porté au cœur.
L’adjudant donna d’autres détails que les deux flics engrangèrent. Rosko demanda son avis à Alexandra Cormier, tandis qu’ils perquisitionnaient au domicile, en présence du mari effondré.
— À part le mode opératoire identique, pour l’instant, on ne note pas de points communs entre les deux victimes.
Elle renvoya la question à son chef :
— Tu crois à un tueur en série ?
— Il est trop tôt pour se prononcer, pour l’instant, on n’en est qu’à deux, si j’ose dire. Elle sourit de cet humour premier degré. Le point commun peut être le milieu médical, un aide-soignant à Vannes, une infirmière ici, tu vas t’en occuper. Je veux ton rapport détaillé sur mon bureau dans trois jours.
Il voulait tester la nouvelle recrue, voir ce qu’elle avait vraiment dans le ventre, si elle ne répugnait pas à la paperasserie, lui si, donc quitte à la mettre là-dessus, si la dureté du terrain la rebutait. Il la laissa interroger Maurice Calmont.
— Non, je ne lui connaissais aucun ennemi, elle était bien vue par tout le monde, une infirmière, pensez… Nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d’années et nous étions très heureux en ménage. Que vais-je devenir maintenant ?
La fliquette ne put répondre à cette question et le cuisina un bon quart d’heure, avant que les deux policiers ne lèvent le camp. Selon les dires de Rosko, ils n’étaient pas au bout de leurs peines.
II
Heureusement pour lui, du moins le pensait-il, un événement allait changer sa vie.
L’heure de la retraite avait sonné pour Jacques Plank et les aiguilles de la pendule lui indiquaient qu’il pouvait faire le point sur sa vie active. Elle avait été banale en somme, sans à-coups, d’une platitude absolue, c’est ce qu’il lui reprochait. Elle s’était agrémentée de quelques voyages, de beaucoup de lectures, de tentatives artistiques infructueuses, l’un de ses manques les plus criants. Elle s’était construite au fil des rencontres, surtout des femmes dont il appréciait plus la compagnie que celle des hommes.
Il n’avait jamais eu d’ami très cher, ses copains étudiants ne passant pas la barrière de la fin des études, ses fréquentations professionnelles n’avaient pas vraiment compté, son réseau social ne s’était tissé que de gens sans importance à ses yeux ; il avait gardé quelques contacts, mais ils s’étaient délités dans le tourbillon de l’aventure personnelle. Pourtant, il aurait aimé connaître l’Amitié avec un grand A, celle où bien des secrets sont partagés, ce qui les rend plus précieux encore, où des choses sont ressenties de la même façon. Quand on ne peut prendre une décision sans recueillir l’avis de l’autre, ou que l’on a besoin de réconfort pour agir plus sereinement. Quand on partage les moments de pur bonheur, mais plus encore les passages éprouvants d’infortune, s’allégeant l’un l’autre du trop lourd fardeau à porter seul. Non, en y réfléchissant bien, il n’avait jamais eu d’ami véritable, que des relations passagères sans intérêt.
Avec les femmes, il en allait différemment. Il en comptait une demi-douzaine à son tableau de chasse, en y incluant les flirts dont la durée n’avait pas excédé un mois calendaire. Trois d’entre elles l’avaient marqué, excepté sa mère et sa grand-mère. La première se prénommait Vanessa et elle l’accompagna une dizaine d’années jusqu’à la trentaine. C’était une femme imposante, elle avait ferraillé une chape de plomb au-dessus de sa tête, l’empêchant de recevoir les incandescences nécessaires. Il préféra un jour reprendre sa liberté et s’affranchir de cette maîtresse femme qui passait son temps à tout régenter.
Quant à Josyane, elle profita de l’espace laissé vacant et elle s’y engouffra comme une affamée. Elle sortait d’une expérience douloureuse auprès d’un mari qui la battait et trouva dans ce “gentil” garçon une écoute attentive et une tendresse qui léchèrent ses plaies. Mais elle était faite avant tout pour être mère et elle finit par ne plus supporter la stérilité de son mari, préférant aller se faire mettre un enfant dans le ventre ailleurs. Ils se contactaient épisodiquement, se voyaient de temps à autre, se téléphonaient, s’écrivaient ; Jacques Plank était un sentimental qui répugnait à rompre définitivement les ponts. Ils se revoyaient tous deux avec un plaisir évident, ayant l’un comme l’autre une idée précise de l’inventaire dont la balance se révélait positive.
Et puis Mathilda. Mathilda qui lui tomba dessus comme une figure imposée, ne ménageant aucun effort pour se l’accaparer. C’était une femme au tempérament bien trempé, qui avait le don de le rassurer sur bien des points. Véritable fée du logis, elle s’occupait volontiers de tout, ce qui lui facilitait la vie. Plus que d’amour entre eux, c’était plutôt une sorte de pacte pour ne pas mourir dans la solitude, chacun s’épanouissant à sa façon au soleil de l’autre.
Trois femmes et pas d’enfants. Il n’avait jamais envisagé l’adoption. Ses idées étaient claires : du fait de son infirmité – il avait eu les parties broyées dans un moulin à pommes à l’âge de huit ans – et afin de ne pas en souffrir, il avait décidé qu’il n’avait pas été conçu pour être père. Il compensait avec Mathéo, le fils de sa sœur, dont il était le parrain et qu’elle lui confia à maintes reprises tout au long de sa croissance et avec qui il avait, désormais, des conversations que l’adolescent appréciait énormément. Il ne voyait plus Camille, sa cadette, sauf de loin en loin, considérant qu’elle s’était embourgeoisée.
Il ne s’était pas épanoui dans sa carrière, ne faisant rien pour gravir les échelons et ne considérant son travail que comme alimentaire. Ses supérieurs n’avaient jamais fondé de grands espoirs en cet employé qui faisait bien ce qu’on lui demandait, mais qui n’allait jamais au-delà, ne prenant aucune initiative, simplement occupé à passer le temps.
Il ne pouvait que cacher l’amertume qui le rongeait à petit feu, de celle dont on ne connaît pas l’origine exacte, mais qui vous pourrit la vie et vous fait cal au cœur. C’était un fond de perversion qui l’agitait, sans qu’elle dise vraiment son nom, mais il la savait là, tapie en lui et prête à surgir à tout moment. Jusqu’alors, il avait réussi à la maîtriser plus ou moins bien, ne commettant pas d’actes irréversibles ou volontairement négatifs envers autrui, mais il lui faisait confiance, elle était capable de se manifester. Il se rassurait en pensant qu’il n’était pas différent des autres sept milliards, les humains ne sont-ils pas schizophrènes, destructeurs et des personnalités multiples ne cohabitent-elles pas, les rendant capables du meilleur comme du pire ? Mais ce constat était insuffisant pour lui envoyer des éclairs de sérénité.
Heureusement pour lui, du moins le pensait-il, un événement allait changer sa vie.
III
Quel était le contexte qui allait l’amener à un tel bouleversement ?
Il était arrivé à la retraite à cinquante-huit ans et il s’était promis un tas d’occupations pour ne pas sombrer dans un état dépressif, comme il en avait vu bon nombre autour de lui. Jacques Plank, après des études en biologie à l’université – qu’il avait d’ailleurs interrompues rapidement pour se disperser dans des petits boulots alimentaires – avait fait carrière dans la police. Non pas sur le terrain ni dans des services actifs, mais aux archives de la Grande Maison à Nantes. Son travail, surtout vers la fin, n’était pas des plus passionnant – quoiqu’il ait eu à connaître des faits divers tous plus étonnants les uns que les autres, dont plusieurs excitant l’imagination – aussi avait-il passé beaucoup de temps à se préparer dans sa tête à cette échéance inéluctable : la cessation d’activité salariée. Mal terrible quand il y pensait par avance, avec représentation du vide et de la vacuité. Loin de lui, le fait de cesser toute activité ; bien au contraire, il se sentait débordant d’une vitalité qui le ferait se jeter à corps perdu dans divers mouvements associatifs, dans la complétude des nombreuses collections qu’il avait commencées et dans des voyages qu’il n’avait pas eu le temps d’effectuer “de son vivant”. Au moins allait-il s’employer à réaliser quelques-uns de ses vœux.
Sans oublier l’activité Mathilda, ô combien prenante ; il devrait lui consacrer obligatoirement une partie de son temps sous peine de soupe à la grimace. Ils vivaient dans des logements séparés, mais aimaient à se retrouver pour affiner la tendresse qui avait fini par les unir. Mathilda donc, une maîtresse femme au tempérament fort et conquérant, qui lui avait pompé beaucoup d’énergie, mais qui lui en remettait autant au compteur.
Jacques Plank avait toujours été dépendant dans son travail, étant incapable de prendre des responsabilités et prendre un peu de distance avec son épouse encombrante avait constitué pour lui un impératif, mais surtout une bouffée d’oxygène. Il était pourvu d’un caractère docile, prompt aux exécutions, qui préférait laisser faire les choses plutôt que de s’y opposer.
Le lieu investi avait-il de l’importance pour la suite, lui qui venait du Périgord où il avait vécu une dizaine d’années ?
Il avait hérité d’une magnifique longère restaurée, près du pont du Légué, dans la baie de Saint-Brieuc, pour ainsi dire sur ce que d’aucuns appellent la riviera bretonne. C’est dans ce cadre magique, propice à toutes les imaginations, que sa mère s’était suicidée. Jacques Plank comprenait mal les actes suicidaires, surtout ceux des gens âgés – qui ont déjà fait leur vie et qui ont dû résoudre un certain nombre de questions existentielles, il évoquait alors le refus de la déchéance et du délabrement – et encore moins celui de sa mère. Il était passé la voir un mois avant et elle ne présentait pas de trouble du comportement ni une santé altérée, aucun signe qui laissait présager qu’elle mette fin à ses jours.
Quant à son père, il venait d’entrer dans un Alzheimer conséquent et il n’était plus possible, malgré le personnel soignant qui s’occupait de lui, qu’il restât seul à son domicile. Jacques Plank avait dû se résoudre à le faire entrer dans une institution à Quimper, “Les Bruyères”.
Il avait donc pris possession des lieux depuis bientôt un mois ; il ne disait pas de « la maison », car il y avait très peu de souvenirs d’enfance, on l’avait mis très tôt chez ses grands-parents qui l’avaient élevé en partie. L’habitation était relativement agréable – même s’il n’imaginait pas ses parents l’investir, vaquer à leurs occupations – une restauration écologique – mais il pensait qu’on ne fait pas du neuf avec du vieux, aussi trouvait-il l’ensemble trop humide et austère, le soleil n’ayant pas été habitué à y entrer lors de la conception. Derrière, se déroulait un jardin paysager au bout duquel coulait la rivière qui s’élargit avant de rejoindre la mer.
Il n’avait pas l’âme maritime, c’était plutôt un terrien qui avait été élevé à la campagne, ses grands-parents vivaient du côté de Pontivy. Toutefois, il préférait l’habiter plutôt que de la vendre, par respect pour sa mère et puis elle appartenait encore à son père. « De son vivant, tu ne vendras jamais cette maison », avait ordonné Mathilda qui voyait là un moyen possible de rapprochement entre les deux hommes, mais elle seule savait comment. Elle-même louait un appartement dans le centre-ville de Saint-Brieuc, refusant de vivre à demeure chez son Jacques.
Le jardin lui prenait beaucoup de temps en entretien, aussi avait-il loué les services d’un homme à tout faire qui venait trois jours par semaine.
Il se persuada qu’il avait fini par trouver le cadre suffisamment serein pour y couler de douces journées, sans farniente, mais sans figures imposées non plus. Il allait se laisser aller au gré du vent et suivre le mouvement des marées, car il comptait bien s’approprier cette baie, et plus loin la Manche, qui ne l’avaient jamais encore attiré.
IV
Après le cadre posé, on en arrive à ce fameux jour à marquer d’une pierre blanche dans son livre de vie.
Ce jour-là, il était monté au grenier pour humer des souvenirs de son enfance et des relents de ses parents qu’au fond, il avait peu connus. Il régnait un désordre tout à fait propice aux grandes découvertes. Il trouva de grandes malles contenant des magazines très anciens défraîchis, qu’il comptait parcourir un jour, il les mit donc de côté. Sa mère, peintre à la renommée nationale, avait entassé tout son matériel et il trouva dans un porte-documents des croquis, des esquisses, ainsi que quelques toiles achevées sur des supports divers. Il passa rapidement sur les vêtements et divers bibelots qui n’avaient de valeur que sentimentale. Au cours de cette exploration parfaitement décevante, une valise en carton, verte et poussiéreuse, attira son regard, elle semblait l’attendre sous une solive. Il mit un certain temps à forcer la serrure, car elle avait été cadenassée, et trouver la clé n’aurait pas été chose aisée. Il finit par l’ouvrir. Il y avait à l’intérieur un tas de documents officiels, des factures, des rappels, des notes d’électricité et, au fond, un cahier de brouillon de deux cents pages à couverture bleu nuit cartonnée.
Il l’ouvrit avec une émotion de premier communiant, la première page comportait un titre, le nom de l’auteur et une date : le 20 juin 1970 ; il s’agissait apparemment d’un roman : La Madone des Bas-fonds d’un dénommé Brandon Quint.
Une grande partie en était illisible, de nombreux signes avaient bavé, des pages étaient définitivement collées entre elles, le cahier semblait avoir connu bien des vicissitudes, sans doute même une inondation. Après un premier examen rapide, il semblait rester une trentaine de pages accessibles, ce qui représentait suffisamment de matière pour exciter son intérêt.
Il lut en diagonale ce qui demeurait lisible : il suivit par à-coups les pas d’une jeune héroïne qui officiait à la Cour des Miracles et dont l’auteur contait les aventures. L’écriture était serrée, limite pattes de mouche et il eut bien du mal à déchiffrer le contenu. Il tourna une centaine de pages et le roman se terminait sur une phrase suspendue, sans fin réelle. Jacques Plank conclut qu’il s’agissait d’un roman inachevé.
Et se fit jour alors dans sa tête, quelque chose d’incompréhensible, de plus fort que lui : il considéra qu’il n’avait pas trouvé cet écrit par hasard, qu’il lui était destiné, qu’il “devait” en prendre possession. Dès lors, il eut pour projet, dans une échéance sans doute lointaine, de découvrir qui était l’auteur, ce Brandon Quint, et pourquoi son œuvre se trouvait dans le carton « Jacques ».
V
Mathilda accourut dans l’heure qui suivit, Jacques Plank s’était montré tellement brouillon et excité au téléphone, qu’elle croyait qu’il était arrivé quelque accident ou quelque problème insoluble. Elle fut rassurée de le voir sur le pas de la porte où ils échangèrent un chaste baiser sur les lèvres. Puis, elle le bouscula presque et entreprit de faire du rangement, d’épousseter les meubles, de balayer le salon. Une vraie tornade s’était abattue dans ces lieux quiets il y a peu, emportant tout sur son passage.
— Tu me donnes ton linge sale ! ordonna-t-elle, essoufflée, puis elle s’apaisa quelque peu, stoppée par les efforts consentis du haut de sa soixantaine exténuante.
Jacques Plank se dit que c’était une véritable fée du logis, surtout avec la baguette comme accessoire, qui lui épargnait la plupart des tâches matérielles seule exception à la règle, il adorait cuisiner. Il tenta de l’interrompre pour lui parler, mais elle continuait de s’affairer à droite et à gauche, ayant atteint désormais sa vitesse de croisière. Elle n’était pas prête à l’écouter, aussi dut-il attendre que tout fût, non pas impeccable, ça ne l’était jamais, mais qu’elle jugeât l’ensemble potable à ses yeux.
— On peut recevoir des visites à l’improviste, il faut s’y préparer et il n’y a rien de plus désagréable que d’arriver dans un endroit sale ; en ce qui me concerne, je traque tellement la crasse, que je ne suis pas disponible, tant qu’elle n’a pas disparu.
Quand elle rangeait, dépoussiérait, époussetait, elle faisait aussi du rangement dans sa tête.
Elle était constamment sûre et certaine de ses opinions, elle n’en démordait jamais et il fallait user de diplomatie ou d’astuce, s’abîmer en palabres infinies pour l’amener à les changer, ne faisant de concessions que parcimonieusement. Jacques Plank, quant à lui, n’était sûr de rien, il ne l’avait jamais été, il tergiversait sans cesse, remettait à plus tard si un choix se profilait à l’horizon, mais il avouait que les certitudes de sa femme le rassuraient.
Elle se calma enfin, garda un chiffon à la main, s’assit du bout des fesses sur une chaise cannée et se disposa enfin à l’écouter.
— Qu’as-tu donc à me dire de si urgent ?
— Urgent n’est pas le mot… disons important… disons curieux.
— Ne joue pas sur les mots.
Elle le questionna de nouveau, mais cette fois du regard.
— J’ai trouvé quelque chose au grenier.
— Indéfini singulier ? J’aurais plutôt pensé pluriel…
— Cette fois, c’est toi qui joues sur les mots.
— Il y a là-haut un tel foutoir qu’il faudra bien qu’un jour, je m’en occupe.
— Ne touche à rien ! Il avait lancé cela comme un enfant apeuré à l’idée qu’on lui vole ses jouets. Mais il savait qu’elle passerait outre.
— Alors, cette… chose ?
— Un manuscrit.
Il avait employé un ton emphatique, comme si cette découverte allait changer la face du monde et que Mathilda devait en prendre conscience.
— Un manuscrit ? fit-elle en écholalie, mesurant son intérêt pour l’objet.
— Inachevé, d’un certain Brandon Quint.
— Et alors ?
— J’ai envie de connaître ce romancier, savoir qui est ce mec qui s’invite chez moi dans une valise familiale, pour ainsi dire dans mes bagages.
— Inconnu au bataillon ! Qu’a-t-il publié ?
— Je n’en sais rien, mais ce n’est pas le plus important, je suis persuadé que les fonds de tiroirs regorgent d’œuvres inédites qui auraient mérité d’être publiées…
— C’est ce que disent tous les jaloux ou les aigris.
Elle avait accompagné ses mots d’un sourire. Jacques Plank s’était frotté aux éditeurs, leur envoyant quelques pages mineures et il n’avait reçu que des réponses négatives.
Mathilda réfléchit un instant.
— Ça peut être intéressant, tu n’as rien à faire, en tout cas, qui ne puisse être différé, tu disposeras d’un but, car je pense que, malgré tes bonnes résolutions, tu risques de nous faire une dépression post-professionnelle, on ne sort pas impunément de la vie active, crois-en mon expérience.
Elle avait mis une bonne année à se remettre de son départ à la retraite, aux temps chauds, elle avait été surveillante dans un grand hôpital.
— Tu veux te débarrasser de moi en quelque sorte…
— Tu vas t’atteler à la tâche en faisant des recherches sur ce Brandon Quint dont le cahier a certainement des raisons d’être ici et même, en y pensant, pourquoi n’écrirais-tu pas sa biographie ? C’est à la mode et, si elle est intéressante, ça pourra arrondir ta maigre pension.
Ce n’était qu’une boutade, sa mère lui avait laissé de quoi vivre confortablement avec le fruit des ventes de ses tableaux. Quant à son père, il était sous tutelle et c’est Jacques Plank qui gérait le patrimoine familial.
L’idée lui plut, non pas de se faire éditer, il y avait renoncé depuis longtemps et avait d’ailleurs brûlé de nombreuses ébauches en un autodafé aussi rageur que salutaire, les espoirs de sa jeunesse avaient mis trop de temps à se concrétiser, mais d’en connaître un tant soit peu sur le manuscrit de cet homme qui dormait dans un coin du grenier.
Il lui fallait cependant attendre un déclic, quelque chose d’impératif qui ne s’était pas encore produit.
Le fait qu’il n’ait jamais progressé dans son métier, se satisfaisant du travail bien fait mais sans plus, entraînait chez lui un sentiment d’inachevé qui déteignait sur bien des événements. Il avait toujours été un bon agent, ne prenant pas d’initiatives intempestives, restant dans son rôle dévolu de gratte-papier. Pour tout dire, il n’y avait pas connu de grande aventure intellectuelle, à l’image par exemple de ces capitaines d’industrie qui trouvent dans leur job des raisons de pimenter leur vie ou de ces passionnés qui se donnent tout entier à leur activité. Il avait eu peu d’occasions de s’étonner. Alors aujourd’hui que se profilait cette aventure si nouvelle pour lui, cela pouvait donner un regain d’intérêt à sa deuxième partie d’existence et redresser la courbe descendante.
VI
Il n’était plus possible d’interroger sa mère pour cause de suicide, mais son père peut-être, dans un moment parcellaire de lucidité, pourrait avoir des réminiscences ; le lointain passé apparaissant plus facilement aux Alzheimer que le présent.
Il trouva Eugène Plank dans le parc des Bruyères, l’institution toute récente ne recevait que ce genre de malades, c’était un établissement expérimental qui utilisait des nouvelles méthodes venues des États-Unis.
— Laissez ! dit-il à l’aide médico-psychologique qui poussait le fauteuil de son père et il la remplaça. Il l’amena jusqu’à un banc à la peinture écaillée et se plaça face à lui.
— Bonjour, c’est Jacques, ton fils, tu me reconnais ?
— Ben, bien sûr que tu es mon fils, comment l’ignorer, tu es toujours collé à moi ! Au fait, est-ce que tu es allé voir mes clients ? J’espère que tu t’en occupes bien – son œil s’alluma – prends surtout grand soin de monsieur Lothoré, c’est mon plus gros, je ne peux pas me permettre de le perdre.
Eugène Plank était courtier en assurances et il avait vendu sa clientèle depuis longtemps déjà.
— Ne t’inquiète de rien, lui répondit son fils, tout est en ordre et tout va bien.
Au début, il passait son temps à réfuter ce que disait le malade, mais il s’était vite aperçu que cela ne servait à rien, qu’il fallait entrer dans le jeu et disputer la partie. Il est vrai que constater la déchéance de son père est quelque chose qui mine, un peu comme si on visualisait l’état dans lequel on sera plus tard, certains, d’ailleurs, préfèrent ne plus les voir pour ne pas prendre le risque de s’abîmer. Jacques Plank se situait entre les deux, il venait de temps en temps, mais ne prolongeait pas ses visites, il sortait de là déprimé, ayant du mal à réprimer son vague à l’âme et parfois ses larmes. Ce jour-là, il était venu pour une raison précise.
— Tu ne m’as jamais parlé de Brandon Quint.
Le vieillard roula des yeux bizarres, sembla se concentrer intensément ; en fait, son regard s’était fixé sur un des cygnes noirs de l’étang glissant sur l’onde à la recherche sans doute de son compère qui furetait dans les roseaux.
— Brandon Quint… répéta le fils.
Le père sembla sortir alors de sa rêverie.
— Pierre était un bon ami, mais ce n’était pas le seul, dit-il, puis, sa phrase se suspendit.
Jacques Plank ne savait pas à qui ce prénom renvoyait. Il convoya son père jusqu’à la bibliothèque que lui indiqua une aide-soignante prévenante. Elle les accompagna et installa le résidant près d’une table sur un fauteuil où se trouvait un livre ouvert.
— Il lit toujours le même, dit-elle et elle s’éloigna.
Jacques Plank observa la grande bibliothèque et remarqua que s’y trouvaient cinq autres personnes. Il s’attarda surtout sur un homme aux tempes argentées, qui feuilletait une bande dessinée en faisant des commentaires à haute voix, tout en inventant une histoire différente de celle qu’il lisait. Les autres avaient des livres éparpillés devant eux, mais ils étaient figés sur la première page ou sur la couverture.
Son père, pour sa part, était le seul qui lisait vraiment et en silence. De tout temps, son fils l’avait vu, un livre à la main. Il possédait une collection invraisemblable d’ouvrages hétéroclites, allant du livre d’histoire, en passant par diverses biographies. Sans compter plusieurs centaines de romans tant classiques que modernes, il lui avait notamment parlé de sa passion immodérée pour Borges ou Gabriel Garcia Marquez ainsi que de nombreux auteurs sud-américains. Il avait aussi pour Claude Simon une admiration infinie.
Son père demeurait impassible, sans lever les yeux d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen. « Comprend-il ce qu’il lit ou ne fait-il que passer le temps qui doit s’étirer avec une lenteur extrême ? » Mais qu’importait après tout, du moment qu’il y trouvât son compte. Il s’assit auprès de lui, tout en lui parlant à voix basse et chaleureuse :
— Comment vas-tu maintenant ? Sa réponse ne laissa pas de le surprendre.
— Il y a des suspensions dans les ecchymoses, les meurtres sont en pause, les règlements de comptes pleuvent dans les cathédrales. Puis : Ce sont des histoires de mariages, d’amours impossibles, les petits travers des couples
Il était apparemment revenu à l’auteure anglaise.
— Papa – ça lui fit bizarre dans la bouche, il l’avait peu souvent appelé ainsi, préférant le nommer Eugène, afin de garder ses distances. J’ai découvert ce cahier…
Cette fois, il le sortit et le lui mit sous le nez, le père ne le remarqua pas tout d’abord, puis ses yeux se fixèrent sur la couverture bleu nuit. Un instant encore et ses yeux s’exorbitèrent, le corps tout entier en proie à un effroi intense.
— Qu’est-ce que tu as ?
Il ne parlait plus, ses bras tremblaient. Qu’est-ce qui avait provoqué cette sidération ? Il en était à se poser mille questions, lorsque son père balaya de la main, dans un geste ample, le cahier qu’il avait posé sur la table. Il le projeta au loin, dans un coin de la pièce, tout près d’une femme qui s’en empara.
Jacques Plank eut un mal fou à récupérer son bien, tant la femme s’y accrochait avec une rare énergie. Avec d’infinies précautions et beaucoup de patience, il parvint malgré tout à ce qu’elle le lui tende, tout en marmonnant des phrases incompréhensibles. Il mit le cahier dans sa veste et retourna à son père qui s’était replongé dans sa lecture. Celui-ci dit :
— Le tueur… Il faut arrêter le tueur…
Et il ne sut pas s’il commentait sa lecture, le manuscrit inachevé ou un fait de la vie réelle.
Il se dit que cet ouvrage était pour le moins surprenant, il avait même provoqué un tel effroi chez son père qu’il se devait de tirer cela au clair. Cette fois, il avait toutes les raisons de se lancer à la poursuite de cet auteur et de son œuvre. Il allait devoir se faire violence, c’était plus un homme de pensée que d’action, un contemplatif qui attendait que les choses viennent à lui. Mais ne peut-on avoir, comme les chats, plusieurs vies ?
VII
De retour chez lui, il ouvrit une commode où se trouvaient de nombreux papiers et tomba sur une lettre non signée, mais datée de février 1955 :
« Après ce long silence, je reprends la plume. Ces quelques mots pour vous dire que nous sommes bien installés. La vie lorientaise me convient parfaitement : reconstruction après bombardement. »
Il en tira plusieurs conclusions sur lesquelles il allait s’appuyer par la suite. Premièrement, cette lettre était de la même main que celle du manuscrit, mais on ne pouvait affirmer qu’elle émanait de Brandon Quint, un scribe avait pu intervenir. Deuxièmement, son auteur vivait ou avait vécu à Lorient. Troisièmement, c’était un ami de ses parents, peut-être un ami d’enfance.
En pianotant sur Internet, il constata que Brandon Quint n’était pas référencé en tant qu’auteur et qu’il n’existait nulle trace de son passage sur terre, son souvenir s’était perdu dans les arcanes du temps.
Mathilda lui prépara en un tournemain, le nécessaire et le suffisant et il partit pour Rennes où son père avait passé sa jeunesse et ses parents, les premières années de leur vie en couple.
VIII
Son père était né à Rennes en 1929 et il comptait bien y trouver des traces précieuses ; il y avait vécu une vingtaine d’années, jusqu’en 1951, seul tout d’abord, puis la dernière année, en compagnie de sa mère. Ses parents l’avaient emmené une fois avec eux – il avait une vingtaine d’années – en pèlerinage si on pouvait dire. Il se souvenait encore de la maison, au 10 de la rue des Poissonniers, dans le quartier du Thabor.
Avant de se rendre dans la capitale bretonne, il avait réservé une chambre pour quelques jours dans un hôtel du centre : le “Anne de Bretagne”, situé dans la rue Tronjoly, et il y installa son quartier général où il entreposa, comme il l’eût fait chez lui, ordinateur, divers documents, sans oublier le manuscrit qu’il considérait comme son bien le plus précieux, sans savoir précisément pourquoi.
Il déjeuna d’une dizaine d’huîtres accompagnées d’une bouteille de saint-véran et se rendit Rue des Poissonniers. Si son père et Brandon Quint avaient été amis, ils avaient dû côtoyer les mêmes endroits, fouler les mêmes pavés. Il retrouva la maison telle que dans son souvenir, son père lui en avait parlé en des termes dithyrambiques ; croyant aux âmes du foyer, il avait passé là des heures merveilleuses à découvrir tous les trésors du vieux Rennes, quand ses parents lui en laissaient le loisir. Il lui avait raconté que ceux-ci tenaient un bazar et qu’il passait beaucoup de temps dans la réserve où il y avait des tas de choses propres à aiguiser son imagination.
Il sonna à la lourde porte qui s’ouvrit automatiquement et il déboucha dans une cour intérieure pavée, décorée de quelques énormes potiches de fleurs.
Bientôt, une jeune femme vint à sa rencontre et lui demanda ce qu’il voulait.
— Mon père a habité cette maison il y a bien longtemps et je voudrais savoir s’il est possible de la visiter…
— Grand-père est très âgé et fatigué.
— Oh, je ne veux pas le déranger, peut-être que vous-même vous pourriez…
Elle comprit à demi-mot, réfléchit un instant, puis lui demanda de la suivre.
— Si vous pouviez ne pas faire trop de bruit, il se repose.
— Je glisserai sur le sol comme un serpent.
— Ou comme un cygne sur l’eau, je préfère !
Elle dégageait un certain charme, une grande blonde, la vingtaine passée, des yeux bleu clair immenses, où l’on pouvait se noyer. C’était comme il lui plairait, pour les images d’animaux.
Elle le fit entrer dans une maison bourgeoise, au large hall continué par un couloir qui desservait de nombreuses pièces. Au bout, s’ouvrait un escalier en pierre qu’elle l’invita à emprunter.
— Le bas est entièrement dédié à mon grand-père, je préfère, pour l’instant, vous montrer le reste de la maison.
Il nota plusieurs portraits accrochés au mur et il s’arrêta devant l’un d’entre eux.
Il s’agissait d’un buste signé Marie Plank – sa mère – dont il avait reconnu la facture.
— Il est bien de ma mère, laissa-t-il tomber, tandis qu’il examinait le tableau sous toutes les coutures. Je le trouve magnifique, ma mère avait vraiment du talent. Je vous remercie de m’avoir conduit jusqu’à… elle. Il ajouta : Son catalogue ne comporte aucun portrait masculin, celui-là constitue une exception. C’est fascinant de trouver un tableau d’elle accroché ici !
— Grand-père vous dira dans quelles circonstances…
Puis elle se montra très intéressée par l’activité picturale de sa mère, ce qu’il s’empressa de détailler. Elle l’écouta, intéressée, puis elle lui dit :
— J’adore la peinture, mais je dois dire que j’apprécie peu les œuvres modernes.
— Moi également… J’aimais bien ce que faisait maman. Elle avait un atelier à Saint-Brieuc, mais j’y étais peu souvent et, à l’occasion de mes rares présences, je n’avais pas le droit de la déranger. Quand elle désertait son atelier, elle allait chercher son inspiration dans la campagne avoisinante et, en revenant, elle s’enfermait à double tour. J’ai compris ensuite pourquoi elle voulait rester seule et interdire les lieux aux autres, c’est qu’outre les paysages, elle peignait aussi des femmes nues dont certaines venaient poser pour elle, ce qui devait être très shocking à l’époque…
La jeune femme sourit.
— Elle avait peur que vos yeux soient brûlés ?
— Ou alors que je me jette sur ses modèles…
— Vous aviez déjà un appétit féroce ?
Un ange passa.
— Je n’ai pas saisi votre prénom…
— Bérénice… Bérénice Laporte et mon grand-père se prénomme Casimir. Et vous ?
— C’est vrai que je ne me suis pas présenté : Jacques Plank, le même nom que ma mère. Je débarque sans crier gare chez les gens à la recherche d’un lointain passé et je trouve une charmante jeune femme qui me sert de guide, avouez que les goujats sont parfois récompensés.
Elle rosit de plaisir sans commenter.
Ils contemplèrent le portrait stylisé. Il s’agissait d’un buste dont le visage s’animait de deux yeux coquins, les lèvres fines étant soulignées d’une moustache. Le personnage se trouvait devant une forêt sombre et inextricable, avec sur la droite, un petit étang qu’on devinait derrière un lacis de buissons. N’avait-elle pas voulu évoquer le caractère broussailleux du personnage auprès de l’onde symbolisant le liquide amniotique d’où était sorti cet homme ? Ils décrochèrent le tableau, le retournèrent et virent au dos, écrit au crayon à papier : « Portrait de Pierre Adelphélie. »
— C’est la deuxième fois que je découvre ce prénom. Qui peut-ce être ? s’enquit-il.
Ils passèrent dans plusieurs pièces décorées en divers styles, dont certaines façon Grand Siècle, mais le stuc des frises commençait à se dégrader. Le propriétaire n’était apparemment plus en capacité d’entretenir tout ça. Sa femme et les parents de Bérénice avaient péri ensemble dans un accident d’aéronef au-dessus de la Libye, et sa petite-fille qui faisait des études littéraires à la fac, habitait avec lui et subvenait en partie à ses besoins : elle avait hérité d’un important pécule. Ce qui intéressait Jacques Plank, ce n’était pas l’inventaire du mobilier ou la décoration, mais plutôt le besoin de humer l’atmosphère, de sentir dans quelle ambiance ses parents avaient vécu, surtout son père, les premières années de leur vie. Quand il s’en fût suffisamment gorgé, ils redescendirent.
— Pensez-vous que… J’ai commencé en goujat, je continue dans la même veine… mais il me semble que si votre grand-père détient un tableau de ma mère, déjà, ça nous rapproche…
— Le goujat se fait sentimental.
— …Il pourrait peut-être m’apprendre des choses importantes sur la vie de mes ascendants et, par conséquent, sur la mienne…
— Je ne sais pas si la démarche…
— En fait, je ne suis pas là que pour mon père, je suis là surtout pour un de ses amis, celui du portrait, mais par-dessus tout, pour un auteur qui a écrit un roman sans l’achever et dont je souhaiterais écrire la biographie.
— La bio d’un romancier qui n’est pas allé jusqu’au bout de son œuvre ? Voilà qui est original.
De nouveau, son sourire éclata. Et il la regarda vraiment pour la première fois, elle avait un visage ovale au teint biscotte, une chevelure de la blondeur des blés, elle était vêtue d’un jean et d’un tee-shirt blanc qui moulaient ses formes, surtout ses seins qu’il devina fermes et pour lesquels il eut du mal à cacher son intérêt. Il se tança : ne pas laisser la perversité prendre le dessus. Bérénice perçut le trouble du retraité, elle savait qu’elle faisait de l’effet aux hommes d’âge mûr, celui-là, toutefois, ne semblait pas animé de pensées malsaines.
— Je vais voir si Grand-père peut vous recevoir, et elle s’en fut, glissant sur le parquet ciré – comme un cygne ? – qu’entretenait certainement une femme de ménage plusieurs fois par semaine.
Elle revint au bout de quelques minutes, le fit entrer et referma la porte, laissant les deux hommes en tête-à-tête.