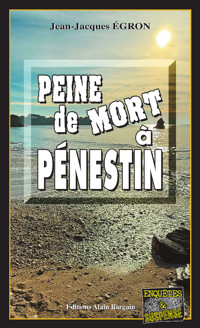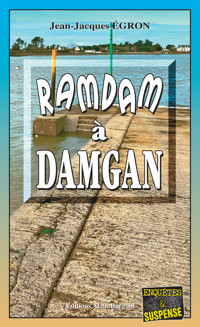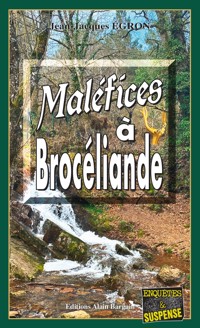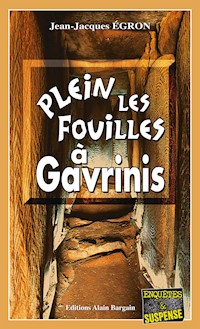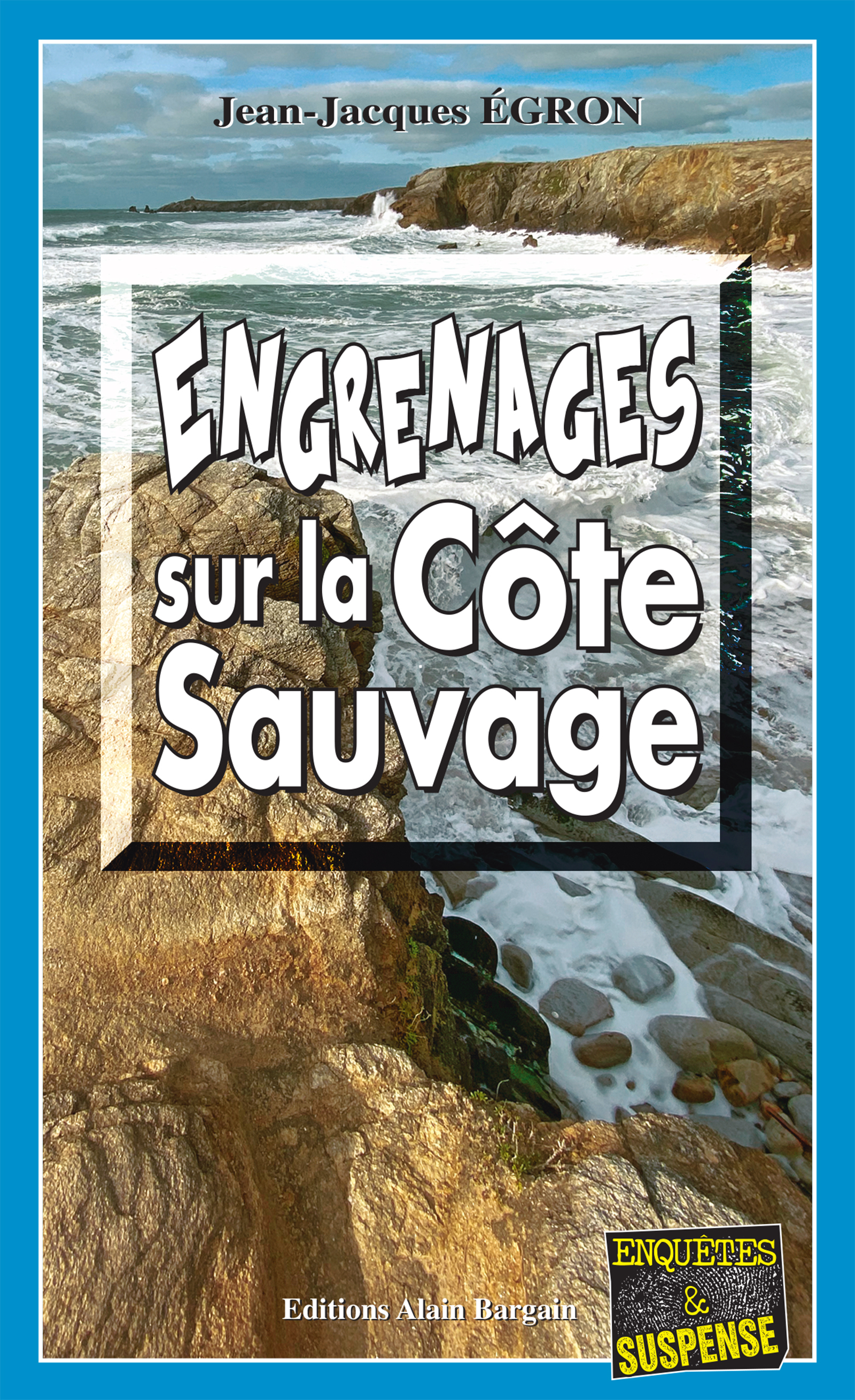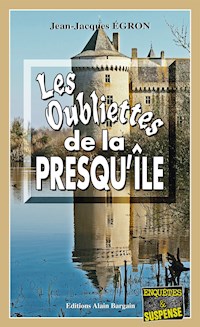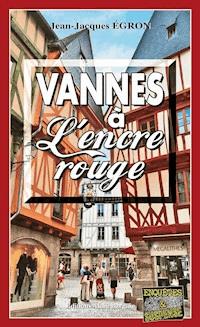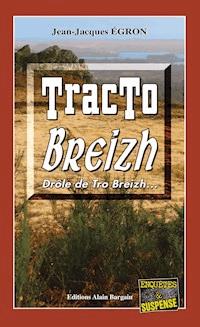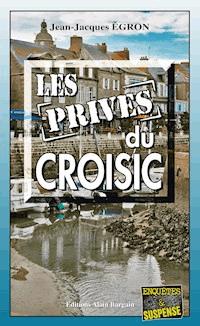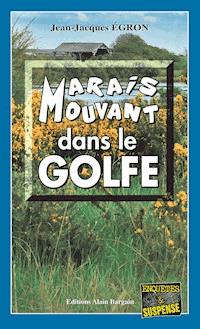Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commandant Rosko
- Sprache: Französisch
Le monde de la photographie pourrait se montrer bien sombre...
C’est l’histoire d’un mec… malingre, invisible, soupçonné de l’enlèvement d’une fillette et d’un meurtre. Ce “photographe”, fasciné, entre autres par les chaussettes blanches, est-il coupable ou victime d’une terrible machination ?
Le commandant Rosko, chargé des deux enquêtes, va découvrir la Bretagne profonde, de La Gacilly – et son festival photo – à Redon – surnommée la « perle du canal de Nantes à Brest » –, en passant par l’Île-aux-Pies et quelques villages pittoresques : Saint-Perreux, Bain-sur- Oust, Rieux, Saint-Nicolas, Rochefort-en-Terre…
Dans les pas de Rosko, nous franchirons des écluses et embarquerons à bord d’une pénichette sur l’Oust au gré des flots.
C’est ainsi qu’après avoir suivi plusieurs pistes et bien des rebondissements, le policier nous mènera à un épilogue des plus inattendus.
Découvrez la Bretagne profonde aux côtés du commandant Rosko !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Paris,
Jean-Jacques Égron a passé son enfance dans le Morbihan. Après des études littéraires, il exerce diverses professions ; il est désormais retraité sur la presqu’île de Rhuys. Il a déjà publié treize romans policiers,
Gros plan sur La Gacilly est son huitième titre aux Éditions Alain Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Remerciements
REMERCIEMENTS
À Josiane, pour ses conseils.
À Marie-George et Éric pour leur logistique.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Johnny Rosko consultait une revue sur le Golfe du Morbihan, devenu PNR – Parc naturel régional – dans son bureau à l’hôtel de police de Vannes quand le téléphone sonna. Un capitaine de la gendarmerie de Redon, réclamait son aide de toute urgence – ils se connaissaient et s’appréciaient. Il pouvait désormais intervenir dans le cadre du GIR Bretagne – Groupe interministériel de recherches – chantre régional de la collaboration entre la Gendarmerie et la Police nationale.
Flanqué du lieutenant Destrac et en accord avec la hiérarchie, il s’était rendu dans la charmante ville-frontière entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Le capitaine Frank – sans C, il y tenait – Marchandet avait reçu un témoignage qu’il souhaitait faire entendre à ses collègues.
Isabelle Techt était une belle trentenaire au corps de liane et au visage angélique bien que figé par l’angoisse. Elle s’exprimait dans un phrasé parfait, avec cependant un débit rapide.
— Ça fait trois jours que Ludivine, ma fille de six ans, a disparu. Je ne vous ai pas prévenus avant, car j’attendais que les ravisseurs me demandent une rançon. Ne voyant rien venir, je préfère que vous vous occupiez maintenant de sa disparition.
Rosko avait failli bondir sur cette mère inconsciente en escaladant le bureau. Il la tança vertement :
— Savez-vous que c’est dans les premières quarante-huit heures qu’on a le plus de chances de retrouver des enfants disparus ? On dispose désormais d’armes telles que l’alerte enlèvement, ainsi que de toute une batterie d’opérations qui entraînent souvent un heureux dénouement. Mais un seul mot d’ordre doit être pris en compte : la RAPIDITÉ d’intervention !
Isabelle Techt s’effondra devant le ton employé. Elle ne se rendait apparemment pas compte de la gravité de la situation. Le policier, voyant qu’elle perdait ses moyens, utilisa un ton plus doux.
— J’ai besoin d’éléments concernant votre fille, des photographies, la façon dont elle était habillée, à quelle heure et où a-t-elle disparu, etc.
La mère de Ludivine fit alors une demande étrange : « Je ne veux pas qu’on en parle dans les médias. » Elle compléta :
— Ni ma famille ni moi ne supporterons de voir nos vies étalées dans les journaux et à la télévision. Je souhaite que vous agissiez en toute confidentialité.
Il eut beau lui dire « que ça augmenterait les chances de récupérer sa fille, certains appels peuvent se montrer utiles, tout dépend à quel ravisseur on a à faire etc. », rien n’y fit. Isabelle Techt exigeait que le secret sur la disparition de sa fille soit maintenu entre les mains des forces de police et de justice.
Rosko demanda conseil à ses supérieurs qui ordonnèrent d’accéder aux desiderata de la mère.
— Tu vois pourquoi j’ai fait appel à toi, résuma le capitaine Marchandet.
— Prépare un bureau pour Julien et moi, je pense que nous allons rester un certain temps sur tes terres.
Ainsi fut fait.
*
Pour le situer, il s’appelle Jean Brot – on ne peut rien contre son patronyme – et il travaille dans une administration fiscale située dans l’un des nouveaux quartiers de la ville de Redon. « Vous voyez où ça se situe sur la carte de France, non ? » Il “fonctionne” différemment des autres et est en quelque sorte, un cas à part, dit-on de lui.
Il possède une renommée tiédasse dans sa petite cité de caractère – comme ils disent sur les prospectus –, La Gacilly, qui aurait pu être élue : « Village préféré des Français », à l’image de la voisine et non moins concurrente : Rochefort-en-Terre. Il s’intéresse en effet depuis toujours à son histoire et il a publié un opuscule sur son patrimoine.
Sa ville, par contre, connaît une grande notoriété, d’où l’effervescence estivale, à cause d’un événement de taille : le festival de photographie, sans doute le plus grand ou l’un des plus grands d’Europe, « ne jouons pas les modestes ! » Il avait d’ailleurs été l’un de ses membres fondateurs en 2004 et depuis, le public avait grossi pour devenir chaque année de plus en plus important. L’été, la ville s’habille de photographies gigantesques et les rues proposent un parcours artistique différent selon le thème. En 2020 par exemple, ce fut Viva Latina, s’étoilant à partir de la place de la Ferronnerie. Mais avec cette notoriété, également due à Yves Rocher et fils dont c’est la patrie, le “gros bourg” connaît un afflux inhabituel de visiteurs. Certes, il comprend leur engouement, mais il a du mal à apprécier leurs allées et venues en troupeau. Il préfère l’ombre à la lumière et plutôt les événements confidentiels que médiatiques. Il entretient généralement des rapports cordiaux mais superficiels en société, et avouons-le, se montre plutôt distant avec ses collègues, surtout avec les femmes. Est-ce dû à son physique peu avantageux ? Il est de petite taille, court de membres, presque chauve et chausse des lunettes à double foyer qui cachent ses yeux de myope pourtant pétillants et débordant de malice. Les femmes lui ont toujours fait peur, de ce fait, il est resté célibataire.
« Célibataire à cinquante ans ! »
Sa mère, attachée à la descendance, avait un avis tranché sur la question mais ne faisait aucun effort pour adouber les “clientes” éventuelles et n’était plus là pour commenter.
Il avait pensé à « manman » en cette fin juin, tandis qu’il se tenait sur la passerelle – seul endroit pour faire une pause correcte et conséquente –, avec quelques collègues fumeurs, contraints de satisfaire à leur vice en dehors des locaux. « Bientôt, ils vont nous interdire de respirer. » Ce troisième étage de l’immeuble flambant neuf, lui permet de prendre de la hauteur et de considérer tout ce qui se situe en dessous avec une certaine condescendance, si l’on veut rester objectif.
De ce promontoire, les fumeurs dominent des HLM où des ombres s’agitent parfois derrière les rideaux. Mais ce qu’il préfère, c’est le tableau champêtre qui s’étale sur la droite. Il s’agrémente d’une rivière presque enfouie sous les herbes et les plantes sauvages. Un saule pleureur y puise son élan vital et le nécessaire au développement de sa chevelure épaisse. Un forsythia et un prunus fleuris en ce beau printemps, complètent le tableau. S’y trouvent aussi, alignées, des maisons bourgeoises qui n’avaient pas vu arriver le nouvel immeuble d’un bon œil, mais avaient dû se plier aux contraintes du modernisme. Au pignon de la première d’entre elles, somnole un jardinet couché le long du courant.
Tout ça pour en venir à…
C’est là qu’un jour, il “la” vit étendre son linge. Elle avait des gestes précis, méthodiques, à la limite des TOC. Elle repliait les manches des chemises, lissait les vêtements pour s’assurer de l’absence de plis, retirait puis remettait les épingles de travers. Même s’il fixait surtout les bras et les mains d’une carnation hâlée, elle était, vue du haut, une grande jeune femme aux cheveux longs d’un brun de jais. Parfois, elle stoppait ses mouvements pour prendre dans ses bras son gros chat aux poils touffus. Puis, après quelques caresses qu’il lui laissait faire, habitué, elle le reposait à terre et il reprenait alors son train de sénateur.
Et ce jour-là, après avoir accompli les mêmes gestes, ceux qu’il fixait la plupart du temps dans son appareil numérique – un Nikon XP2500 –, elle laissa sur le fil – en temps normal, elle ne faisait pas sécher ses dessous –, une paire de chaussettes blanches. Il faut tout de suite dire qu’il est atteint de paraphilie, tout ce qui couvre les pieds et les jambes des femmes le bouleverse au plus haut point. Ce n’était presque rien, un minuscule morceau de tissu mais ce presque rien le troubla d’une façon ahurissante. Il était fasciné pour ainsi dire par ces objets qu’il imaginait ceignant des pieds menus à la Cendrillon. Et les chaussettes laissées là, voletaient au vent léger dans un ballet hypnotique pour lui qui n’avait jamais vu un tel joyau. Il vola quelques clichés des chaussettes blanches, il possédait déjà toute une collection de photographies de cette femme, aussi belle pour lui qu’une madone.
Jean Brot eut du mal à cacher son trouble aux collègues. Les jeunes femmes caquetaient dans des conversations sur leurs familles. Elles le prenaient de temps en temps à témoin pour ne pas l’exclure totalement. Lui, qui n’avait pas compris la question devait faire un effort d’imagination pour lancer une réponse pas trop déplacée. De toute façon, il ne connaît rien aux enfants, aux femmes encore moins, soyons francs. Les cinquantenaires parlaient cinéma, expos, culture. Les collègues hommes partageaient d’autres préoccupations, par exemple écologiques ou sociétales. On avait évoqué un temps le panache nucléaire né au Japon : « Viendrait-il altérer la santé des Français ? » Oubliés rapidement : tremblement de terre, tsunamis et nombre impressionnant de victimes, tant il est vrai qu’on s’intéresse davantage à une rigole qui déborde dans sa cour, qu’à un raz-de-marée lointain.
Mais lui ne jouait pas les mêmes partitions. Il était perdu dans la vision hypnotique des chaussettes, qui virevoltaient au vent et que ses mains, par procuration, auraient eu besoin de toucher, de froisser, de chiffonner ; que ses narines auraient eu besoin de sentir, de humer.
— Qu’en penses-tu Jean ?
Il fallait hélas tout remballer avant l’apothéose, redescendre sur terre avec ceux qui perdent leur temps dans une vie étriquée. Maryse, la collègue qui l’avait interpellé, était une femme espiègle, aux yeux rieurs, prenant tout avec dérision. En temps normal, c’était celle qu’il appréciait le plus, mais là, il eut des envies de meurtre qu’il réprima en haussant les épaules. Il s’en tira par une pirouette, feignant d’ignorer ce dont on parlait. Tous pensèrent qu’il était encore dans la lune où il montait souvent.
Jean Brot a peur des femmes et à la cinquantaine, il n’a eu aucune relation suivie : son union avec Claudie n’avait pas fait long feu. Pourtant il ne déplaît pas à la gent féminine par ses airs mystérieux, il est prévenant, il n’hésite pas à leur servir du café ou du thé, il s’efface devant elles sans problème. Elles mettent ça sur le compte de la politesse, alors qu’il s’agit essentiellement d’appréhension. Simplement, il ne sait pas comment “ça” fonctionne. « Manman » est pour beaucoup dans cet état, l’ayant couvé de façon outrancière, n’hésitant pas à se montrer démonstratrice de tendresse envers lui et ce, devant n’importe qui. Il en avait conçu de la honte et, mécaniquement, une peur d’affronter celles qui n’auraient pu être à la hauteur de sa génitrice.
Après sa mort, il a trouvé une sorte d’équilibre, mais il lui reste encore bien du chemin à parcourir.
Ce penchant pour certains dessous – les chaussettes, les bas – remonte au temps de tante Adélaïde, la sœur de sa mère. Un jour qu’il était rentré plus tôt que prévu à la maison, il l’avait trouvée enlacée avec son père. À quatre ans, la scène ne lui avait pas paru si vilaine, mais ce qu’il en avait retenu, c’était ces chaussettes blanches à ses pieds et des vêtements éparpillés par terre ; tout cela paraissait apporter du plaisir aux deux partenaires. La tante n’émettait-elle pas de petits cris sur lesquels on ne pouvait avoir aucun doute ? Quant à son père, il se pâmait dans des grognements qu’il ne lui connaissait pas. La coïncidence était troublante d’avoir retrouvé cet objet tant convoité chez une personne qui habitait la maison au petit jardin.
La pause se termina, mais il alluma une deuxième cigarette afin de rester plus longtemps dans son doux rêve. Il voulait en profiter pour lui tout seul, sans que d’autres yeux puissent venir le souiller. La fascination, bien loin de décroître, augmenta encore. Un couple de pies traversa son champ de vision. Les oiseaux façonnaient un nid, transportant brindilles et objets hétéroclites dans un immense érable dont les branches commençaient à se couvrir de feuilles. Nous étions au printemps et ça lui évoqua la montée de sève qui s’était abattue sur lui.
Il dut s’arracher au tableau magique et revint dans son bureau. Le travail lui occuperait suffisamment l’esprit jusqu’au soir, pour dissiper cette pensée unique qui l’avait envahi et qui ne quitterait plus sa tête et son corps – il le savait déjà.
II
Comme Rosko était dans le coin pour la disparition de la petite Ludivine, on en profita pour lui refiler un autre bébé et de taille : un homicide.
Disons-le tout net, le cadre était enchanteur, le temps s’était mis de la partie en jetant dans l’azur une brise légère coupant quelque peu la chaleur qui aurait pu être étouffante. Ajoutons que la nature s’était parée d’une verdure attirante – nous étions dans le cadre enchanteur de l’Île-aux-Pies –, les arbres bordant l’Oust projetaient une ombre propice aux nombreux promeneurs qui flânaient le long du chemin de halage. La rivière passait majestueusement entre les falaises de granite, ruban d’argent déroulé dans un spectaculaire défilé où naviguaient pêlemêle : bateaux, barges, canoës ou péniches. Un chapelet d’îlots égrenait des noms d’oiseaux : Île-aux-Pies, Île-aux-Geais, Île-aux-Corbeaux… Les sites d’escalade profitaient des pentes rocheuses sur les deux rives ; sur l’une d’elles, un petit malin avait mêlé escalade et accrobranches.
Une flopée d’activités étaient proposées : la pêche pour taquiner la carpe et le goujon, les sports de pagaie comme le canoë-kayak, permettant de chatouiller le nénuphar. Une nature omniprésente où ouvrir ses sens et se laisser pénétrer par les odeurs, les couleurs, les bruits, et pourquoi ne pas terminer par la dégustation d’une crêpe maison dans l’un des restaurants…
Tout incitait au calme et à la zénitude, bercé par le murmure apaisant de l’onde. Tout donc aurait été parfait dans le meilleur des mondes pour le commandant Johnny Rosko si on ne l’avait pas appelé pour ce qui passait d’ores et déjà pour un meurtre. Il était accompagné de son fidèle lieutenant Julien Destrac et du major Imbert, de la gendarmerie de Redon, ce dernier, mandaté par le capitaine Frank Marchandet. La brigade avait été sollicitée en premier et l’enquête lui fut confiée conjointement avec l’équipe du commissariat de police de Vannes.
— Je suis très content que l’on collabore, ça fait taire les grincheux qui n’ont que la guerre des polices à la bouche. Rosko marchait d’un pas léger, vêtu d’une chemisette à fleurs et d’un pantalon de lin, Destrac d’une chemise blanche sur un jean délavé.
En ce mois de juillet, le temps était clément sur ce territoire breton où le climat est moins maussade qu’on le prétend. Le gendarme fut disert en ce qui concerne l’endroit : le site de l’Île-aux-Pies s’étend sur 25 kilomètres et couvre 8 communes. L’île est reliée à la terre par un seul pont à Bain-sur-Oust, dans le 35. Nous sommes ici à la limite des départements du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine.
Le major poursuivit :
— Maintenant, il va nous falloir grimper, fit celui qui avait déjà passé la tenue réglementaire de la gendarmerie.
Et en effet, la côte était raide. Ils passèrent auprès d’épicéas centenaires, puis parvinrent dans une forêt de chênes, de hêtres, de châtaigniers et de résineux. Devant une stèle, le major expliqua qu’il s’agissait d’un monument commémorant la résistance où cinq ou six hommes, jeunes pour la plupart, avaient été fusillés à cet endroit pendant la guerre de 39/45. Rosko lut machinalement les noms, mais surtout les âges et il fut offusqué de constater que certains avaient à peine 18 ans, fauchés en pleine jeunesse. Ils poursuivirent leur chemin jusqu’à parvenir dans une sorte d’immense clairière où s’étalaient de nombreux bâtiments. Rosko fut fasciné par le gigantisme de ceux-ci et très surpris qu’on les découvre dans un tel lieu aussi reculé. Le major expliqua une nouvelle fois :
— C’était les bâtiments de Ker Kendalc’h. À Saint-Vincent-sur-Oust, le Centre a accueilli pendant 40 ans, sur 35000 mètres carrés, des stages autour de la culture bretonne – danse, musique, chant, langues… – mais aussi des classes vertes, l’association était connue sur la France entière. Les bâtiments ont vieilli, comme vous pouvez le constater.
Rosko mesura l’ampleur du vieillissement, en effet les façades se lézardaient, des vitres avaient été cassées, des tags fleurissaient un peu partout et une végétation très dense s’était épanouie.
Le gendarme compléta :
— Maintenant, l’association a vendu locaux et terrain et ils sont basés à Auray.
— À qui appartiennent ce qu’il faut bien appeler les ruines ?
— Cela appartenait à Redon Agglomération, je crois, il y a eu un article dans le journal Ouest-France ou Le Télégramme, ça a été vendu à un groupe d’investisseurs qui veulent monter un musée dans l’un des bâtiments et un centre de remise en forme dans les trois autres.
Ils gagnèrent une maison – la scène de découverte du cadavre avait été balisée – aux murs envahis de lierre, aux fenêtres dont les vitres avaient été cassées et poussèrent avec difficulté une porte vermoulue qui avait été entrouverte. Ils entrèrent dans une pièce vaste et haute de plafond.
*
Le corps gisait là sur le dos, accent circonflexe tombé d’une lettre mal écrite, mort d’un coup de lame au cœur, mais l’arme avait disparu. Les gars de la scientifique appelés à la rescousse, s’affairaient autour de la dépouille. Ils avaient déjà effectué un arsenal de prélèvements, tous plus précis les uns que les autres, et déposaient leurs découvertes dans des tubes de verre ou des sachets en plastique. Ils mesuraient, prenaient des clichés, discutaient entre eux sur le meilleur angle, vêtus de blanc et ressemblant à des explorateurs lunaires. Tous ces indices, les plus infimes fussent-ils, seraient appelés à jouer, peut-être, un rôle important dans la résolution de l’enquête qui avait été ouverte, ainsi qu’une information judiciaire par un réquisitoire du procureur de la République.
Destrac et Rosko se tinrent à distance du cadavre, respectant le travail de leurs collègues. Le major Imbert s’enquit :
— Nous vous aiderons du mieux possible, avec tous nos moyens… ils ne sont pas énormes évidemment. Comment comptez-vous procéder ?
Rosko ne réfléchit pas longtemps avant de répondre.
— Comme d’habitude, la technique de l’escargot, on commence près d’ici et on élargit… Tout d’abord, vous allez faire des recherches sur ceux qui squattent régulièrement les lieux. Mais en tout premier, il va falloir trouver la scène du crime.
Le gendarme Imbert s’étonna.
— Que voulez-vous dire ?
— Visiblement, il a été traîné ici après avoir été tué, on voit des traces sur le sol et il n’y a pas assez de sang.
L’autre trouva bizarre cet enquêteur, mais on l’avait prévenu que c’était une pointure, alors il n’y avait qu’à se laisser guider.
Dans les environs, Rosko avait remarqué des tas de bouteilles vides, des stigmates de feux de camp, des couvertures ou des morceaux de tissu rapiécés, des piles de cartons et une sorte de journal de menus faits quotidiens, tenu à même le mur, écrit à la craie, plus quelques tags de street art.
— En premier lieu, trouvez les ou l’artiste, occupez-vous aussi de l’association bretonnante, pour découvrir notamment si d’anciens membres ne pourraient pas être concernés. Et pendant ce temps, Julien et moi allons interroger des proches de la victime. Dans une enquête de ce genre, Imbert, il convient de sonder le terrain de proche en proche, un peu comme on le fait dans les fouilles archéologiques. Imaginez des cercles partant de la victime et s’éloignant peu à peu, en vagues successives, un peu comme un objet jeté dans l’eau.
Le major avait acquiescé à toutes les paroles du commandant.
— C’est ainsi que je compte procéder… Voilà mon numéro de portable, vous serez mon interlocuteur privilégié et vous me tiendrez au courant minute par minute de l’avancée de vos investigations et, j’ose espérer de vos trouvailles ou découvertes, Julien ou moi, vous ferons part des nôtres.
Imbert ne manqua pas de faire le salut militaire devant un plus haut gradé et il rompit les rangs pour se mettre au travail.
— Tu as remarqué Julien, comme on se modernise : deux drones sont en train de filmer les environs et la scène de découverte du cadavre elle-même. Ce qui me paraît judicieux, compte tenu de la topographie et de la géographie des lieux : forêts, rochers mégalithiques, fourrés, rivière…
— Bien sûr, ces engins représentent un énorme progrès, mais avec ces recherches sur les robots tueurs, les drones n’ont rien à leur envier. Ils pourraient facilement être téléguidés pour lâcher des bombes ultra-performantes.
— Tu as raison, ce n’est pas le progrès qui est mauvais pour l’homme, mais l’utilisation qu’on en fait qui représente le danger. Hiroshima n’a pu exister qu’à cause de fous furieux qui détenaient la bombe et non pas à cause de ceux qui l’ont conçue, méfions-nous dès à présent de l’utilisation de l’intelligence artificielle, elle pourrait nous réserver des mauvaises surprises si l’on n’y prend garde.
— Ouais, on doit vivre avec son temps, mais faire gaffe aux dérives de certains cerveaux.
Julien Destrac, pour couper court, revint à l’enquête proprement dite :
— Une équipe de plongeurs sonde plusieurs endroits du canal afin de retrouver l’arme ou d’autres indices intéressants.
Rosko avait reçu un rapport sur son portable. Il regarda les traits du cadavre pour y déceler quelques infos utiles. Il s’agissait du rapport concernant les premiers éléments glanés sur la victime. Il le lut tout haut pour en faire aussi profiter son adjoint.
« — Yves Clodic, 52 ans, marié, deux enfants, habite Saint-Vincent-sur-Oust – on précisait son adresse exacte –, il était sous-directeur de l’entreprise agroalimentaire SOGESAMO – traduction : Société générale de salaisons modernes –, dont le siègesocial se situe à Moréac dans le Morbihan, avec un établissement à Muzillac, donc non loin de Saint-Vincent-sur-Oust et de Redon.
Selon les premiers éléments recueillis, c’était une personne sans histoires, que l’on présentait comme un individu sain d’esprit.
Etc, etc, etc. »
— Tu prendras connaissance du reste, pendant le trajet en bagnole, on file à Saint-Vincent, chez la veuve.
*
Jean Brot vit seul dans une longère restaurée au fond d’une venelle menant au moulin, après le pont enjambant l’Aff – au milieu duquel se situe la frontière entre le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. Après la rue Lafayette, il emprunte celle du Relais Postal, passe place de la Ferronnerie et il atteint la rue du Clos Sérot. Il traverse la ville superbement fleurie par les jardiniers de la commune, des géraniums-lierre, des pétunias, des daturas, écrin magnifique pour le festival de photos durant chaque été.
L’habitation s’orne d’un magnifique escalier extérieur en pierre. La maison fait partie intégrante du patrimoine de La Gacilly et il y puise inspiration et sources historiques. Autant le dire, il se sent bien dans son havre, caché des autres, à l’abri derrière les petites fenêtres qui empêchent les rayons du soleil de s’épanouir, il aime regarder par un prisme. Les sept milliards de terriens lui font peur. Il s’expose très peu à la lumière. Il préfère se trouver à l’extérieur des choses, spectateur au théâtre de Shakespeare. Il profite des scènes jouées sans jamais s’impliquer. Assister au spectacle représente pour lui une jouissance infinie, il peut s’y projeter, servir de doublure au besoin – il connaît les rôles par cœur et il saurait même améliorer le jeu –, il peut devenir le héros, sans que personne n’attente à sa vie ni n’agresse son intimité. Il apprécie le contour des choses, celui des gens, le flou artistique ; il garde ses distances, loin de leur aura, car il ne sait pas comment y entrer, apeuré par les risques et périls de la pénétration. Il a passé son temps à construire des protections, à ériger des murs autour de son “fort” intérieur.
Du plus loin qu’il se souvienne, il a toujours collectionné : les insectes qu’il allait chasser avec son père, les feuilles et les fleurs – il s’était constitué un herbier dès l’âge de cinq ans –, les images à l’école, les voitures, les articles sur les chanteurs. Il avait l’impression de tenir le monde en sa possession, de le dominer. Il préfère cet univers onirique à la réalité qu’il trouve triste et surtout dangereuse.
Cette personnalité de collectionneur porte les germes du fétichisme, avec son corollaire : une certaine forme de voyeurisme, mais les photographes ne le sont-ils pas tous un peu ? Amasser du matériel pour compenser le manque de matière humaine. Regarder sans toucher. Surtout les femmes qu’il prend en photo – la plupart du temps sans leur demander leur avis. Ça le rassure, il n’a pas à s’investir. Il adore tout en elles, ce qu’elles portent aux pieds ou vêt leurs jambes, chaussures, bas mais surtout chaussettes. Et leur odeur, leurs parfums, qu’il peut à loisir capturer et mettre en “tube” à l’image du héros du roman de Süskind, Le Parfum.
Il a consulté, après de multiples tergiversations, persuadé qu’il est atteint de quelque penchant honteux. Le spécialiste a été on ne peut plus clair : « C’est une maladie », ce qui l’a rassuré un peu : ça peut se soigner. Quant à le guérir, le toubib ne s’est pas prononcé. Il a parlé de difficultés psychosomatiques : « C’est dans la tête », a-t-il traduit.
Sa mère n’était physiquement pas très épaisse, mais elle dégageait une énergie telle, qu’elle emportait tous ceux qui passaient à sa portée. Elle avait étouffé le petit Jean sous trop d’amour. Il sait qu’il l’a idéalisée, elle était à ses yeux la perfection sur terre, alors, comment les autres femmes pourraient-elles lui ressembler ? Son père cheminait dans des histoires différentes et il ne faisait que de rares haltes au foyer. Il le qualifiait intermittent du spectacle quand il pensait à lui.
« Maintenant je suis libéré de toi ! » criait-il, parfois, dans un demi-sommeil, n’osant affronter sa mère à la clarté du jour.
Elle était morte…
Ses parents sont décédés dans un accident de bateau. Ils effectuaient une croisière dans les îles grecques – l’un de leurs seuls voyages à l’étranger –, et le paquebot avait été pris dans une tempête au large de Santorin. Les secours n’avaient repêché que quelques corps et les leurs ne furent retrouvés que longtemps plus tard. Il récupéra seulement des ossements qu’il fit incinérer… si bien qu’il eut beaucoup de mal à faire son deuil. Il imaginait les restes avalés par la gueule du volcan sous la mer.
Il en voulut longtemps à la mer, puis il crut qu’avec cette disparition, une renaissance s’annonçait. Il n’en fut rien. Sa mère remontait continuellement à la surface de ses souvenirs. Pire, sa présence devenait de plus en plus prégnante, comme si elle n’avait pas eu le temps de le presser suffisamment contre sa poitrine.
Jusqu’au moment de sa disparition, sa mère veillait jalousement sur ses fréquentations féminines.
— Tu ne vas pas t’amouracher de cette coureuse !
Il a continué à entendre sa voix par-dessus les limbes. Trouvant à toutes les femmes au moins un défaut, il a dû se contenter d’un vermisseau, tel le héron de la fable. Claudie ne fut qu’une parenthèse vite refermée.
Ces chaussettes blanches, dans son paysage vide de femme, représentent pour lui une opportunité. Il lui semble, qu’après avoir tiré les premiers fils de la pelote, il va pouvoir se tricoter un gilet pour l’hiver. Cela devient une obsession, une idée fixée à sa peau. À chaque fois qu’il veut penser à autre chose, elle réapparaît, obsédante.
La « femme d’en bas », comme il l’appelle, ne met à sécher que des chaussettes de couleur blanche, il se persuade que ce sont toujours les mêmes, plongeant encore plus loin dans son intimité et il attend ce rite avec une telle impatience qu’il se sent malheureux si elle y sursoit. Les chaussettes représentent aussi une énigme : n’en possède-t-elle que de cette couleur-là, les perd-elle dans le bac à linge, ou la femme est-elle elle-même, fétichiste ? Il n’a pas la réponse à ces questions, ce qui l’excite encore plus. Il se met alors à explorer au quotidien les travers et les habitudes de la femme d’en bas qu’il considère comme un objet d’étude, lui, entomologiste étudiant un drôle d’insecte – va-t-il se faire piquer ?
III
Redon est une ville charmante pour qui sait l’apprivoiser, et pour peu qu’on s’y attarde, cernée d’eau, certes, mais bien ancrée malgré tout sur le sol breton. Bien sûr, Rosko allait manquer de temps pour la pénétrer vraiment mais il se promit de venir l’explorer plus profondément un jour – avec une femme ? Si ce n’était pas sûr, c’était au moins peut-être.
Il leur fut rapide de se rendre à Saint-Vincent-sur-Oust où la veuve les reçut dans une petite maison de ville, apprêtée et coquette. La façade s’insérait entre deux autres, tandis qu’un jardinet propret, derrière des grilles, contenait quelques essences méditerranéennes, se plaisant sous la douceur du climat breton.
La femme était de petite taille, de corpulence boulotte et trapue, mais il se dégageait d’elle une impression d’énergie à soulever des montagnes. Cependant, sous le coup de l’émotion, elle était dévastée par la douleur. Toute la force que l’on sentait en elle semblait s’être dissipée pour un temps, comme si son mari l’avait soutenue et que maintenant qu’il était parti, elle se vidait de toute énergie.
— Je me dois pourtant de continuer à vivre pour Sonia et Aldo, nos deux enfants.
Hélène Clodic montra une photo où apparaissaient deux adolescents se ressemblant trait pour trait. Leur mère expliqua qu’il s’agissait de deux faux jumeaux, mais qu’ils étaient très proches de tempérament. Elle était très fière d’eux, dit-elle dans un sanglot. Ils allaient pouvoir lui apporter un peu de la résilience dont elle aurait besoin dans les années à venir.
Et peut-être, à terme, lui permettre de faire son deuil. Rosko lui demanda :
— Votre mari a-t-il eu des problèmes dans son travail ou dans sa vie privée ?
Elle réfléchit quelques instants.
— De son travail il ne me parlait presque pas, il va falloir vous renseigner auprès de ses collègues et de son patron André Seigneur. Quant au reste… nous avons des amis fidèles, je ne les vois pas tuer Yves, ni personne d’autre d’ailleurs.
— Vous avait-il prévenu de sa virée en bateau ?
— Oui, il voulait se ressourcer, c’est ce qu’il m’a dit avant de partir. Dire qu’il est mort non loin de chez nous…
Elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Le lieutenant Destrac lui tendit un mouchoir en papier. Rosko ajouta :
— Pouvez-vous nous décrire votre mari, je veux bien sûr parler de sa personnalité ?
Elle haussa les épaules, en signe d’abattement.
— Autoritaire, trop parfois, très dur avec les enfants, avec ses employés, car il était exigeant avec lui-même, il voulait toujours atteindre la perfection. Du coup, il en demandait énormément à tout le monde. C’était dû en grande partie à son éducation. Son père était militaire et ne souffrait aucune objection.
Rosko acquiesça, ayant connu lui-même… Elle poursuivit :
— Lui, ses sœurs et ses frères devaient filer droit, sous peine de punitions aussi bien physiques que morales. Ça lui a forgé le caractère, il voulait que ses enfants réussissent, ça partait d’un bon sentiment.
— Et avec vous, il agissait de même ?
— Oh moi… elle haussa de nouveau les épaules, ce qui pouvait signifier un tas de choses.
— Pouvons-nous voir le bureau de votre mari et votre chambre ?
— Je vous dis tout de suite que nous faisions chambre à part depuis plus d’un an.
— Une raison particulière ?
— Aucune, si ce n’est que nous avions trouvé cela plus pratique.
Les deux policiers ne trouvèrent rien de particulier qui puisse les mettre sur une piste précise.
Dès qu’ils la quittèrent, Rosko s’ouvrit de la signification de la formule « oh moi » à Destrac, tout en lui demandant son avis sur cette audition.
— Ça me fait une impression bizarre et à toi ?
Le lieutenant était dans le même état d’esprit, ce qui fit dire à Rosko :
— Il va falloir revoir la veuve et ce, dans un endroit plus… officiel.
— D’après les dires de beaucoup, c’était un chaud lapin, je pense que sa femme ne pouvait ignorer cela, d’où…
— Cela lui donne un mobile. Je suis d’accord avec toi, il se peut qu’elle nous cache pas mal de choses.
— Et les gamins ?
— On va les laisser tranquilles pour l’instant.
*
Jean Brot passait beaucoup de temps à ranger ses placards – les piles de linge étaient alignées méthodiquement – si bien qu’il lui en restait peu pour la préparation des repas. Chez lui, tout devait être en ordre, le moindre écart représentait un grain de sable qui déréglait l’ensemble de ses rouages. Ce soir-là, ne dérogeant pas à la règle, il avait voulu s’acheter une pizza à emporter. Il connaissait l’itinéraire par cœur : il se rendit à pied par la D773, croisa la rue de l’Aff et déboucha place de la Ferronnerie, l’un des hauts lieux du festival photo, puis il emprunta la rue La Fayette, non loin de l’office du tourisme, des Halles et de l’hôtel de ville, qui se pare tous les printemps de très belles jardinières. Il passa rue de Montauban, emprunta la rue du Relais Postal et il déboucha place du Général-de-Gaulle. Il connaît bien les gérants de “La Terrasse de l’Oust” avec qui il échange quelques mots sur la météo du jour.
Après s’être préparé un ti-punch, il avait posé sur la table une grande malle contenant sa précieuse collection qui commençait à prendre des proportions importantes. Il ouvrit la caverne d’Ali Baba, sinon la boîte de Pandore.
Il visionna premièrement une jeune femme se maquillant qu’il avait pris en vidéo, l’ostensible tube de rouge à lèvres parfumé à la myrtille qu’elle arborait le transporta dans les sous-bois, naquit dans son imagination une enfant cueillant des fleurs. Deuxièmement, il regarda la photographie d’une femme mûre tenant un foulard de soie entre ses doigts et s’en délecta de longues minutes en fermant les yeux. « À qui appartenait-il déjà ? » L’image de la propriétaire lui apparut fugacement dans un flou artistique. Elle devait avoir les yeux verts, « c’est ça… immensément ouverts, avec un je-ne-sais-quoi d’appel malgré la distance. » Troisièmement, il passa en revue diverses photos dont les sujets lui rappelaient des souvenirs variés, certains agréables, d’autres très douloureux, mais tant qu’ils étaient enfermés là-dedans, prisonniers, il avait l’impression que rien de fâcheux ne pourrait lui arriver.
Il n’avait pas encore extirpé… c’était le quatrièmement… Ces chaussettes blanches sur la pellicule représentaient un élargissement de ses possibles, un nouveau tournant que prendrait sa collection s’il pouvait s’en emparer, le summum de ses revendications.
Il avait refusé d’en parler à un “vrai” psychiatre. Ces temps-ci, ils étaient surtout occupés par les bipolaires. Il avait pourtant lu un article d’une célébrité de la région, ce du Pontieux de Brenadan en avait soulagé plus d’un, mais il avait l’impression qu’il aurait mis le doigt sur son syndrome, donc sur une pathologie. Pour l’instant, il se satisfaisait de ce qu’il appelait « une petite manie » – à défaut d’une petite amie –, mais après tout, n’était-ce pas sa passion qu’il poursuivait ? L’article avait brossé un tableau clinique en demi-teinte. Freud expliquait le trouble par l’angoisse de la castration, l’enfant découvrant l’absence de pénis de sa mère, ce qu’il réfutait d’un revers de la main.
« Le fétichisme n’est plus considéré comme une déviance dangereuse et pathologique. Ce n’est plus l’excitation provoquée par le fétiche qui se révèle problématique, mais la souffrance et les difficultés dans la vie quotidienne qu’elle peut occasionner. »
Plus loin :
« Est dit fétichiste celui ou celle qui fantasme sur un objet inhabituel depuis au moins six mois. La personne atteinte voit sa vie sociale et/ou professionnelle perturbée par cette attirance. »
Il ne satisfaisait pas à tous les critères. L’article poursuivait en précisant que le traitement n’avait rien d’obligatoire, sauf si la personne concernée en souffrait, ce qui n’était pas son cas, lui se sentait divinement bien. La psychiatrie pourrait mettre en lumière le traumatisme originel, mais il le connaissait déjà. Toutefois, ses parents étaient morts, on n’y pourrait plus rien changer. Pas plus que sa vieille tante Adélaïde qui souffrait désormais d’Alzheimer.
Sans lien apparent, il se projeta au lycée.
Les quatre autres membres de sa bande évoquaient rarement leurs expériences avec les filles, sexuelles ou platoniques. Ils parlaient mecs : sport, compétition, musique, menus faits du lycée, dénigrement des professeurs et du personnel de surveillance, quotidien des pensionnaires… « Qui se ressemble s’assemble », les cinq n’abordaient le sujet que contraints et forcés.
Ils venaient de milieux divers. Les deux Than, Michel et Olivier, des homonymes au lien de parenté lointain, cousins bretons. Le premier, issu de commerçants, le deuxième, au père grand patron de l’industrie versé dans les ouvertures et fermetures.