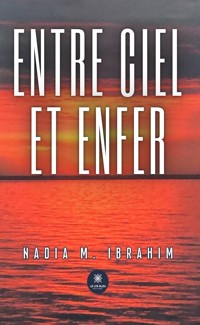
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"Entre ciel et enfer" est un témoignage qui vous transporte des paysages d’Algérie aux horizons lointains de l’Australie. Il raconte l’histoire d’une femme fragile et d’un homme persuadé que sa vie était parfaitement orchestrée. Unis par un objectif commun, ils affrontent des épreuves, des dictatures et des lois oppressives. Leur voyage révèle la puissance du courage et de la résilience, délivrant un message d’espoir et de persévérance.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Après avoir traversé de nombreuses épreuves difficiles entre l’Algérie, l’Irak et l’Australie,
Nadia M. Ibrahim a décidé de coucher son vécu sur papier. Elle offre ainsi une source d’inspiration et de soutien à ceux qui pourraient vivre des situations similaires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nadia M. Ibrahim
Entre ciel et enfer
© Lys Bleu Éditions – Nadia M. Ibrahim
ISBN : 979-10-422-4398-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre I
Lydia relut pour la troisième fois la lettre qu’elle venait de recevoir. Les mots dansaient devant ses yeux sans qu’elle puisse réellement en assimiler le contenu. Elle, qui n’écrivait ses « petits » poèmes que pour elle-même et n’avait jamais prétendu être une véritable poétesse, venait de recevoir une invitation pour participer au Merbed, une rencontre internationale annuelle d’écrivains et de poètes qui avait lieu depuis des décennies à Bagdad en Irak. Avec ses petits poèmes, elle était loin d’imaginer qu’un jour elle serait officiellement invitée au Merbed et à Bagdad. Bagdad ! la ville de Shéhérazade et les Mille et Une Nuits. La cité des merveilles, dansant entre le Tigre et l’Euphrate, rêve et réalité. La ville où toutes les fantaisies sont permises. Lydia regarda encore une fois le papier avec les armoiries officielles du gouvernement irakien. L’événement aurait lieu début décembre, et ce mois de décembre 1995 allait changer le cours entier de la vie de la jeune femme.
Lydia était professeur de biologie à l’université d’Oran en Algérie. À 27 ans, de petite taille d’à peine un mètre cinquante-cinq, une silhouette fine et un visage rond aux cheveux châtain clair coupés courts, des yeux noisette aux reflets verts, toujours cachés derrière les lunettes qu’elle portait depuis l’âge de douze ans, la jeune femme semblait être, à peine âgée de16 ou 17 ans. Sa vie ressemblait à celle de centaines d’Algériennes qui avaient bravé la peur pour continuer à vivre dans un pays déchiré par une guerre civile qui durait depuis quatre longues années et dont la fin ne semblait guère très proche. L’Algérie était la proie d’un conflit opposant un terrorisme inconnu à un peuple qui ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait et pourquoi rien ni personne ne faisait le moindre effort pour lui procurer la sécurité qui représentait le moindre des droits dans ce pays pourtant fort et puissant par son armée et son système juridique. Dans cette Algérie où les voitures piégées fauchaient des vies innocentes à chaque coin de rue, où les attentats contre les intellectuels étaient monnaie courante, Lydia, tout comme de nombreuses autres personnes, refusait de céder aux menaces de mort et de fuir l’Algérie. Elle continuait à lutter à sa manière contre ce courant qui cherchait à draguer le pays des siècles en arrière. Elle avait appris à vivre avec la peur et le courage, car elle ne savait jamais si elle retournerait, à son domicile en vie, à la fin de la journée. Elle avait décidé de mettre en veilleuse la terreur de voir en toute personne marchant en contresens un potentiel terroriste qui, arrivé à son niveau, sortirait, peut-être, une arme pour mettre fin à son existence, à cette petite lumière qui continuait à briller dans un tout petit coin de ce vaste pays où l’obscurantisme gagnait du terrain.
Lydia vivait à Oran, loin de ses parents qui résidaient toujours dans son village natal à quelques kilomètres de Mostaganem, surnommé « le triangle de la mort », où personne n’osait s’aventurer sans risquer de perdre littéralement la tête. La région était déclarée zone libérée. Pendant la journée, la vie semblait plus ou moins normale. Mais la nuit appartenait aux groupuscules qui prenaient possession des lieux, commettant meurtres et décapitations sans que ni les casernes militaires ou même les postes de police, pourtant à proximité, fermés dès le coucher du soleil, n’interviennent. Chaque jour, les habitants enterrent leurs morts en se demandant qui serait la prochaine victime. Dans cet environnement terrifiant, ses parents et sa petite sœur continuaient de vivre, alors que deux de ses frères avaient depuis longtemps quitté le pays à la recherche de nouveaux cieux, libres et en sécurité. Son troisième frère, un officier de police stationné aux alentours d’Alger, ne donnait de ses nouvelles que par téléphone.
Partagée entre la peur et le courage, Lydia contemplait, confuse, l’invitation et se demandant comment le ministère de la culture en Irak avait pu se procurer ses coordonnées. La seule possibilité était le professeur Kadem. Elle se rappela la conversation qu’elle avait eue quelques mois auparavant avec son ancien professeur de physique d’origine irakienne, qui était devenu son collègue plus tard et qui, au cours d’une discussion dans la salle des professeurs, lui avait demandé si elle n’avait jamais pensé à visiter l’Irak. Elle avait répondu qu’elle n’avait jamais envisagé cette possibilité, vu la délicatesse politique du pays après la guerre du Golfe et l’embargo imposé à son gouvernement et son peuple. Le professeur Kadem lui avait fait promettre d’honorer une invitation officielle si l’occasion se présentait. Elle avait souri poliment à son collègue, sachant que des séminaires scientifiques, qui seraient éventuellement la seule raison d’une visite en Irak, étaient quasiment impossibles, mais n’avait jamais pensé que ses gribouillages poétiques allaient être la source d’une telle opportunité. Encore une fois, elle regarda le papier en se demandant ce qu’elle pourrait faire dans un séminaire pareil. Mais qu’importe, cette invitation pourrait peut-être lui offrir l’opportunité de quitter, pour quelques semaines, l’atmosphère pesante d’Oran et de se rendre dans la ville mythique qu’était Bagdad, associée aux djinns et aux anges, bien qu’au fond d’elle-même, une petite voix, lui rappelait que l’Irak subissait également une autre version de terrorisme. Celle du régime de Saddam Hussein. Sa raison et sa conscience lui dictaient de refuser, mais une petite voix au fond de son cœur lui chuchotait que cette invitation représentait une chance inattendue de s’échapper, ne serait-ce que pour quelques jours, de son propre monde.Confuse, Lydia glissa la lettre du consulat irakien dans son cartable au milieu de ses notes du cours de biologie qu’elle venait de terminer et copia la fameuse Scarlett O’hara dans « autant en emporte le vent » en se disant : J’y penserais demain.
En ce début octobre, l’année universitaire était déjà entamée. Lydia avait pris la décision de se rendre à Bagdad pour le Merbed. Mais elle devait s’organiser avant la date de départ prévu le 27 novembre. Elle oscillait sans arrêt entre l’excitation et la peur. D’un côté, elle était enthousiaste à l’idée de visiter un pays qu’elle connaissait si bien à travers les lectures, mais la crainte de l’inconnu lui donnait des frissons qu’elle ne pouvait éviter. Les pays du Golfe avaient toujours été un mystère. Elle avait ses propres opinions sur la condition féminine au Moyen-Orient, qu’elle jugeait parmi les moins valorisées au monde, les femmes étant complètement soumises aux hommes malgré les richesses dont elles étaient couvertes. L’Irak ne faisait pas exception, avec la dictature absolue de Saddam en place. Son anxiété face à la possibilité de rencontrer une forme nouvelle de terrorisme amplifiait ses craintes. Néanmoins, elle choisit de repousser toute réflexion négative et ne penser qu’au côté exotique de cette aventure.
Une simple valise à la main, Lydia arriva à l’aéroport d’Alger. Vêtue d’un tailleur saumon à la jupe juste en dessous des genoux et des escarpins à talons carrés, elle ressemblait à une enfant fragile. Au parking presque vide, seuls les taxis exclusivement réservés à l’aéroport étaient stationnés. Tout véhicule particulier était interdit depuis le début du conflit de peur de voitures piégées. Elle se glissa dans le premier taxi de la file pour se rendre à Hydra, le quartier où se situait l’ambassade d’Irak. Le trajet était à la fois long et ennuyeux. Tout ajoutait au sentiment de malaise que Lydia ressentait à chaque fois qu’elle se déplaçait à la capitale. La densité du trafic sur l’autoroute de l’aéroport, l’inhabituelle chaleur en cette fin d’année, l’odeur d’échappement des voitures engagées dans une bataille de châssis contre châssis et même la voix du chauffeur qui parlait sans arrêt, tout était source se stress. Les nombreux barrages policiers, supposés instaurer une certaine sécurité, contribuaient plutôt à ralentir la circulation. Le chauffeur ne cessait de se plaindre de tout à Alger, le terrorisme, l’armée, la police, le coût de la vie, même de l’air pollué et irrespirable. Lydia fut soulagée de voir le panneau indiquant la sortie pour Hydra. Contrairement au reste de la ville, ce quartier était riche et soigné. Les bâtiments vétustes aux balcons transformés en pièces additionnelles étaient absents ici. Les villas, avec jardins aux clôtures couvertes de fleurs, étaient bien soignées. Même les voitures semblaient neuves à Hydra. Le quartier des ambassades était protégé de tous côtés par des policiers en tenue d’apparat, armés jusqu’aux dents et soutenus par des véhicules blindés qui bloquaient presque toutes les issues, contrôlant tous les véhicules sauf ceux avec une plaque diplomatique bien visible. Le taxi de Lydia fut, lui aussi, arrêté et fouillé. Les documents du chauffeur et de sa passagère furent vérifiés avant qu’ils puissent continuer. Les ambassades étaient à proximité les unes des autres. Les drapeaux des différents pays flottaient au sommet des bâtiments. Plus l’État était économiquement puissant, plus grande était la surface de son ambassade. Devant celles de certains pays européens, des centaines de personnes, principalement des jeunes, se pressaient avec des papiers et des passeports à la main, attendant d’être reçues pour déposer une demande de visa qui leur permettrait de quitter leur enfer quotidien. Le taxi s’arrêta finalement devant une bâtisse qui ressemblait plutôt à une prison, avec des murs très hauts finis par des fils de fer barbelés et des portes blindées surveillées par un garde. Le drapeau irakien flottait au-dessus du bâtiment. Lydia ressentit un serrement au cœur en voyant cette forteresse. Le chauffeur, payé à l’avance, déposa la valise de Lydia et disparut en un clin d’œil, comme s’il ne voulait pas être vu à cet endroit. Incertaine de ce qu’elle devait faire, Lydia s’approcha du policier qui semblait somnoler et lui demanda comment elle pouvait accéder à l’ambassade. Sans un mot, le jeune homme pointa le doigt vers l’interphone que Lydia n’avait pas remarqué. Elle sonna et la porte s’ouvrit automatiquement. À peine entrée, la lourde porte se referma. Une autre porte, en verre cette fois-ci, la séparait de la réception. Enfin, elle se retrouva dans une pièce presque vide faisant office de réception. Mis à part le bureau, une chaise et un vieux canapé, la pièce était dénuée de tout autre meuble. Un employé assis derrière le bureau complètement dénudé de tout papier fixait une télévision diffusant une chaîne Irakienne d’après le logo en haut de l’écran. Incertaine de s’il fallait se présenter ou attendre qu’il lui parle, Lydia attendait patiemment. Probablement surpris par son silence, le monsieur se tourna dans sa direction. Il devait avoir la quarantaine, de teint mat, des yeux bleu azur et une imposante moustache rousse lui mangeait la moitié du visage. Lydia s’adressa à lui en utilisant l’Arabe classique qu’elle avait appris à l’école.
Il répondit poliment avec un sourire à peine retenu, en dialecte algérien avec un accent moyen-oriental.
Se sentant rougir, Lydia lui tendit l’invitation qu’elle avait retirée de son sac avant d’entrer. Il se leva immédiatement.
Elle prit place sur le canapé, qui semblait avoir connu des jours meilleurs en regardant autour d’elle tandis que le jeune homme composait un numéro sur le vieil appareil téléphone noir que Lydia avait uniquement vu chez ses grands-parents. Le mur en face d’elle était presque entièrement occupé par une carte géographique de l’Irak, avec, comme elle le nota, le Koweït annexé. Elle essaya d’estimer la distance depuis les frontières Jordano-Irakiennes jusqu’à Bagdad. La communication terminée, le réceptionniste lui proposa du thé, qu’elle n’eut pas le temps d’accepter ou de refuser, car un autre homme en costume gris et cravate rouge fit son entrée depuis l’intérieur de l’ambassade. Tout aussi grand que le premier, il avait la peau très blanche, mais ses cheveux et sa grosse moustache étaient d’un noir bien trop foncé pour être naturel.
Elle était contente de ne pas être la première. Avec un sourire bienveillant, Abou Hamza la précéda dans la petite cour intérieure dont plusieurs bureaux y donnaient et l’invita à accéder à celui du milieu, qui s’avéra être le bureau du consul. Lydia y pénétra timidement. C’était la première fois qu’elle était reçue à l’intérieur d’une ambassade et autorisée à entrer dans le bureau d’un diplomate d’un rang aussi haut. Son cœur battait la chamade. Contrairement à la modeste réception, la pièce était grandiose avec ses meubles de style arabesque, probablement importés d’Irak. Les tapis luxueux recouvrant le sol étaient tout simplement somptueux et les murs garnis de tableaux représentant la vie rurale irakienne. Comme l’avait dit Abou Hamza, trois hommes d’un certain âge étaient déjà présents. Ce dernier se chargea des présentations, mais Lydia ne put retenir aucun des noms. Le consul, avec des moustaches tout aussi imposantes que les deux premiers Irakiens, lui souhaita chaleureusement la bienvenue. Après avoir serré la main de chacun des présents avec un sourire poli sans dire un mot, elle s’assit sur une chaise restée vacante après que les trois Algériens, apparemment bien plus âgés qu’elle, eurent occupé le majestueux canapé.
L’un des trois poètes venus de Constantine à l’est de l’Algérie se tourna vers elle avec un sourire.
Les Algériens remirent leurs passeports à Abou Hamza. Jamais auparavant, les formalités de visa n’avaient été aussi simples pour la jeune femme. Elle n’était pas habituée à prendre un café avec le consul, alors que le personnel de l’ambassade s’occupe à faire le nécessaire. À la fin, dictature ou pas, elle savourait ce nouveau plaisir qui n’était pas si mal.
Tout au long de la matinée, poètes, écrivains et journalistes en route vers Bagdad affluèrent à l’ambassade d’Irak. La délégation représentant l’Algérie au Merbed cette année comptait 21 hommes et 3 femmes, dont Lydia. Presque tous les autres participants étaient des professionnels, certains d’entre eux, même très connus. Lydia se sentait comme le vilain petit canard avec ses modestes écrits que personne ou presque n’avait encore lus. L’une des jeunes femmes, qui allait être sa compagne de voyage, se distinguait des autres.
Djamila était difficile à décrire. Une femme qui occupait l’espace où elle se trouvait, tant par son physique que par sa personnalité. À première vue, on serait intimidé par cette montagne faite femme, qui ne parlait pratiquement que l’arabe classique qu’elle maîtrisait à la perfection. Alors que Lydia n’avait qu’un Arabe très basique. Elle sentait qu’elle aurait besoin d’un dictionnaire pour pouvoir suivre ce qui se passait entre Djamila et l’inspecteur d’académie venu de Sétif, avec lequel, elle semblait bien familière. Tous deux devaient être assez connus dans le milieu littéraire arabe, mais Lydia ne savait pas du tout qui ils pouvaient être. Pratiquement tout le monde dans la pièce se connaissait, soit personnellement, soit de nom. Tandis qu’elle ne connaissait personne et personne ne la connaissait. Au fils de la matinée, perdue dans des discussions dans un arabe parfait, elle se sentait de plus en plus embarrassée. De plus, tous étaient beaucoup plus âgés et plus grands qu’elle. Avec sa petite taille, ses quarante-cinq kilos et ses lunettes correctives, elle donnait l’impression d’être une enfant perdue au milieu de ce monde. Djamila fut la première à lui adresser la parole. Sa voix était à la fois puissante et apaisante, et son sourire adoucissait ses traits. Lydia ressentit immédiatement de la sympathie envers cette femme impressionnante.
Lydia sentit ses joues rougir. Prétendre participer à une rencontre internationale de poésie sans avoir publié le moindre vers était assez audacieux.
Djamila plaisait beaucoup à Lydia, qui souriait en observant sa réaction face à ce qu’elle allait lui révéler.
Immédiatement, la personne à droite de Djamila, qui se révéla être professeur de littérature à l’université d’Alger, réagit avec un certain étonnement.
Lydia commençait à se sentir mal à l’aise. Heureusement, Abou Hamza vint à la rescousse.
Lydia était soulagée. Elle avait l’impression d’être le vilain petit canard, car la majorité des présents militaient pour l’arabisation du pays, s’opposant ainsi à la langue de Molière, héritage du colonisateur. Seule Djamila vint à sa rescousse.
Soudain, comme si elle se rappelait quelque chose d’important, Djamila se tourna vers Abou Hamza, qui, comme Lydia l’apprendrait plus tard, était originaire du village natal de Saddam Hussein. Tous ceux qui travaillaient à l’ambassade le craignaient, car il avait le pouvoir de mettre fin à leur carrière ou même à leur vie d’un simple rapport.
La discussion continua toute la matinée autour des thèmes de la guerre en Irak et de l’embargo économique. De temps en temps, Djamila se tournait vers Lydia pour l’encourager à participer, sans succès apparent. Soudain, un cri de joie retentit parmi les personnes proches de la porte.
« Ah !!!! Ibn Echatee. »
Un nouvel arrivant fit son entrée dans la pièce sous les embrassades et les accolades. Même Djamila se leva pour enlacer le monsieur qui parlait et saluait tout le monde en même temps avec un fort accent palestinien. Arrivé devant Lydia, il s’arrêta pour la regarder en clignant les yeux avec curiosité.
Un homme amical, qui avait été silencieux jusqu’à présent, se tourna vers Lydia et lui demanda :
Un jeune employé du consulat entra avec les passeports et les visas. Le consul remercia tout le monde et leur expliqua qu’il ne leur restait plus qu’à se rendre à l’ambassade de Jordanie pour obtenir le visa de transit nécessaire pour le voyage d’Amman à Bagdad par la route. C’était à deux pas, et Abou Hamza suggéra qu’ils laissent leurs bagages pour éviter de les transporter pendant les formalités.
L’aller-retour ne prit pas plus d’une heure et le groupe se retrouva de nouveau face à Abou Hamza, qui leur dit.
En fait, Oum Hamza avait préparé un festin. Lydia remarqua les différents plats à base de viande et de poisson, bien au-delà de la bourse de ce que la plupart des Algériens, mais tout était pris en charge par l’ambassade, probablement. Les invités se régalèrent du repas, suivi d’un bon thé à la tradition orientale. Les discussions, de toutes sortes, initiées à l’ambassade, se poursuivirent toute l’après-midi. Finalement, Monsieur Gharbi donna le signal de départ et Djamila se tourna vers Lydia :
Il ajouta avec une tonalité paternelle :
Cela ne déplaisait pas à Lydia, car vu les circonstances que vivait le pays, séjourner à l’hôtel aurait été risqué pour une femme seule. Ainsi, Lydia et Djamila furent logées dans une grande chambre au deuxième étage de la somptueuse villa où vivait Abou Hamza avec sa femme et ses deux garçons, qui n’étaient apparus que pour saluer les invités avant de disparaître. La maîtresse de maison avait une beauté typiquement orientale, avec de grands yeux marron et de longs cheveux noirs. Elle était surprise de voir que ces jeunes femmes voyageaient seules, bien qu’elle ne l’ait pas exprimé clairement, car son mari surveillait attentivement chacun de ses faits et gestes, comme s’il voulait contrôler ce qu’elle pourrait dire ou faire.
Le lendemain, à six heures du matin, les vingt-quatre Algériens qui devaient partir en Irak se retrouvèrent à l’aéroport. Ils se rassemblèrent devant le guichet d’enregistrement pour le vol Alger-Amman. Djamila semblait ravie de retrouver ses compagnons de voyages précédents et elle se chargea de les présenter à Lydia. Notamment, elle se tourna vers une grande et élégante jeune femme qui s’approchait du groupe.
Lydia observait avec admiration Fouzia qui aurait facilement, pu prétendre être descendante des pharaons, avec ses énormes yeux noirs soulignés de khôl et son abondante chevelure noire flottant librement jusqu’au bas de son dos. Lydia lui arrivait à peine aux épaules.
Abou Hamza, qui était arrivé à l’aéroport avec Lydia et Djamila dans sa voiture personnelle, s’occupait de toutes les formalités d’enregistrement. Les contrôles de sécurité des bagages, effectués à la fois par scanner et manuellement, se déroulèrent si rapidement que Lydia se demandait si elle était vraiment dans un aéroport algérien. Cependant, lorsqu’elle arriva devant le douanier, elle comprit le secret de cette facilité lorsqu’il lui demanda.
Le douanier rappela à Lydia les manifestations organisées par les Algériens lors de la frappe des forces de coalition contre Bagdad après l’invasion du Koweït. Une grande partie de la population qui ne connaissait de Saddam que ce que leur montrait la seule chaîne d’information en Algérie et qui ignorait les souffrances infligées par leur prétendu héros à son peuple, était sortie dans les rues pour exprimer leur soutien, non pas au peuple irakien, mais à leur souverain. Ces mêmes personnes qui avaient manifesté en 1988 contre leur misérable vie en Algérie et qui, le lendemain, clamaient longue vie au président Chadli Benjedid après son discours à la télévision.
Lydia observa le douanier avec tristesse, sachant qu’il voulait probablement se débarrasser d’elle rapidement afin de fouiller quelqu’un qui partait plutôt pour l’Europe, susceptible de cacher des devises. Elle le remercia avec un sourire.
Le voyage de presque cinq heures d’Alger à Amman, en Jordanie, fut long et épuisant. Le service à bord du vol d’Air Algérie n’avait pas changé d’un poil : même menu, même rapidité à servir les repas et les collations au début du vol, puis plus rien jusqu’à l’arrivée.
L’aéroport d’Amman ressemblait à tous les aéroports des pays arabes. Présence policière partout, contrôle minutieux de tous les passagers, traitement différent en fonction de l’origine du voyageur. Ayant l’habitude des aéroports, Lydia fut l’une des premières à terminer les formalités de douane et de contrôle aux frontières. Dès qu’elle passa la porte de sortie, elle scruta la foule pour essayer de repérer leurs hôtes. Fouzia, arrivée juste derrière elle, saluait un homme en costume-cravate, typique des officiels des pays arabes, qui semblait sortir du même moule que les autres.
Fouzia se tourna vers Lydia qui l’avait suivie.
Ils attendirent que tous les Algériens sortent pour connaître la suite du programme. Le nommé Saad salua un à un tous les membres de la délégation et les remercia chaleureusement d’avoir accepté de venir représenter l’Algérie à cet événement.
Lydia s’abstint de commentaires, réalisant que tout le monde semblait déjà être au courant du départ immédiat, sauf elle. À la suite de Saad, le groupe se dirigea vers le luxueux autocar stationné devant la porte d’arrivée internationale de l’aéroport Reine Alia. Chacun choisit un siège pour être le plus à l’aise possible, en vue d’un voyage qui promettait d’être long et plein de découvertes pour Lydia. Le départ eut lieu en fin d’après-midi, et le véhicule offrait un confort exemplaire. Le chauffeur et les deux accompagnateurs discutaient en écoutant une musique d’une tristesse inégalée, tandis qu’un deuxième chauffeur, allongeait sur la banquette arrière, aménageait en lit de fortune, se reposait, probablement pour prendre des forces avant de relayer son collègue.
La route empruntée était large et bien entretenue, mais le paysage plutôt désertique, bien que les Jordaniens essayaient, apparemment, de faire pousser quelques arbres rachitiques éparpillés ici et là, la sensation de désolation était bien trop présente. L’architecture différait complètement de celle des pays du Maghreb. Aux abords de la ville, des maisons construites avec des pierres blanches taillées dans des carrières, visibles occasionnellement sur le chemin, ressemblaient toutes plus ou moins les unes aux autres. L’ensemble donnait une impression de vide sans âme, assez froid. En s’éloignant d’Amman, le paysage semblait se métamorphoser. De chaque côté de la route s’alignaient d’énormes blocs de pierre noire volcanique, créant une vision de science-fiction. Lydia contemplait le paysage, se demandant ce qui avait pu se produire des milliers d’années auparavant pour donner naissance à ce sombre panorama qui s’étendait à perte de vue.
La distance entre la capitale jordanienne et la frontière était d’environ deux heures de route. Peu avant d’y parvenir, l’autocar s’arrêta devant une rangée de petits magasins en bord de route, qui ressemblaient plutôt à des bazars proposant toutes sortes d’articles. Fouzia, devenue malgré elle la guide du groupe, se dirigea vers l’avant du bus et se tourna vers les autres passagers.
Elles se dirigèrent vers le premier magasin qui semblait le mieux approvisionné, et Lydia acheta quelques boîtes de chocolat et des biscuits. En prenant exemple sur les autres voyageurs, elle opta pour des biscuits salés et des bouteilles d’eau pour la route. Elle choisit des chocolats de marques connues pour éviter d’avoir affaire à la graisse animale, souvent présente dans les chocolats locaux. Bien qu’elle ne fût pas complètement convaincue par tout ce que disaient Fouzia et tous ceux ayant déjà fait le voyage, particulièrement en ce qui concerne la propreté des aires de repos le long de la route, elle décida de suivre le mouvement.
L’arrivée à la frontière ne prit pas plus d’une demi-heure. Les formalités du côté jordanien furent rapidement expédiées. Tous descendirent de l’autocar pour que leurs passeports et visas soient vérifiés, puis restitués aux voyageurs. Ce qui sembla inhabituel à Lydia, c’est qu’aucune fouille ni des passagers ni du véhicule ne fut effectuée. Elle apprit par la suite que tout cela se déroulait sans encombre grâce aux arrangements entre les chauffeurs traversant les deux pays et les employés des frontières. Le chauffeur présentait toujours son passeport en premier, avec quelques billets à l’intérieur. Donner des pourboires pour faciliter le passage rapide des véhicules était monnaie courante.
Il était minuit et demi quand l’autocar atteignit la frontière entre la Jordanie et l’Irak. Une effervescence impressionnante régnait à une heure aussi tardive. Le nombre de voyageurs, qui marchant avec leurs papiers à la main et qui dormant sur leurs bagages éparpillés un peu partout, rivalisait avec le nombre de véhicules. Des autocars, des taxis blancs et oranges ainsi que des voitures privées bourrées de voyageurs et de marchandises, qui n’avaient pas d’autres options en raison de l’embargo interdisant tout trafic aérien, que d’emprunter cette voie pour entrer ou sortir d’Irak. Les véhicules étaient stationnés partout, et le nombre de personnes en attente semblait inimaginable, mais les plus remarquables étaient les camions-citernes stationnés de part et d’autre de la route, probablement en raison de la fermeture des autres frontières. On aurait dit que le pays tout entier était rassemblé à ce point de passage.
L’autocar, qui continuait de progresser au milieu de ce chaos, s’arrêta devant une muraille en béton armé de plusieurs mètres de hauteur, surmonté de barbelés, avec une énorme double porte en forme d’arche imposante au centre. Au-dessus de ladite porte, à droite, se dressait un immense et impressionnant portrait de Saddam Hussein, dont d’énormes lunettes noires cachaient le regard perçant qui lui était attribué. Le sourire du dirigeant irakien laissait apparaître des dents d’une blancheur éclatante, sans le moindre défaut. La formule « Bienvenue en Irak » était bien mise en évidence en dessous de la photo. Lydia sentit son cœur se serrer, car cette image n’avait qu’une signification. Saddam était l’Irak et l’Irak était Saddam, et personne ne pouvait contester cela. La vue de ce visage au sourire énigmatique lui donna des frissons. Le véhicule qui transportait les Algériens pénétra sur le territoire Irakien par cette porte juste au-dessous de la photo. Lydia était bel et bien en route vers le pays de toutes les merveilles et de toutes les souffrances.
Chapitre II
L’autocar s’arrêta près d’un premier poste de contrôle militaire, juste devant l’immense portrait du dirigeant du pays. Dans leur dialecte local, difficilement compréhensible pour les étrangers, le chauffeur expliqua au soldat en poste qu’il transportait une délégation venue d’Algérie pour participer au Merbed et donc, des invités officiels du ministère de la culture et de l’information. Vêtu d’un uniforme froissé qui avait connu des jours meilleurs, le militaire, avec son fusil mitrailleur accroché à l’épaule dont la pointe était dirigée vers le sol, monta nonchalamment à bord du véhicule pour s’adresser aux Algériens.
L’autocar prit un chemin privé, éclairé et désert, pour s’arrêter devant un grand pavillon. Deux personnes, vraisemblablement des gardiens, assis sur de vieux sièges près d’un feu sur lequel trônait une théière noire fumante, se levèrent en voyant le véhicule s’immobiliser à leur hauteur. Sous la direction du militaire, ils ouvrirent la porte de la salle des « tachrifates », réservée aux VIP.
À vrai dire, Lydia et ses compagnons ne ressemblaient guère à des « Very Important Personalities » avec leurs visages fatigués et leurs vêtements froissés après près de 20 heures de voyage, sans repos, depuis leur départ d’Alger. Lydia ne désirait plus qu’une petite douche pour se rafraîchir. Cependant, ils se trouvèrent tous dans une vaste salle aménagée à l’orientale, ornée de somptueux tapis persans et de canapés recouverts de velours bordeaux, agrémentés de coussins disposés négligemment. L’atmosphère évoquait les salons vus aux informations, où les rois et les princes accueillaient leurs invités. Devant chaque canapé se trouvait une table basse avec des carafes d’eau et des verres d’une propreté qui ne laissait rien transparaître de l’aspect extérieur de l’endroit. Aux murs étaient accrochés des tableaux représentant la vie rurale du pays, exception faite de celui faisant face à l’entrée, sur lequel trônait un autre immense portrait de Saddam Hussein. Cette photographie semblait dater du début de sa présidence où le dirigeant était encore jeune. Lydia fixa la photo, cherchant à discerner en ce jeune homme séduisant le dictateur qui détenait depuis lors le pouvoir de vie et de mort sur ce peuple qui, depuis l’arrivée d’El-Hajaj Ibn Youssef en 694 à aujourd’hui, n’avait pas connu un jour de répit.
Un garde des frontières se chargea de la collecte des passeports, tandis qu’un autre distribuait des formulaires à remplir pour les exempter du test de dépistage du VIH, test obligatoire pour toute personne entrant au pays, qu’elle soit Irakienne ou non. Djamila chuchota dans l’oreille de Lydia que le test coûtait cinquante dollars américains. Officiellement, c’était une mesure de prévention contre le SIDA, mais officieusement, une manière de récolter des devises. Elle alla même plus loin en expliquant que ceux qui ne souhaitaient pas subir le test n’avaient qu’à glisser un petit billet aux membres du personnel en charge de la prise de sang, et le tour était joué.
L’un des jeunes hommes près de la porte de la salle entra avec une cafetière dorée dans une main et des petites tasses empilées les unes sur les autres, dans l’autre. Il versa à peine une gorgée dans chaque tasse qu’il offrit aux Algériens. Bien que Lydia ne soit pas une grande amatrice de café, l’odeur était trop alléchante. Elle prit une petite tasse et en avala le contenu. Mais sa surprise fut désagréable. Le café était amer, sans sucre, et tellement fort. Elle comprit alors pourquoi tous ceux qui avaient visité le pays auparavant avaient refusé d’en boire.
Un lourd silence s’installa dans la salle. Le groupe était trop épuisé pour engager la moindre conversation. Le militaire revint avec les passeports et les informa que le départ serait donné dès que les chauffeurs et les accompagnateurs auraient achevé les formalités d’entrée et la fouille de l’autocar. Il ajouta que les Algériens, en tant qu’invités, n’allaient pas être soumis à la fouille.
L’attente sembla plus longue que prévu, mais personne ne se plaignit. Tous restèrent silencieux en attendant la reprise du voyage. Fouzia, la plus familière avec le pays, se leva pour s’adresser aux voyageurs.
La question fut close, et l’argent fut remis au jeune homme qui avait servi le café. L’autocar redémarra et le voyage reprit. Cependant, il dut s’arrêter à trois autres points de contrôle pour vérification de papiers avant de finalement recevoir l’autorisation de rouler sur le sol irakien. Le trajet entre les frontières et Bagdad semblait plus long que ce que Lydia avait imaginé. La fatigue se faisait de plus en plus ressentir chez tous les membres du groupe. Quant aux Irakiens qui les accompagnaient, ils discutaient àvoix basse tout en écoutant toujours leur musique triste, une mélodie à fendre l’âme.
Le désert d’Al-Anbar s’étendait à perte de vue. La route était droite et si bien entretenue que l’autocar semblait être sur pilote automatique. Seuls des camions-citernes circulant dans les deux sens croisaient leur chemin de temps à autre. Enfin, vers trois heures du matin, des petites lumières déchirèrent la mosaïque noire qui enveloppait l’horizon. Ils atteignirent une aire de repos où les voyageurs pouvaient se restaurer, boire et utiliser les toilettes.
Le lieu était désert, à l’exception de trois jeunes hommes enveloppés dans des couvertures d’apparence douteuse, assis sur des tabourets autour d’une sorte de grande lanterne qui servait également de chauffage. Sans bouger de leurs sièges improvises, ils tournèrent leurs visages brûlés par le soleil ardent du jour et le froid glacial de la nuit vers le véhicule qui s’arrêtait à leur niveau. En voyant les voyageurs descendre de l’autocar, ils abandonnèrent leur confort avec réticence et se dirigèrent vers l’intérieur du bâtiment. Les trois jeunes femmes du groupe furent les dernières à quitter le véhicule, allant directement vers la salle d’eau. Fouzia ajustait déjà son maquillage, tandis que Lydia, désirant utiliser les toilettes, s’arrêta net en voyant le simple trou dans le sol en ciment. Elle se tourna vers ses deux compagnes.
Les jeunes femmes se rafraîchirent le visage et les mains et rejoignirent les hommes assis par petits groupes à l’intérieur du bâtiment. Il faisait trop froid dehors pour s’aventurer à l’extérieur. Les trois irakiens se déplaisaient entre les tables pour servir ces clients de nuit en silence. Lydia observa avec suspicion les chiches kebabs servis à certains de ses compagnons de voyage et décida de se contenter d’un thé chaud accompagné des biscuits qu’elle avait achetés à Amman. Contrairement à ce qu’elle pensait, le thé était délicieux. Elle apprit plus tard que c’était grâce à la cardamome que les moyen-orientaux faisaient systématiquement bouillir avec leur thé noir. Elle savoura ce breuvage chaud avec plaisir, mais s’abstint de prendre une seconde tasse de peur d’être incommodée pour le reste du trajet. Elle ne souhaitait surtout pas être contrainte de réutiliser des toilettes du même genre.
Le seul chauffeur qui était descendu avec le groupe mangeait à sa guise en buvant plusieurs tasses de thé, peut-être pour rester éveillé. L’autocar reprit la route, et Lydia s’installa sur le siège avant pour observer le ruban de la route interminable qui se déroulait devant ses yeux. La chaussée était parfaitement entretenue, et aucune secousse ne venait perturber le doux glissement du véhicule sur l’asphalte. De temps en temps, de grands panneaux indiquaient la direction de Bagdad. Chaque fois que le nom de cette illustre cité apparaissait, son cœur faisait un bond dans sa poitrine. Elle peinait toujours à croire qu’elle allait réellement marcher sur les traces de Haroun al-Rachid et de Shéhérazade, voire de ses propres yeux les lieux qu’elle avait imaginés maintes fois d’après les descriptions dans les nombreux ouvrages. Elle essaya de s’assoupir, mais l’excitation était trop forte pour fermer les yeux. Elle se laissa alors porter par le rêve du Merbed qui lui permettrait de rencontrer des personnalités du monde arabe capables de jongler avec le verbe et d’emporter les simples mortels dans un univers de rêve à travers leurs écrits.
Le klaxon de l’autocar réveilla Lydia en sursaut. La fatigue l’avait finalement rattrapée et elle s’était assoupie brièvement. Ils venaient d’arriver dans une petite ville qui semblait être bien modeste pour être Bagdad.
Lydia cessa de déranger le chauffeur, qui les avait ignorés tout au long du voyage. Elle sortit un peigne et un tube de rouge à lèvres de son sac pour réajuster sa coiffure et se donner une apparence plus humaine. Elle ne voulait surtout pas ressembler à un zombie en arrivant à l’hôtel.
Les premières maisons de Bagdad étaient plutôt tristes, avec leurs couleurs ternes et leurs toits qui avaient perdu leur éclat d’origine. Les rues étaient poussiéreuses et avaient bien besoin d’un bon nettoyage. Cependant, tout comme entre Bagdad et Amman, les routes, elles, étaient toutes bien entretenues. Les feux de circulation fonctionnaient parfaitement et semblaient être respectés. Toutefois, l’autocar freinait fréquemment pour laisser passer d’autres véhicules ou des piétons qui traversaient à leur guise. À travers la vitre à sa droite, Lydia observait les Bagdadis pour se faire une première idée de ce peuple qui avait inspiré tant d’histoires au fil des siècles.
Sa première remarque fut la présence d’enfants, beaucoup d’enfants, dans les rues à cette heure de la journée. Des enfants de tout âge, dont beaucoup avaient l’air de venir de milieux plus que modestes, à en juger par leurs vêtements usés et leurs vieilles chaussures, parfois déchirées ou même sans chaussures du tout. Presque tous les hommes avaient une moustache, souvent épaisse, et beaucoup portaient également une barbe. Leurs vêtements variaient, allant du costume-cravate porté par certains, au jean et baskets, ou encore la dichdacha, une longue robe portée par les hommes. Tous arboraient la même peau bronzée que Lydia avait déjà remarquée chez les serveurs de l’aire de repos. Les femmes, pour la plupart, étaient enveloppées d’une sorte de drap noir qui les couvrait de la tête aux pieds et traînait derrière elles. Certaines, plus jeunes portaient des jupes longues et des pulls ou des vestes, mais toutes avaient un foulard sur la tête et aucune ne portait de pantalon.
À chaque arrêt de l’autocar, des enfants et des femmes s’empressaient autour en tendant la main aux passagers. Le chauffeur leur criait dessus pour les faire partir, mais ils ne semblaient pas très intimidés, continuant à tendre la main et à parler tous ensemble jusqu’à ce que l’autocar redémarre. Cette scène choqua profondément Lydia. Elle avait entendu parler du déclin économique de l’Irak depuis le début du conflit irako-américain, mais elle n’avait pas vraiment mesuré l’ampleur de la pauvreté qui régnait. Son cœur se serrait chaque fois que son regard croisait celui de ces enfants, qui auraient dû être à l’école plutôt que de mendier dans les rues poussiéreuses. Le trajet de l’entrée de Bagdad jusqu’à l’hôtel où ils allaient séjourner dura un peu plus d’une heure.
L’hôtel Mansour-Milia ressemblait à tous les hôtels cinq étoiles, avec sa structure imposante en forme rectangulaire de plusieurs étages et ses fenêtres, dont certaines avec balcons, ornaient la façade avant et arrière du bâtiment. Le tout, niché dans un superbe jardin dont une muraille protégeait toute la superficie. Le portail central en style artisanal et si distingué, formé d’une grande porte en mosaïque et deux portillons en fer forgé, rappelant immédiatement les récits des Mille et Une Nuits, ouvrait le passage à un jardin somptueux à l’avant de l’hôtel. Le véhicule s’engagea dans l’allée centrale, où des arbres majestueux se dressaient des deux côtés du passage. Une fontaine circulaire se dressait au milieu avec ses jets d’eau cristalline qui diffusaient une fraîcheur bienvenue malgré la chaleur de ce mois de novembre. La verdure des pelouses et des arbres contrastait avec les massifs de fleurs colorées. Ce jardin était en contraste total avec l’apparence désertique de la ville à l’extérieur de l’hôtel. Enfin, le véhicule s’arrêta sous un auvent en marbre devant lequel s’élevait un grand escalier menant à l’entrée principale de l’hôtel. Plusieurs porteurs s’empressèrent de s’occuper des bagages, tandis que le groupe d’Algériens descendait lentement. Lydia vérifia une dernière fois qu’elle n’avait rien oublié sur son siège, avant de descendre à son tour, remerciant les quatre hommes qui les avaient accompagnés depuis Amman jusqu’à Bagdad.
Elle monta les grands escaliers en suivant les autres participants. Fouzia, familière des lieux, devançait tout le monde. À l’intérieur de l’hôtel, à gauche de la grande porte vitrée, qui devait faire plus de quatre mètres de haut, se trouvait le comptoir de réception en demi-cercle. Trois jeunes femmes et deux jeunes hommes se tenaient derrière le comptoir arborant un grand sourire chaleureux en souhaitant la bienvenue aux arrivants. Une autre grande photo du chef de l’État, en costume-cravate, ornait le mur face à l’entrée. Il devait s’agir de la photo officielle que l’on retrouvait probablement partout, des bureaux aux écoles, voire, même dans les maisons. Un deuxième niveau était relié à la réception par un petit escalier de quelques marches, conduisant directement au hall. Un homme d’une quarantaine d’années, de taille moyenne, moustachu, mais soigneusement rasé, vêtu d’un costume bleu nuit et d’une cravate rouge sur une chemise blanche impeccable, accourut depuis le hall pour les accueillir.
Rapidement, les clés des chambres furent remises et tout le groupe se dirigea vers les ascenseurs situés au bout du hall, au deuxième niveau. La chambre de Lydia était la 104. Les chambres 103 et 105 étaient attribuées respectivement à Djamila et Fouzia. La pièce était spacieuse et propre, avec un grand balcon offrant une vue sur une double piscine et les jardins arrière, qui semblaient encore plus enchanteurs que ceux de devant. Toutefois, la vue la plus magnifique était celle du majestueux Tigre, que Lydia voyait pour la première fois. Le fleuve, bien plus large que ce qu’avait imaginé la jeune femme, avait une eau couleur sombre. Des barques voguaient sur ses eaux. Lydia pouvait également admirer les différents ponts reliant les deux rives du fleuve, ainsi qu’une grande partie de la ville. Enfin, Bagdad, avec toutes ses promesses et ses surprises agréables et désagréables à venir, s’étendait devant les yeux admiratifs de la jeune femme.
Lydia se prépara pour la soirée en prenant un long bain chaud dans la spacieuse baignoire de sa salle de bain. Elle s’allongea ensuite sur le lit et ferma ses yeux pour se reposer juste pour quelques minutes et sombra dans un sommeil profond. Lorsqu’elle se réveilla, il était huit heures trente du soir, ce qui signifiait qu’elle avait dormi d’une traite pendant six heures. La fatigue avait finalement eu raison d’elle. En se regardant dans le miroir, elle réalisa à quel point ce repos lui avait fait du bien. Elle avait retrouvé des couleurs et son teint semblait plus frais. Mais elle mourrait de faim. Ouvrant sa valise qu’elle n’avait pas encore défaite, elle opta pour un pantalon noir, une chemise bleu ciel et jeta négligemment une petite veste en coton bleu foncé sur ses épaules. Après un maquillage léger, un coup de brosse dans ses cheveux courts, des escarpins légers aux pieds, elle descendit au rez-de-chaussée. Face aux ascenseurs, elle remarqua une sculpture représentant le buste d’un homme portant un turban et une moustache. D’après l’apparence, cet homme devait être l’un des fondateurs du pays. Lydia lut sur la stèle le nom d’Abou Jaafar El-Mansour, l’un des califes abbassides ayant gouverné de 754 à 775. D’après l’inscription, il était le fondateur de Bagdad et en avait fait la capitale de l’empire abbasside. Cela expliquait le nom de l’hôtel et la présence de sa statue.
Se sentant un peu perdue, Lydia cherchait des visages familiers. Alaa la remarqua et se dirigea vers elle.
Plutôt que de se diriger vers le restaurant, Alaa la précéda vers une longue table recouverte d’une nappe blanche, située au bout du hall, où l’on pouvait lire en Arabe : « Bureau des invités du Merbed ». Alaa ouvrit un tiroir et en sortit deux carnets de tickets qu’il remit à Lydia.





























