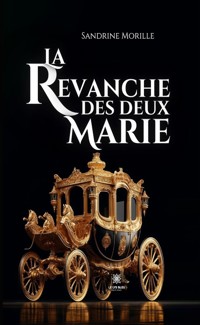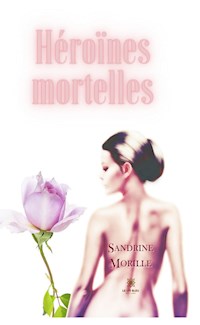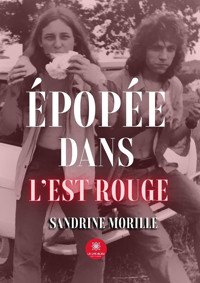
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Installé en France depuis son enfance, Tom est un jeune homme déterminé et courageux. Très tôt, il développe un attachement pour la Pologne, pays d’origine de ses grands-parents qui l’ont élevé. Il n’a alors qu’une seule envie, celle de renouer avec ses racines et retrouver son géniteur qui l’a abandonné tout petit. Avec son ami Wil, il se lance dans cette aventure surprenante où espionnage, crime et romance se côtoient dans un cocktail saisissant.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Enseignante d’histoire,
Sandrine Morille débute sa carrière artistique en signant deux ouvrages d’histoire sur la ville de Nogent-le-Roi en Eure-et-Loir, et plus tard un recueil de poèmes. Elle est également l'auteure de
J'ai couru après la mer, j'ai couru après l'amour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandrine Morille
Épopée dans l’Est rouge
Roman
© Lys Bleu Éditions – Sandrine Morille
ISBN : 979-10-377-8690-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre 1
Premier voyage 1968
Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout.
Philippe Pollet-Villard
— Lequel a couché avec ma femme, je veux savoir ?
On n’avait quasiment pas dormi de la nuit. Trop bu, trop fumé, esprit hors service, quand ce policier a fait irruption dans la cuisine. Il est entré comme ça, sans frapper, fusil à l’épaule. Je n’ai jamais eu autant la trouille que ce matin-là et mon copain Wilfried n’en menait pas large non plus. Heureusement que je parlais polonais et que je comprenais ce qu’il racontait.
— Qu’est-ce qu’il dit Tom ? Qu’est-ce qu’il nous veut ?
— Wil, t’as couché avec qui cette nuit ?
— Aïe, tu crois que ce sont les chaussons de sa femme que j’ai aux pieds ?
En baissant la tête, j’ai pu admirer les jolies petites mules roses à pompon qu’il portait. C’était étrange. Un type baraqué et armé nous menaçait et j’avais une incontrôlable envie de rire. Il nous regardait droit dans les yeux. Puis tout à coup, il a fait demi-tour et a quitté la pièce sans explication, comme ça. Quelle scène hallucinante ! Une histoire parmi tant d’autres que j’aurais à raconter plus tard à mes petits-enfants… Wilfried et moi avions déjà traversé tant de choses tous les deux… On étudiait ensemble à l’école Estienne où l’on préparait un bac technique spécialité imprimerie. Et l’on ne faisait pas que travailler ! Fumer en douce dans les toilettes, faire des blagues aux profs, copier sur le devoir de l’autre, organiser des rencards merdiques, ça nous connaissait. On avait tout juste dix-huit ans. Le week-end, on prenait la voiture du père de Wilfried et on filait loin, parfois jusqu’aux Pays-Bas, voir des concerts et faire le plein de drogues illégales. Nous étions totalement inconscients. L’idée que l’on pouvait se faire arrêter ne nous traversait même pas l’esprit. On se faisait sans arrêt des blagues potaches et on en rigolait pendant des jours. Une fois, Wil s’est endormi lors d’un concert. Il devait être genre une ou deux heures du matin et on avait cours le lendemain. Lorsque le groupe a remballé, j’ai secoué mon poto :
— Wil, il est 7 heures. Faut te réveiller, le bus part bientôt.
Il s’est levé d’un bond et a filé vers la salle de bain en rentrant. Je l’entendais se préparer. Il n’avait pas pigé que c’était une farce et qu’il lui restait en réalité quelques heures de sommeil devant lui. Je ne le lui ai dit que lorsqu’il est sorti de là tout propre et bien habillé.
Tout le trajet de Paris à Varsovie avait été une succession d’aventures incroyables. L’anecdote des mules à pompons n’en était qu’un exemple. J’avais tellement idéalisé ce voyage vers la patrie de mes grands-parents que j’avais du mal à intégrer la réalité. On était des étrangers ici. Pourtant mon grand-père m’avait prévenu, de même que le cinéaste Ted Robertt dont il était le jardinier.
— Tom, la Pologne ce n’est pas la France. Y’a la dictature là-bas, ce sont des communistes, des fous. Ils peuvent t’arrêter et te torturer pour un rien, même pire.
Ma mère, que j’appelais par son prénom Maréva, ne cessait de me dire que j’avais des idées « ridicules », que je n’étais qu’un « entêté » qui en paierait le prix. Elle me disait cela comme à son habitude, sans même daigner me regarder, comme un rebut de l’humanité. Elle détestait mon meilleur ami et ne le traitait guère mieux. Sans doute aurait-elle été incapable de vous renseigner sur les études que nous suivions, si j’avais une petite amie ou pas… et lorsque je tombais malade, elle m’isolait soigneusement dans la pièce d’à côté de peur que je ne sois contagieux. Autant vous dire qu’elle ne nous a pas demandé de détails sur notre projet de voyage. Lorsque mes grands-parents l’évoquaient devant elle, elle se contentait de hocher la tête en laissant échapper un « pffffff » qui voulait tout dire.
Rien n’y a fait. Malgré les avertissements, on est partis, moi et mon meilleur ami. Nous avions seulement une Ami 6 break et un peu d’argent. On s’en fichait, on dormirait à la belle étoile s’il le fallait. Et puis personne ne le savait, mais moi le communisme ça me plaisait bien. L’idée du partage et de la fraternité entre camarades, l’égalité, la fin de l’exploitation par les patrons… J’écoutais les discours d’Alain Krivine, je lisais Lénine, j’adhérais aux thèses trotskystes. Il fut même un temps où j’allais participer à des manifestations de la Ligue communiste révolutionnaire. Ma famille n’étant pas du tout politisée, le sujet est resté longtemps sous le tapis.
J’étais heureux d’être arrivé jusqu’ici, sur la terre de mes ancêtres. J’avais en ma possession une photo de mon arrière-grand-père de noblesse autrichienne épousant mon arrière-grand-mère, simple servante polonaise. Je ne connaissais rien de leur histoire, mais leur sang coulait dans mes veines et je ressentais beaucoup d’émotion à l’idée de marcher dans leurs pas. Ma mère restait muette sur ce sujet. À chaque fois que je l’interrogeais, elle me renvoyait dans les cordes « Tu es trop jeune pour comprendre », « c’est du passé, inutile de s’étendre là-dessus », « intéresse-toi plutôt à l’histoire de ton pays, la France …». Mais grâce à ma grand-mère Honorine que j’appelais Mémé et à mon pépé, j’avais l’impression de tout connaître de la Pologne. Leur intégration en France avait été particulièrement difficile. Engagés en 1952 chez Ted Robertt, ils n’avaient pas échappé au racisme de l’époque envers leur communauté, ce qui fait qu’ils ne sont jamais vraiment sentis Français. Moi-même j’avais subi quelques humiliations à ce sujet à l’école. Une petite dont j’étais tombé amoureux avait même refusé de sortir avec moi à cause « de mes origines ». Même mes grands-parents paternels, croisés une seule fois en Bretagne, avaient témoigné de leur aversion pour ces « étrangers » et refusaient d’appeler ma mère par son prénom qui faisait trop « hébreu ». Ils l’avaient rebaptisée Ginette, montrant ainsi toute leur condescendance. Mémé n’en tenait rigueur à personne, sa foi lui permettait de surmonter toutes ces bassesses. Elle restait fière de son pays et m’apprenait à cuisiner les plats traditionnels tout en me reprenant sur mon accent maladroit. Le matin, un obwazanek, délicieux bagel polonais, m’attendait près de mon bol de café au lait. Le midi, le bigos s’apparentait à notre choucroute. Le soir, on se contentait souvent d’une soupe, notamment le zurek épicé, le barzc rouge et le choldnik idéal pour se rafraîchir par une chaude journée d’été. Bien sûr, je préférais les desserts : le sernik (pâte à base de fromage frais), des pancakes minces et le makowiec, un rouleau de graines au pavot. Mais j’étais trop jeune alors pour arroser le tout de vodka.
On s’est bien rattrapés sur ce sujet avec Wilfried une fois à l’Est. La zubrowka, avec ses quarante degrés d’alcool, nous a laissé quelques migraines mémorables. Côté nourriture, c’était plus dur. Sur place, le communisme entraînait des pénuries constantes de produits de consommation courante. On s’est retrouvés à faire la queue pendant des heures devant des magasins presque vides pour un peu de viande, de sucre ou de papier toilette. Les étalages croulaient en revanche sous des pots de moutarde et des bouteilles de vinaigre que l’industrie agroalimentaire communiste produisait en quantité faramineuse. La bureaucratie poussée à l’extrême ralentissait encore les approvisionnements et désespérait même les personnes les plus patientes. Ce qui était d’autant plus extraordinaire dans ces circonstances, c’était le sens de l’humour dont faisaient preuve les Polonais et leur tendance à rire d’eux-mêmes et de leur pays.
On avait pourtant décidé de profiter à fond. Comme deux bons touristes, Wilfried et moi sommes allés visiter Varsovie. La ville avait été reconstruite à l’identique après la Seconde Guerre mondiale. On a flâné chaque jour Place du château, Place du marché de la vieille ville et on a arpenté maintes fois la très populaire Avenue royale.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— On dirait du fric… dans des urnes en verre. En pleine rue ?
— Peut-être des faux billets ?
Un vieux monsieur qui passait par là et qui devait comprendre le français s’est arrêté pour éclairer nos lanternes.
— Vous pouvez y mettre de l’argent vous aussi. C’est pour achever la reconstruction de la ville.
— Vous n’avez pas peur des voleurs ? lui dit Wil.
— Ce serait vraiment ignoble de prendre cet argent alors que tout le monde pourra en bénéficier.
Décidément, nous n’étions pas chez nous…
À l’entrée du parc Lazienki, le magnifique monument à la gloire de Chopin était un incontournable. On en oubliait presque la misère qui régnait dans le pays, d’autant plus que les Polonais faisaient preuve d’hospitalité et discutaient avec nous assez facilement. Ils aimaient parler de leur pays, de leurs familles et de leurs rêves. Mais des sentiments douloureux se cachaient derrière les sourires de façade. Ces gens portaient encore en eux les marques de la guerre. À peine en avaient-ils eu fini avec les troupes hitlériennes qu’il avait fallu qu’ils tombent sous un nouveau joug. Un joug violent, sournois, méprisant les hommes et les valeurs auxquelles tout être humain devrait pouvoir aspirer. Où se cachaient la paix, la liberté et la démocratie ? Pourquoi devaient-elles se limiter aux pays à l’ouest du continent ? Pourquoi construire de nouveaux murs et de nouvelles frontières ? Décidément, les hommes n’apprendraient jamais rien. L’Histoire semblait les condamner tous définitivement, alors qu’ils n’avaient rien fait, rien demandé. Le communisme n’était qu’une utopie à laquelle il m’était désormais difficile de croire tant les souffrances qu’il avait engendrées se lisaient sur les visages et dans les regards de ces hommes et de ces femmes que je rencontrais. Quelques indécrottables du régime qui comprenaient vite que nous venions de l’ouest essayaient de nous convaincre du contraire, comme cette dame âgée croisée sur un banc qui regardait admirativement la photo de soldats en uniforme. « Presque tout le monde a un travail ici, de huit heures à seize heures. Les femmes ont le droit de voter, de travailler, de divorcer et d’avorter. Personne ne m’a jamais dit que les hommes étaient meilleurs à l’école. Les salaires sont assez égalitaires, même si le système est corrompu. Certains ouvriers de métiers pénibles sont particulièrement bien payés. L’économie planifiée a un certain avantage, la production se trouve prévue d’avance. Le système D et l’entraide règnent. On a des congés dans des centres de vacances d’entreprise, au camping, ou chez l’habitant à la campagne, dans des petites constructions entourées de nature. Pas de bétonisation à outrance comme chez vous ! Alors, n’allez pas me vanter les mérites de votre capitalisme éhonté qui se fiche comme d’une guigne des pauvres gens comme moi ! ».
Quel leurre ! La propagande marchait rudement bien par ici. Nous, il nous était impossible de rêver bien longtemps dans cette ambiance permanente de surveillance et de suspicion. Le lendemain de notre arrivée, on s’est retrouvés convoqués dans les bureaux de la Bezpieka, la police politique du régime communiste. Quelqu’un avait dû parler de notre présence. Il existait tout un tas d’informateurs appelés « collaborateurs secrets…». J’aurais plutôt dit « gros collabos » tout court. Assis dans un bureau étroit où les rapports s’empilaient sur de petites tables, nous avons dû expliquer les raisons de notre présence et certifier que nous n’avions pas d’intentions malveillantes.
— C’est quand même un long chemin depuis la France, vous n’avez pas peur ?
J’étais seul à répondre, car Wilfried ne comprenait pas un traître mot de ce que lui racontait l’officier. Celui-ci, du haut de son mètre quatre-vingt-quinze, le toisait. Mon vieux pote qui faisait trente centimètres de moins était tout blanc. Je craignais qu’il ne finisse par vomir ou pire, par se faire pipi dessus.
— Pourquoi aurions-nous peur ? La Pologne est un pays accueillant et j’y ai encore de la famille. Nous allons d’ailleurs leur rendre visite.
C’était vrai. J’avais tout un tas de cousins et de cousines sur place, mais je n’ai pas jugé utile de préciser que je ne les avais encore jamais vus de ma vie. Ma mère n’avait jamais voulu retourner en Pologne. C’était pourtant le pays de ses parents. Elle semblait avoir honte de leur condition. Honorine n’était qu’une simple cuisinière et mon grand-père, un simple jardinier, même s’ils vivaient dans le magnifique moulin de Ted Robertt. Elle avait également honte de nos racines juives, mais criait haut et fort qu’elle n’était ni antisémite ni raciste. Tu parles ! La première fois que j’ai passé un disque des Beatles à la maison, j’avais alors quatorze ans, elle m’a balancé un truc du genre « Tu ne peux pas arrêter cette musique de Noirs ! ». Mes grands-parents, eux, restaient fiers de leurs racines. Mon pépé parlait français comme une vache espagnole parce qu’il ne voulait pas renoncer à sa langue maternelle. Chaque dimanche, il mettait ses plus beaux habits comme il avait l’habitude de le faire dans son pays. Sauf qu’il ne se contentait pas d’aller à la messe et passait sa journée au PMU !
Le policier polonais continuait de nous scruter de ses petits yeux sournois. Sa coupe blonde très courte contrastait avec notre longue chevelure brune. Son regard bleu perçant cherchait sans doute quelque secret bien planqué au fond de nos âmes. On sentait qu’il avait envie de nous arrêter, peut-être même de nous torturer. Mais comme il n’avait rien contre nous, nous avons été finalement relâchés au bout de douze heures éprouvantes d’interrogatoire. En ressortant du bureau, Wilfried s’est mis à prendre une grande inspiration. Des larmes brillaient au coin de ses yeux.
— Allez, ça va aller Wil, t’en fais pas. On va pouvoir continuer notre périple tranquillement maintenant. Qu’est-ce que tu aurais envie de faire là tout de suite ?
— Rien ! Par pitié, rien du tout ! J’ai juste besoin de me laver et de dormir au moins vingt-quatre heures.
— OK, tu as raison. On a qu’à se reposer et demain à nous la famille en Pologne !
— Ça va être difficile pour moi, je ne maîtrise pas un mot de polonais je te rappelle.
— On fait comme d’hab’, je te sers d’interprète. Et au pire un mot ultra-utile, essentiel si j’ose dire : tu dis « no » ! Tout simplement. Et ce tout petit mot t’évitera mille et une complications ; ça signifie un peu tout et rien : « ouais », « d’accord », « bof », « tout à fait ! » Etc. ou alors tu fais un « No, dobra ! » (« Eh bien… », « bref ! », « bon, eh bien… ».)
En même temps, je me mettais à la place de mon ami. Passer des semaines dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c’est une sacrée galère. Mais que c’était bon d’être ici. Ma grand-mère m’avait tellement parlé de son pays que j’avais l’impression d’être chez moi. Lorsque l’on préparait les repas tous les deux, je l’écoutais raconter sa vie à Michalowice non loin de Cracovie. Là-bas, il n’y avait pas de routes bitumées, juste des chemins en terre battue. Pour se déplacer, on pouvait prendre le car. On y rencontrait des gens surprenants qui voyageaient avec des paniers remplis de saucisson, de pâté, de vin ou avec des cages à poulets. Elle était la dernière d’une famille de douze enfants, huit filles et quatre garçons dont l’aîné Janek dont elle parlait toujours avec des larmes dans la voix. Il possédait une grosse mobylette dont il se servait pour aller voir les bisons. Un jour, il s’était tué en voulant faire le malin sur sa machine. Elle racontait aussi la maison familiale avec ses quatre pièces et au centre un magnifique poêle en céramique fleuri ainsi qu’une réserve d’eau. L’eau, il fallait aller la chercher au puits, dans la cour. Elle lui manquait cette maison, avec les rires des enfants, les grosses poutres en bois derrière lesquelles on pouvait se cacher, et l’odeur du tabac des champs voisins. Le soir avant de dormir, Janek lui jouait parfois de l’harmonica et elle s’endormait paisiblement en imaginant qu’elle serait heureuse toute sa vie. Jamais elle n’aurait pensé devoir quitter la Pologne pour la France. Et puis il y avait eu la guerre et la traque des juifs… Je savais à ce moment-là qu’il était inutile de lui en demander davantage. Trop de souvenirs se bousculaient dans sa tête, elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Je me dressais alors sur la pointe des pieds pour poser un gros baiser sur sa joue et un sourire renaissait sur ses lèvres.
Mes grands-parents m’avaient donné l’adresse d’une cousine, Sasha. Je n’ai pas dormi de la nuit à l’idée de rencontrer un membre de ma famille. Je traînais comme un boulet dans le cœur l’absence de mon père qui nous avait abandonnés trop tôt ma mère et moi. Rien ne pourrait remplacer ce manque, mais j’avais besoin de sentir un peu d’amour filial. La présence de Wilfried me rassurait, car je ne savais pas comment cette femme qui ne m’avait jamais vu allait m’accueillir. Finalement, tout s’est passé dans la plus grande simplicité. Je n’aurais jamais dû flipper autant.
— Un cousin ? De France ? Mais oui, tu es Tom, le fils de Maréva ! Quel bonheur de te rencontrer !
Et là, contre toute attente, elle m’a embrassé sur la bouche. Je n’ai su que plus tard qu’il s’agissait d’une coutume dans les pays de l’Est et en Russie. Sur le coup, ça fait quand même bizarre.
— Tu vas rester dormir ici avec ton ami. Vous êtes les bienvenus. Je vais te présenter mon mari et mes enfants.
— Je ne savais pas que j’avais des petits cousins.
— Ah pour sûr, on ne raconte pas grand-chose dans cette famille, ce sont des cachottiers. Si si, j’ai un grand garçon et une fille.
Tous les quatre vivaient difficilement dans un appartement deux pièces. Ma cousine, Sasha, petite brune d’une quarantaine d’années, m’a raconté par la suite comment son père, mon oncle, avait tout perdu durant la Seconde Guerre mondiale. Leur maison familiale, située dans le quartier de Mokotow, avait été totalement détruite par les Allemands. Ils peinaient à joindre les deux bouts. Sasha était institutrice et son mari travaillait dans une aciérie. Les épreuves de la vie se lisaient sur leurs visages déjà très marqués pour leur âge. Si l’on pouvait dire que Sasha était encore jolie avec son carré châtain et ses yeux verts pailletés de bleu, son mari Vladimir paraissait beaucoup plus vieux, plus taciturne aussi. Des cheveux grisonnants, des lunettes sales, on se demandait ce qu’elle pouvait bien lui trouver.
Wilfried se balançait sur ses deux jambes. Il se sentait gêné, peut-être à titre d’étranger ou bien parce qu’il se rendait compte de la misère dans laquelle vivaient Sasha et les siens, lui qui évoluait dans un milieu plus que confortable. Il ouvrit la bouche pour la première fois depuis notre arrivée.
— On ne veut pas vous déranger, vous savez. On peut trouver une auberge, ou dormir à la belle étoile, on en a l’habitude.
Je servais de traducteur malicieux…
— Mais ça ne va pas non ? lui répondit Sasha d’un air fâché. Déjà, vous allez commencer par manger un bon repas parce que vous êtes maigres comme des coucous tous les deux. Et puis je sortirai les paillasses qui sont au grenier avec de grosses couvertures. Vraiment, ce serait offensant pour nous que vous refusiez. Nous sommes ravis de vous accueillir. En plus, les nuits sont archi froides ici, vous ne survivriez pas dehors. Je ne parle même pas des ours ou des bisons.
En prononçant ces dernières paroles, ma cousine me fit un clin d’œil. Elle avait visiblement fait mouche, car Wilfried semblait pétrifié de peur.
— Mais vous n’avez pas de place, on sera de trop…
— Quelle bêtise ! On vous installera par terre près du poêle. C’est sûr que ce ne sera pas du grand luxe, mais vous serez au chaud et à l’abri des bêtes sauvages.
Elle se mit à rire aux éclats, heureuse de sa taquinerie à l’égard de mon brave copain.
— Alors ça marche, on va chercher nos sacs dans la voiture !
Wilfried était blanc comme un linge. Il avait toujours été du genre trouillard et cela lui valait bien des moqueries.
— Dis Tom, tu crois qu’il y a réellement des ours dans le coin ?
— Elle te faisait marcher Wil ! Enfin bon fais gaffe quand même, on ne sait jamais !
Le soir venu, après le dîner, alors qu’il faisait nuit noire et que seul le poêle allumé apportait un peu de lumière, ma cousine sortit de vieilles photos d’une boîte en carton jaunie. Ses enfants, Mani et Hanna les découvraient également pour la première fois. Les deux adolescents, d’une incroyable politesse, fruit d’une éducation « à la baguette », semblaient très émus.
— C’est toi là Tom ? me dit Hanna. Tu étais beau, tu l’es toujours…
Elle rougit alors jusqu’aux oreilles, ce qui ne manqua pas d’amuser tout le monde, en particulier son grand frère qui se moquait d’elle ouvertement.
— Oui, c’est vrai que j’étais plutôt mignon étant bébé. Ça fait bizarre de me voir dans les bras de ma tante que je n’ai pas connue. Tu sais Hanna, j’étais aussi sage que toi étant petit. J’ai même été enfant de chœur. J’ai adoré cette période, tout particulièrement les enterrements. Je sais que ce n’est pas drôle, mais, ces jours-là, le curé nous apportait des pains au chocolat pour nous réconforter. Quel sacré curé ! Un grand bonhomme qui se tenait toujours tout droit. Il était dingue d’opérettes. Il nous emmenait même à Paris voir des spectacles de Luis Mariano.
— Regarde Tom ! me dit Sasha, c’est toi avec ton père là ? Il n’était pas mal non plus.
La toute petite photo en noir et blanc montrait un nourrisson dans les bras d’un géant légèrement barbu. Un léger sourire en coin, une jolie fossette, une chevelure épaisse. Quel choc de le voir !
— Oui, je sais, un bourreau des cœurs. Il a trompé ma mère bien des fois avant de nous abandonner et je dois bien avoir plusieurs dizaines de demi-frères et sœurs maintenant. Je ne sais même pas s’il est toujours vivant.
— Il n’est pas mort. Il est revenu plusieurs fois en Pologne, toujours accompagné de la même femme brune, très belle, à l’allure très posée, une Tchèque. Je crois qu’il vit toujours là-bas du côté de Prague.
J’essayais de ne rien faire paraître des émotions qui me traversaient, mais cela bouillait fort en moi. Il était vivant, il avait une autre femme et il ne m’avait jamais donné le moindre signe de vie depuis l’âge de mes cinq ans. La dernière fois que je l’avais vu, c’était au restaurant avec ma mère. Je jouais avec un dinosaure en plastique qu’il m’a pris des mains et qu’il a jeté par la fenêtre en me disant que j’étais trop grand « pour ces conneries là ». Je ne me souviens pas qu’il m’ait jamais pris sur ses genoux ni même qu’il m’ait embrassé. Son air froid me dissuadait de l’appeler papa. Depuis, ma mère évitait soigneusement de parler de lui. Je crois qu’elle me détestait parce que je lui rappelais trop celui qui lui avait brisé le cœur. Je n’osais pas aborder le sujet. Cela avait développé en moi un sentiment d’anxiété et d’insécurité profonde. J’en aurais eu des questions à lui poser. J’ignorais surtout la raison pour laquelle il était parti. Était-il vraiment un coureur de jupons comme l’affirmait maman ? Sasha avait parlé d’une seule compagne.
J’ai eu bien du mal à trouver le sommeil après cela. Mon père vivant… Où était-il à cette heure ? Pensait-il parfois à moi ? Je vais paraître pour un taré en disant cela ou pour un gamin qui n’aurait pas grandi, mais j’ai toujours pensé que mon père était un agent secret infiltré à l’est. C’est ce que racontait l’un de mes oncles lorsque j’étais petit, mais j’ignorais si c’était sous l’effet de l’alcool ou non. Je l’imaginais tuer des adversaires de sang-froid, mettre sur écoute des gens hauts placés, effectuant des missions palpitantes l’amenant à quitter sa famille.
— Ce n’est pas impossible et ça expliquerait pas mal de choses, non ?
— D’une certaine façon, oui, mais ton histoire est un peu trop énorme pour être crédible, me dit Wilfried en finissant son bol de mauvais café coupé à la chicorée. Pouahhh c’est une purge ce truc !
— Oui enfin bon, c’est noir et c’est chaud, on ne va pas se plaindre…
Une fois le petit-déjeuner avalé et après avoir remercié vivement Sasha et les enfants pour leur accueil, nous sommes remontés à bord de notre bonne vieille Ami 6. Hanna courut derrière la voiture jusqu’à ce que nous ne soyons plus dans son champ de vision. Une voiture sacrément costaude avec laquelle nous comptions bien traverser toute l’Europe.
— En même temps me dit Wil, ce serait top que ton père sévisse dans l’espionnage. Tu l’imagines à bord d’un bolide de sport évitant les ennemis qui lui tirent dessus, et toutes les nanas ramassées à la pelle. Bond, James Bond !
— Et les séances de torture pour ceux qui se font chopper, les disparitions inquiétantes, le goulag et j’en passe. Si ça se trouve, à l’heure où l’on se parle, il est emprisonné quelque part à ressasser sa vie et à regretter ses mauvaises actions.
— Euh, Tom, ta cousine nous a dit qu’il se promenait avec une belle brune. Je crois bien qu’il se la coule douce ici depuis des années et que tu n’en sauras pas plus.
— Ouais, t’as p’têt raison. Faut que j’arrête de me faire des films sans queue ni tête.
— Voilà qui est bien dit. On est quand même en vacances, alors arrête de gamberger et profite !
— Dis Wil, je sais qu’on est ici pour passer du bon temps, mais si nous allions visiter Auschwitz en hommage à ton père ? Aussitôt, les yeux de mon copain se sont mis à briller.
— Oui, balbutia-t-il, bonne idée.
Nous sommes d’abord passés par la ville de Tarnow. Là, le Mikvah, un grand bain, était un endroit prisé des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, le quatorze juin quarante, les nazis y avaient enfermé sept cent cinquante-trois prisonniers de la prison locale. Ils ont ensuite été conduits au camp d’Auschwitz. Ils furent les premiers prisonniers à entrer dans le camp. À leur arrivée dans le camp, ils furent tatoués du numéro trente et un à sept cent cinquante-huit. Les numéros un à trente étaient attribués à des prisonniers allemands.
Gégé, le père de Wilfried y avait été déporté et était resté pendant deux ans dans le terrible camp de la mort. Avant notre départ, il avait demandé à Wil de lui rapporter un peu de terre de là-bas. Lui-même n’avait pas le courage de retourner sur les lieux. Mais contrairement à d’autres survivants, il en parlait souvent : son pyjama rayé, les maladies à vous vider les intestins, les restrictions de nourriture, les aboiements des gardes, les insultes et les coups, et surtout ces fumées noires qui sortaient des crématoires. Avec son petit gabarit, il réussissait souvent à échapper aux regards noirs et aux brimades des SS qui les surveillaient. Il se souvenait du bruit des bottes et des longues silhouettes noires guettant sur les miradors ; il y avait aussi les barbelés tout autour comme pour empêcher les animaux de s’enfuir. Parfois, il sortait des blagues sordides sur les Juifs. On ne savait pas trop si l’on devait en rire, mais manifestement, cela l’aidait à exorciser ses vieux démons.
Lorsque vous passez sous le portail avec l’inscription « le travail rend libre », vous prenez le poids des millions de morts de la Shoah sur les épaules. Personne ne peut rester indifférent, c’est impossible. On peut ressentir à quel point l’homme est capable de tout, en l’occurrence ici du pire. Des tas de chaussures, de cheveux, des montagnes de casseroles et de valises, tout était hallucinant ! Quelle émotion indescriptible de marcher dans ces pièces en imaginant le quotidien des êtres innocents qui étaient amenés sciemment à la mort ! On pouvait imaginer l’orchestre des plus grands virtuoses déportés jouant pour les SS qui rentraient du boulot le soir. On atteignait le paroxysme de l’horreur dans les chambres à gaz dont les plafonds de ciments étaient déchiquetés par les griffures des ongles de victimes qui avaient dû souffrir le martyre avant de rendre leur dernier souffle, entassées les unes sur les autres. J’avais du mal à concevoir cette barbarie, tout cela dépassait l’entendement. Et que dire de ceux qui retiraient les corps de ces salles pour les emmener ensuite dans les fours crématoires afin de faire de la place pour les corps suivants ? Comment des êtres humains avaient-ils pu en venir à organiser une horreur pareille ? Wilfried était resté silencieux depuis le début de ce pèlerinage. Il pensait certainement à son père et à tout ce que celui-ci avait dû endurer pendant toutes ces années de déportation. Il lui avait sûrement caché les moments les plus terribles. C’est étrange de dire cela maintenant, mais j’enviais mon ami et cette relation étroite qu’il entretenait avec Gégé. Celui-ci n’avait pas toujours été très cool, il posait même souvent des limites qui nous faisaient pester contre lui. Mais l’on sentait tellement de tendresse entre eux ainsi qu’une sorte d’admiration respective. Il pouvait y avoir entre eux des conflits de générations, mais ils se réconciliaient toujours très vite. Moi, dès lors qu’il s’agissait de parler de mon père, un sourire forcé s’esquissait sur mon visage, le silence s’installait, mes épaules s’affaissaient et je me mettais à bafouiller un « Je ne sais pas, mon père était… c’était mon père, voilà. Je ne sais pas qui il est, c’est tout ».
En tous cas, ni Wil ni moi ne sortirions indemnes de ce périple. On avait décidé de rester encore deux jours dans le pays. L’argent commençait à manquer. On avait quand même réussi à remplir le coffre de vodka et de cadeaux en vrai cristal pour la famille. Le temps devenait de plus en plus froid. Le mois de novembre se terminait et le thermomètre affichait moins dix degrés depuis quelques matins. Nous avions néanmoins envie de rester un peu, ne serait-ce que pour visiter Cracovie et la mine de sel de Wieliczka dont mes grands-parents m’avaient tant parlé. Ce fut un autre choc, un émerveillement, devrais-je plutôt dire ! De quoi oublier l’air glacial qui nous collait la goutte au nez. La visite débutait par des galeries sans fin soutenues par de très longs rondins de bois. On se serait cru dans un labyrinthe. Par moments nous apparaissaient d’incroyables chapelles ornées de sculptures. La plus impressionnante restait sans conteste la chapelle Sainte-Cunégonde : cinquante-quatre mètres de longueur avec des décorations uniquement à base de sel. C’étaient les conditions de travail très dangereuses des mineurs qui exacerbaient leur sentiment religieux. Ils célébraient sous terre des messes quotidiennes sur les autels qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués de leurs mains. J’essayais d’imaginer ces gens pétris de foi et d’espoir malgré les douleurs, mais aussi l’esprit de camaraderie qui devait se développer par la force des choses.
Et c’est là que je l’ai vu pour la première fois. Elle portait une belle robe noire jusqu’à mi-mollet avec un grand col Claudine blanc joliment brodé. On aurait dit une poupée avec sa taille marquée, ses grands yeux bleus, ses longs cheveux blonds ondulés et ses joues rosies par le froid. Quand son regard a croisé le mien, j’ai failli m’effondrer. Jamais la vision d’une femme ne m’avait fait un tel effet. Elle m’a souri, elle s’est retournée et puis tout est devenu noir.
— Tom, réveille-toi, mais qu’est-ce qu’il t’arrive bon sang ?
— Où est-elle passée ?
— Qui ?
— La jeune femme blonde à la robe noire qui tournoyait sur elle-même. On aurait dit un soleil.
— Bah le soleil, il t’a tapé sur le crâne mon gars. Allez, debout. Tu vas réussir à te relever tout seul ?
— Oui oui, ne t’inquiète pas. Elle est partie… Je ne la reverrai plus jamais. Ma fée !
— Oh la la, il est grand temps que l’on remonte à la surface et que tu prennes l’air !
En sortant de la mine aidé de Wil et de deux autres hommes bien costauds, je l’ai cherchée partout, mais il n’y avait plus rien à espérer.