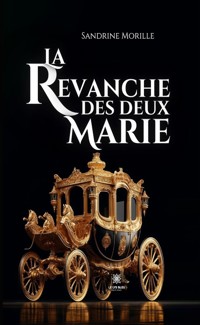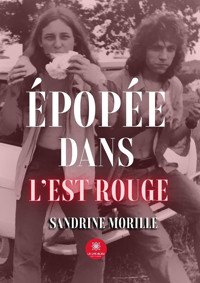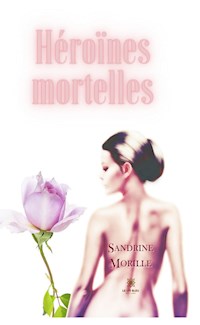Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Fred, un jeune homme rêveur et décalé, choisit de se lancer dans la Marine nationale pour fuir une famille qu’il ne supporte plus. Il s’y intègre parfaitement et peut enfin vivre des aventures dignes des héros des livres qu’il dévore mais une rencontre amoureuse l'amène à changer de vie et à quitter l'océan, décision qui l'entraînera dans une descente en enfer
. J’ai couru après la mer, j’ai couru après l’amour nous invite, à travers les aventures ordinaires et extraordinaires de son héros, à une réflexion sur le sens de la vie et l'importance de ne pas passer à côté à force de toujours espérer mieux.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Pour
Sandrine Morille, l’écriture de
J’ai couru après la mer, j’ai couru après l’amour est liée à son arrivée en Normandie. Elle tombe amoureuse de la Manche, pleine d’espoir devant les nouveaux horizons qu’elle offre à chacun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandrine Morille
J’ai couru après la mer,
j’ai couru après l’amour
Roman
© Lys Bleu Éditions – Sandrine Morille
ISBN : 979-10-377-5306-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Très tôt, j’ai compris que ma mère ne m’avait pas désiré. Pourtant, lorsqu’aujourd’hui je me retourne sur mon passé, je suis fier de tout ce que j’ai accompli. Maupassant disait avec raison « La vie, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit ». J’ai connu des envies de grands larges, des couchers de soleil dans l’Océan Indien, des amitiés éternelles et aussi pas mal de déboires sentimentaux. J’ai idéalisé les histoires de pirates, j’ai aimé la mer comme une femme dont on ne peut jamais connaître toutes les profondeurs. Je l’ai quittée à grands regrets pour d’autres contrées moins glorieuses. À certains moments, je me suis perdu dans les ivresses de l’amour, inconscient du mal que je pouvais faire autour de moi. Je remplissais ma vie en multipliant les aventures et tout ça pourquoi ? Peut-être juste pour la retrouver, Elle…
Chapitre 1
La mer, mon amour
Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et les marins.
Le philosophe Aristote
Je ne suis pourtant pas né sur le littoral. J’ai passé toute mon enfance à Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loir, dans une vieille maison de la rue des Petits Souliers, une longère avec un grand terrain où l’on cueillait des tas de mirabelles l’été. Entouré de bons copains, mon côté casse-cou m’a valu de nombreux tours chez le médecin. On me surnommait déjà Frédo à l’époque, j’étais un bon p’tit gars toujours souriant. Bonhommes de neige l’hiver, parades costumées sur les chars lors de la fête de la Saint Sulpice, vacances sur l’île de Ré. On y grimpait en courant les 1854 marches du phare des Baleines et l’on gambadait dans la forêt de Trousse chemise. La légende raconte que les femmes de l’île de Ré allaient sur la plage lorsque passait un navire et qu’elles troussaient leur chemise pour dévoiler leur anatomie ; les marins déroutaient leurs embarcations et venaient se fracasser sur les rochers. Il ne restait plus ensuite aux dames qu’à piller les bateaux. Qu’est-ce que j’aimais écouter ce genre d’histoires…
« T’es qu’un rêveur Frédéric, me répétait ma mère. Tu ferais bien d’avoir un peu plus les pieds sur terre, sinon la vie ne te fera pas de cadeau ».
Et mon père de lui répondre :
« Qu’est-ce qu’il est con ce gosse ! Je me demande bien ce qu’on va en faire ».
J’esquissais alors un petit sourire mais leurs remarques constantes creusaient des cicatrices profondes. Je ne comprenais pas d’où venait leur aversion à mon égard. Surtout que j’étais apprécié par tout le monde en dehors de mes deux géniteurs. J’étais le chouchou des maîtresses d’école, le curé me donnait des bonbons en douce au catéchisme, les vieux de Nogent m’appelaient affectueusement « Mon petit » et saluaient ma politesse à leur égard. Les enfants de mon âge ne m’ont jamais harcelé, aucun souci avec qui que ce soit, même à l’adolescence. En grandissant vint l’époque des boums, des slows, la découverte des filles, le premier baiser, la première fois. Quel souvenir ! Sur le capot d’une Simca 1000 couleur Bordeaux, deux minutes chrono montre en main, je ne suis pas certain que ma jeune partenaire ait eu le temps de sentir quoi que ce soit. Moi, j’étais fier comme un paon d’avoir assuré.
À l’époque, on savait se serrer les coudes et affronter les tempêtes, on partageait nos rêves de conquête du monde. Certains amis sont devenus des frères de cœur et j’ai tissé avec eux des liens bien plus forts qu’avec les membres de ma propre famille. Il faut dire que l’ambiance à la maison n’était pas très bonne. Mon père rentrait fatigué de longues journées à l’usine, ma mère se plaignait de ses « mioches » qui l’exténuaient, mon frère était un vaurien voleur et menteur. J’ai longtemps détesté ma sœur, j’en étais jaloux. Il est vrai que Camille était jolie, coquette et très calme. Il suffisait qu’elle porte sur mon père un regard enjôleur pour qu’il fonde instantanément. Mes parents s’inquiétaient sans cesse pour « la pauvre petite », qui en fait se portait à merveille, totalement indifférente au reste de l’univers. « Ta sœur, la pauvre, sois un peu plus gentil avec elle ! Porte-lui son cartable, débarrasse son assiette, aide-la à passer l’aspirateur dans sa chambre »… Ils se souciaient de ses résultats scolaires et l’aidaient même à faire ses devoirs le soir. Moi je restais seul à me battre avec mes tables de multiplication sur un coin de la table du salon. Je lui en voulais à mort et l’on se disputait souvent. Ce n’est que bien plus tard que je me suis rendu compte que c’était le seul membre de la famille pour qui je comptais au moins un peu. Il m’est arrivé de penser qu’elle avait souffert de mon attitude et que j’aurais dû essayer de tisser avec elle quelques liens précieux. Il reste de tout cela comme une mélancolie, un goût amer qui me poursuivra longtemps.
Ils passaient tout leur temps devant le petit écran de télé en noir et blanc, assis statiques, sans autre occupation. Le dimanche matin, on allait tous à la messe en rang d’oignon comme des petits saints que nous n’étions pas. L’important c’était de paraître et de montrer aux autres Nogentais que la famille savait se tenir. On pavoisait dans des costumes ridicules sur le parvis de l’église. Parfois, je me demandais si je n’avais pas été adopté, ou peut-être puni pour avoir été mauvais dans une vie antérieure. J’avais beau essayé de m’évader par la lecture ou par le jeu, je me sentais seul et malheureux coincé entre quatre murs. J’y étouffais, j’y mourrais à petit feu dans l’indifférence générale. Quand je me plaignais de ci ou de ça, je recevais une torgnole « pour m’apprendre ». C’était supposé être de l’éducation… Je ne savais pas comment réagir. Sûrement pas en pleurant, cela leur aurait procuré trop de plaisir. Il devait bien exister un moyen d’échapper à cette maison de fous. Plus je grandissais et plus germait en moi l’idée de me tirer le plus loin possible de ces gens qui au mieux m’ignoraient, au pire me rabaissaient.
Je me suis posé la question de monter à Paris pour m’inscrire aux Beaux Arts, mais mes parents ont refusé de payer mes études. « Trop chères », « pas de débouchés », « t’as aucun talent », « tu vas pas vivre à nos crochets toute ta vie », ils avaient somme toute une confiance en moi assez limitée… Je l’ai très mal vécu. Un père et une mère ne sont-ils pas censés soutenir leurs enfants, surtout à des périodes cruciales de leur existence où leur avenir est en jeu ? Mais bon, il a fallu faire avec.
Alors, après le lycée de mécanique à Dreux, comme ça sur un coup de tête, je suis parti pour Saint-Mandrier près de Toulon rejoindre l’école des mécaniciens de la flotte. Quelques affiches publicitaires pour l’armée avaient suffi à m’interpeller. L’occasion était trop belle, j’allais enfin m’envoler loin de Nogent et surtout très loin de toute cette famille que je méprisais autant qu’ils me détestaient. J’en étais convaincu, ma voie était toute trouvée : m’engager dans la Marine nationale pour faire le tour du monde, dépasser l’horizon, braver tous les dangers et me sentir ENFIN vivant. J’avais 17 ans…
Quand Frédéric est parti, mon cœur de père en a pris un sacré coup. Son départ signifiait qu’il était malheureux avec nous ici à Nogent et que nous n’avions pas su comprendre ses attentes et ses envies pour l’avenir. Avec sa mère, on pensait qu’il ferait comme tout le monde dans la famille, qu’il trouverait du travail dans une entreprise locale et qu’il fonderait une famille avec une petite du coin. Les prétendantes étaient nombreuses autour de lui mais il rêvait de choses inaccessibles, Paris, les arts, le théâtre, des univers totalement étrangers pour nous. On se demandait comment cela lui était passé par la tête. À vrai dire, je n’ai jamais compris cet enfant, à croire qu’il n’était pas de moi ou qu’on l’avait échangé à la maternité. Et puis on n’avait pas l’argent pour tous ces projets qui n’aboutiraient peut-être à rien. Quelle drôle d’idée quand même de rejoindre l’armée, lui qui n’obéissait même pas à sa mère quand elle lui demandait simplement de mettre la table. Oh, il allait certainement souffrir et regretter sa décision. Dans peu de temps, on le reverrait tout penaud frapper à la porte de la maison pour demander pardon et réintégrer le giron familial. Ce n’était sûrement qu’une affaire de quelques semaines…
Waouh ! À Saint-Mandrier, la cour d’honneur s’ouvrait devant moi et j’admirais tous les bâtiments gigantesques entourés d’une végétation méridionale que je ne connaissais pas. Le climat du Sud réchauffait les cœurs, pour la première fois de mon existence le chant des cigales résonnait à mes oreilles. Rien à voir avec l’humidité permanente et les paysages de champs de blé de la Beauce. J’avais hâte de travailler en atelier et de me former vraiment au métier. Vous imaginez ? J’allais devenir matelot ! Et pourtant, en montant pour la première fois sur un bateau militaire, comme pas mal de mes camarades, le mal de mer m’a pris et m’a tenu pendant huit jours. Je ne pouvais plus rien manger, l’estomac en vrac, la tête vide et cette désagréable sensation de bouger tout le temps au rythme des vagues.
« Allez mon gars, te vide pas de toutes tes tripes. T’en auras besoin par la suite ».
« J’crois que j’vais mourir. J’ai plus de force là… bouh ».
Par chance, tout cela n’a été très vite qu’un mauvais souvenir qui n’a en rien terni ma motivation. Les deux années dans le Var ont défilé à toute allure, elles furent riches en enseignements mais j’y ai découvert bien plus que des cours de mécanique. On nous inculquait le goût de l’effort, l’exigence personnelle, l’importance de servir son pays, sans oublier la fameuse chanson des arpètes :
Nos anciens ont tracé la route
Elle mène vers l’aventure
L’apprenti jamais ne doute
De la valeur du mot servir ;
Travaillons, nous servons la France,
Travaillons de tout notre cœur,
Mécanicien, ta récompense,
Elle est déjà dans ta valeur.
Nos chefs nous menaient la vie dure. Je me souviens en particulier d’un ancien officier reconverti en maître d’apprentissage qui nous balançait les outils à la tête et nous traitait sans arrêt de fainéants « Ah les jeunes de maintenant, ça ne sait plus rien faire de ses dix doigts ». Il prenait du plaisir à nous malmener et on le lui rendait bien, en sabotant parfois son travail avec des plaisanteries de gamin, du genre des punaises étalées sur sa chaise, cacher ses bouquins ou ses lunettes… tout cela ne volait pas bien haut mais on en rigolait bien.
C’est à Saint-Mandrier que j’ai fait la connaissance du Loustique ou Loulou. Nous avions le même âge et nos parcours étaient presque similaires. Lui aussi avait choisi de quitter une famille étouffante et de larguer les amarres loin, bien loin de toutes les tracasseries.
« Tu verras mon Frédo, un jour on montera à bord du Clémenceau. Ptêt bien même que t’en seras le pacha et moi ton second. On fendra les flots en donnant des ordres impossibles aux p’tits choufs et on régnera en maîtres sur tous les océans du monde ».
« Tu vas trop au cinéma voir des films toi. On n’aura jamais le bagage pour commander et on s’en fiche. On sera sur un rafiot, la mer et les gonzesses à nos pieds et on profitera à fond de la vie ».
« Moi je regarde ptêt trop de films, mais toi tu vis que pour les nanas mon gars ! »
Des tapes dans le dos bien viriles ponctuaient nos échanges. Après ça, Loulou remettait ses cheveux blonds en place, trop courts pour être bien plaqués, et il fredonnait un tas de refrains populaires qui mettaient tout le monde de bonne humeur. On partageait tous les deux cette envie de bouffer la vie et d’envoyer paître tout ce qui pourrait nous la gâcher.
Puis ce fut passage obligé par les classes à Hourtin en Gironde, au bord du lac. Le premier jour m’a marqué : je me rappelle la grille d’entrée sur laquelle était fixée une discrète pancarte « Site militaire d’Hourtin »… Temps gris, café très fort avalé à la hâte près de la gare de Bordeaux. Mille huit cents apprentis marins se dévisageaient discrètement les uns les autres, tenant fièrement leurs sacs et leurs ordres d’incorporation. Certains avaient dû venir de fort loin et une certaine appréhension se lisait sur les visages. À l’arrivée, passage obligé par le coiffeur… Quel souvenir mémorable ! Accueil chaleureux et un brin ironique du paysagiste qui taillait les tifs : « Alors jeune homme, on vous fait une coupe basse ou semi-basse ? Avec brushing ? » Son sourire narquois était peu engageant… L’absence de miroirs dans ce salon de coiffure m’a quelque peu inquiété. À juste titre ! Dire que la mode était aux cheveux longs même pour les garçons…
Comme les huit appelés de ma section qui m’ont précédé, j’ai eu droit à l’habituelle coupe « bachi » qui consiste à passer la tondeuse position zéro sur tout le crâne pour que plus rien ne dépasse du béret marin. Deux roues de vélo en guise de tour d’oreilles… Trois minutes plus tard et vingt centimètres de cheveux en moins, j’étais méconnaissable ! On nous a donné ensuite l’uniforme réglementaire (vareuse, caban, pantalon à pont mais aussi chaussures, sac marin, valise, cirage, couvert, tasse et gobelet métalliques…), puis photos d’identité. Retour dans les chambrées pour récupérer un savon et une serviette avant la douche collective obligatoire sous le regard sarcastique et les quolibets des sous-officiers d’Hourtin. Les premiers temps n’ont pas été faciles. Les journées étaient bien occupées depuis le branle-bas sonné au clairon vers 6 h jusqu’au dégagé à 17 h 30. On maniait les armes (tir au fusil, pistolet et pistolet-mitrailleur, jet de grenades), enchaînant avec sept ou huit kilomètres de marche le barda sur le dos, puis les tours de gardes, on apprenait aussi les nœuds marins, à présenter et reposer l’arme. J’en ai vu des camarades pleurer d’épuisement.
« Non mais sérieux, ça sert à quoi de se faire humilier ainsi. Trop débile ce service militaire. Apprendre à se battre contre des Russes qu’on ne verra jamais, y sont dingos là-haut ».
Je me foutais pas mal de la guerre froide que se menaient les Américains et les Russes. Je ne me plaignais pas pour ma part, même si c’était exténuant et même si je préférais de loin les joutes à l’aviron et les courses en chaloupe à vous faire péter les rames aux fameux exercices du matin. On se prenait des bosses de rire à chaque fois qu’un gars tombait à l’eau. Je me sentais dans mon élément. Mon côté boute-en-train m’a permis de m’intégrer rapidement. J’ai bien vite retenu les chansons grivoises de la Marine que j’entonnais de bon cœur avant l’extinction des feux à vingt-deux heures trente. J’utilisais l’argot de la Baille à tort et à travers pour montrer que j’en étais : pour être passé en stage dans vos murs et en manœuvre sur vos bâtiments, je n’ai jamais oublié qu’après avoir été « embarqué » en soirée, j’ai dormi un peu, le temps que le « branle bas » me sorte des bras de Morphée. Qu’il m’a fallu ensuite me présenter à la « rampe » avant de passer par les « coursives » pour ranger mon « caisson » ! Tout ça avant d’être convoqué par le « capitaine d’armes » pour ne pas avoir pointé à l’heure à « l’aubette ». Je ressentais ce besoin de me mettre en avant, de m’intégrer, d’avoir une nouvelle famille. Je ne pensais même plus à la mienne restée là-bas à Nogent.
Il manquait des filles le soir, on les imaginait dénudées et on se racontait ce qu’on leur ferait si elles étaient là. L’époque était à la libération sexuelle, aux mini-jupes ras des fesses et aux hauts moulants qui ne laissaient guère de place à l’imagination. Pas de sida, on pouvait multiplier les partenaires sans craindre quoi que ce soit. La pilule nous mettait à l’abri de gosses non désirés, le pied quoi ! J’ai appris beaucoup sur la sexualité, de quoi sans me vanter donner bien du plaisir à mes futures partenaires.
« Je peux vous dire que les blondes sont les plus belles, les rousses les plus chaudes et les brunes les plus venimeuses. Toujours se méfier des brunettes ». J’affirmais cela comme un expert et les autres m’écoutaient bouche bée ou avec un sourire en coin. Certains n’étaient pas dupes et savaient bien que mon expérience était encore limitée.
Mais toute bonne chose a une fin. À la fin des classes, nous avons reçu notre brevet de matelot qualifié et le ruban de la Marine nationale. Je n’étais pas peu fier de porter le bachi avec son pompon rouge.
« Regarde ça Loustique, un porte-bonheur que de jolies damoiselles pourront toucher. On va en ramasser à la pelle, j’te raconte pas. »
Des larmes perlaient au coin des yeux de mon Loulou, trop d’émotion sans doute devant ce cap que l’on franchissait tous les deux.
« T’es con mon Frédo, avec le physique que t’as, si t’en trouves une qui veut de toi, ce sera déjà bien ! » On déconnait mais on n’en menait pas large tous les deux. On venait de franchir une sacrée étape qui allait changer nos vies à tout jamais.
Un mélange de mélancolie et d’exaltation s’empara de moi au moment de quitter Hourtin mais hors de question de le montrer. Je restais impassible à l’extérieur mais ça bouillonnait sec à l’intérieur. Je passais d’apprenti marin à matelot !Avec en prime 12 jours de congés avant d’embarquer sur nos unités respectives. Voir du pays, logé, nourri et habillé gratos, la vie en mer, toujours préparé à virer, le rêve allait devenir réalité…
S’en suivirent cinq années de bons et loyaux services, à sillonner la Mer Rouge, les océans Atlantique et Indien en tant que mécano dans la Royale. Cinq années où se sont liées les amitiés les plus sincères. Le moment aussi où j’ai connu ma première femme, une erreur de jeunesse, un mariage dans la précipitation… et un divorce tout aussi rapide. Pour être honnête, j’ai même enchaîné trois mariages en deux ans. Pour l’une d’elles, je me suis fait tatouer sur le bras droit un bateau avec cette légende : « Assez de naviguer, je m’arrête pour t’aimer ». Ce tatouage en jouxte un deuxième, celui de la fée clochette, en gros sur mon torse. Le troisième n’a aucune signification, un simple souvenir de cette époque de marin fier de l’être. Mais bon, vous comprendrez bientôt toute l’histoire.
Je me souviendrai jusqu’à mon dernier souffle de la première fois où je suis monté à bord de l’EDIC 9094, c’était en 1973, sous le soleil de la rade. Je venais d’arriver dans le port militaire de Lorient où des milliers de personnes travaillaient entre l’arsenal, la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué et l’état-major de la force maritime des fusiliers marins et commandos. Le rafiot lui-même était sacrément impressionnant avec ses cinquante-neuf mètres de long sur plus de onze de large et une vitesse maximale de huit nœuds. Tout cet univers maritime me happait complètement. Je me voyais en Jean Bart, en Duguay-Trouin, en Surcouf, en tous ces autres corsaires dont les histoires avaient bercé ma jeunesse. Pour moi, la ville de Lorient était surtout associée à une légende de la voile, une idole pour tous les marins : Éric Tabarly. Trois de ses Pen Duick avaient été construits aux Chantiers de la Perrière : la goélette Pen Duick III, le trimaran Pen Duick IV et Pen Duick V, un monocoque de 10,70 m. Je restais plutôt admirateur du premier, celui acheté par son père, avec lequel il fit de nombreuses croisières et régates. C’est à bord de ce voilier qu’Éric Tabarly avait disparu en mer lors d’une nuit de juin 1998 au large du Pays de Galles. Une histoire bien mystérieuse, de celle qui me faisait toujours autant fantasmer.
Je transpirais à grosses gouttes sous mon bachi tellement il faisait chaud, plus que dans le sud de la France contrairement aux légendes urbaines qui veulent que le temps soit toujours pourri en Bretagne. On s’est retrouvés embarqués, six officiers mariniers et quinze choufs, dont Loulou, mon potequi avait du mal à ne pas faire le pitre en montant la coupée. Il fredonnait « au gré du vent », la chanson de Lorient dont les paroles trouvaient un certain écho en moi :
J’ai pas le secret du bonheur
Et j’suis pas toujours à la fête
Mais tant que battra bien mon cœur
Je poursuivrai encore la quête
Pour juste un peu de liberté
Pour approcher la vérité
Pour lever mon verre à l’amitié
Au gré du vent je vais
« Mon Frédo c’est parti pour l’aventure ! Accroche-toi, ça va swinguer ». Dans sa belle tenue de chouf, j’aurais bien aimé le voir danser…
Mais il a fallu bien vite retrouver son sérieux. Dès que vous posez le pied à bord d’un bâtiment de la marine, l’étiquette militaire exige de se tourner vers le pavillon qui se trouve à la poupe et d’effectuer le salut militaire pour rendre hommage à la nation pour laquelle on s’est engagé. Une immense fierté m’a envahi à ce moment-là ! Aussitôt, j’ai pris le ferme engagement de ne plus regarder en arrière et de me laisser porter par les flots. Quelle sensation incroyable quand vous sentez pour la première fois le vent souffler et le bateau avancer en silence.Quoi de plus agréable que de se réveiller le matin perdu au milieu des mers.Le premier soir, le premier coucher de soleil resteront à jamais dans ma mémoire. Je m’imaginais enlacer la femme que j’aime, regardant ensemble vers le grand large. Les étoiles scintillant de mille feux descendaient bas sur l’horizon et dessinaient avec la lune un paysage des plus romantiques. On ne pouvait rester indifférent devant un tel spectacle et je voyais mes jeunes coéquipiers tout aussi fascinés que moi par cette vue onirique. Jany surtout semblait ne plus pouvoir détacher son regard du ciel. Celui qui allait devenir mon frère avait des larmes plein les yeux. Pour ma part, je savais encore bien cacher mes émotions à cette époque, mon visage ne laissait transparaître aucune émotion. Sans doute cette fierté de jeune mâle qui pense que virilité rime avec placidité. Cela ne m’empêchait pas d’être au fond un grand sensible, lisant et relisant ces vers de Chateaubriand :
J’aime à créer des mondes enchantés
Baignés des eaux d’une mer inconnue.
L’ardent désir, des obstacles vainqueur,
Trouve, embellit des rives bocagères,
Des lieux de paix, des îles de bonheur,
Où, transporté par les douces chimères,
Je m’abandonne aux songes de mon cœur.
Nul va sans dire que les copains m’ont bien chambré quand ils ont découvert mon penchant pour les belles-lettres en total décalage avec le langage des marins. Jany ne se privait pas…
« Mais il sait lire le Fred, j’y crois pas. Donne un peu ton beau livre qu’on regarde ». Mon bouquin fut lancé de mains en mains, dans un brouhaha de moqueries anodines. Aucune chance de le récupérer malgré mes tentatives !
Fred est un sacré personnage ! Il m’a plu de suite. Je ne parle pas de séduction physique même si c’est un beau gars. Atypique, indépendant, carrément fun. Il aimait répéter « Souris ! Ça emmerde ceux que tu détestes et ça fait du bien à ceux que tu aimes ! » Il parlait beaucoup, semblait à l’aise avec tout le monde. On avait beaucoup de points communs apparemment. On se lançait dans une aventure complètement folle en s’engageant dans la Marine, on ne savait même pas vraiment ce qui nous attendait sur les théâtres d’opérations.Un besoin d’adrénaline nous faisait avancer. On partageait cette capacité à nous extasier pour un rien, à envisager l’avenir avec un grand A, radieux, et aussi ce jardin secret bien caché au fond de nous, mélange de romantisme et d’amertume vis-à-vis du passé. Son sens de l’humour l’aidait à traverser les épreuves et je n’en étais pas dépourvu non plus. Nous le savions tous les deux, cette vie là était faite pour nous !
Le métier de mécanicien naval (on disait plutôt chaffustard entre nous) n’était pas de tout repos. J’assurais la conduite, l’entretien, la maintenance et le dépannage de l’appareil propulsif du navire et des machines auxiliaires. Il fallait quotidiennement vérifier le bon état des installations, et si une avarie survenait, localiser et diagnostiquer la panne. Les conditions de travail n’étaient pas celles d’aujourd’hui, nous n’avions même pas de casque antibruit dans les compartiments machines.Je devais également être prêt à ranger la clé à molette pour endosser la tenue de pompier en lutte contre les incendies, une crainte bien plus présente que le milieu aquatique ne le laisse présager. Et puis quel que soit son rôle à bord, on est avant tout un militaire qui peut être appelé au poste de combat. Mon fusil semi-automatique FSA-MAS m’a servi quelquefois… Le gaucher que je suis ne s’en sortait vraiment pas mal ! Sans compter les tâches diverses qui ponctuent la vie du navire et qui font la cohésion du groupe. Les quarts rythmaient la journée. Le « zérac » entre minuit et quatre heures était sans conteste le plus redouté. Après le branle-bas, l’équipage au complet se réunissait sur la plate-forme et se découvrait pour les couleurs.Notre devise était : « Honneur, patrie, valeur, discipline ». S’ensuivait le « briefing opérations ». Les matelots restaient debout, les officiers étaient assis et l’on écoutait le pacha nous donner les informations de la journée : point météo, position, présence d’autres navires dans la zone, logistique… De temps en temps, quelques répliques un peu plus légères détendaient l’atmosphère :
« Demain soir, ce sera agneau pour tout le monde ! »
« C’est dégoûtant l’agneau, on pourrait pas plutôt avoir des saucisses ? »
Les repas constituaient le moment le plus attendu, regonflant le moral et comblant les frustrations, mais fallait faire gaffe de pas trop prendre de kilos, certains en gagnaient dix pendant une mission. Les ordres étaient ensuite donnés dans le calme et chacun rejoignait son poste. La date du retour, toujours incertaine dans ce genre de mission, était une angoisse dont personne ne parlait et que l’on ne peut imaginer si on ne l’a pas vécue… Alors on essayait de plaisanter et de faire passer le temps lors des moments libres. Qu’est-ce qu’on a pu jouer aux cartes, à la corde, on transformait le radier en piscine… Et l’on regardait les photos de filles à poil dans des magazines qu’on se refilait en douce.
« Les gars à midi on mange quoi ? »
« Mais tu penses qu’à bouffer Fred ! Comment tu fais pour ressembler à un fil de fer ? »
« Je bosse moi, m’sieur »
« Ah ouais, bah vu comment tu ronfles, tu fais pas que bosser mon gars… » Les choufs étaient tous pliés de rire.
On se charriait beaucoup mais on s’adorait, on était frères d’armes. Le destin de chacun était lié à celui des autres, encore plus après le cérémonial du passage de la ligne. Je pense qu’aujourd’hui on parlerait carrément de bizutage. La première fois qu’on a franchi l’Équateur, quelle fiesta… Les marins et passagers qui traversent pour la première fois la ligne équatoriale en bateau sont invités à se présenter devant sa majesté Neptune. Pour être autorisés à franchir sans encombre cette zone redoutée entre hémisphère nord et hémisphère sud, les néophytes doivent payer un tribut au roi des mers et des océans et recevoir le « baptême ». Pour ce faire, les anciens se déguisent pour endosser les rôles du dieu Neptune et de son épouse Amphitrite, mais aussi en astronome, juge, évêque de la ligne ou encore en « sauvages ». Les nouveaux sont alors conviés à des festivités durant lesquelles ils auront à passer diverses épreuves ; l’une des plus célèbres est l’immersion dans la piscine improvisée sur le pont ou à la lance à incendie. Enduit de savon, recouvert de mousse puis de boue, on devait biser le cul du facteur, je vous laisse deviner de quoi il s’agit… Une fois cette cérémonie terminée, les baptisés, devenus « chevaliers des mers », reçoivent un certificat de passage de la ligne qui doit être précieusement gardé et présenté à chaque passage de ligne suivant, sous peine de devoir se présenter à nouveau devant le roi des mers et des océans… Et après alcool à gogo sur le rafiot, un vrai cirque ! Étrangement, certains camarades ont très mal vécu tout ce rite de passage, peut-être à cause d’une certaine pudeur, je ne sais pas. Moi je me suis bien marré et avec Jany on en a longtemps recausé comme l’un de nos meilleurs souvenirs à bord. Cela a encore renforcé notre sentiment de former notre petite famille à nous.
Dans le genre incident qui vous soude, je me rappelle aussi d’une inspection surprise de caisson suite à l’abus d’alcool d’un bosco lors de son quart à la barre (il avait changé de cap de quatre-vingt-dix degrés). Les chefs nous avaient prévenus et avaient récupéré les bouteilles illicites avant l’arrivée du commandant en second, du Pitaine et du Bidel, ce qui nous avait évité, je crois, pas mal d’emmerdes ce jour-là. J’aurais de quoi écrire un ou deux livres de mémoires rien qu’avec ce qui nous est arrivé à bord des rafiots.
Quel bonheur ce fut pendant toutes ces années ! Je crois pouvoir dire sans me vanter que j’avais toutes les qualités nécessaires : la rigueur, la discipline, la solidarité et l’esprit d’équipe. Les autres choufs appréciaient ma bonne humeur, ils savaient que sous mon côté un peu bourru se cachait un cœur en or, et que le langage grossier que j’avais adopté ne correspondait pas vraiment à ma personnalité. Je n’ai jamais eu d’ennemi, de faux amis, on était tous francs et loyaux dans la Marine. Cela ne signifie pas que tout s’est toujours passé haut la main, bien au contraire. Il y eut notamment les tempêtes, les avaries, ces instants où vous priez le dieu Neptune pour en sortir vivant. Tant de grands marins ont péri en pleine mer, cette idée ne peut pas complètement échapper à votre esprit lorsque les vents grondent et que les flots se déchaînent. Le point positif, c’est que je suis sorti renforcé de toutes ces épreuves, aussi bien physiquement que mentalement. Cela m’a beaucoup aidé plus tard, lorsqu’il a fallu affronter d’autres périodes de gros temps et connaître des changements de vie plus souvent subis que voulus.