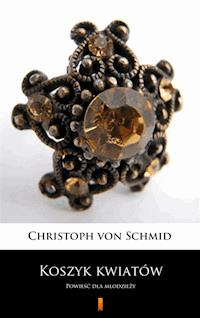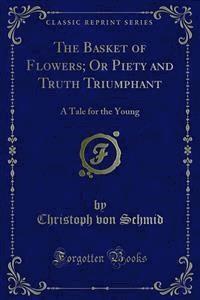1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dans "La Bague trouvée ou Les fruits d'une bonne éducation", Christoph von Schmid dépeint une fable morale centrée sur l'importance de l'éducation et de l'intégrité personnelle. À travers une narration simple et accessible, il illustre comment de petites décisions peuvent avoir un impact significatif sur la vie des personnages. Le style de l'auteur se caractérise par des dialogues vifs et un langage évocateur destiné à capter l'attention des jeunes lecteurs tout en portant des valeurs morales profondes. Publié au début du XIXe siècle, le livre s'inscrit dans une tradition de littérature éducative qui cherche à formuler des leçons de vie tout en divertissant le lecteur. Christoph von Schmid, né en 1768 dans le sud de l'Allemagne, était un prêtre catholique et un écrivain engagé. Son expérience dans l'enseignement et son désir de transmettre des valeurs éthiques et morales à la jeunesse ont clairement influencé son œuvre. Sa sensibilité à la condition humaine et son intérêt pour l'éducation des jeunes ont orienté sa plume vers des récits enrichissants, intégrés dans un discours moral, ce qui explique l'impact durable de son travail. Je recommande vivement "La Bague trouvée" à tout lecteur soucieux de transmettre des valeurs d'intégrité et de responsabilité. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire pour enfants, offre des réflexions pertinentes sur le choix et la vertu. En le lisant, on ne peut qu'être sensible aux messages universels qu'il véhicule, faisant de ce livre un excellent outil pour éveiller les consciences des jeunes générations.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
La Bague trouvée ou Les fruits d'une bonne éducation
Table des matières
PRÉFACE
Le but de ce petit ouvrage est de montrer en quoi consiste la base d’une bonne éducation. Un respect filial, un amour sincère envers Dieu, une sainte frayeur de lui déplaire par le péché ; en un mot, tous les attributs de la piété sont comme autant de plantes dont les germes ne peuvent être déposés trop tôt dans le cœur tendre et impressionnable des enfants, si l’on veut que l’éducation porte des fruits.
Les personnages des contes que l’on va lire sont des enfants pénétrés de respect, d’amour et de soumission envers les auteurs de leurs jours, leur donnant toute la satisfaction possible et devenant la consolation et l’appui de leur vieillesse. Puissent de tels exemples être comme autant de miroirs qui réfléchissent sans cesse aux yeux de la jeunesse la manière dont tout enfant bien né doit se comporter à l’égard de ses parents!
Plusieurs motifs m’ont engagé à présenter en forme de lettres ces nouveaux contes. Si, d’une part, il ne peut jamais être que bon et avantageux pour les enfants de se former au style épistolaire, c’est, de l’autre, encore par des exemples qu’ils y parviendront avec le plus de facilité. Enfin, bien qu’une chose soit déjà bonne et utile quant au fond, il ne faut pas manquer de la rendre aussi bonne et aussi utile que possible quant à la forme.
La piété est utile à tout, et renferme la promesse de la vie présente ainsi que de celle à venir. Elle seule rend vraiment utile ce que l’on peut enseigner de bon dans les écoles, et de même qu’en arithmétique les zéros n’ont de valeur qu’au moyen d’un chiffre positif, de même aussi nos efforts et nos connaissances ici-bas restent nuls si la piété ne vient leur donner du prix.
LA BAGUE TROUVÉE
LETTRE PREMIÈRE.
Paul, petit berger, à sa sœur Marie.
Wiesenthal, le 1er mai 1806.
Chère sœur,
Nous avons eu hier une magnifique soirée de printemps. J’étais assis sous un arbre, m’amusant à jouer de la flûte. Mon troupeau paissait tranquillement au bord du ruisseau. Mon petit livre, que je conserve depuis le temps où j’allais à l’école, était à mes côtés. Le soleil couchant dorait le ciel et la terre de ses rayons de flamme. En ce moment, monsieur le vicaire vint à passer. Il m’écouta pendant quelques instants, puis il s’approcha de moi. A la vue de mon livre posé sur le gazon:
— Saurais-tu lire, mon petit ami? me demanda-t-il avec bonté.
— Oh! oui, monsieur, lui répondis-je.
Et, pour le lui prouver, j’ouvris aussitôt mon livre, et j’en lus une page sans faire la moindre faute. Il parut tout surpris, et me dit:
— D’où est-tu donc? quels sont les bons parents qui t’ont si diligemment envoyé à l’école? et par quelles circonstances te trouves-tu dans notre village?
Je lui racontai alors mon histoire et lui appris comment, par suite des désastres de la guerre, nous avons perdu toute notre fortune et avons été contraints de quitter notre patrie; comment notre bon père a perdu la vie sur le champ de bataille, comment une cruelle maladie tient notre bonne maman alitée à Tannenberg, à six lieues d’ici, comment ma chère sœur Marie lui prodigue ses soins et cherche, au moyen de son rouet, à pourvoir aux besoins de la pauvre malade; comment enfin, voulant aussi gagner quelque chose, je me suis, ce printemps, engagé comme berger à Wiesenthal. Je ne pus lui donner tous ces tristes détails sans verser bien des larmes.
Après m’avoir écouté attentivement, il me dit avec un tendre intérêt:
— Console-toi, mon enfant, et sèche tes pleurs. Imite la piété et la probité de tes honnêtes parents, et, à coup sûr, tu verras ton sort s’améliorer.
Portant ensuite la main à sa poche, il me donna la belle pièce d’argent toute neuve que j’envoie à notre chère maman. Présente-lui mes tendres respects. Puisse-t-elle recouvrer bientôt la santé ! Adieu, chère sœur.
Ton affectionné frère,
PAUL.
LETTRE DEUXIÈME.
Marie à Paul.
Tannenberg, le 15 mai 1806.
Cher frère,
Ah! mes pleurs coulent par torrents! Faut-il que la première lettre que je t’écris soit la plus triste de toutes celles que j’écrirai de ma vie! Notre chère maman est morte avant-hier dans la nuit et a été enterrée ce matin.
J’étais assise près de son lit, le soir qui précéda sa mort. Elle venait de recevoir les derniers sacrements, et avec quelle piété, quelle ferveur! il semblait qu’elle fût déjà dans le ciel et qu’elle vît de ses propres yeux le Dieu qui venait de se donner à elle. Alors ta lettre est arrivée. Je la lui lus. Des larmes de joie coulèrent de ses yeux.
— Hélas! ma chère enfant, me dit-elle, jamais je ne me relèverai de ce lit de douleur. Je ne tarderai pas à me réunir à Dieu, notre bon père céleste. Cependant ma plus douce consolation dans ma dernière heure, c’est de n’avoir rien négligé pour votre éducation. Ah! mes chers enfants, puisse votre cœur rester constamment pieux et bon! Puisse-t-il se former au bien chaque jour davantage! Ayez sans cesse Dieu devant les yeux, aimez-le par-dessus tout, observez ses saints commandements et ceux de son Église, et mettez en lui toute votre confiance. Ne cessez d’invoquer de tout votre cœur notre divin Sauveur Jésus-Christ, suivez en tout point sa sainte doctrine, et que sa belle vie soit toujours le modèle de la vôtre. Priez chaque jour que l’Esprit divin veuille vous éclairer et vous diriger, et prêtez à ses inspirations une oreille docile. Aimez-vous d’un amour mutuel. Ne faites de mal à personne. Quels que puissent être votre indigence et vos besoins, que jamais votre main ne se souille du moindre larcin. Fuyez tout péché, quelque léger qu’il puisse être, et conservez votre innocence pure et sans tache. Si votre conduite est telle, Dieu ne manquera pas de pourvoir à vos besoins. Recevez mes tendres adieux et séchez vos larmes. Je vais dans le céleste séjour, où je ne cesserai de prier pour vous. Telles sont les dernières paroles de votre mère mourante. Garde-toi de les oublier, ma chère Marie, et fais-en part à notre cher Paul, en lui envoyant ma dernière bénédiction. J’eusse vivement désiré l’embrasser encore une fois avant de quitter ce monde; mais le ciel, où j’espère fermement retrouver votre père, nous réunira tous un jour.
Elle nous donna encore à tous deux sa bénédiction maternelle; puis, trois heures après, elle rendit doucement et saintement le dernier soupir. Depuis ce fatal moment, je suis comme noyée dans mes larmes. Je voudrais pouvoir te retracer ici toutes les belles exhortations par lesquelles monsieur le curé a su la disposer à une sainte mort, ainsi que toutes les bontés dont il l’a comblée pendant sa maladie; mais cela m’est impossible. Le digne homme ne laissait passer pour ainsi dire aucun jour sans la visiter, et lui envoyait ce qu’il avait de mieux pour sa nourriture. Non-seulement il lui donna un médecin, mais il voulut encore se charger des frais de pharmacie. Il ne l’a pas quittée pendant son agonie, et il a su, par de consolantes paroles, lui rendre la mort douce et facile. Il est donc de ton devoir, mon cher frère, de prier ardemment le bon Dieu de récompenser un aussi digne pasteur.
Mais prie aussi pour moi; car je me trouve maintenant bien malheureuse. Nous Voici dès de moment devenus tous deux, à la vérité, de pauvres orphelins délaissés; mais tu as sur moi l’avantage d’être déjà assez grand et assez fort pour te procurer, en qualité de berger, un petit morceau de pain, tandis que moi je ne sais qu’entreprendre. Je me sens encore trop faible pour soutenir les travaux de la campagne. Mendier!... que cette idée me répugne! Ce genre de vie traîne de si près la corruption après lui!... Dieu veuille avoir compassion de ta malheureuse sœur!
MARIE.
LETTRE TROISIÈME.
Paul à Marie.
Wiesenthal, le 2 juin 1806.
Tu dis bien, ma chère et bonne sœur: «Dieu veuille avoir compassion de nous!» C’est à peine si je puis te tracer ces lignes, tant je suis éploré. Te dire tout l’effroi et toute la désolation que ta lettre m’a causés serait impossible. Hélas! qui eût cru que notre chère maman dût mourir si inopinément? Il faut pourtant nous résigner; car tout ce que Dieu fait est bien fait. Telle doit être notre persuasion, malgré toutes les apparences contraires.