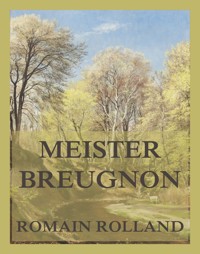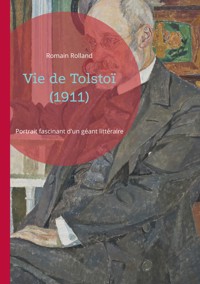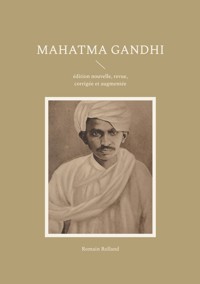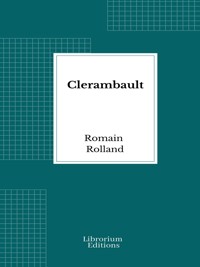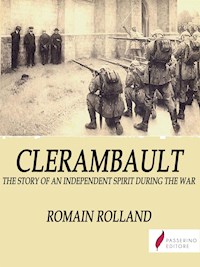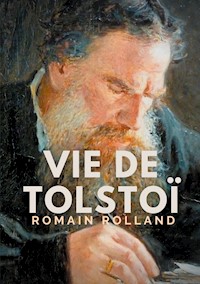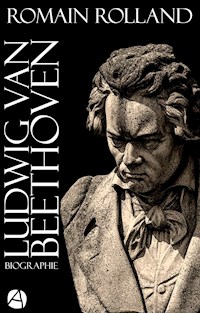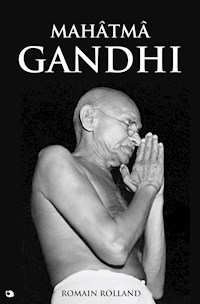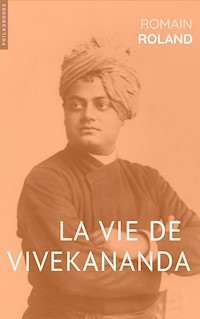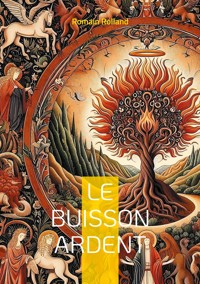
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Le Buisson ardent » de Romain Rolland est le quatrième volume de la série « Jean-Christophe », une oeuvre monumentale qui retrace la vie d'un musicien de génie. Dans ce tome, Jean-Christophe, désormais adulte et compositeur reconnu, traverse une période de crise existentielle et artistique. L'histoire débute alors que Jean-Christophe, exilé à Paris, se trouve confronté à une société qu'il juge superficielle et corrompue. Déçu par le monde artistique parisien, il remet en question son art et sa vocation. Cette quête intérieure le conduit à explorer de nouvelles formes musicales et à s'interroger sur le rôle de l'artiste dans la société. Au coeur de ce tumulte intérieur, Jean-Christophe fait la rencontre de Grazia, une femme italienne qui devient sa muse et son amour impossible. Cette relation platonique et intense nourrit sa créativité et l'aide à surmonter ses doutes. Rolland dépeint avec finesse les tourments de l'artiste, ses moments d'inspiration fulgurante et ses périodes de doute profond. Le « buisson ardent » du titre fait référence à cette flamme créatrice qui consume Jean-Christophe, à la fois source de souffrance et d'illumination. L'auteur aborde également des thèmes sociaux et politiques, critiquant l'antisémitisme et le nationalisme exacerbé de l'époque. À travers les réflexions de Jean-Christophe, Rolland plaide pour un humanisme universel et une fraternité entre les peuples. « Le Buisson ardent » est une oeuvre profonde qui explore les liens entre l'art, l'amour et l'engagement social. Rolland y livre une réflexion puissante sur la condition de l'artiste et sa place dans un monde en pleine mutation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PREMIÈRE PARTIE
DEUXIÈME PARTIE
PREMIÈRE PARTIE
Calme du cœur. Les vents suspendus. L’air immobile…
Christophe était tranquille ; la paix était en lui. Il éprouvait quelque fierté de l’avoir conquise. Et secrètement, il en était contrit. Il s’étonnait du silence. Ses passions étaient endormies ; il croyait, de bonne foi, qu’elles ne se réveilleraient plus.
Sa grande force, un peu brutale, s’assoupissait, sans objet, désœuvrée. Au fond, un vide secret, un : « à quoi bon », caché ; peut-être le sentiment du bonheur qu’il n’avait pas su saisir. Il n’avait plus assez à lutter ni contre soi, ni contre les autres. Il n’avait plus assez de peine, même à travailler. Il était arrivé au terme d’une étape ; il bénéficiait de la somme de ses efforts antérieurs ; il épuisait trop aisément la veine musicale qu’il avait ouverte ; et tandis que le public, naturellement en retard, découvrait et admirait ses œuvres passées, lui, commençait à s’en détacher, sans savoir encore s’il irait plus avant. Il jouissait, dans la création, d’un bonheur uniforme. L’art n’était plus pour lui, à cet instant de sa vie, qu’un bel instrument, dont il jouait en virtuose. Il se sentait, avec honte, devenir dilettante.
« Il faut, disait Ibsen, pour persévérer dans l’art, autre chose et plus qu’un génie naturel : des passions, des douleurs qui remplissent la vie et lui donnent un sens. Sinon, l’on ne crée pas, on écrit des livres. »
Christophe écrivait des livres. Il n’y était pas habitué. Ces livres étaient beaux. Il les eût préférés moins beaux et plus vivants. Cet athlète au repos, qui ne savait que faire de ses muscles, regardait, avec le bâillement d’un fauve qui s’ennuie, les années, les années de tranquille travail qui l’attendaient. Et comme, avec son vieux fonds d’optimisme germanique, il se persuadait volontiers que tout était pour le mieux, il pensait que c’était là sans doute le terme inévitable ; il se flattait d’être sorti de la tourmente, d’être devenu son maître. Ce n’était pas beaucoup dire… Enfin ! On règne sur ce qu’on a, on est ce qu’on peut être… Il se croyait arrivé au port.
Les deux amis n’habitaient pas ensemble. Quand Jacqueline était partie, Christophe avait pensé qu’Olivier reviendrait s’installer chez lui. Mais Olivier ne le pouvait point. Malgré le besoin qu’il avait de se rapprocher de Christophe, il sentait l’impossibilité de reprendre avec lui l’existence d’autrefois. Après les années passées avec Jacqueline, il lui eût semblé intolérable, et même sacrilège, d’introduire un autre dans l’intimité de sa vie, — cet autre l’aimât-il mieux mille fois et fût-il mieux aimé de lui que Jacqueline. — Cela ne se raisonne pas.
Christophe avait eu peine à comprendre. Il revenait à la charge, il s’étonnait, il s’attristait, il s’indignait. — Puis, son instinct, supérieur à son intelligence, l’avertit. Brusquement, il se tut, et trouva qu’Olivier avait raison.
Mais ils se voyaient, chaque jour ; et jamais ils n’avaient été plus unis, quand ils vivaient sous le même toit. Peut-être n’échangeaient-ils pas dans leurs entretiens les pensées les plus intimes. Ils n’en avaient pas besoin. L’échange se faisait, de soi-même, sans paroles, par la grâce des cœurs aimants.
Tous deux causaient peu, absorbés, l’un dans son art, et l’autre dans ses souvenirs. La peine d’Olivier s’atténuait ; mais il ne faisait rien pour cela, il s’y complaisait presque : ce fut pendant longtemps sa seule raison de vivre. Il aimait son enfant ; mais son enfant — un bébé vagissant — ne pouvait tenir grand place dans sa vie. Il y a des hommes qui sont plus amants que pères. Il ne servirait à rien de s’en scandaliser. La nature n’est pas uniforme ; et il serait absurde de vouloir imposer à tous les mêmes lois du cœur. Nul n’a le droit de sacrifier ses devoirs à son cœur. Du moins, il faut reconnaître au cœur le droit de n’être pas heureux, en faisant son devoir. Ce qu’Olivier aimait le plus peut-être en son enfant, c’était celle dont la chair l’avait formé.
Jusqu’à ces derniers temps, il avait fait peu attention aux souffrances des autres. Il était un intellectuel, qui vit trop enfermé en soi. Ce n’était pas égoïsme, c’était habitude maladive du rêve. Jacqueline avait encore élargi le vide autour de lui ; son amour avait tracé entre Olivier et les autres hommes un cercle magique, qui persistait après que l’amour n’était plus. Et puis, il était, de tempérament, un petit aristocrate. Depuis l’enfance, en dépit de son cœur tendre, il s’était tenu éloigné de la foule, pour des raisons de délicatesse de corps et d’âme. L’odeur et les pensées de ces gens lui répugnaient.
Mais tout avait changé, à la suite d’un fait-divers banal, dont il venait d’être le témoin.
Il avait loué un appartement très modeste, dans le haut Montrouge, non loin de Christophe et de Cécile. Le quartier était populaire, et la maison habitée par de petits rentiers, des employés, et quelques ménages ouvriers. En tout autre temps, il eût souffert du milieu où il se trouvait un étranger ; mais en ce moment, peu lui importait, ici ou là : il se trouvait partout un étranger. Il savait à peine qui il avait pour voisins, et il ne voulait pas le savoir. Quand il revenait du travail — (il avait pris un emploi dans une maison d’éditions) — il s’enfermait avec ses souvenirs, et il n’en sortait que pour aller voir son enfant et Christophe. Son logement n’était pas le foyer pour lui : c’était la chambre noire où se fixent les images du passé ; plus elle était noire et nue, plus nettement ressortaient les images intérieures. À peine remarquait-il les figures qu’il croisait sur l’escalier. À son insu pourtant, certaines se fixaient en lui. Il est telle nature d’esprits qui ne voient bien les choses qu’après qu’elles sont passées. Mais alors, rien ne leur échappe, les moindres détails sont gravés au burin. Olivier était ainsi : il était peuplé d’ombres des vivants. Au choc d’une émotion, elles surgissaient ; et Olivier s’étonnait, les reconnaissait sans les avoir connues, parfois tendait les mains pour les saisir… Trop tard.
Un jour, en sortant de chez lui, il vit un rassemblement devant la porte de la maison, autour de la concierge qui pérorait. Il était si peu curieux qu’il eût continué son chemin sans s’informer ; mais la concierge, désireuse de recruter un auditeur de plus, l’arrêta, pour lui demander s’il savait ce qui était arrivé à ces pauvres Roussel. Olivier ne savait même pas qui étaient « ces pauvres Roussel » ; et il prêta l’oreille, avec une indifférence polie. Quand il apprit qu’une famille d’ouvriers, père, mère et cinq enfants venait de se suicider de misère, dans sa maison, il resta comme les autres à regarder les murs de la bâtisse, en écoutant la narratrice qui ne se lassait pas de recommencer l’histoire. À mesure qu’elle parlait, des souvenirs lui revenaient, il s’apercevait qu’il avait vu ces gens ; il posa quelques questions… Oui, il les reconnaissait : l’homme — (il entendait sa respiration sifflante dans l’escalier) — un ouvrier boulanger, au teint blême, le sang bu par la chaleur du four, les joues creuses, mal rasé ; il avait eu une pneumonie, au commencement de l’hiver ; il s’était remis à la tâche, insuffisamment guéri ; une rechute était survenue ; depuis trois semaines, il était sans travail et sans forces. La femme, traînant d’incessantes grossesses, percluse de rhumatismes, s’épuisait à faire quelques ménages, passait les journées en courses, pour tâcher d’obtenir de l’Assistance Publique de maigres secours qui ne se pressaient pas de venir. En attendant, les enfants venaient, et ne se lassaient point : onze ans, sept ans, trois ans, — sans parler de deux autres qu’on avait perdus sur la route ; — et pour achever, deux jumeaux qui avaient choisi ce moment pour faire leur apparition ; ils étaient nés, le mois passé.
— Le jour de leur naissance, racontait une voisine, l’aînée des cinq, la petite de onze ans, Justine — pauvre gosse ! — s’est mise à sangloter, en demandant comment elle viendrait à bout de les porter tous les deux.
Olivier revit sur-le-champ l’image de la fillette, — un front volumineux, des cheveux pâles tirés en arrière, les yeux gris trouble, à fleur de tête. On la rencontrait toujours, portant les provisions, ou la sœur plus petite ; ou bien elle tenait par la main le frère de sept ans, un garçon au minois fin et chétif, qui avait un œil perdu. Quand ils se croisaient dans l’escalier, Olivier disait, avec sa politesse distraite :
— Pardon, mademoiselle.
Elle, ne disait rien ; elle passait, raide, s’effaçant à peine ; mais cette courtoisie illusoire lui faisait un secret plaisir. La veille au soir, à six heures, en descendant, il l’avait rencontrée pour la dernière fois ; elle montait un seau de charbon de bois. Il n’y avait pas pris garde, sinon à ce que la charge semblait bien lourde. Mais c’est chose naturelle, pour les enfants du peuple. Olivier avait salué, comme d’habitude, sans regarder. Quelques marches plus bas, levant machinalement la tête, il avait vu, penchée sur le palier de l’étage, la petite figure crispée, qui le regardait descendre. Elle s’était aussitôt détournée et avait repris sa montée. Savait-elle où cette montée la menait ? — Olivier n’en doutait pas, et il était obsédé par la pensée de cette enfant, qui rapportait dans son seau trop lourd la mort, comme une délivrance, — les malheureux petits, pour qui ne plus être voulait dire ne plus souffrir ! Il ne put continuer sa promenade. Il rentra dans sa chambre. Mais là, sentir ces morts près de lui… Quelques cloisons l’en séparaient… Penser qu’il avait vécu à côté de ces angoisses !
Il alla voir Christophe. Il avait le cœur serré ; il se disait qu’il est monstrueux de s’absorber, comme il avait fait, dans de vains regrets d’amour, lorsque tant d’êtres souffraient de malheurs mille fois plus cruels, et qu’on pouvait les sauver. Son émotion était profonde ; elle n’eut pas de peine à se communiquer. Christophe, facilement impressionnable, fut remué à son tour. Au récit d’Olivier, il déchira la page qu’il venait d’écrire, se traitant d’égoïste qui s’amuse à des jeux d’enfant. Mais ensuite, il ramassa les morceaux déchirés. Il était trop pris par sa musique ; et son instinct lui disait qu’une œuvre d’art de moins ne ferait pas un heureux de plus. Cette tragédie de la misère n’était pour lui rien de nouveau ; depuis l’enfance, il était habitué à marcher sur le bord de tels abîmes, et à n’y pas tomber. Même, il était sévère pour le suicide, à ce moment de sa vie où il se sentait en pleine force et ne concevait pas qu’on pût, pour quelque souffrance que ce fût, renoncer à la lutte. La souffrance et la lutte, qu’y a-t-il de plus normal ? C’est l’échine de l’univers.
Olivier avait aussi passé par des épreuves semblables ; mais jamais il n’avait pu en prendre son parti, ni pour lui, ni pour les autres. Il avait l’horreur de cette misère, où la vie de sa chère Antoinette s’était consumée. Après qu’il avait épousé Jacqueline, quand il s’était laissé amollir par la richesse et par l’amour, il avait eu hâte d’écarter le souvenir des tristes années où sa sœur et lui s’épuisaient à gagner, chaque jour, leur droit à vivre le lendemain, sans savoir s’ils y réussiraient. Ces images reparaissaient, à présent qu’il n’avait plus son égoïsme juvénile à sauvegarder. Au lieu de fuir le visage de la souffrance, il se mit à sa recherche. Il n’avait pas beaucoup de chemin à faire pour la trouver. Dans son état d’esprit, il devait la voir partout. Elle remplissait le monde. Le monde, cet hôpital… Ô douleurs d’agonies ! Douleurs de chair blessée, pantelante, qui pourrit vivante. Silencieuses tortures des cœurs que le chagrin consume. Enfants qu’on n’aime point, pauvres filles sans espoir, femmes séduites ou trahies, hommes déçus dans leurs amitiés, leurs amours et leur foi, troupe lamentable des malheureux que la vie a meurtris et qu’elle oublie !… Le plus atroce n’était pas la misère et la maladie ; c’était la cruauté des hommes, les uns envers les autres. À peine Olivier eut-il levé la trappe qui fermait l’enfer humain que monta vers lui la clameur de tous les opprimés, les pauvres exploités, les peuples persécutés, l’Arménie massacrée, la Finlande étouffée, la Pologne écartelée, la Russie martyrisée, l’Afrique livrée en curée aux rapaces européens, les misérables de tout le genre humain. Il en fut suffoqué ; il l’entendait partout, il ne pouvait plus ne plus l’entendre, il ne pouvait plus concevoir qu’il y eût des gens qui pensassent à autre chose. Il en parlait sans cesse à Christophe. Christophe, troublé, disait :
— Tais-toi ! laisse-moi travailler.
Et comme il avait peine à reprendre son équilibre, il s’irritait, jurait :
— Au diable ! Ma journée est perdue ! Te voilà bien avancé !
Olivier s’excusait.
— Mon petit, disait Christophe, il ne faut pas toujours regarder dans le gouffre. On ne peut plus vivre.
— Il faut tendre la main à ceux qui sont dans le gouffre.
— Sans doute. Mais comment ? En nous y jetant aussi ? Car c’est cela que tu veux. Tu as une propension à ne plus voir dans la vie que ce qu’elle a de triste. Que le bon Dieu te bénisse ! Ce pessimisme est charitable, assurément ; mais il est déprimant. Veux-tu faire du bonheur ? D’abord, sois heureux.
— Heureux ! Comment peut-on avoir le cœur de l’être, quand on voit tant de souffrances ? Il ne peut y avoir de bonheur qu’à tâcher de les diminuer, en combattant le mal.
— Fort bien. Mais ce n’est pas en allant me battre à tort et à travers que j’aiderai les malheureux. Un mauvais soldat de plus, ce n’est guère. Mais je puis consoler par mon art, répandre la force et la joie. Sais-tu combien de misérables ont été soutenus dans leurs souffrances par la beauté d’une pensée, d’une chanson ailée ? À chacun son métier ! Vous autres de France, en généreux hurluberlus, vous êtes toujours les premiers à manifester contre toutes les injustices, d’Espagne ou de Russie, sans savoir bien de quoi il s’agit. Je vous aime pour cela. Mais croyez-vous que vous avanciez les choses ? Vous vous y jetez en brouillons, et le résultat est nul, — quand par hasard il n’est pas pire… Et vois, jamais votre art n’a été plus étiolé qu’en ce temps où vos artistes prétendent se mêler à l’action universelle. Chose étrange que tant de petits-maîtres dilettantes et roués osent s’ériger en apôtres ! Ils feraient beaucoup mieux de verser à leur peuple un vin moins frelaté. — Mon premier devoir, c’est de faire bien ce que je fais, et de vous fabriquer une musique saine, qui vous refasse du sang et mette en vous du soleil.
Pour répandre le soleil sur les autres, il faut l’avoir en soi. Olivier en manquait. Comme les meilleurs d’aujourd’hui, il n’était pas assez fort pour rayonner la force, à lui tout seul. Il ne l’aurait pu qu’en s’unissant avec d’autres. Mais avec qui s’unir ? Libre d’esprit et religieux de cœur, il était rejeté de tous les partis, politiques et religieux. Ils rivalisaient tous entre eux, d’intolérance et d’étroitesse. Dès qu’ils avaient le pouvoir, c’était pour en abuser. Seuls, les faibles et les opprimés attiraient Olivier. En ceci du moins il partageait l’opinion de Christophe, qu’avant de combattre les injustices lointaines, on devait combattre les injustices prochaines, celles qui vous entourent et dont on est plus ou moins responsable. Trop de gens se contentent, en protestant contre le mal commis par d’autres, sans songer à celui qu’ils font.
Il s’occupa d’abord d’assistance aux pauvres. Son amie, madame Arnaud, faisait partie d’une œuvre charitable. Olivier s’y fit admettre. Mais dans les premiers temps, il eut plus d’un mécompte : les pauvres dont il dut se charger n’étaient pas tous dignes d’intérêt ; ou ils répondaient mal à sa sympathie, ils se méfiaient de lui, ils lui restaient fermés. D’ailleurs, un intellectuel a peine à se satisfaire de la charité toute simple : elle arrose une si petite province du pays de misère ! Son action est presque toujours morcelée, fragmentaire ; elle semble aller au hasard, et panser les blessures, au fur et à mesure qu’elle en découvre ; elle est, en général, trop modeste et trop pressée pour s’aventurer jusqu’aux racines du mal. Or, c’est là une recherche dont l’esprit d’Olivier ne pouvait se passer.
Il se mit à étudier le problème de la misère sociale. Il ne manquait point de guides. En ce temps, la question sociale était devenue une question de société. On en parlait dans les salons, au théâtre, dans les romans. Chacun avait la prétention de la connaître. Une partie de la jeunesse y dépensait le meilleur de ses forces.
Il faut à toute génération nouvelle une belle folie. Même les plus égoïstes parmi les jeunes gens ont un trop-plein de vie, un capital d’énergie qui leur a été avancé et qui ne veut point rester improductif ; ils cherchent à le dépenser dans une action, ou — (plus prudemment) — dans une théorie. Aviation ou Révolution. Le sport des muscles ou celui des idées. On a besoin, quand on est jeune, de se donner l’illusion qu’on participe à un grand mouvement de l’humanité, qu’on renouvelle le monde. Beauté d’avoir des sens qui vibrent à tous les souffles de l’univers ! On est si libre et si léger ! On ne s’est pas encore chargé du lest d’une famille, on n’a rien, on ne risque guère. On est bien généreux, quand on peut renoncer à ce qu’on ne tient pas encore. Et puis, il est si bon d’aimer et de haïr, et de croire qu’on transforme la terre avec des rêves et des cris ! Les jeunes gens sont comme des chiens aux écoutes : on les voit frémir et aboyer au vent. Une injustice commise, à l’autre bout du monde, les faisait délirer.
Aboiements dans la nuit. D’une ferme à l’autre, au milieu des grands bois, ils se répondaient sans répit. La nuit était agitée. Il n’était pas facile de dormir, dans ce temps-là. Le vent charriait dans l’air l’écho de tant d’injustices !… L’injustice est innombrable ; pour remédier à l’une, on risque d’en causer d’autres. Qu’est-ce que l’injustice ? — Pour l’un, c’est la paix honteuse, la patrie démembrée. Pour l’autre, c’est la guerre. Pour celui-ci, c’est le passé détruit, c’est le prince banni ; pour celui-là, c’est l’Église spoliée ; pour ce troisième, c’est l’avenir étouffé, la liberté en danger. Pour le peuple, c’est l’inégalité ; et pour l’élite, c’est l’égalité. Il y a tant d’injustices différentes que chaque époque choisit la sienne, — celle qu’elle combat, et celle qu’elle favorise.
À ce moment, le plus gros des efforts du monde étaient tournés contre les injustices sociales, — et visaient inconsciemment à en produire de nouvelles.
Et certes, ces injustices étaient grandes et s’étalaient aux yeux, depuis que la classe ouvrière, croissant en nombre et en puissance, était devenue un des rouages essentiels de l’État. Mais en dépit des déclamations de ses tribuns et de ses bardes, la situation de cette classe n’était pas pire, elle était meilleure qu’elle n’avait jamais été dans le passé ; et le changement ne venait pas de ce qu’elle souffrait plus, mais de ce qu’elle était plus forte. Plus forte, par la force même du capital ennemi, par la fatalité du développement économique et industriel, qui avait rassemblé ces travailleurs en armées prêtes au combat et, par le machinisme, leur avait mis les armes à la main, avait fait de chaque contremaître un maître qui commandait à la lumière, à la foudre, au mouvement, à l’énergie du monde. De cette masse énorme de forces élémentaires, que des chefs depuis peu tâchaient d’organiser, se dégageait une chaleur de brasier, des ondes électriques qui parcouraient, de proche en proche, le corps de la société humaine.
Ce n’était pas par sa justice, ou par la nouveauté et par la force de ses idées que la cause de ce peuple remuait la bourgeoisie intelligente, bien qu’ils voulussent le croire. C’était par sa vitalité.
Sa justice ? Mille autres justices étaient violées dans le monde, sans que le monde s’en émût. Ses idées ? Des lambeaux de vérités, ramassés çà et là, ajustés aux intérêts et à la taille d’une classe, aux dépens des autres classes. Des credo absurdes, comme tous les credo, — Droit divin des rois. Infaillibilité des papes, Suffrage universel, Égalité des hommes, — pareillement absurdes, si l’on ne considère que leur valeur de raison, et non la force qui les anime. Qu’importait leur médiocrité ? Les idées ne conquièrent pas le monde, en tant qu’idées, mais en tant que forces. Elles ne prennent pas les hommes par leur contenu intellectuel, mais par le rayonnement vital qui, à certains moments de l’histoire, s’en dégage. On dirait un fumet qui monte : les odorats les plus grossiers en sont saisis. La plus sublime idée restera sans effet, jusqu’au jour où elle devient contagieuse, non par ses propres mérites, mais par ceux des groupes humains qui l’incarnent et lui transfusent leur sang. Alors la plante desséchée, la rose de Jéricho, soudainement fleurit, grandit, remplit l’air de son arôme violent. — Telles de ces pensées, dont l’éclatant drapeau menait les classes ouvrières à l’assaut de la citadelle bourgeoise, étaient sorties du cerveau de rêveurs bourgeois. Tant qu’elles étaient restées dans les livres des bourgeois, elles étaient comme mortes : des objets de musée, des momies emmaillotées dans des vitrines, que personne ne regarde. Mais aussitôt que le peuple s’en était emparé, il les avait faites peuple, il y avait ajouté sa réalité fiévreuse, qui les déformait, et qui les animait, soufflant dans ces raisons abstraites ses espoirs hallucinés, un vent brûlant d’Hégire. Elles se propageaient de l’un à l’autre. On en était touché, sans savoir ni par qui, ni comment elles avaient été apportées. Les personnes ne comptaient guère. L’épidémie morale continuait de s’étendre ; et il se pouvait que des êtres bornés la communiquassent à des êtres d’élite. Chacun en était porteur, à son insu.
Ces phénomènes de contagion intellectuelle sont de tous les temps et de tous les pays ; ils se font sentir même dans les États aristocratiques, où tâchent de se maintenir des castes fermées entre elles. Mais nulle part, ils ne sont plus foudroyants que dans les démocraties, qui ne conservent aucune barrière sanitaire entre l’élite et la foule. Celle-là est aussitôt contaminée, quoi qu’elle fasse. En dépit de son orgueil et de son intelligence, elle ne peut résister à la contagion : car elle est bien plus faible qu’elle ne pense. L’intelligence est un îlot, que les marées humaines rongent, effritent et recouvrent. Elle n’émerge de nouveau que quand le flux se retire. — On admire l’abnégation des privilégiés français qui abdiquèrent leurs droits, dans la nuit du 4 Août. Ce qui est le plus admirable sans doute, c’est qu’ils n’ont pu faire autrement. J’imagine que bon nombre d’entre eux, rentrés dans leur hôtel, se sont dit : « Qu’ai-je fait ? J’étais ivre… » La magnifique ivresse ! Loué soit le bon vin et la vigne qui le donne ! La vigne, dont le sang enivra les privilégiés de la vieille France, ce n’étaient pas eux qui l’avaient plantée. Le vin était tiré, il n’y avait qu’à le boire. Qui le buvait, délirait. Même ceux qui ne buvaient point avaient le vertige, rien qu’à humer en passant l’odeur de la cuvée. Vendanges de la Révolution !… Du vin de 89, il ne reste plus à présent, dans des celliers de famille, que quelques bouteilles éventées ; mais les enfants de nos petits-enfants se souviendront que leurs arrière-grands-pères en eurent la tête tournée.
C’était un vin plus âpre, mais non moins fort, qui montait au cerveau des jeunes bourgeois de la génération d’Olivier. Ils offraient leur classe en sacrifice au dieu nouveau, Deo ignoto : — le peuple.
Certes, ils n’étaient pas tous également sincères. Beaucoup ne voyaient là qu’une occasion de se distinguer de leur classe, en affectant de la mépriser. Pour la plupart, c’était un passe-temps intellectuel, un entraînement oratoire, qu’ils ne prenaient pas tout à fait au sérieux. Il y a plaisir à croire que l’on croit à une cause, que l’on se bat pour elle, ou bien que l’on se battra, — du moins, qu’on pourrait se battre. Il n’est même pas mauvais de penser que l’on risque quelque chose. Émotions de théâtre.
Elles sont bien innocentes, quand on s’y livre naïvement, sans qu’il s’y mêle de calcul intéressé. — Mais d’autres, plus avisés, ne jouaient qu’à bon escient ; le mouvement populaire leur était un moyen d’arriver. Tels les pirates Northmans, ils profitaient de la mer montante pour lancer leur barque à l’intérieur des terres ; ils comptaient pénétrer au fond des grands estuaires, et rester enfoncés dans les villes conquises, tandis que la mer se retire. La passe était étroite, et le flot capricieux : il fallait être habile. Mais deux ou trois générations de démagogie ont formé une race de corsaires, pour qui le métier n’a plus de secrets. Ils passaient hardiment, et n’avaient même pas un regard pour ceux qui sombraient en route.
Cette canaille-là est de tous les partis ; grâce à Dieu, aucun parti n’en est responsable. Mais le dégoût que ces aventuriers inspiraient aux sincères et aux convaincus avait conduit certains d’entre eux à désespérer de leur classe. Olivier voyait de jeunes bourgeois riches et instruits, qui avaient le sentiment de la déchéance de la bourgeoisie et de leur propre inutilité. Il n’avait que trop de penchant à sympathiser avec eux. Après avoir cru d’abord à la rénovation du peuple par l’élite, après avoir fondé des Universités Populaires et y avoir dépensé sans compter beaucoup de temps et d’argent, ils avaient constaté l’échec de leurs efforts ; leurs espoirs avaient été excessifs, leur découragement l’était aussi. Le peuple n’était pas venu à leur appel, ou il s’était sauvé. Quand il venait, il entendait tout de travers, il ne prenait de la culture bourgeoise que les vices et les ridicules. Enfin, plus d’une brebis galeuse s’étaient glissées dans les rangs des apôtres bourgeois, et les avaient discrédités, en exploitant du même coup le peuple et les bourgeois. Alors, il semblait aux gens de bonne foi que la bourgeoisie était condamnée, qu’elle ne pouvait qu’infecter le peuple, et que le peuple devait à tout prix se libérer, faire son chemin tout seul. Ils restaient donc sans autre action possible que de prédire ou de prévoir un mouvement qui se ferait sans eux et contre eux. Les uns y trouvaient une joie de renoncement, de sympathie humaine, profonde et désintéressée, qui se rassasie d’elle-même et de son sacrifice. Aimer, se donner ! La jeunesse est si riche de son propre fonds qu’elle peut se passer d’être payée de retour ; elle ne craint pas de rester dépourvue. Et elle peut se priver de tout, sauf d’aimer. — D’autres satisfaisaient là un plaisir de raison, une logique impérieuse ; ils se sacrifiaient non aux hommes, mais aux idées. C’étaient les plus intrépides. Ils éprouvaient une jouissance orgueilleuse à déduire de leurs raisonnements la fin fatale de leur classe. Il leur eût été plus pénible de voir leurs prédictions démenties que d’être écrasés sous le poids. Dans leur ivresse intellectuelle, ils criaient à ceux du dehors : « Plus fort ! Frappez plus fort ! Qu’il ne reste plus rien de nous ! »
— Ils s’étaient faits les théoriciens de la violence.
De la violence des autres. Car, suivant l’habitude, ces apôtres de l’énergie brutale étaient presque toujours des gens distingués et débiles. Plus d’un étaient fonctionnaires de cet État, qu’ils parlaient de détruire, fonctionnaires appliqués, consciencieux et soumis. Leur violence théorique était la revanche de leur débilité, de leurs rancœurs et de la compression de leur vie. Mais elle était surtout l’indice des orages qui grondaient autour d’eux. Les théoriciens sont comme les météorologistes : ils disent, en termes scientifiques, non pas le temps qu’il fera, mais le temps qu’il fait. Ils sont la girouette, qui marque d’où souffle le vent. Quand ils tournent, ils ne sont pas loin de croire qu’ils font tourner le vent.
Le vent avait tourné.
Les idées s’usent vite dans une démocratie, d’autant plus vite qu’elles se sont plus promptement propagées. Combien de républicains en France s’étaient, en moins de cinquante ans, dégoûtés de la république, du suffrage universel, et de tant de libertés conquises avec ivresse ! Après le culte fétichiste du nombre, après l’optimisme béat qui avait cru aux saintes majorités et qui en attendait le progrès humain, l’esprit de violence soufflait ; l’incapacité des majorités à se gouverner elles-mêmes, leur vénalité, leur veulerie, leur basse et peureuse aversion de toute supériorité, leur lâcheté oppressive, soulevaient la révolte ; les minorités énergiques — toutes les minorités — en appelaient à la force. Un rapprochement baroque, et cependant fatal, se faisait entre les royalistes de l’Action Française et les syndicalistes de la C. G. T. Balzac parle, quelque part, de ces hommes de son temps, « aristocrates par inclination, qui se faisaient républicains par dépit, uniquement pour trouver beaucoup d’inférieurs parmi leurs égaux. » — Maigre plaisir. Il faut contraindre ces inférieurs à se reconnaître tels ; et pour cela, nul moyen qu’une autorité qui impose la suprématie de l’élite — ouvrière ou bourgeoise — au nombre qui l’opprime. Les jeunes intellectuels, petits bourgeois orgueilleux, se faisaient royalistes, ou révolutionnaires, par amour-propre froissé et par haine de l’égalité démocratique. Et les théoriciens désintéressés, les philosophes de la violence, en bonnes girouettes, se dressaient au-dessus d’eux, oriflammes de la tempête.
Et il y avait enfin la bande des littérateurs en quête d’inspiration, — de ceux qui savent écrire, mais ne savent trop quoi écrire : comme les Grecs à Aulis, bloqués par le calme plat, ils ne peuvent plus avancer, et guettent impatiemment le bon vent, quel qu’il soit, qui viendra gonfler leurs voiles. — On voyait là des illustres, de ceux que l’Affaire Dreyfus avait inopinément arrachés à leurs travaux de style et lancés dans les réunions publiques. Exemple trop suivi, au gré des initiateurs. Une foule de littérateurs s’occupaient maintenant de politique, et prétendaient régenter les affaires de l’État. Tout leur était prétexte à former des ligues, lancer des manifestes, sauver le Capitole. Après les intellectuels de l’avant-garde, les intellectuels de l’arrière : les uns valaient les autres. Chacun des deux partis traitait l’autre d’intellectuel, et se traitait lui-même d’intelligent. Ceux qui avaient la chance de posséder dans leurs veines quelques gouttes de sang du peuple, en étaient glorieux ; ils y trempaient leur plume, ils écrivaient, avec. — Tous, bourgeois, mécontents, et cherchant à reprendre l’autorité que la bourgeoisie avait, par son égoïsme, irrémédiablement perdue. Il était rare que ces apôtres soutinssent longtemps leur zèle apostolique. Au début, la cause leur valait des succès, qui n’étaient probablement pas dûs à leurs dons oratoires. Leur amourpropre en était délicieusement flatté. Depuis, ils continuaient, avec moins de succès, et quelque peur secrète d’être un peu ridicules. À la longue, ce dernier sentiment tendait à l’emporter, doublé de la lassitude d’un rôle difficile à jouer, pour des hommes de leurs goûts distingués et de leur scepticisme. Ils attendaient, pour battre en retraite, que le vent le leur permît, et aussi leur escorte. Car ils étaient prisonniers et de l’une et de l’autre. Ces Voltaire et ces Joseph de Maistre des temps nouveaux cachaient sous leur hardiesse de propos et d’écrits une incertitude épeurée, qui tâtait le terrain, craignait de se compromettre auprès des jeunes gens, s’évertuait à leur plaire, à être plus jeunes qu’eux. Révolutionnaires, ou contre-révolutionnaires, par littérature, ils se résignaient à suivre la mode littéraire qu’ils avaient contribué à fonder.
Le type le plus curieux qu’Olivier rencontra, dans cette petite avant-garde bourgeoise de la Révolution, fut le révolutionnaire par timidité.
L’échantillon qu’il en avait sous les yeux se nommait Pierre Canet. De riche bourgeoisie, et de famille conservatrice, hermétiquement fermée aux idées nouvelles : magistrats et fonctionnaires, qui s’étaient illustrés en boudant le pouvoir ou en se faisant révoquer ; gros bourgeois du Marais, qui flirtaient avec l’Église et pensaient peu, mais bien. Il s’était marié, par désœuvrement, avec une femme au nom aristocratique, qui ne pensait pas moins bien, ni davantage. Ce monde bigot, étroit et arriéré, qui remâchait perpétuellement sa morgue et son amertume, avait fini par l’exaspérer, — d’autant plus que sa femme était laide et l’assommait. D’intelligence moyenne, d’esprit assez ouvert, il avait des aspirations libérales, sans trop savoir en quoi elles consistaient : ce n’était pas dans son milieu qu’il aurait pu apprendre ce qu’était la liberté. Tout ce qu’il savait, c’est qu’elle n’était point là ; et il se figurait qu’il suffisait d’en sortir pour la trouver. Il était incapable de marcher seul. Dès ses premiers pas au dehors, il fut heureux de se joindre à des amis de collège, dont certains étaient férus des idées syndicalistes. Il se trouvait encore plus dépaysé dans ce monde que dans celui d’où il venait ; mais il ne voulait pas en convenir : il lui fallait bien vivre quelque part ; et des gens de sa nuance, (c’est-à-dire sans nuance), il n’en pouvait trouver. Dieu sait pourtant que la graine n’en est pas rare en France ! Mais ils ont honte d’eux-mêmes : ils se cachent, ou se teignent en l’une des couleurs politiques à la mode, voire en plusieurs. D’ailleurs, il subissait l’ascendant de ses amis.
Suivant l’habitude, il s’était attaché surtout à celui qui était le plus différent de lui. Ce Français, bourgeois français et provincial dans l’âme, s’était fait le fidèle Achate d’un jeune docteur juif, Manousse Heimann, un Russe réfugié, qui, à la façon de beaucoup de ses compatriotes, avait le double don de s’installer tout de suite chez les autres comme chez lui, et de se trouver si à l’aise dans toute révolution qu’on pouvait se demander ce qui l’intéressait davantage en elle : si c’était le jeu, ou la cause. Ses épreuves et celles des autres lui étaient un divertissement. Sincèrement révolutionnaire, ses habitudes d’esprit scientifique lui faisaient regarder les révolutionnaires et lui-même, comme des sortes d’aliénés. Il observait cette aliénation chez les autres et chez lui, tout en la cultivant. Son dilettantisme exalté et son extrême inconstance d’esprit lui faisaient rechercher les milieux les plus opposés. Il avait des accointances parmi les hommes au pouvoir, et jusque dans le monde de la police ; il furetait partout, avec cette curiosité maladive et dangereuse qui donne à tant de révolutionnaires russes l’apparence de jouer un double jeu, et qui parfois de cette apparence fait une réalité. Ce n’est pas trahison, c’est versatilité, au reste désintéressée. Combien d’hommes d’action, pour qui l’action est un théâtre, où ils apportent les aptitudes de bons comédiens, honnêtes, mais toujours prêts à changer de rôles ! À celui de révolutionnaire Manousse était fidèle, autant qu’il pouvait l’être : c’était le personnage qui s’accordait le mieux avec son anarchie naturelle et avec le plaisir qu’il avait à démolir les lois des pays où il passait. Malgré tout, ce n’était qu’un rôle. On ne savait jamais la part d’invention et de réalité qu’il y avait dans ses propos ; et lui-même finissait par ne plus le savoir très bien.
Intelligent et moqueur, doué de la finesse psychologique de sa double race, sachant lire à merveille dans les faiblesses des autres, comme dans les siennes, et habile à en jouer, il n’avait pas eu de peine à dominer Canet. Il trouvait plaisant d’entraîner ce Sancho Pança dans des équipées à la Don Quichotte. Il disposait de lui sans façons, de sa volonté, de son temps, de son argent, — non pour lui, (il n’avait pas de besoins, on ne savait de quoi, ni comment il vivait), — mais pour les manifestations les plus compromettantes de la cause. Canet se laissait faire ; il tâchait de se persuader qu’il pensait comme Manousse. Il savait très bien le contraire : ces idées l’effaraient ; elles choquaient son bon sens. Et il n’aimait pas le peuple. De plus, il n’était pas brave. Ce gros garçon, grand, large et corpulent, à la figure poupine, complètement rasée, le souffle court, la parole affable, pompeuse et enfantine, qui avait des pectoraux d’Hercule Farnèse, et qui était d’une jolie force à la boxe et au bâton, était le plus timide des hommes. S’il s’enorgueillissait de passer parmi les siens pour un esprit subversif, il tremblait en secret devant la hardiesse de ses amis. Sans doute, ce petit frisson n’était pas trop désagréable, aussi longtemps qu’il ne s’agissait que d’un jeu. Mais le jeu devenait dangereux. Ces animaux-là se faisaient agressifs, leurs prétentions croissaient ; elles inquiétaient Canet dans son égoïsme foncier, son sentiment enraciné de la propriété, sa pusillanimité bourgeoise. Il n’osait pas demander : « Où me menez-vous ? » Mais il pestait tout bas contre le sans-gêne des gens qui n’aiment rien tant qu’à se casser le cou, sans s’inquiéter de savoir s’ils ne risquent pas de casser en même temps le cou des autres. — Qui l’obligeait à les suivre ? N’était-il pas libre de leur fausser compagnie ? Le courage lui manquait. Il avait peur de rester seul, tel un enfant qu’on laisse en arrière sur la route et qui pleure. Il était comme tant d’hommes : ils n’ont aucune opinion, sinon qu’ils désapprouvent toutes les opinions exaltées ; mais pour être indépendant, il faudrait rester seul, et combien en sont capables ! Combien, même des plus clairvoyants, auront la témérité de s’arracher à l’esclavage de certains préjugés, de certains postulats qui pèsent sur tous les hommes d’une même génération ? Ce serait mettre une muraille entre soi et les autres. D’un côté, la liberté dans le désert ; de l’autre côté, les hommes. Ils n’hésitent point : ils préfèrent les hommes, le troupeau. Il sent mauvais, mais il tient chaud. Alors, ils font semblant de penser ce qu’ils ne pensent pas. Ce ne leur est pas très difficile : ils savent si peu ce qu’ils pensent !… « Connais-toi toi-même ! »… Comment le pourraient-ils, ceux qui ont à peine un moi ! Dans toute croyance collective, religieuse ou sociale, ils sont rares ceux qui croient, parce qu’ils sont rares ceux qui sont des hommes. La foi est une force héroïque ; son feu n’a jamais brûlé que quelques torches humaines ; elles-mêmes vacillent souvent. Les apôtres, les prophètes et Jésus ont douté. Les autres ne sont que des reflets, — sauf à certaines heures de sécheresse des âmes, où quelques étincelles tombées d’une grande torche embrasent toute la plaine ; puis, l’incendie s’éteint, et l’on ne voit plus luire que des charbons sous la cendre. À peine quelques centaines de chrétiens croient réellement au Christ. Les autres croient qu’ils croient, ou bien ils veulent croire.