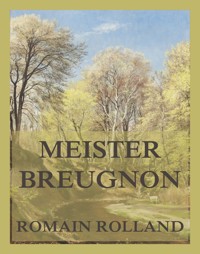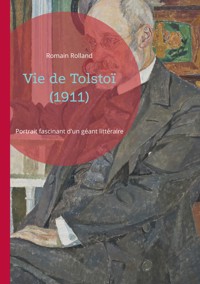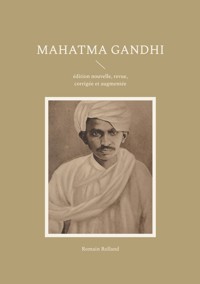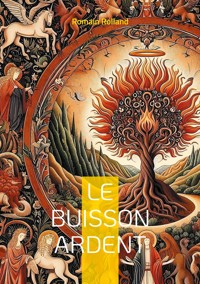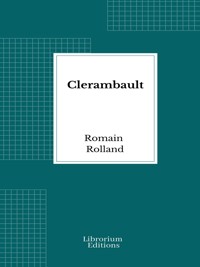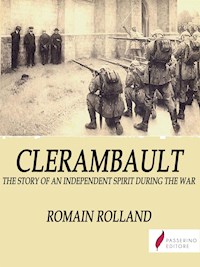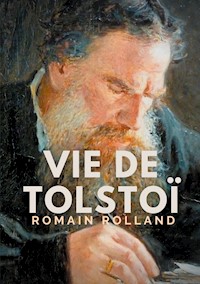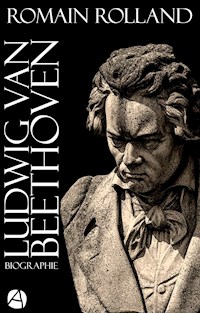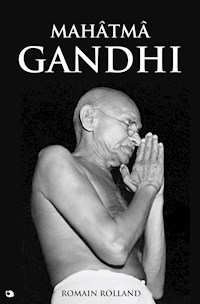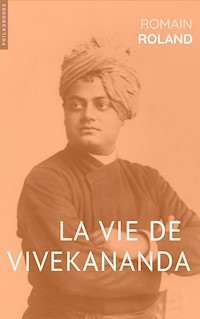Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Véritable manifeste pacifiste, "Au-dessus de la mêlée" de Romain Rolland est un texte fondateur qui appelle à la lucidité et à la non-violence face à l'horreur de la Grande Guerre. Publié en septembre 1914 dans le Journal de Genève, cet article retentissant exhorte les belligérants à prendre de la hauteur pour saisir l'ampleur du désastre qui s'annonce. Avec une clairvoyance et un courage exceptionnels, Rolland dénonce la folie meurtrière qui s'empare de l'Europe, entraînant les peuples dans une tragédie fratricide. Refusant de céder aux passions nationalistes et à la rhétorique guerrière, il en appelle à la raison, à l'humanité, à la communion des esprits par-delà les frontières. Mais "Au-dessus de la mêlée" n'est pas seulement un cri d'alarme. C'est aussi un vibrant plaidoyer pour un idéal de paix et de fraternité universelle, enraciné dans les valeurs humanistes de la culture européenne. Aux "idoles" sanglantes de la patrie et de la race, Rolland oppose la figure de "l'Homme libre", citoyen du monde et serviteur de la vérité. Incompris et vilipendé en son temps, ce texte prophétique vaudra à son auteur les pires attaques mais aussi le prix Nobel de littérature en 1915. Salué par une minorité d'intellectuels comme Bertrand Russell ou Stefan Zweig, il deviendra après-guerre un classique de la pensée pacifiste et non-violente. Plus d'un siècle après sa parution, "Au-dessus de la mêlée" n'a rien perdu de sa force et de son actualité. Face aux fanatismes et aux tentations guerrières qui menacent notre temps, la voix de Romain Rolland résonne comme un appel toujours nécessaire à l'éveil des consciences et à la fraternité humaine. Un message d'une brûlante urgence, à méditer plus que jamais en ces temps troublés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIERES
I
NTRODUCTION
I. Lettre à Gérard Hauptmann (29 août 1914)
II.
Pro Aris
(septembre 1914)
III. Au-dessus de la Mêlée (15 septembre 1914)
IV. De deux maux le moindre (10 octobre 1914)
V.
Inter Arma Caritas
(30 octobre)
VI. Au Peuple qui souffre pour la justice (2 novembre 1914)
VII. Lettre à ceux qui m'accusent (17 novembre 1914)
VIII. Les Idoles (4 décembre 1914)
IX. Pour l'Europe (9 janvier 1915)
X. Pour l'Europe : Un appel de la Hollande (15 février 1915)
XI. Lettre à Frédéric Van Eeden (12 janvier 1915)
XII. Notre Prochain, l'Ennemi (15 mars 1915)
XIII. Lettre au Journal
Svenska Dagbladet
(10 avril 1915)
XIV. Littérature de Guerre (19 avril 1915)
XV. Le Meurtre des Élites (1er juin 1915)
XVI. Jaurès (1er août 1915)
Notes
INTRODUCTION
Un grand peuple assailli par la guerre n’a pas seulement ses frontières à défendre : il a aussi sa raison. Il lui faut la sauver des hallucinations, des injustices, des sottises, que le fléau déchaîne. À chacun son office : aux armées, de garder le sol de la patrie. Aux hommes de pensée, de défendre sa pensée. S’ils la mettent au service des passions de leur peuple, il se peut qu’ils en soient d’utiles instruments ; mais ils risquent de trahir l’esprit, qui n’est pas la moindre part du patrimoine de ce peuple. Un jour, l’histoire fera le compte de chacune des nations en guerre ; elle pèsera leur somme d’erreurs, de mensonges et de folies haineuses. Tâchons que devant elle la nôtre soit légère !
On apprend à l’enfant l’Évangile de Jésus ! l’idéal chrétien. Tout, dans l’éducation qu’il reçoit à l’école, est fait pour stimuler en lui la compréhension intellectuelle de la grande famille humaine. L’enseignement classique lui fait voir, par delà les différences de races, les racines et tronc communs de notre civilisation. L’art lui fait aimer les sources profondes du génie des peuple. La science lui impose la foi dans l’unité de la raison. Le grand mouvement social qui renouvelle le monde lui montre autour de lui l’effort organisé des classes travailleuses pour s’unir en des espoirs et des luttes qui brisent les barrières des nations. Les plus lumineux génies de la terre chantent, comme Walt Whitman et Tolstoï, la fraternité universelle dans la joie ou la souffrance, ou, comme nos esprits latins, percent de leur critique les préjugés de haine et d’ignorance qui séparent les individus et les peuples.
Comme tous les hommes de mon temps, j’ai été nourri de ces pensées ; j’ai tâché, à mon tour, d’en partager le pain de vie avec mes frères plus jeunes ou moins fortunés. Quand la guerre est venue, je n’ai pas cru devoir les renier, parce que l’heure était arrivée de les mettre à l’épreuve. J’ai été outragé. Je savais que je le serais et j’allais au devant. Mais je ne savais point que je serais outragé, sans même être entendu. Pendant plusieurs mois, personne en France n’a pu connaître mes écrits que par des lambeaux de phrases artificieusement découpés, déformés par mes ennemis. C’est une grande lâcheté. Elle a duré presque un an. Si quelques journaux socialistes ou syndicalistes réussirent, çà et là, à faire passer quelques fragments[1], ce n’est qu’au mois de juin 1915 que, pour la première fois, mon principal article, celui qui était l’objet des pires accusations, — Au-dessus de la Mêlée, — datant de septembre 1914, put être publié intégralement (presque intégralement), grâce au zèle malveillant d’un pamphlétaire maladroit, à qui je suis redevable d’avoir pu faire pénétrer, pour la première fois, ma parole dans le public de France.
Un Français ne juge pas l’adversaire sans l’entendre. Qui le fait, c’est lui-même qu’il juge et qu’il condamne : car il prouve qu’il a peur de la lumière. — Je mets sous les yeux de tous, les textes diffamés[2]. Je ne les défendrai pas. Qu’ils se défendent eux-mêmes !
J’ajouterai un seul mot. Je me suis trouvé, depuis un an, bien riche en ennemis. Je tiens à leur dire ceci : ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m’apprendre la haine. Je n’ai pas affaire à eux. Ma tâche est de dire ce que je crois juste et humain. Que cela plaise ou que cela irrite, cela ne me regarde plus. Je sais que les paroles dites font d’elles-mêmes leur chemin. Je les sème dans la terre ensanglantée. J’ai confiance. La moisson lèvera.
Septembre 1915.
ROMAIN ROLLAND.
1. ↑ Un seul article, les Idoles, put, je crois, être publié en entier dans la Bataille Syndicaliste.
2. ↑ Je laisse mes articles dans l’ordre chronologique. Je n’y ai rien changé. On y remarquera, dans le trouble des événements, certaines contradictions et des jugements hâtifs que je modifierais aujourd’hui... D’une façon générale, les sentiments ont évolué de l’indignation à la pitié. À mesure que s’étend l’immensité des ruines, on sent la pauvreté des protestations, comme devant un tremblement de terre, « Il y a plus qu’une guerre, m’écrivait le vieux Bodin, le 1er octobre 1914. Ce qui se passe est comme un châtiment qui tombe sur tout le monde. »
I
LETTRE OUVERTE À GERHART HAUPTMANN
Samedi 29 août 1914[1].
Je ne suis pas, Gerhart Hauptmann, de ces Français qui traitent l’Allemagne de barbare. Je connais la grandeur intellectuelle et morale de votre puissante race. Je sais tout ce que je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ; et encore à l’heure présente, je me souviens de l’exemple et des paroles de notre Gœthe — il est à l’humanité entière — répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme, à ces hauteurs « où l'on ressent le bonheur ou le malheur des autres peuples comme le sien propre ». J’ai travaillé, toute ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations ; et les atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la ruine de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à souiller de haine mon esprit.
Quelques raisons que j’aie donc de souffrir aujourd’hui par votre Allemagne et de juger criminels la politique allemande et les moyens qu’elle emploie, je n’en rends point responsable le peuple qui la subit et s’en fait l’aveugle instrument. Ce n’est pas que je regarde, ainsi que vous, la guerre comme une fatalité. Un Français ne croit pas à la fatalité. La fatalité, c’est l’excuse des âmes sans volonté. La guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de leur stupidité. On ne peut que les plaindre, on ne peut leur en vouloir. Je ne vous reproche pas nos deuils ; les vôtres ne seront pas moindres. Si la France est ruinée, l’Allemagne le sera aussi. Je n’ai même pas élevé la voix, quand j’ai vu vos armées violer la neutralité de la noble Belgique. Ce forfait contre l’honneur, qui soulève le mépris dans toute conscience droite, est trop dans la tradition politique de vos rois de Prusse ; il ne m’a pas surpris.
Mais la fureur avec laquelle vous traitez cette nation magnanime, dont le seul crime est de défendre jusqu’au désespoir son indépendance et la justice, comme vous-mêmes, Allemands, l’avez fait en 1813 c’en est trop ! L’indignation du monde se révolte. Réservez-nous ces violences à nous Français, vos vrais ennemis ! Mais vous acharner contre vos victimes, contre ce petit peuple belge infortuné et innocent !... quelle honte !
Et non contents de vous en prendre à la Belgique vivante, vous faites la guerre aux morts, à la gloire des siècles. Vous bombardez Malines, vous incendiez Rubens. Louvain n’est plus qu’un monceau de cendres, — Louvain avec ses trésors d’art, de science, la ville sainte ! Mais qui donc êtes-vous ? et de quel nom voulez-vous qu’on vous appelle à présent, Hauptmann, qui repoussez le titre de barbares ? Êtes-vous les petit-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ? Est-ce aux armées que vous faites la guerre, ou bien à l'esprit humain ? Tuez les hommes, mais respectez les œuvres ! C’est le patrimoine du genre humain. Vous en êtes, comme nous tous, les dépositaires. En le saccageant, comme vous faites, vous vous montrez indignes de ce grand héritage, indignes de prendre rang dans la petite armée européenne qui est la garde d’honneur de la civilisation.
Ce n’est pas à l’opinion du reste de l’univers que je m’adresse contre vous. C’est à vous-même, Hauptmann. Au nom de notre Europe, dont vous avez été jusqu’à cette heure un des plus illustres champions, — au nom de cette civilisation pour laquelle les plus grands des hommes luttent depuis des siècles, — au nom de l’honneur même de votre race germanique, Gerhart Hauptmann, je vous adjure, je vous somme, vous et l’élite intellectuelle allemande où je compte tant d’amis, de protester avec la dernière énergie contre ce crime qui rejaillit sur vous.
Si vous ne le faites point, vous montrez de deux choses l’une, — ou bien que vous l’approuvez (et alors que l’opinion du monde vous écrase !) — ou bien que vous êtes impuissants à élever la voix contre les Huns qui vous commandent. Et alors, de quel droit pouvez-vous encore prétendre, comme vous l’avez écrit, que vous combattez pour la cause de la liberté et du progrès ? Vous donnez au monde la preuve qu’incapables de défendre la liberté du monde, vous l’êtes même de défendre la vôtre, et que l’élite allemande est asservie au pire despotisme, à celui qui mutile les chefs-d’œuvre et assassine l’Esprit humain.
J’attends de vous une réponse, Hauptmann, une réponse qui soit un acte. L’opinion européenne l’attend, comme moi. Songez-y : en un pareil moment, le silence même est un acte.
Journal de Genève, mercredi 2 septembre 1914.
1. ↑ Un télégramme de Berlin (Agence Wolff), reproduit par la Gazette de Lausanne du 29 août 1914, venait d’annoncer que « l’ancienne ville de Louvain, riche en œuvres d’art, n’existait plus aujourd’hui. »
II
PRO ARIS
Septembre 1914.[1]
Parmi tant de crimes de cette guerre infâme, qui nous sont tous odieux, pourquoi avons-nous choisi, pour protester contre eux, les crimes contre les choses et non contre les hommes, la destruction des œuvres et non pas celle des vies ? Plusieurs s’en sont étonnés, nous l'ont même reproché, — comme si nous n’avions pas autant de pitié qu’eux pour les corps et les cœurs des milliers de victimes qui sont crucifiées ! Mais de même qu’au-dessus des armées qui tombent plane la vision de leur amour, de la Patrie, à qui elles se sacrifient, — au-dessus de ces vies qui passent passe sur leurs épaules l'Arche sainte de l’art (et de la pensée des siècles. Les porteurs peuvent changer. Que l’Arche soit sauvée ! À l’élite du monde en incombe la garde. Et puisque le trésor commun est menacé, qu’elle se lève pour le protéger.
J’aime à voir que, d’ailleurs, ce n’est pas dans les pays latins que ce devoir sacré a pu jamais cesser d’être tenu pour le premier de tous. Notre France, qui saigne de tant d’autres blessures, n’a rien souffert de plus cruel que de l’attentat contre son Parthenon, la cathédrale de Reims, Notre-Dame de France. Les lettres que j’ai reçues de familles éprouvées, de soldats qui, depuis deux mois, supportent toutes les peines, me montrent (et j’en suis fier, pour eux et pour mon peuple) qu’aucun deuil ne leur fut plus lourd. — C’est que nous mettons l’esprit au-dessus de la chair. Bien différents en cela de ces intellectuels allemands qui, tous, à mes reproches pour les actes sacrilèges de leurs armées dévastatrices, m’ont répondu, d’une voix : « Périssent tous les chefs-d’œuvre, plutôt qu’un soldat allemand !... »
Une œuvre comme Reims est beaucoup plus qu’une vie : elle est un peuple, elle est ses siècles qui frémissent comme une symphonie dans cet orgue de pierre ; elle est ses souvenirs de joie, de gloire et de douleur, ses méditations, ses ironies, ses rêves ; elle est l’arbre de la race, dont les racines plongent au plus profond de sa terre et qui, d’un élan sublime, tend ses bras vers le ciel. Elle est bien plus encore : sa beauté qui domine les luttes des nations, est l’harmonieuse réponse faite par le genre humain à l’énigme du monde, — cette lumière de l’esprit, plus nécessaire aux âmes que celle du soleil.
Qui tue cette œuvre assassine plus qu’un homme, il assassine l’âme la plus pure d’une race. Son crime est inexpiable, et Dante l’eût puni d’une agonie éternelle de sa race, — éternellement renouvelée. Nous qui répudions l’esprit vindicatif de ce cruel génie, nous ne rendons pas un peuple responsable des actes de quelques-uns. Il nous suffit du drame qui se déroule sous nos yeux, et dont le dénouement presque infaillible doit être l'écroulement de l'hégémonie allemande. Ce qui le rend surtout poignant, c’est que pas un de ceux qui constituent l’élite intellectuelle et morale de l’Allemagne, — cette centaine de hauts esprits et ces milliers de braves cœurs, dont aucune grande nation ne fut jamais dépourvue, — pas un ne se doute vraiment des crimes de son gouvernement ; pas un, des atrocités commises en Wallonie, dans le Nord et dans l'Est français, pendant les deux ou trois premières semaines de la guerre ; pas un, (cela semble une gageure !) de la dévastation volontaire des villes de Belgique et de la ruine de Reims. S’ils venaient à envisager la réalité, je sais que beaucoup d’entre eux pleureraient de douleur et de honte ; et de tous les forfaits de l’impérialisme prussien, le pire, le plus vil, est d’avoir dissimulé ses forfaits à son peuple : car, en le privant des moyens de protester contre eux, il l’en a rendu solidaire pour des siècles ; il a abusé de son magnifique dévouement.
Certes, les intellectuels sont coupables, eux aussi. Car si l’on peut admettre que les braves gens qui, dans tous les pays, acceptent docilement les nouvelles que leur donnent en pâture leurs journaux et leurs chefs, se soient laissés duper, on ne le pardonne pas à ceux dont c’est le métier de chercher la vérité au milieu de l’erreur et de savoir ce que valent les témoignages de l’intérêt ou de la passion hallucinée ; leur devoir élémentaire (devoir de loyauté autant que de bon sens), avant de trancher dans ce débat affreux, dont l'enjeu était la destruction de peuples et de trésors de l’esprit, eût été de s’entourer des enquêtes des deux partis. Par loyalisme aveugle, par coupable confiance, ils se sont jetés tête baissée dans les filets que leur tendait leur impérialisme. Ils ont cru que le premier devoir pour eux était, les yeux fermés de défendre l’honneur de leur État contre toute accusation. Ils n’ont pas vu que le plus noble moyen de le défendre était de réprouver ses fautes et d’en laver leur patrie...
J’ai attendu des plus fiers esprits de l’Allemagne ce viril désaveu qui aurait pu la grandir, au lieu de l’humilier. La lettre que j’écrivis à l’un d’eux, au lendemain du jour où la voix brutale de l’Agence Wolff proclama pompeusement qu’il ne restait plus de Louvain qu’un monceau de cendres, — l’élite entière d’Allemagne l’a reçue en ennemie. Elle n’a pas compris que je lui offrais l’occasion de dégager l’Allemagne de l’étreinte des forfaits que commettait en son nom son Empire. Que lui demandais-je ? Que vous demandais-je à tous, artistes d’Allemagne ? — D’exprimer tout au moins un regret courageux des excès accomplis et d’oser rappeler à un pouvoir sans frein que la patrie elle-même ne peut se sauver par des crimes et qu’au-dessus de ses droits sont ceux de l’esprit humain. Je ne demandais qu’une voix, une seule qui fût libre... Aucune voix n’a parlé. Et je n’ai entendu que la clameur des troupeaux, les meutes d’intellectuels aboyant sur la piste où le chasseur les lance, cette insolente Adresse où, sans le moindre essai pour justifier ses crimes, vous avez, unanimement, déclaré qu’ils n’existaient point. Et vos théologiens, vos pasteurs, vos prédicateurs de cour, ont attesté de plus que vous étiez très justes et que vous bénissiez Dieu de vous avoir faits ainsi... Race de pharisiens ! Quel châtiment d’en haut flagellera votre orgueil sacrilège !... Ah ! vous ne vous doutez pas du mal que vous aurez fait aux vôtres ! La mégalomanie, menaçante pour le monde, d’un Ostwald ou d’un H.-S. Chamberlain[2], l’entêtement criminel des quatre-vingt-treize intellectuels à ne pas vouloir voir la vérité, auront coûté plus cher à l’Allemagne que dix défaites.
Que vous êtes maladroits ! Je crois que de tous vos défauts, la maladresse est le pire. Vous n’avez pas dit un mot, depuis le commencement de cette guerre, qui n’ait été plus funeste pour vous que toutes les paroles de vos adversaires. Les pires accusations qu’on ait portées contre vous, c’est vous qui en avez fourni, de gaieté de cœur, la preuve ou l’argument. De même que ce sont vos Agences officielles qui, dans l’illusion stupide de nous terroriser, ont lancé, les premières, les récits emphatiques de vos plus sinistres dévastations, — c’est vous qui, lorsque les plus impartiaux de vos adversaires s’efforçaient, par justice, de limiter à quelques-uns de vos chefs et de vos armées la responsabilité de ces actes, en avez rageusement réclamé votre part. C’est vous qui, au lendemain de cette ruine de Reims, qui, dans le fond du cœur, devait aussi consterner les meilleurs d’entre vous, au lieu de vous excuser, vous en êtes, par orgueil imbécile, vantés[3]. C’est vous, malheureux, vous, représentants de l’esprit, qui n’avez point cessé de célébrer la force et de mépriser les faibles, comme si vous ne saviez pas que la roue de la fortune tourne, que cette force un jour pèsera de nouveau sur vous, ainsi qu’aux siècles passés, où du moins vos grands hommes conservaient la ressource de n’avoir pas abdiqué devait elle la souveraineté de l’esprit et les droits sacrés du droit !... Quels reproches, quels remords vous vous préparez pour l’avenir, ô conducteurs hallucinés, qui menez vers le fossé votre nation qui vous suit, ainsi que les aveugles trébuchants de Brueghel !
Les tristes arguments que vous nous avez opposés, depuis deux mois !
1°La guerre est la guerre, dites-vous, c’est-à-dire sans mesure commune avec le reste des choses, au delà de la morale, de la raison, de toutes les limites de la vie ordinaire, une sorte d’état surnaturel, devant quoi il ne reste qu’à s’incliner sans discuter ;
2°L'Allemagne est l'Allemagne, c’est-à-dire sans mesure commune avec le reste des peuples ; les lois qui s’appliquent aux autres ne s’appliquent pas à elle, et les droits qu’elle s’arroge de violer le droit n’appartiennent qu’à elle. C’est ainsi qu’elle peut, sans crime, déchirer ses promesses écrites, trahir ses serments donnés, violer la neutralité des peuples qu’elle a juré de défendre. Mais elle prétend, en retour, trouver dans les peuples qu’elle outrage « de chevaleresques adversaires » ; et que cela ne soit pas et qu’ils osent se défendre, par tous les moyens et les armes qui leur restent, elle le proclame un crime !...
On reconnaît bien là les enseignements intéressés de vos maîtres prussiens ! Artistes d’Allemagne, je ne mets pas en doute votre sincérité ; mais vous n’êtes plus capables de voir la vérité ; l’impérialisme de Prusse vous a enfoncé sur les yeux et jusque sur la conscience, son casque à pointe.
« Nécessité ne connaît pas de loi. »... Voici le Onzième Commandement, le message que vous apportez aujourd’hui à l’univers, fils de Kant !... Nous l’avons entendu plus d’une fois, dans l’histoire : c’est la fameuse doctrine du Salut Public, mère des héroïsmes et des crimes. Chaque peuple y a recours, à l’heure du danger ; mais les plus grands sont ceux qui défendent contre elle leur âme immortelle. Il y a quelque quinze ans, lors de ce fameux procès où l’on vit opposé un seul homme innocent à la force de l’État, nous l’avons, nous Français, affrontée et brisée, l’idole du Salut Public, quand elle menaçait, comme disait notre Péguy, « le salut éternel de la France ».
Écoutez-le, celui que vous venez de tuer, écoutez un héros de la conscience française, écrivains qui avez la garde de la concience de l’Allemagne !
« Nos adversaires d'alors, écrit Charles Péguy, parlaient le langage de la raison d’État, du salut temporel du peuple et de la race. Et nous, par un mouvement chrétien profond, par une poussée révolutionnaire et ensemble traditionnelle de christianisme, nous n'allions pas à moins qu'à nous élever à la passion, au souci du salut éternel de ce peuple. Nous ne voulions pas que la France fût constituée en état de péché mortel. »