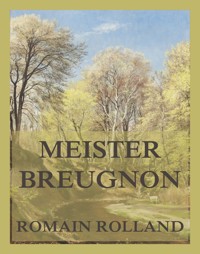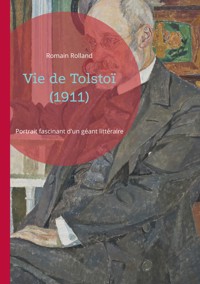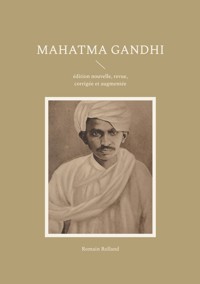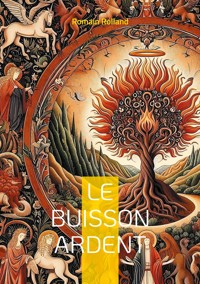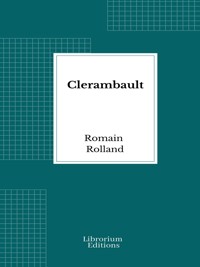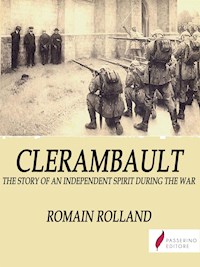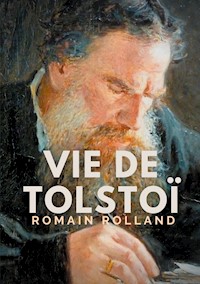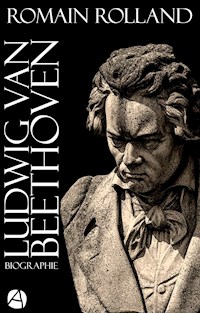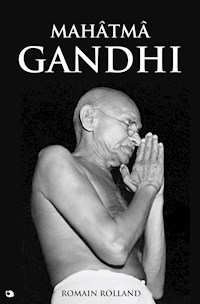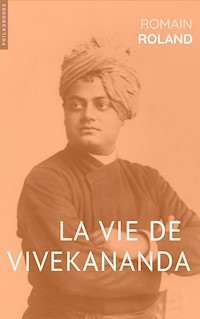
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le grand disciple, qui allait reprendre l’héritage spirituel de Ramakrishna et semer sur le monde le grain de sa pensée, était, physiquement et moralement, son antithèse absolue.
Nul n’échappait à la magie de ce regard, qui pouvait aussi bien envelopper de son charme irrésistible, étinceler d’esprit, d’ironie, de génie, se perdre dans l’extase, ou plonger impérieusement au fond des consciences et foudroyer de sa fureur.
Mais, surtout, il n’est pas un qui l’ait approché, dans l’Inde ou en Amérique, sans être saisi de sa majesté. Il était né roi. Quand ce jeune homme de vingt-neuf ans, alors inconnu, apparut, à Chicago, à la séance inaugurale du Parlement des Religions,
qu’ouvrit en septembre 1893 le cardinal Gibbons, il fit oublier tous ceux qui l’entouraient : il domina.
Sa force et sa beauté, la grâce et la dignité de son port de tête, la lumière sombre de ses yeux, sa démarche imposante, et, dès qu’il parla, la splendide musique de sa voix chaude et profonde , assujettirent la multitude de ces Anglo-Saxons d’Amérique, prévenus contre lui par leurs préjugés de couleur.
Et la pensée du guerrier-prophète de l’Inde laissa marquée sa griffe aux flancs des Etats-Unis.
Romain Rolland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La vie de Vivekananda
et l'évangile universel
Romain Rolland
Table des matières
I. La vie de Vivekananda
Prélude
1. Le « parivrajaka »
2. Le pèlerin de l’Inde
3. Le grand voyage en Occident et le Parlement des religions
4. L’Amérique, au temps du premier voyage de Vivekananda
5. La prédication en Amérique
6. La rencontre de l’Inde avec l’Europe
7. Le retour dans l’Inde
8. La fondation de la Ramakrishna mission
9. Le second voyage en Occident
10. Le départ
II. L'évangile Universel
Partie I
1. Maya et la marche à la liberté
2. Les grand-routes
3. La science religion universelle
4. Civitas dei : la cité de l’homme
5. Cave canem !
Conclusion
II. La Ramakrishna Math Et Mission
1. La Ramakrishna Math et Mission
2. Le réveil de l’Inde après Vivekananda
III. Appendice
1. Appendice Note I
2. Appendice Note II
Notes
À propos de l’auteur
La vie de Vivekananda
Prélude
Le grand disciple, qui allait reprendre l’héritage spirituel de Ramakrishna et semer sur le monde le grain de sa pensée, était, physiquement et moralement, son antithèse absolue.
Le Maître Séraphique avait passé sa vie aux pieds ou dans les bras de la Divine Aimée, la Mère — Dieu vivant. Il lui était fiancé, dès l’enfance, ainsi qu’en ces mariages de l’Inde ; avant d’avoir conscience de soi, il avait conscience qu’il l’aimait. Et s’il avait dû, par la suite, traverser pour la rejoindre des années de tourments, c’était comme en ces épopées de chevaliers errants, dont toutes les épreuves ont pour unique objet de mériter l’aimée et de la conquérir. Elle seule était au terme de toutes les routes entrecroisées dans la forêt. Elle seule. Dieu multiple, aux milliers de visages. Et quand il l’avait atteinte, il avait appris à connaître, un à un, ces visages, à la posséder toute. Ainsi, il avait étreint, en elle, le monde entier. Et le reste de sa vie s’était écoulé dans la plénitude sereine de cette Joie cosmique, dont Beethoven et Schiller ont, dans notre Occident, chanté la révélation.
Mais il l’avait réalisée mieux que nos tragiques héros. La Joie n’apparaît à Beethoven que comme un regard bleu, au travers du chaos des nuées qui s’entrechoquent. Et le Paramahamsa — le cygne de l’Inde — avait, au-delà du rideau des jours tumultueux, posé son grand vol blanc sur le lac de saphir de l’éternité.
Il n’était pas donné à ses plus fiers disciples de le suivre. Le plus puissant d’entre eux, l’esprit aux plus vastes ailes — Vivekananda — n’y parvint que par vols emportés, au milieu de tempêtes qui me font plus d’une fois songer à celles de Beethoven. Même quand il s’y pose, les voiles de sa barque se gonflent à tous les vents. Tous les cris de la terre, les souffrances du temps, l’entourent de leur cercle affamé de goélands. Toutes les passions de la force (non celles de la faiblesse) se disputent ce cœur de lion. Il est l’énergie faite homme, et il la prêche aux hommes. Pour lui, comme pour Beethoven, elle est la base de toutes les vertus. Il ira jusqu’à dire, dans sa répulsion pour la passivité dont le joug séculaire pèse sur le front bovin de l’Orient :
— « Avant tout, soyez virils et forts ! Jeunes hommes, j’ai du respect même pour le méchant, s’il est viril et fort : car sa force le fera, quelque jour, renoncer à sa méchanceté et même à toute œuvre égoïste. Et elle le mènera à la vérité1. »
Son aspect athlétique s’oppose au tendre corps si frêle — (si résistant) — de Ramakrishna. Il est grand (cinq pieds huit pouces et demi), carré d’épaules, large de poitrine, corpulent et lourd 2; des bras musculeux, exercés à tous les sports. Il a le teint olivâtre, la figure pleine, un vaste front, une robuste mâchoire3, des yeux magnifiques, larges, sombres, un peu bombés, aux lourdes paupières, dont le dessin appelle la comparaison classique avec la feuille de lotus. Nul n’échappait à la magie de ce regard, qui pouvait aussi bien envelopper de son charme irrésistible, étinceler d’esprit, d’ironie, de génie, se perdre dans l’extase, ou plonger impérieusement au fond des consciences et foudroyer de sa fureur. Mais, surtout, il n’est pas un qui l’ait approché, dans l’Inde ou en Amérique, sans être saisi de sa majesté. Il était né roi. Quand ce jeune homme de vingt-neuf ans, alors inconnu, apparut, à Chicago, à la séance inaugurale du Parlement des Religions, qu’ouvrit en septembre 1893 Ie cardinal Gibbons, il fit oublier tous ceux qui l’entouraient : il domina. Sa force et sa beauté, la grâce et la dignité de son port de tête, la lumière sombre de ses yeux, sa démarche imposante, et, dès qu’il parla, la splendide musique de sa voix chaude et profonde4, assujettirent la multitude de ces Anglo-Saxons d’Amérique, prévenus contre lui par leurs préjugés de couleur. Et la pensée du guerrier-prophète5 de l’Inde laissa marquée sa griffe aux flancs des États-Unis6.
Nul n’eût pu l’imaginer au second rang. Où il était, il était le premier. Même son maître Ramakrishna, dans une vision que j’ai rappelée7, se représente, auprès du disciple aimé, comme un enfant auprès d’un grand Rishi. Il avait beau se refuser lui — même à ces hommages, se juger durement, s’humilier, — chacun, du premier regard, reconnaissait en lui le chef, l’oint du Seigneur, l’homme marqué du sceau de la force qui commande aux hommes. Quelqu’un qui le croisa, bans le connaître, dans les Himalayas, s’arrêta, saisi, et cria :
— « Çiva !...8»
C’était comme si le dieu de sa prédilection lui eût inscrit son nom au front.
Mais ce front de maître était battu, comme une cime, par les quatre vents de l’esprit. Et bien rarement il connut le calme de l’air, les espaces limpides de la pensée, où planait le sourire de Ramakrishna. Ce corps trop puissant9, ce cerveau trop vaste, étaient le champ de bataille désigné pour tous les heurts de l’âme orageuse. Le présent et le passé, l’Orient et l’Occident, le rêve et l’action, s’y livraient assaut. Il savait trop, il pouvait trop, pour consentir à une harmonie faite du renoncement à une partie de sa nature, à une partie de la vérité. Et la synthèse des grandes forces opposées exigeait des années de combats, où son héroïsme se consuma, avec sa vie. La bataille et la vie étaient, pour lui, synonymes10... Bien court fut le lot de jours qui lui fut mesuré. Seize ans, de la mort de Ramakrishna à celle du grand disciple... Une flambée !... Il avait moins de quarante ans, quand on étendit l’athlète sur son bûcher...
Mais la flamme de ce bûcher brûle encore aujourd’hui. Et comme l’ancien phénix, de ses cendres est re-née la conscience de l’Inde — l’oiseau magique — la foi dans son unité et dans le grand Message, que depuis les Védas couvre l’esprit qui rêve d’un peuple millénaire, et dont il doit le compte au reste de l’humanité.
Le « parivrajaka »
L’appel de la terre a l’âme errante
Après la nuit de Noël 1886, que j’ai contée dans le précédent volume, — cette Veillée mystique de Baranagore, où fut fondée, dans les larmes d’amour, au souvenir du maître disparu, la nouvelle Communion des apôtres, — bien des mois et des ans s’écoulèrent avant que s’organisât l’œuvre qui devait faire passer dans l’action vivante la pensée de Ramakrishna.
Le pont était à bâtir. Et ils ne s’y décidaient point. Le seul qui en eût l’énergie et le génie constructeur — Naren1 lui-même — hésitait. Il était, comme eux tous, plus qu’eux tous, incertain, écartelé entre le rêve et l’action. Et, avant d’établir l’arche qui relierait les deux rives, il lui fallait connaître et explorer l’autre rive : — l’Inde réelle et le monde d’aujourd’hui. Mais rien encore n’était clair : la mission à venir brûlait obscurément, au cœur fiévreux du jeune prédestiné de vingt-trois ans. La tâche était si lourde, si vaste, si complexe ! Comment l’étreindre, même en esprit ? Et quand et par où commencer ? Il éloignait avec angoisse le moment de décider. Mais pouvait-il empêcher la discussion passionnée dans le secret de sa pensée ? Elle se poursuivait, chaque nuit, depuis l’adolescence, — non entre des idées, mais entre les instincts ardents et opposés de sa nature, entre les Désirs affamés : — Désir d’avoir, de vaincre, de dominer la terre. Désir de renoncer toute chose de la terre, pour avoir Dieu...2
La lutte se renouvela, toute sa vie. À ce guerrier de l’âme, à ce conquérant, il fallait tout : le monde et Dieu. Tout dominer. Tout renoncer. Le trop de forces qui gonflaient ce corps d’athlète romain et ce cerveau d’imperator exigeaient le commandement. Mais ce trop de forces, ces eaux torrentielles, quel lit assez large pour les contenir, que celui du fleuve Dieu, le don total à l’Unité ? Qui tranchera le débat d’orgueil et d’amour impérieux, des grands Désirs, frères rivaux et souverains ?
Ce fut un troisième élément, que Naren ne prévoyait point, que seul perçut de loin le regard prophétique de Ramakrishna. À une heure où les autres montraient leur inquiétude ou leur méfiance de ce jeune homme, en qui se brisaient des forces tumultueuses, le maître avait annoncé :
— « Un jour, quand Naren entrera en contact avec les souffrants, avec les misérables, l’orgueil de son caractère se fondra en un mode de compassion infinie. Sa forte foi en lui sera l’instrument qui rétablit la confiance et la foi perdues dans les cœurs découragés. Et sa libre conduite, fondée sur un puissant empire de soi, resplendira aux yeux des autres, comme la manifestation de la vraie liberté du Soi3. »
Cette rencontre avec la souffrance et la misère humaine — mais non point vague et générale — la misère précise, la misère proche, la misère de son peuple, la misère de l’Inde — devait être le grand choc sur le silex, d’où jaillit l’étincelle qui mit le feu à l’âme entière. Et sur la pierre du foyer, dans cette mission du Service humain, l’orgueil, l’ambition et l’amour, la foi, la science et l’action, toutes les forces, tous les désirs, furent jetés, furent associés, mêlèrent leurs flammes en une seule : — « Une Religion qui nous donne la foi en nous et le respect des autres, le pouvoir de nourrir des affamés, de vaincre la misère, de relever les masses. Si vous voulez trouver Dieu, servez l’homme ! 4»
Mais cette conscience de sa mission ne devait lui venir et s’imposer qu’après des années d’expériences directes, où il vit de ses yeux, il toucha de ses mains, le corps misérable et glorieux de l’humanité — sa mère l’Inde, dans sa tragique nudité.
Nous allons, avec lui, refaire le pèlerinage de ces Wanderjahre. Les premiers mois, la première année de Baranagore, furent consacrés à l’édification mutuelle des disciples. Aucun d’eux n’était disposé à prêcher les hommes. Il leur fallait se concentrer dans la recherche de la réalisation mystique ; et les délices de la vie intérieure leur faisaient détourner les yeux du dehors. Naren, qui partageait leur nostalgie de l’infini, mais qui sentait les dangers sur l’âme passive de cette attraction élémentaire, qui s’exerce comme la gravitation sur la pierre qui tombe — Naren, chez qui tout, même le rêve, était action — ne toléra point l’enlisement torpide en la méditation. Il fit de cette période de recueillement conventuel une ruche de l’intelligence laborieuse, une haute École de l’esprit. La supériorité de son génie et de son instruction avait imposé, d’emblée, à ses compagnons sa direction tacite, mais vigoureuse, bien que plusieurs d’entre eux fussent plus âgés que lui. Le dernier mot du maître, avant qu’il prît congé d’eux, n’avait-il pas été à Naren :
— « Prenez soin de ces garçons ! 5»...
Naren, résolument, prit en main la conduite de ce jeune séminaire, et il ne lui permit pas l’oisiveté en Dieu. Il les tint en haleine, il talonna sans relâche les esprits ; il leur lisait les grands livres de la pensée humaine, il leur exposait l’évolution de l’esprit universel, il les obligeait à la discussion serrée et passionnée de tous les grands problèmes philosophiques et religieux, il les orientait infatigablement vers les larges horizons de la Vérité sans frontières, qui dépasse les murs des écoles et des races, qui embrasse et unifie toutes les vérités particulières6. Cette synthèse de l’esprit achevait les promesses du message d’amour de Ramakrishna. Le maître invisible présidait à leurs entretiens.
Mais la nature du religieux Indien n’est pas — (quoi qu’on pense, en Europe, de l’immobilité asiatique) — de rester, comme les bourgeois de France, confiné au même lieu. Même les contemplatifs ont dans le sang le séculaire instinct d’errer à travers l’univers, sans lieu fixe, sans attaches, partout indépendants, et partout étrangers. Cette tendance du moine errant, qui, dans la vie religieuse hindoue, a un nom spécial, celui de Parivrajaka, ne tarda pas à faire sentir sur les frères de Baranagore sa force irrésistible. Dès le début de leur union, le groupe ne fut jamais réuni au complet. Deux des principaux, Yogananda et Latu, n’assistaient pas à la consécration de Noël 1886. D’autres avaient suivi à Brindaban la veuve de Ramakrishna. D’autres, comme le jeune Saradananda, disparaissaient brusquement, sans dire où ils allaient. Naren, qui veillait à maintenir les liens de la confrérie, était lui-même tourmenté du même désir de s’échapper... Ce besoin migrateur de l’âme, aspirant à se perdre dans l’Océan de l’air, le pigeon ramier, qui étouffe sous le toit d’un colombier !... Comment le mettre d’accord avec la fixité nécessaire à l’ordre naissant ?... — On s’arrangea, du moins, pour que toujours une portion du groupe restât à Baranagore, tandis que les autres frères suivaient « l’Appel de la Forêt ». Et l’un d’eux, — un seul : Sasi (Soshi) — ne quitta jamais le foyer. Gardien fidèle du Math, axe immobile, faîte du pigeonnier, autour duquel tournaient les volées vagabondes7...
Naren résista deux ans à la poussée de la fuite. À part de courtes visites, il resta à Baranagore jusqu’en 1888. Puis, il partit soudain, mais d’abord non pas seul, avec un compagnon ; et si intense que fût son désir d’échapper, pendant deux ans et demi il revint toujours, rappelé par ses frères ou par quelque événement imprévu. Puis, il fut débordé par la folie sacrée de l’évasion ; le désir comprimé pendant cinq ans fit sauter les écluses. Et en 1891, seul, sans second, sans nom, le bâton et le bol à la main, comme un mendiant inconnu, il s’engloutit, pour des années, dans l’immensité de l’Inde.
Une logique cachée présidait à cette course éperdue. Le mot immortel : — « Tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé » — n’a jamais été aussi vrai que pour ces âmes possédées d’un Dieu invisible, qui luttent avec lui, afin de lui arracher le secret de la mission, dont il veut les charger.
Qu’une mission lui échut, Naren n’en doutait point : sa force, son génie lui en répondaient, et la fièvre de l’heure, la misère des temps, et le muet appel qu’il entendait monter de son Inde opprimée, le tragique contraste de la grandeur auguste de son peuple millénaire, de ses destins non remplis, et de cette terre dégradée, trahie par ses enfants, cette angoisse de mort et de résurrection, de désespoir et d’amour, qui dévorait son cœur. Mais quelle serait cette mission ? Qui la lui dicterait ? Le saint maître était mort, sans la lui avoir fixée. Et parmi les vivants, qui donc 8 était capable d’éclairer son chemin ? — Dieu seul. Qu’il Le « Parivrajaka parle ! Pourquoi se tait-il ? Pourquoi me refuse-t-il sa réponse ?... Naren va le chercher.
Il quitta brusquement Calcutta, en 1888, passa par Bénarès, Dayodia, Lucknow, Agra, Brindaban, l’Inde du Nord, les Himalayas.
On ne saurait rien de ce voyage et des suivants — Naren gardant le secret de ses expériences religieuses — sans les souvenirs des frères qui l’y ont rencontré, ou accompagné9. Dès le premier de ces pèlerinages, en 1888, après Brindaban, à une petite station de chemin de fer, Hatras, il fit son premier disciple, sans le chercher, — un homme qui, sans le connaître l’instant d’avant, sous la fascination seule de son regard, laissa tout, sur le champ, pour le suivre, et lui resta fidèle jusqu’à la mort : — Sarat Chendra Gupta (qui prit le nom de Sadananda)10. Ils allaient en mendiants, souvent repoussés, parfois mourant de faim et de soif, ne se souciant point des castes, et fumant au besoin la pipe du paria. Sadananda tomba malade, et Naren le porta sur ses épaules, à travers les jungles dangereuses. Puis, la maladie le prit à son tour, et il dut rentrer à Calcutta.
Déjà, ce premier voyage avait fait resurgir devant ses yeux de voyant passionné l’Inde antique, l’Inde éternelle, la terre vivante des Védas, avec son peuple de héros et de dieux, vêtus de la gloire des légendes et de l’histoire, Aryens, Mogols et Dravidiens, — tous un11. Du premier coup, il avait réalisé l’unité spirituelle de l’Inde, l’unité de l’Asie, et cette illumination, il la communiqua à ses frères de Baranagore. De son second voyage, en 1889, à Ghazipur, il paraît avoir rapporté une intuition de l’Évangile de l’Humanité, qu’écrivaient, à leur insu, les yeux fermés, les démocraties nouvelles d’Occident. Il dit à ses frères comment, « en Occident, l’idéal ancien du droit divin, qui était jadis l’apanage d’un seul, en arrivait peu à peu à être reconnu comme la propriété de tous, sans distinction de classes, et que l’esprit humain en venait aussi à la perception de la divinité de la Nature et de l’Unité ». Il voit et proclame sur-le-champ la nécessité d’introduire dans l’Inde ces idées expérimentées avec bonheur par l’Amérique et par l’Europe. — Ainsi se manifestent, dès le début, la liberté et la largeur de cet esprit, qui cherche et veut le bien commun, le progrès spirituel de tous les hommes, par l’effort uni de tous les hommes.
Les brefs voyages suivants, de 1889 à 1890, à Allahabad et à Ghazipur, éclaircissent encore sa conception universelle. On le voit, dans ses Entretiens, à Ghazipur, qui s’achemine vers la synthèse de la foi hindoue et de la science moderne, des idéaux du Vedanta et des réalisations sociales d’aujourd’hui, de l’Esprit pur et des dieux sans nombre, qui en sont des « sous-idées » nécessaires à la faiblesse humaine, de toutes les religions, qui sont vraies toutes, en qualité de phénomènes de conscience, de méthodes variées, et d’étapes diverses du développement de l’esprit humain, qui gravit, cahin-caha, vers les sommets de son être.
Ce ne sont encore que des éclairs, de brèves ébauches de sa pensée future. Mais tout s’amasse et tout fermente dans le cerveau. Et une force énorme gonfle ce jeune homme, à l’étroit dans son couvent de Baranagore, dans le rôle présent qui lui est assigné, dans la communion même de ses amis. Il n’y tient plus ! Il lui faut briser tout ce qui le lie, jeter ces chaînes, ce rôle, ce nom, ce corps — tout ce Naren — s’en refaire d’autres, un autre moi où puisse à l’aise respirer l’être géant qui a grandi, se réenfanter : — et ce sera Vivekananda ! On dirait d’un Gargantua, qui arrache ses langes, où il étouffe... Ne parlons point du seul Appel religieux au pèlerin, qui prend congé des hommes ses frères, pour suivre Dieu ! En ce jeune athlète, qui meurt de sa force inemployée, c’est l’instinct vital qui commande et qui se traduit parfois, en une brutale parole, sur laquelle les disciples pieux jetteront un voile. Il dira, à Bénarès :
— « Je vais partir ; mais je ne reviendrai jamais, avant d’avoir éclaté sur la société comme une bombe, et qu’elle me suive comme un chien. »
Et nous savons bien que lui-même a broyé ces démons redoutables et qu’il les a ployés, au service des humbles, à la suprême humilité. Mais il nous plaît de penser que ces démons étaient en lui, qu’il suffoquait de ces forces sauvages d’orgueil et d’ambition, de ce trop pour un seul qui veut la domination, — qu’il y avait en lui un Napoléon.
Il s’arrache donc, au début de juillet 1890 — et cette fois, pour des années — à ce cher foyer de Baranagore qu’il a fondé, à ce nid de l’âme où l’a couvé Ramakrishna. Ses ailes l’emportent. Il va d’abord demander, pour le voyage au long cours, la bénédiction de la « Sainte Mère » (la veuve de Ramakrishna)12. Il veut rejeter tout attachement et faire retraite dans l’Himalaya. Mais de tous les biens, la solitude — (ce trésor ! et cet effroi des âmes grégaires !) — est le plus rude à conquérir. Parents, amis, vous le disputent. (Tolstoï l’a su, qui ne put jamais le leur reprendre, jusqu’au lit de mort d’Astapovo...) La vie sociale excipe de mille droits sur qui la fuit. Et combien plus, quand l’évadé est encore jeune prisonnier !... Naren l’apprit, à ses dépens. Mais aux dépens aussi de ceux qui l’aimaient ! Ses frères moines s’acharnaient à le suivre. Il lui fallut presque brutalement trancher ce lierre13. — Mais le monde tragique ne lui permettait pas de l’oublier. La mort d’une sœur vint le retrouver dans sa solitude. Pitoyable victime d’une société cruelle, elle lui rappelait le sort sacrifié de la femme hindoue et les douloureux problèmes de la vie de son peuple, dont il ne pouvait se désintéresser sans crime. Par une chaîne de circonstances, qu’on eût pu dire pré-établies, il était constamment arraché à cette « Beata Solitudo, Sola Beatitudo », à l’heure où il pensait enfin l’étreindre, et rejeté, errant, de ces Himalayas du silence dans les plaines où les hommes soulèvent la poussière et le bruit. De ces agitations de la pensée et des fatigues, des privations, il eut deux graves maladies, à Shrinagar et à Meerut, au pied des Himalayas, au bord du Gange ; il faillit mourir de la diphtérie. Et l’extrême faiblesse qui suivit lui rendait encore plus difficile la décision du grand voyage solitaire.
Mais il la prit. S’il devait mourir, que ce fût en route, et sur sa route, — celle que son Dieu lui avait élue ! En février 1891, malgré ses amis, seul, il partit de Delhi. C’était, cette fois, le grand départ. Comme un plongeur, il s’enfonça dans l’océan de l’Inde. Et l’océan de l’Inde le recouvrit. Il n’était plus, parmi ses flots et ses épaves, entre mille autres, qu’un sannyasin anonyme, en haillons jaunes. Mais dans ses yeux, le feu du génie. Un prince caché. Ne se déguise point qui veut !
Le pèlerin de l’Inde
Le grand périple de deux ans, autour de l’Inde, — puis, de trois ans, autour du monde — (en avait-il, dès le début, l’intuition nette ?) — était la réponse adéquate de son instinct à la double exigence de sa nature : l’indépendance et le service. Il allait, libre de tout ordre, de toute caste, de tout foyer, seul avec Dieu, errant perpétuel. Et pas une heure de sa vie qui ne le mît en contact avec les peines et les désirs et les abus et la misère et toute la fièvre des vivants, riches et pauvres, villes et champs ; il épousait leurs existences ; et le grand Livre de la vie lui révélait ce que tous les livres des bibliothèques ne peuvent donner (car ils ne sont que des herbiers), et même ce que l’ardent amour de Ramakrishna n’avait pu qu’entrevoir en rêve : — le visage tragique du jour présent, le Dieu qui se débat dans l’humanité, le cri d’appel des peuples de l’Inde, des peuples du monde, et le devoir héroïque du nouvel Œdipe, qui doit délivrer Thèbes des griffes du Sphinx, ou périr avec Thèbes.
Wanderjahre. Lehrjahre. Éducation unique... Il n’était pas seulement l’humble petit frère, qui couche dans les étables ou sur les grabats des gueux. Il était de plain-pied avec tous. Aujourd’hui, mendiant insulté, que recueillent les parias. Demain, hôte des princes, conversant en égal avec les premiers ministres et les maharajas. Frère des opprimés, penché sur leur misère. Sondant le luxe des grands, éveillant dans leur âme engourdie le souci du bien public. Contrôlant d’aussi près la science des pandits que les problèmes de l’économie industrielle et rurale, qui commandent la vie des peuples. Enseignant, s’instruisant. Et, pas à pas, se faisant la Conscience de l’Inde, son Unité et ses Destins. Ils s’incarnaient en lui. Et le monde les vit, en Vivekananda.
L’itinéraire passa par le Rajpoutana, Alwar (février-mars 1891), Jaipur, Ajmir, Khetri, Ahmedabad et le Kathiawar (fin septembre), Junagad et le Gujrat, Porbandar (séjour de huit à neuf mois), Dvaraka, Palitana la cité des temples près du golfe de Kambaze, l’État de Baroda, Khandwa, Poona, Belgauni (octobre 1892), Bangalore dans l’État de Mysore, Cochin, Malabar, l’État de Travancore, Trivandru, Madura... Il s’acheminait vers l’extrême pointe de l’immense pyramide, le cap Comorin, où s’élève le Bénarès de l’Inde du Sud, Rameswaram, la Rome du Râmâyana, et, au-delà, à Kanyakumari, le sanctuaire de la Grande Déesse (fin 1892).
Du Nord au Sud, la terre antique de l’Inde était pleine de dieux ; et la chaîne ininterrompue de leurs bras innombrables ne faisait qu’un Seul Dieu. Il en réalisait l’unité de chair et d’esprit. Il la réalisait également dans la communion des vivants de toutes castes et hors castes. Et il leur enseignait à la réaliser. Il leur portait, de l’un à l’autre, la compréhension mutuelle, — aux esprits forts, aux intellectualistes épris de l’abstrait, le respect pour les images, les Dieux idoles, — aux jeunes hommes, le devoir de l’étude des grands vieux livres du passé ; les Védas, les Pûranas, les annales anciennes — et, plus encore, leur peuple d’aujourd’hui, — à tous, le religieux amour de la mère Inde et la passion de se consacrer à sa rédemption.
Il ne prenait pas moins qu’il ne donnait. Son vaste esprit, qui pas un jour ne cessait de travailler à élargir ses connaissances1, ses expériences, épousait tous les ruisseaux de pensées qui se dispersaient et se perdaient, dans la terre de l’Inde, et dont la source lui apparaissait identique. Aussi éloigné de la dévotion aveugle des orthodoxes, qui s’engourdissaient dans l’odeur trouble des eaux stagnantes, que du rationalisme borgne des réformateurs du Brahmosamaj, qui, dans les meilleures intentions, s’acharnaient à dessécher les fontaines mystiques des énergies cachées, il eût voulu les conserver toutes, harmoniser en le drainant tout ce réseau enchevêtré des eaux d’un continent de l’âme religieuse.
Il voulait plus : – (on n’est pas impunément le contemporain des grands ingénieurs qui ouvrent le passage entre les mers et, bon gré mal gré, rejoignent les mains des continents !) — il portait partout l’Imitation de Jésus et, avec la Bhagavad, il répandait la pensée du Christ2. Aux jeunes gens, il enjoignait d’étudier la science d’Occident3. Mais l’élargissement de sa pensée ne s’exerçait pas seulement dans le champ des idées. Une révolution s’opérait dans sa vision morale des autres hommes et dans ses rapports avec eux. Si jamais fut orgueil de jeune homme, intolérance d’intellectuel, mépris d’aristocrate pour tout ce qui s’écarte de son idéal hautain de pureté, ce fut chez le jeune Narendra : — « À vingt ans — (c’est lui qui parle) — j’étais un fanatique, dépourvu de sympathie, incapable de la moindre concession. Je ne voulais même pas marcher sur le trottoir, du côté du théâtre, dans les rues de Calcutta4... »
Dès les premiers mois de son pèlerinage, chez le maharaja de Khetri près Jaipur (avril 1891), une petite danseuse lui donna, sans y penser, une leçon d’humilité. Quand elle parut, le moine dédaigneux se leva pour partir. Le prince le pria de rester. La petite danseuse chanta :
— « O Seigneur, ne considère pas mes qualités mauvaises !Tu dis. Seigneur : « À mes yeux, tout est le même5 ». Fais de nous deux le même Brahman ! Ce morceau de fer est dans la statue du temple. Cet autre est le couteau dans la main du boucher. Quand ils touchent la pierre philosophale, tous deux se transmutent en or. Donc, Seigneur, ne considère pas mes qualités mauvaises ! Tu dis :« A mes yeux, tout est le même !... »
« Cette goutte d’eau est dans la Jumna sacrée. Cette autre, dans le fossé souillé. Quand elles tombent dans le Gange, toutes deux deviennent saintes. Ainsi, Seigneur, ne considère pas mes qualités mauvaises ! Tu dis : « À mes yeux, tout est le même...6»
Naren fut bouleversé. La foi confiante de l’humble chant le pénétra, pour la vie. Bien des années après, il le rappelait avec émotion.
Un à un, ses préjugés tombaient, même ceux qu’il eût jugés le plus solidement fondés. Dans les Himalayas, il vécut parmi des races de Tibétains, qui pratiquent la polyandrie. Il était l’hôte d’une famille de six frères qui se partageaient la même femme ; et, dans son zèle de néophyte, il prétendit leur remontrer leur immoralité. Mais ce furent eux que ses leçons scandalisèrent :
— « Quel égoïsme ! dirent-ils. Vouloir se réserver sa femme pour soi seul !... » Vérité, au bas des monts. Erreur, en haut... Il aperçut la relativité de la vertu, — ou, du moins, des vertus auxquelles s’attache avec le plus d’assurance la moralité de tradition. Et une ironie transcendantale, à la Pascal, lui apprit à élargir sa conception morale, en jugeant du bien et du mal d’une race ou d’un âge, d’après les yeux de cette race ou de cet âge.
Ailleurs, il fraya avec la pègre des bas-fonds, et reconnut chez des voleurs de grand chemin « des pécheurs qui étaient des saints en puissance »7. — Partout il partagea les privations et les affronts des classes opprimées. Dans l’Inde centrale, il vécut chez une famille de balayeurs parias. Il découvrit les trésors d’âme de ce bas peuple, que foule aux pieds la société ; et sa misère le suffoqua. Il ne pouvait plus en détourner sa vue. Il sanglotait :
— « O mon pays ! O mon pays !... » en apprenant, par les journaux, qu’à Calcutta des hommes venaient de mourir de faim. Il se demandait, en se frappant la poitrine :
— « Qu’avons-nous fait, nous les soi-disant hommes de Dieu, les Sannyasins, qu’avons-nous fait pour les masses ?... »
Il se rappelait le rude mot de Ramakrishna :
— « La religion n’est pas pour les ventres vides. »
Et, s’irritant contre les spéculations intellectuelles de la foi égoïste, il fixait à la religion, pour premier devoir, « de nourrir les pauvres et de les relever »8. Il l’imposait aux riches, aux ministres, et aux princes :
— « Aucun de vous ne peut-il donner une vie pour l’amour des autres ?... La lecture du Védanta, la pratique de la méditation, laissez-les, remettez-les à une vie prochaine ! Que ce corps d’aujourd’hui soit consacré au service des autres ! Et alors, je saurai que vous n’êtes pas venus à moi en vain...9 »
Un jour prochain, sa voix pathétique devait faire retentir ce cri sublime :
— « Puissé-je naître et renaître encore et souffrir mille misères, pourvu que je puisse adorer et servir le seul Dieu qui existe, la Somme totale de toutes les âmes, et, par-dessus tout, mon Dieu les méchants, mon Dieu les misérables, mon Dieu les pauvres de toutes les races !... »
À cette date de 1892, c’est la misère proche, celle de l’Inde qui remplit toute sa pensée, bouche le jour à tout autre. Elle le poursuit, comme un tigre en chasse, du nord au sud, dans sa fuite à travers l’Inde. Elle consume ses nuits d’insomnies. Au cap Comorin, il est traqué ; elle le broie dans ses mâchoires. Cette fois, il lui abandonne son corps et son âme. Il voue sa vie aux masses malheureuses.
Mais comment leur venir en aide ? L’argent manque, et le temps presse. Ce ne sont point les cadeaux princiers de quelques maharadjahs ou les offrandes de quelques groupes de bonne volonté qui peuvent nourrir la millième partie des besoins les plus urgents. Avant que l’Inde se réveille de son ataraxie et s’organise pour le bien commun, la ruine de l’Inde sera consommée. — Il tourne les yeux vers l’Océan, l’au-delà des mers. C’est au monde entier qu’il faut s’adresser. Le monde entier a besoin de l’Inde. Le salut de l’Inde, la mort de l’Inde, seront les siens. Ces réserves immenses de l’âme, les laissera-t-il détruire, comme il a fait de celles de l’Égypte et de la Chaldée, que longtemps après il s’évertuera à exhumer, quand il n’en reste plus que des débris, dont l’âme est morte pour jamais ?... L’appel de l’Inde à l’Europe et à l’Amérique s’ébauche dans la pensée du solitaire. C’est à la fin de 1891, entre Junagad et Porbandar, qu’il paraît y avoir songé, pour la première fois. À Porbandar, où il commence l’étude du français, un pandit l’engage à se rendre en Occident, où sa pensée sera mieux comprise que dans son propre pays :
— « Prenez-le d’assaut, et revenez ! »
À Khandwa, au début de l’automne 1892, il entend parler d’un Parlement des Religions, qui doit se tenir, l’année suivante, à Chicago, et la première idée lui vient d’y prendre part. Toutefois, il s’interdit de rien tenter encore pour la réalisation du projet, et il refuse des souscriptions pour l’y aider, avant qu’il ait achevé son vœu de grand pèlerinage autour de l’Inde. À Bangalore, vers la fin d’octobre, il dit clairement au maharadjah son intention d’aller demander à l’Occident « les moyens d’améliorer la situation matérielle de l’Inde », et de lui apporter, en échange, l’Évangile du Védânta. À la fin de 1892, il est décidé.
À cette date, il se trouve aux bornes ultimes de l’Inde, à l’extrême pointe méridionale, d’où Hanuman le dieu singe fit son bond fabuleux. Lui, qui est un homme comme nous et qui ne dispose pas du chemin des demi-dieux, c’est sur la plante de ses pieds qu’il a traversé l’immense terre indienne. Son corps, depuis deux ans, a connu, tout du long, le contact de ce grand corps ; il a eu à souffrir de la faim, de la soif, de la nature meurtrière, des hommes insultants ; il arrive exténué. Et, au cap Comorin, il n’a pas une monnaie pour payer le bateau qui mène au but de son pèlerinage, au Saint des Saints, Kanyakumari : il se jette à la mer, et nage au milieu des requins... Le voici arrivé ; et de là, se retournant, comme du haut d’un mont, il embrasse toute l’Inde qu’il vient de parcourir, et le monde de pensées qui l’assiègent depuis deux ans. Depuis deux ans, il vit dans un bouillonnement, une fièvre le dévore, il porte « une âme en feu », il est « un ouragan »10. Tels les suppliciés qui subissaient jadis la torture de l’eau, il se sent submergé par les torrents d’énergie qu’il accumule ; les parois de son être vont se briser11... Et sur cette terrasse de tour, qu’il vient d’escalader, aux limites du monde, et d’où le panorama du monde se déroule, — au moment qu’il s’arrête, le sang gronde en ses tempes, comme la mer à ses pieds ; il est près de tomber. C’est le suprême assaut des dieux qui se heurtent en lui... Quand l’assaut est fini, la première bataille est gagnée. La lumière s’est faite. Il a vu le chemin qui l’attend. Sa mission est choisie.
Il regagne à la nage le continent de l’Inde. Par la côte opposée, il remonte vers le Nord. À pied, par Ramnad et par Pondichéry, il se rend à Madras. Et là, dans les premières semaines de 1893, il proclame publiquement sa volonté de Mission en Occident12. Son nom, sans qu’il l’ait cherché, s’est déjà répandu ; dans cette ville de Madras, intelligente, vibrante, où il fait deux séjours, il est assiégé de visiteurs, et il trouve son premier groupe de disciples dévoués, qui se consacrent à lui et qui ne l’abandonneront plus ; quand il sera parti, ils continueront de le soutenir, avec leurs lettres et avec leur foi ; et lui, des terres lointaines, maintiendra sa direction sur les amis de Madras. Son amour brûlant pour l’Inde a éveillé en eux des échos passionnés. Et leur enthousiasme décuple la puissance de sa conviction. Il parle contre la recherche du salut personnel, pour le salut public, pour la régénération de la mère patrie, pour la résurrection des forces spirituelles de l’Inde et leur rayonnement sur l’univers...
— «Le temps est venu... La foi des Rishis doit se faire dynamique... Il faut sortir de soi... »
Des nababs, des banquiers, lui offrent de l’argent pour le voyage d’outre-mer. Il refuse. Il demande à ses disciples qui cherchent des souscriptions, de s’adresser plutôt aux classes moyennes : car...
— «... c’est pour le peuple et les pauvres que je vais !... »
Ainsi qu’il avait fait, au début de son pèlerinage, il demande à « la Sainte Mère » (la veuve de Ramakrishna) sa bénédiction pour le lointain voyage. Et elle lui envoie celle de Ramakrishna, qui la lui a remise en rêve, pour le disciple aimé.
Il ne paraît pas qu’il ait écrit à ses frères spirituels de Baranagore : (sans doute, pensait-il que ces contemplatifs, habitués à la chaleur du nid, seraient effarouchés de ses idées de service social et de voyages d’évangélisation au pays des gentils ; elles troublent la quiétude pieuse des âmes qui se sauvent, sans s’inquiéter des autres). — Mais le hasard voulut que, presque à la veille de son départ, à la station du Mont-Abu, près de Bombay, il rencontra deux d’entre eux, Brahmananda et Turiyananda ; et il leur dit, avec une passion pathétique, dont l’ébranlement se communiqua à Baranagore13, l’appel impérieux de l’Inde souffrante qui l’obligeait à partir :
— « J’ai voyagé par toute l’Inde, et ç’a été pour moi une torture de voir la pauvreté et la misère terribles des masses. Je ne puis retenir mes larmes. C’est à présent ma ferme conviction qu’il est inutile de prêcher aux malheureux la religion, sans soulager leur pauvreté et leurs souffrances. C’est pour cette raison, c’est pour sauver les pauvres de l’Inde, que je vais partir pour l’Amérique14. »
Il se rendit à Khetri, où son ami le maharaja lui donna Le Pèlerin de l’Inde, son Dewan (premier ministre), pour l’escorter jusqu’à Bombay, où il s’embarqua. Au moment du départ, il se revêtit,' en même temps que de la robe de soie rouge et du turban ocre, du nom de Vivekananda qu’il allait imposer au monde15.
Le grand voyage en Occident et le Parlement des religions
Ce voyage est, en vérité, une étonnante aventure. Le jeune Swami s’y lance, au hasard, les yeux fermés. Il a entendu parler vaguement d’un Parlement des Religions, qui doit s’ouvrir, quelque part, un jour, en Amérique ; et il s’y rend, sans que ni lui, ni ses disciples et amis indiens, étudiants, pandits, ministres, ou maharadjahs, aient pris la peine de s’informer. Il ne sait rien, ni la date exacte, ni les conditions d’admission. Il n’est muni d’aucune pièce qui l’accrédite. Il va devant lui, sûr de son fait, comme s’il lui suffisait de se présenter, à son heure — à l’heure de Dieu. Et bien que le maharajas de Khetri lui ait fait prendre son billet sur le bateau, et, malgré lui, l’ait équipé de cette belle robe, qui ne fera pas moins que son éloquence pour fasciner la badauderie américaine, ni lui ni les autres n’ont songé aux conditions de climat et aux coutumes : il gèlera sur le bateau, en arrivant au Canada : il est en costume d’apparat et de promenade dans l’Inde.
Il part de Bombay, le 31 mai 1893, passe par Ceylan, Penhong, Singapour, Hongkong d’où il va visiter Canton, Nagasaki d’où il se rend par terre à Yokohama, voyant Osaka, Kioto et Tokio. Partout, en Chine comme au Japon, son attention est attirée par tout ce qui peut confirmer son hypothèse — sa conviction — du rayonnement religieux de l’Inde antique sur les Empires d’Extrême-Orient, et de l’unité spirituelle d’Asie1. En même temps, la pensée des maux dont souffre son pays ne le quitte point ; et la vue des progrès réalisés par le Japon ravive la blessure. Il va de Yokohama à Vancouver ; et, par le train, il se trouve vers la mi-juillet, tout étourdi, à Chicago. Le long de sa route, il a laissé ses plumes. Il est, pour les tire-laine, un gibier indiqué : on le voit de loin ! Et d’abord, ce grand enfant erre en badaud, bouche bée, dans la foire mondiale qu’est l’Exposition universelle de Chicago. Tout lui est neuf et le frappe de stupeur. Il n’eût jamais imaginé la puissance, la richesse, le génie d’invention de ce monde d’Occident. D’une vitalité plus forte et plus sensible à la force d’un Tagore, qu’un Gandhi, oppressés par la frénésie de mouvement et de bruit, par le machinisme européo-américain (surtout américain), Vivekananda y respire à l’aise ; il en subit la griserie exaltante, et son premier élan est de juvénile adhésion ; il ne ménage point son admiration. Pendant douze jours, il emplit ses yeux avides de ce monde nouveau. Puis, il songe à se rendre au bureau d’informations pour le Parlement des Religions... Ô stupeur ! Il apprend que le Parlement ne s’ouvre qu’après le10 septembre — que, pour l’inscription des délégués, le délai est passé — et qu’au reste, on n’accepte aucune inscription sans références officielles. Or, il n’en a aucune, il est un inconnu, qu’aucun groupe reconnu n’accrédite ; et sa bourse se vide ; elle ne lui permettra pas d’attendre jusqu’à la date du Congrès... Il est atterré. Il câble sa détresse à des amis de Madras, pour qu’une société religieuse officielle lui accorde une subvention. Mais les sociétés officielles ne pardonnent point aux indépendants, qui ont osé se passer d’elles. Un chef de cette société lance cette réponse :
— « Que le diable crève de froid ! 2».
(Let the devil die of cold !)
Le diable ne meurt ni ne se rend... Et, s’en remettant au sort, au lieu de couver, inactif, les quelques dollars qui lui restent, il les dépense, à visiter Boston. Le sort l’aide. Le sort aide toujours ceux qui savent l’aider. Un Vivekananda ne passe nulle part inaperçu. Cet inconnu fascine. Dans le wagon pour Boston, son aspect, ses réponses, frappent une voisine, une riche dame des Massachusetts, qui le questionne, s’intéresse à lui, l’invite dans sa maison, le présente à l’helléniste J. H. Wright, professeur à Harvard ; et celui-ci, aussitôt saisi par le génie du jeune Hindou, se met à son service : il insiste pour que Vivekananda représente l’hindouisme, au Parlement des Religions ; il écrit au président du Comité ; il offre au pèlerin sans ressources un billet de chemin de fer pour Chicago, des lettres de recommandation pour la commission des logements. Bref, tout est aplani. Vivekananda retourne à Chicago. Le train arrive tard ; et l’étourdi, qui a perdu l’adresse du Comité, ne sait où aller. Nul ne daigne renseigner cet homme de couleur. Il voit une grande caisse vide, dans un coin de la gare, il s’y allonge, et dort. Au matin, il va cherchant son chemin et mendiant, de porte en porte, comme un sannyasin. Mais il est dans une ville qui connaît, comme Panurge, mille et une manières de soutirer de l’argent — hors une, celle de Saint-François, la mendicité de Dieu. J’ajoute que le quartier où il se trouve ne parle qu’allemand, personne ne le comprend : on le traite de nègre, et on lui ferme les portes au nez. Après avoir longtemps erré, il s’assied dans la rue, épuisé. D’une fenêtre d’en face, on le remarque, on lui demande s’il n’est pas délégué au Parlement des Religions, on l’invite à entrer ; et une fois de plus, le sort lui a fait trouver une de celles qui seront ses meilleurs partisans américains3. Quand il est reposé, on l’accompagne au Parlement. Et il y est logé. L’aventureux voyage, où il a failli sombrer, le mène cette fois au port. Mais ce n’est point le repos, c’est l’action qui commence. Et maintenant que la part a été faite aux hasards, place à la volonté ! Cet inconnu d’hier, ce mendiant, cet homme au sang méprisé par le Mob où confluent les résidus de plus d’une demi-douzaine des populaces de l’univers, — du premier coup, il va imposer sa royauté du génie.
Le lundi 11 septembre 1893, Ie Parlement ouvrit ses assises. Le cardinal Gibbons siégeait au centre. Autour de lui, à droite, à gauche, les délégués orientaux : Protap Chunder Mazoombar4, chef du Brahmosamaj, un vieil ami de Vivekananda, représentant les théistes de l’Inde, avec Nagarkar, de Bombay ; Dharmapala, représentant les bouddhistes de Ceylan ; Gandhi5, représentant les Jaïns ; Chakravarti, représentant, avec Annie Besant, la Société théosophique. — Mais de tous, le jeune inconnu qui ne représentait rien, qui représentait tout, l’homme d’aucune secte, l’homme de l’Inde entière, aimantait les regards des milliers d’assistants6. Sa fascinante figure, sa noblesse altière — et l’éclatant plumage7, qui rehaussait l’effet de cette apparition d’un monde légendaire — cachaient son émotion. Il n’en a point fait mystère. C’était la première fois qu’il avait à parler devant de telles assemblées et quand les délégués, présentés un à un, eurent à s’annoncer eux-mêmes au public, en une brève harangue, Vivekananda fit reculer son tour, d’heure en heure, deux ou trois fois, jusqu’à la fin de la journée8.
Mais alors ce fut un jet de flamme. Dans le gris sur gris de toutes les froides dissertations, il incendia les âmes de cette foule qui écoutait. À peine eut-il prononcé les premiers mots bien simples :
— « Sœurs et frères d’Amérique !... »
que des centaines se levaient de leur place et l’acclamaient. Il se demanda si c’était de lui qu’il s’agissait. Il était le premier, sans s’en douter, qui fût sorti du formalisme du Congrès et qui parlât aux masses le langage qu’elles attendaient. Le silence rétabli, il salua la plus jeune des nations, au nom du plus ancien ordre monastique du monde — l’ordre védique des Sannyasins. Il présenta l’hindouisme, comme la mère des religions, ayant apporté aux hommes ce double précepte :
– « Acceptez-vous, comprenez-vous les uns les autres !
Il cita ces deux beaux passages de livres sacrés :
« Qui vient à Moi, sous quelque forme que ce soit. Je viens à lui. »
« Tous les hommes peinent par des voies qui, à la fin, mènent à Moi. »
Chacun des autres orateurs avait parlé de son Dieu, du Dieu de sa secte. Lui — lui seul — parlait de leurs Dieux à tous, et les embrassait dans l’Être universel. C’était le souffle de Ramakrishna qui, par la bouche de son grand disciple, faisait tomber les frontières. Pour un instant, il n’y eut plus de Pyrénées ! Le Parlement des Religions fit une ovation au jeune orateur.
Les jours suivants, il reprit la parole, dix ou douze fois9. Et à chaque fois, il reprenait, avec de nouveaux arguments et la même force de conviction, sa thèse d’une Religion universelle, sans limites de temps ou d’espace, fédéralisant tous les Credo de l’esprit humain, depuis le fétichisme asservi du sauvage jusqu’aux plus libres affirmations créatrices de la science moderne, et les harmonisant en une grandiose synthèse, qui, loin d’opprimer l’espoir d’un seul, aidât tous les espoirs à croître et à fleurir, selon la nature propre de chacun 10. Nul autre dogme que la divinité inscrite en l’homme, et son pouvoir d’évolution indéfinie...
– « Offrez cette religion au monde, et toutes les nations du monde vous suivront. Le concile d’Açoka11 était celui de la foi bouddhiste. Le concile d’Akbar12 n’était qu’une Académie de salon. Il est réservé à l’Amérique de proclamer au globe entier que le Divin est dans toutes les religions. Puisse vous inspirer Celui qui est le Brahman des Hindous, le Ahura Mazda des Zoroastriens, le Bouddha des Bouddhistes, le Jéhovah des Juifs, le Père Céleste des chrétiens !...13 Le chrétien n’a pas à devenir hindouiste ou bouddhiste. Ni l’hindouiste ou le bouddhiste, chrétien. Mais chacun doit s’assimiler l’esprit des autres, sans cesser de maintenir son individualisme et de croître selon ses lois propres... Le Parlement des Religions a prouvé que la sainteté, la pureté, la charité, ne sont la possession exclusive d’aucune église du monde, et que chaque foi a produit des hommes et des femmes qui sont de sublimes exemplaires de l’humanité... Sur la bannière de chaque religion, il sera bientôt écrit, en dépit de sa résistance : « Entr’aide et non combat. Pénétration mutuelle, et non destruction. Harmonie et paix, et non stériles discussions14. »
L’effet de ces fortes paroles fut immense. Par-dessus la tête des représentants officiels du Parlement, elles s’adressaient à tous, et elles remuèrent l’opinion. La célébrité de Vivekananda instantanément rayonna ; et l’Inde entière en bénéficia. La presse américaine le reconnut : «Il est sans aucun doute la plus grande figure, au Parlement des Religions. Nous sentions, en l’écoutant, l’absurdité d’envoyer des missionnaires chez cette savante nation...15»
On imagine qu’un tel aveu ne pouvait caresser l’oreille des missionnaires chrétiens. Aussi, le succès de Vivekananda souleva-t-il parmi eux d’âpres rancîmes, qui devaient ne point reculer devant l’emploi des armes les moins honorables : Il n’aigrit pas moins la jalousie de certains représentants hindous, qui se voyaient éclipsés par ce «moine vagabond», sans titres et sans attaches. Et la théosophie, pour qui Vivekananda ne fut jamais tendre ne lui pardonna point16.
Mais en cette première heure de la gloire naissante — ce soleil qui se lève — l’éclat de la lumière étouffa toutes les ombres. Vivekananda se trouva l’homme du jour.
Que pense-t-on qu’il éprouva de cette victoire ? Il en pleura. Le moine errant voyait que la vie de libre solitude avec Dieu était finie. Quelle âme religieuse ne comprend ces regrets ? Lui-même l’avait voulu... Non ! Il avait été voulu par la force inconnue, qui lui dictait sa mission... Mais l’autre voix intérieure, qui lui disait : « Renonce ! Vis en Dieu !... » Jamais il ne put satisfaire à l’une, sans manquer partiellement à l’autre. D’où les crises périodiques de ce génie orageux, dont les tourments, en apparence contradictoires, logiques cependant, n’ont jamais pu être compris par les esprits tout d’une pièce : ceux qui n’ont qu’une pensée font de leur pauvreté une vertu obligatoire et traitent de confusion ou de duplicité l’effort puissant et pathétique des âmes trop riches vers l’harmonie. Vivekananda fut et sera toujours en butte à ces interprétations malveillantes, que sa fierté hautaine ne faisait rien pour pallier.
La complexité n’était pas seulement dans son esprit, elle était dans la situation même. Après comme avant le succès (et peut-être davantage après), sa tâche était ardue. Après avoir failli succomber de pauvreté, il risquait d’être accablé sous la richesse. Car le snobisme américain s’était jeté sur lui, et, dans le premier mouvement, menaçait de l’étouffer sous son luxe et sous ses vanités. Vivekananda souffrait jusqu’au vomissement, de cet argent gâché. Dans sa chambre, la nuit, il était pris de crises de désespoir, il se roulait par terre, en songeant aux peuples qui mouraient de faim :
— « O Mère, gémissait-il, que ferai-je de la renommée, quand mon peuple gît dans la misère !... »
Autant pour servir la cause de cette Inde infortunée que pour s’affranchir de la tutelle de ses riches protecteurs, il accepta l’offre d’un bureau de conférences, pour une tournée aux États-Unis : East et Middle West, Chicago, Iowa, Des Moines, Saint Louis, Minneapolis, Detroit, Boston, Cambridge, Baltimore, Washington, New York, etc. Le moyen était risqué. Mais si l’on s’imaginait qu’il allait, à l’instar de tant d’autres conférenciers, acheter les applaudissements et les dollars, en passant l’encensoir sous le nez du public américain, on fut vite détrompé !...
La première impression de saisissement et d’admiration devant la formidable puissance de la jeune République s’était dissipée. Vivekananda, presque aussitôt, se heurta à la brutalité, à l’inhumanité, à la petitesse d’esprit, à l’étroit fanatisme, à la monumentale ignorance, à cette écrasante incompréhension, candide et sûre de soi, à l’égard de tout ce qui pense, à l’égard de tout ce qui croit, à l’égard de tout ce qui vit autrement que la nation parangon du genre humain... Il n’était point patient. Il ne ménagea rien. Il stigmatisa les vices et les crimes de la civilisation d’Occident, ses caractères de violence, de pillage, de destruction. Une fois qu’il devait, à Boston, parler d’un beau sujet religieux qui lui était particulièrement cher17, il ressentit une telle répulsion, à la vue de l’auditoire, de ces gueules rusées et cruelles de gens d’affaires et du monde, qu’il se refusa à leur livrer l’accès de son sanctuaire, et, brusquement, changeant de sujet, il chargea avec fureur contre la civilisation, dont ces renards et ces loups étaient les représentants18. Le scandale fut éclatant. Des centaines d’auditeurs quittèrent la salle avec fracas. Et la presse s’enflamma.
Il fut surtout implacable pour le faux christianisme, le mensonge religieux : — « Cessez votre vantardise ! Qu’est-ce que votre christianisme a jamais fait dans le monde sans l’épée ?... Votre religion est prêchée, au nom du luxe. Tout est hypocrisie, dans ce que j’ai entendu prêcher ici... Tout cet amas de richesses, qui se recommande du Christ ! Christ ne trouverait pas chez vous une pierre, pour y poser sa tête... Vous n’êtes pas chrétiens. Retournez au Christ !... »
Une explosion de colère répondit à cette méprisante leçon. À dater de ce jour, il ne cessa d’avoir à ses talons une bande de clergymen, qui le poursuivirent de leurs invectives et de leurs accusations, allant jusqu’à répandre en Amérique et dans l’Inde des calomnies infamantes sur sa vie et ses mœurs19. Le moins honteux n’est pas que certains représentants hindous de sociétés rivales, offusqués par la gloire de Vivekananda, ne craignirent point de ramasser ces bas commérages de missionnaires haineux. Et, à leur tour, ces missionnaires chrétiens, reprenant les armes fournies par ces Hindous jaloux20, dénonçaient dans l’Inde, avec un zèle comique, le libre Sannyasin qui n’observait point en Amérique le régime strict commandé par l’hindouisme orthodoxe21. Vivekananda vit, avec dégoût, lui revenir de l’Inde, dans les lettres apeurées de ses disciples, l’écume de cette vague fielleuse des dévots. Avec quelle hauteur il la rejette à la face de ceux qui l’en éclaboussent !
— « Croyez-vous que je sois né pour vivre et pour mourir dans la peau d’un de ces lâches serviteurs de castes, superstitieux, impitoyables, hypocrites, athées, que vous ne trouvez que parmi les Hindous cultivés ? Je hais la lâcheté. Je ne veux rien avoir à faire avec ces lâches... J’appartiens au monde, autant qu’à l’Inde. Il ne faut pas plaisanter là-dessus ! Quel pays a un droit spécial sur moi ? Suis-je l’esclave de quelque nation ?... Je sens, derrière moi, un pouvoir plus grand que l’homme ou que le Dieu, ou que le diable !... »
Une lettre d’un de ses disciples américains, Swami Kripananda22, nous brosse un tableau rétrospectif de ses tribulations aux États-Unis :
« Cette serre chaude de monstruosités pseudo-religieuses, dévorée d’une soif morbide de l’anormal, de l’occulte, de l’exceptionnel, où une crédulité insensée fait pulluler des centaines de sociétés : gobelins, revenants, mahâtmâs, faux prophètes, cet hospice d’aliénés de toutes les couleurs, était pour Vivekananda un milieu abominable. Il lui fallait d’abord nettoyer cette écurie d’Augias... »
Il envoya à tous les diables la foule de badauds, de bateleurs, de pêcheurs en eau trouble, de gobeurs, accourue à ses premières conférences. Tout de suite, il avait reçu d’intrigants, d’affairistes, de charlatans religieux, des offres d’association, des promesses, des menaces, des lettres de chantage. Inutile de dire leur effet sur un tel caractère. Il ne toléra point la moindre emprise sur lui. Il rejeta toute alliance d’une secte contre une autre. Et pas une fois, il n’évita l’occasion d’engager la lutte publique, et sans merci, contre les « combinaisons » qui voulaient l’utiliser. Il faut se hâter de dire, pour l’honneur de l’Amérique, que cette intransigeance morale, ce viril idéalisme, cette intrépide loyauté lui attirèrent de toutes parts une élite de défenseurs et d’admirateurs, dont un groupe devait former ses premiers disciples d’Occident et les ouvriers les plus actifs de son œuvre de régénération hindoue.
L’Amérique, au temps du premier voyage de Vivekananda
LES PRÉCURSEURS ANGLO-SAXONS DE L’ESPRIT D’ASIE : EMERSON, THOREAU, WALT WHITMAN
Il y aurait grand intérêt à connaître avec exactitude comment l’esprit américain avait été, au cours du XIX e siècle, pénétré, directement ou indirectement, par des infiltrations hindoues : car il n’est point douteux qu’elles n’aient contribué à la formation de l’étrange mentalité morale et religieuse des États-Unis d’aujourd’hui, qu’un pur Européen a tant de peine à comprendre — cette mixture étonnante de puritanisme anglo-saxon, d’optimisme d’action yankee, de pragmatisme, de scientisme, et de pseudo-védantisme. Je ne sache pas qu’un historien s’en soit sérieusement occupé. C’est pourtant un problème psychologique de premier ordre, qui intéresse l’histoire de notre civilisation. Je n’ai pas les moyens de le résoudre, actuellement. Mais je puis au moins en dégager quelques éléments.
Il semble bien qu’un des introducteurs principaux de la pensée hindoue aux États-Unis ait été Emerson1. Et Emerson paraît lui-même avoir subi fortement, en ceci, l’impulsion de Thoreau.
Il était prédisposé à ces influences ; dès 1830, elles commencent à poindre dans son Journal, où il note des références à des textes religieux hindous. Son fameux discours de 1838, à l’Université de Harvard, qui fit scandale en son temps, énonce une croyance au divin dans l’homme, assez apparentée au concept de l’âme Atman Brahman. Sans doute, il y attache étroitement une acception morale ou moraliste, qui est sa marque propre et celle de sa race. Mais l’aboutissement en est la réalisation extatique d’un véritable yoga de la « justice », conçue dans le double sens de bien moral et d’équilibre cosmique ; et s’y mêlent à la fois Karma (action), bhakti (amour) et jnâna (sagesse)2.
Emerson avait assez peu de méthode dans sa façon de lire, comme d’écrire ; et Cabot, dans le Mémoire qu’il lui a consacré, nous dit qu’il se contentait volontiers d’extraits et de citations, plutôt que de l’ensemble des livres. Mais Thoreau était grand liseur ; et entre 1837 et 1862, il voisinait avec Emerson. En juillet 1846, Emerson note que Thoreau lui a lu des passages de sa « Semaine sur les rivières Concord et Merrimack ». Or cette « Semaine » (Week, section : Monday) est un flot bouillonnant d’enthousiasme pour la Gita, pour les grands poèmes et les hautes philosophies de l’Inde. Thoreau voudrait une Joint Bible (une Bible combinée) des Écritures asiatiques : hindoues, chinoises, persanes, hébraïques, « à porter jusqu’aux confins de la terre », et il prend pour devise : « Ex Oriente lux »3.
On peut penser que ces suggestions ne furent pas perdues pour Emerson, et que le brûlant Asiatisme de Thoreau se communiqua à lui.
C’était le temps où le « Club transcendental », qu’il avait fondé à Boston, était en pleine effervescence ; et, depuis 1840, son journal trimestriel, qu’il dirigeait avec l’Hypatie américaine, Marguerite Fuller, the Dial, publiait des traductions des langues orientales. L’ébranlement produit en lui par la pensée de l’Inde dut être bien fort, pour qu’il en vînt à écrire, en 1856, une poésie aussi profondément védantiste que son beau « Brahma »4.
Il faut penser que la Nouvelle-Angleterre traversait alors une crise de renouvellement spirituel et d’idéalisme enivré, qui répondait (avec des éléments bien différents, moins cultivés, plus robustes, infiniment plus près de la nature), à la flambée idéaliste de notre Europe d’avant 18485. L’anarchique Brookfarm de George Ripley (entre 1840 et 1847), la fiévreuse assemblée des Amis du progrès universel, à Boston, en 1840, groupaient des hommes et des femmes de toutes les opinions et de toutes les professions, brûlants d’énergies primitives, qui aspiraient à se libérer des mensonges du passé sans savoir quelle vérité adopter : car la masse humaine ne peut vivre si elle ne peut se persuader qu’elle possède La Vérité6.
Hélas ! celle que le demi-siècle américain qui suivit a épousée, n’a répondu guère à la généreuse attente de la lune de miel ! La vérité n’était point mûre. Ni surtout ceux qui la voulaient prendre.