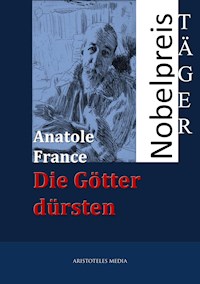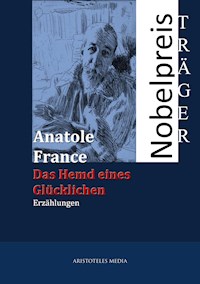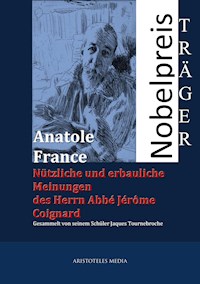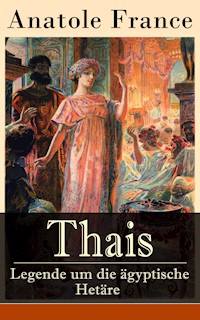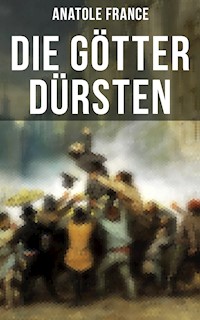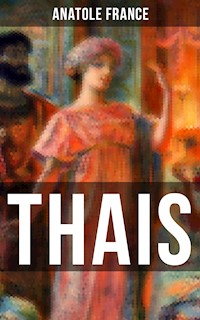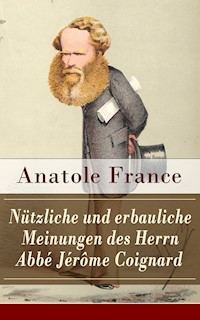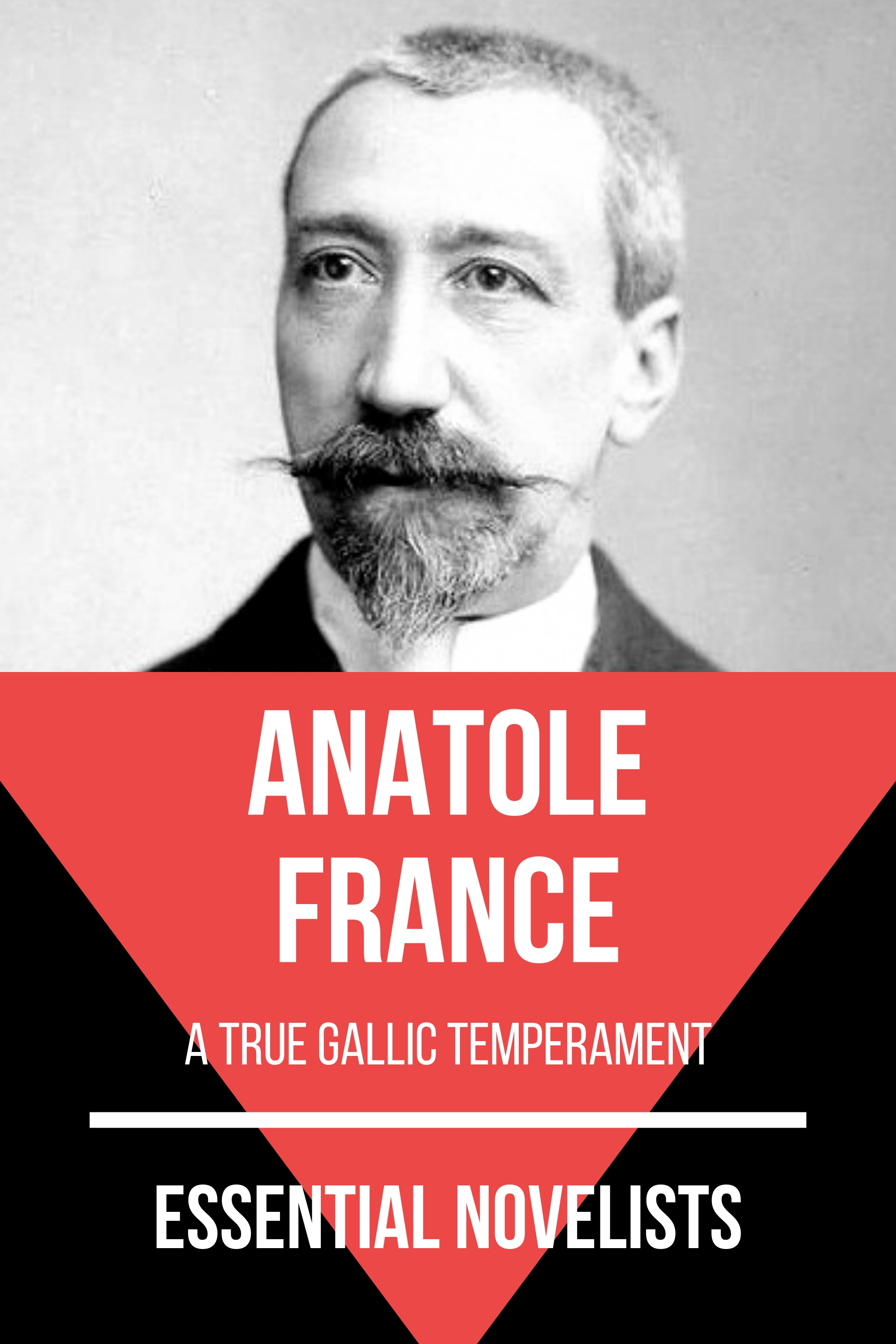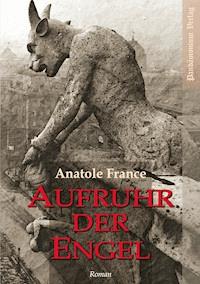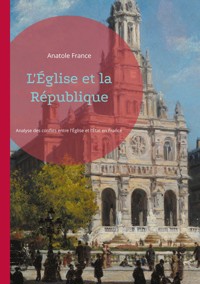Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Les Autels de la peur" est un court roman d'Anatole France, publié initialement en feuilletons en 1884. Ce texte, considéré comme une esquisse de son oeuvre ultérieure "Les Dieux ont soif", plonge le lecteur dans l'atmosphère tumultueuse de la Révolution française. À travers une série de tableaux chronologiques, France dépeint l'évolution mortifère et haineuse de cette période historique. Le récit suit un promeneur solitaire, dont la rêverie est interrompue par les échos de la révolution qui résonnent dans un Paris déserté. Ce personnage incarne les tensions internes et les réflexions philosophiques sur la nature humaine face à la violence et au changement. L'écriture de France, reconnue pour sa pureté stylistique, offre une exploration introspective des émotions et des peurs qui hantent les individus en temps de crise. Ce roman, bien que daté, reste une lecture agréable grâce à la maîtrise narrative de l'auteur, qui parvient à captiver par la profondeur de ses observations sociales et psychologiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
I. 14 JUILLET 1789
II. 9 JUILLET 1790
III. 15 SEPTEMBRE 1792
IV. 12 BRUMAIRE AN II
V. 12 NIVÔSE AN II (1er janvier 1794)
VI. 13-17 FLORÉAL AN II
VII. 14-22 FLORÉAL AN II
VIII. 14-22 FLORÉAL AN II
IX. 26 FLORÉAL AN II
X. 26 FLORÉAL AN II
XI. 27 FLORÉAL AN II
I.
14 JUILLET 1789
Le Cours-la-Reine était désert. Le grand silence des jours d’été régnait sur les vertes berges de la Seine, sur les vieux hêtres taillés dont les ombres commençaient à s’allonger vers l’Orient et dans l’azur tranquille d’un ciel sans nuages, sans brises, sans menaces et sans sourires. Un promeneur, venu des Tuileries, s’acheminait lentement vers les collines de Chaillot. Il avait la maigreur agréable de la première jeunesse et portait l’habit, la culotte, les bas noirs des bourgeois, dont le règne était enfin venu. Cependant son visage exprimait plus de rêverie que d’enthousiasme. Il tenait un livre à la main ; son doigt, glissé entre deux feuillets marquait l’endroit de sa lecture, mais il ne lisait plus. Par momens, il s’arrêtait et tendait l’oreille pour entendre le murmure léger et pourtant terrible qui s’élevait de Paris, et dans ce bruit plus faible qu’un soupir il devinait des cris de mort, de haine, de joie, d’amour, des appels de tambours, des coups de feu, enfin tout ce que, du pavé des rues, les révolutions font monter vers le chaud soleil de férocité stupide et d’enthousiasme sublime. Parfois, il tournait la tête et frissonnait. Tout ce qu’il avait appris, tout ce qu’il avait vu et entendu en quelques heures emplissait sa tête d’images confuses et terribles : la Bastille prise et déjà décrénelée par le peuple ; le prévôt des marchands tué d’un coup de pistolet au milieu d’une foule furieuse ; le gouverneur, le vieux de Launay, massacré sur le perron de l’Hôtel de Ville ; une foule terrible, pâle comme la faim et comme la peur, ivre, hors d’elle-même, perdue dans un rêve de sang et de gloire, roulant de la Bastille à la Grève et, au-dessus de 100,000 têtes hallucinées, les corps des invalides pendus à une lanterne et le front couronné de chêne d’un triomphateur en uniforme blanc et bleu ; les vainqueurs, précédés des registres, des clés et de la vaisselle d’argent de l’antique forteresse, montant au milieu des acclamations ; le perron ensanglanté ; et devant eux les magistrats du peuple, La Fayette et Bailly, émus, glorieux, étonnés, les pieds dans le sang, et la tête dans un nuage d’orgueil ! Puis la peur régnant encore sur la foule déchaînée ; au bruit semé que les troupes royales vont entrer de nuit dans la ville, les grilles des palais arrachées pour en faire des piques, les dépôts d’armes pillés, les citoyens élevant des barricades dans les mes et les femmes montant des grés sur les toits des maisons pour en écraser les régimens étrangers !
Mais les scènes violentes se sont réfléchies dans son imagination jeune et rêveuse avec les teintes de la mélancolie. Il a pris son livre préféré, un livre anglais plein de méditations sur les tombeaux, et il s’en est allé le long de la Seine, sous les arbres du Cours-la-Reine, vers la maison blanche, où nuit et jour va sa pensée. Tout est calme autour de lui. Il voit sur la berge des pêcheurs à la ligne, assis, les pieds dans l'eau ; il sourit en pensant qu’ils prennent des goujons le 14 juillet 1789, et il suit en rêvant le cours de la rivière. Parvenu aux premières rampes des collines de Chaillot, il rencontre une patrouille qui surveille les communications entre Paris et Versailles. Cette troupe, armée de fusils, de mousquets, de hallebardes, est composée d’artisans portant le tablier de serge ou de cuir, d’hommes de loi de noir vêtus, d’un prêtre et d’un géant barbu, en chemise, nu-jambes. Ils arrêtent quiconque veut passer : on a surpris des intelligences entre le gouverneur de la Bastille et la cour ; on craint une surprise.
Mais le promeneur est jeune et son air ingénu. Les amoureux sont marqués d’un signe : ils ont une douceur obstinée qui fait tomber tous les obstacles. Celui ci dit à peine quelques mots et la troupe le laisse passer en souriant. Il entre dans le village et s’arrête à mi-côte devant la grille d’un jardin.
Ce jardin est petit, mais des allées sinueuses, des plis de terrain, en prolongent la promenade. Des saules trempent le bout de leurs branches dans un bassin où nagent des canards. À l’angle de la rue, sur un tertre, s’élève une gloriette légère et une pelouse fraîche s’étend devant la maison. Là, sur un banc rustique une jeune femme est assise ; elle penche la tête ; son visage est caché par un grand chapeau de paille, couronné de fleurs naturelles. Elle porte sur sa robe à raies blanches et roses un fichu noué à la taille qui, placée un peu haut, donne à la jupe une longueur élancée, non sans grâce. Les bras, serrés dans une manche étroite, reposent. Une corbeille de forme antique, posée à ses pieds, est remplie de pelotes de laine. Près d’elle, un enfant dont les yeux bleus brillent à travers les mèches de ses cheveux d’or, fait des tas de sable avec sa pelle.
La jeune femme restait immobile et comme charmée, et lui, debout à la grille, se refusait à rompre un charme si doux. Enfin, elle leva la tête et montra un visage jeune, presque enfantin, dont les traits ronds et purs avaient une expression naturelle de douceur et d’amitié. Il s’inclina devant elle. Elle lui tendit la main.
— Bonjour, Monsieur Germain ; quelle nouvelle ? Quelle nouvelle apportez ? comme dit la chanson. Je ne sais que des chansons.
— Pardonnez-moi, Madame, d’avoir troublé vos songes. Je vous contemplais. Seule, immobile, accoudée, vous m’avez semblé l’ange du rêve.
— Seule ! seule ! répondit-elle, comme si elle n’avait entendu que ce mot : seule ! L’est-on jamais ?
Et, comme elle vit qu’il la regardait sans comprendre, elle ajouta :
— Laissons cela ; ce sont des idées que j’ai... Quelles nouvelles ?
Alors il lui conta la grande journée, la Bastille vaincue, la liberté fondée.
Fanny l’écouta gravement, puis :
— Il faut se réjouir, dit-elle ; mais notre joie doit être la mâle joie du sacrifice. Désormais les Français ne s’appartiennent plus ; ils se doivent à la révolution qui va changer le monde.
Comme elle parlait ainsi, l’enfant se jeta joyeusement sur ses genoux.
— Regarde, maman ; regarde le beau jardin.
Elle lui dit en l’embrassant :
— Tu as raison, mon Émile ; rien n’est plus sage au monde que de faire un beau jardin.
— Il est vrai, ajouta Germain ; quelle galerie de porphyre et d’or vaut une verte allée ?
Et il se représentait la douceur de conduire à l’ombre des arbres cette jeune femme appuyée à son bras.
— Ah ! s’écria-t-il, en jetant sur elle un regard profond, que m’importent les hommes et les révolutions !
— Non, dit-elle, non ! je ne puis détacher ainsi ma pensée d’un grand peuple qui veut fonder le règne de la justice. Mon attachement aux idées nouvelles vous surprend, Monsieur Germain. Nous ne nous connaissons que depuis peu de temps. Vous ne savez pas que mon père m’apprit à lire dans le Contrat social et dans l’Évangile. Un jour, dans une promenade, il me montra Jean-Jacques. Je n’étais qu’une enfant, mais je fondis en larmes en voyant le visage assombri du plus sage des hommes. J’ai grandi dans la haine des préjugés. Plus tard, mon mari, disciple comme moi de la philosophie de la nature, voulut que notre fils s’appelât Émile et qu’on lui enseignât à travailler de ses mains. Dans sa dernière lettre, écrite il y a trois ans à bord du navire sur lequel il périt quelques jours après, il me recommandait encore les préceptes de Rousseau sur l’éducation. Je suis pénétrée de l’esprit nouveau. Je crois qu’il faut combattre pour la justice et pour la vérité.
— Comme vous, Madame, soupira Germain, j’ai l’horreur du fanatisme et de la tyrannie ; j’aime comme vous la liberté, mais mon âme est sans force. Ma pensée s’échappe à chaque instant de moi-même. Je ne m’appartiens pas, et je souffre.
La jeune femme ne répondit pas. Un vieillard poussa la grille et s’avança les bras levés, en agitant son chapeau. Il ne portait ni poudre ni perruque. Des cheveux gris et longs tombaient des deux côtés de son crâne chauve. Il était entièrement vêtu de ratine grise ; les bas étaient bleus, les soulier sans boucles.
— Victoire ! victoire ! s’écriait-il. Le monstre est dans nos mains et je vous en apporte la nouvelle, Fanny !
— Mon voisin, je viens de l’entendre de M. Marcel Germain que je vous présente. Sa mère était à Angers l'amie de ma mère. Depuis six mois qu’il est à Paris il veut bien venir me voir de temps en temps au fond de mon ermitage. Monsieur Germain, vous voyez devant vous mon voisin et ami M. Franchot de La Cavanne, homme de lettres.
— Dites : Nicolas Franchot, laboureur.
— Je sais, mon voisin, que c’est ainsi que vous avez signé vos mémoires sur le commerce des grains. Je dirai donc, pour vous plaire et bien que je vous croie plus habile à manier la plume que la charrue, M. Nicolas Franchot, laboureur.
Le vieillard saisit la main de Marcel et s’écria :