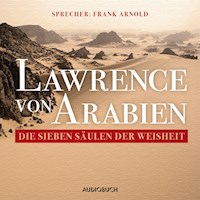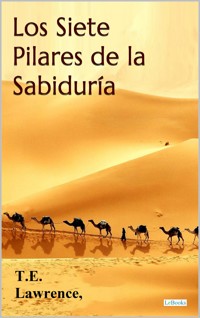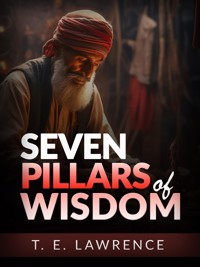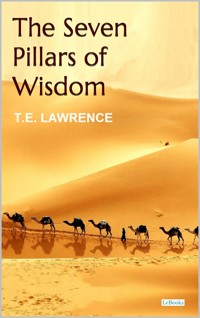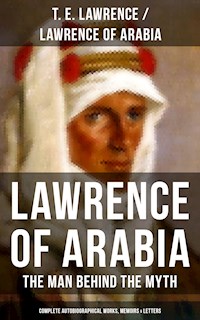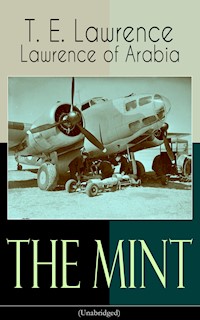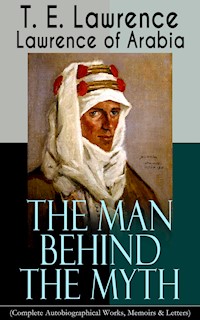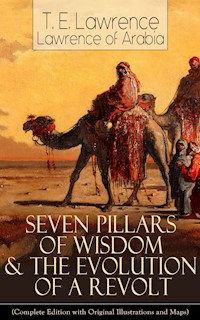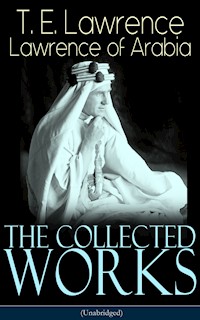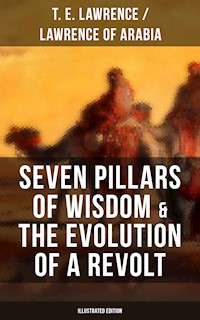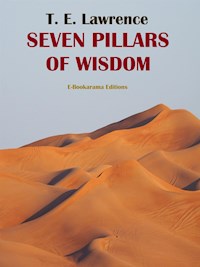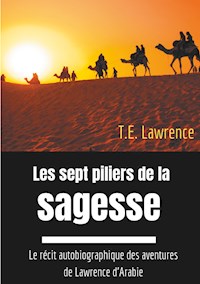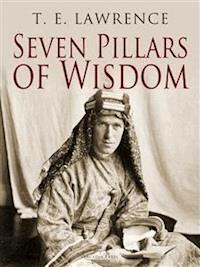4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret mythomane doué pour les lettres, ou un chef de guerre, inventeur inspiré de la guérilla ? Sa transformation en bédouin n'était-elle qu'un simulacre ? Et son homosexualité ? Le mythe de Lawrence d'Arabie découle de sa vie et de sa personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien sans cette autobiographie fascinante, mélange de récit d'aventures, d'analyse politique et de réflexion philosophique, qui fait date dans la prose anglaise du XXe siècle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE
T. E. Lawrence
Traduction et édition 2024 par Stargatebook
Tous les droits sont réservés
Table des matières
Dédicace à S.A.
Remerciements
Chapitre introductif
Introduction. Les fondements de la révolte
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Livre I. La découverte de Feisal
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Livre II. L'ouverture de l'offensive arabe
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Livre III. Un détournement de chemin de fer
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
Livre IV. Extension à Akaba
Chapitre XXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
Chapitre XLIV
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
Chapitre LI
Chapitre LII
Chapitre LIII
Chapitre LIV
Livre V. Marquer le temps
Chapitre LV
Chapitre LVI
Chapitre LVII
Chapitre LVIII
Chapitre LIX
Chapitre LX
Chapitre LXI
Chapitre LXII
Chapitre LXIII
Chapitre LXIV
Chapitre LXV
Chapitre LXVI
Chapitre LXVII
Chapitre LXVIII
Livre VI. Le raid sur les ponts
Chapitre LXIX
Chapitre LXX
Chapitre LXXI
Chapitre LXXII
Chapitre LXXIII
Chapitre LXXIV
Chapitre LXXV
Chapitre LXXVI
Chapitre LXXVII
Chapitre LXXVIII
Chapitre LXXIX
Chapitre LXXX
Chapitre LXXXI
Livre VII. La campagne de la mer Morte
Chapitre LXXXII
Chapitre LXXXIII
Chapitre LXXXIV
Chapitre LXXXV
Chapitre LXXXVI
Chapitre LXXXVII
Chapitre LXXXVIII
Chapitre LXXXIX
Chapitre XC
Chapitre XCI
Livre VIII. La ruine de High Hope
Chapitre XCII
Chapitre XCIII
Chapitre XCIV
Chapitre XCV
Chapitre XCVI
Chapitre XCVII
Livre IX. L'équilibrage pour un dernier effort
Chapitre XCVIII
Chapitre XCIX
Chapitre C
Chapitre CI
Chapitre CII
Chapitre CIII
Chapitre CIV
Chapitre CV
Chapitre CVI
Livre X. La maison est parfaite
Chapitre CVII
Chapitre CVIII
Chapitre CIX
Chapitre CX
Chapitre CXI
Chapitre CXII
Chapitre CXIII
Chapitre CXIV
Chapitre CXV
Chapitre CXVI
Chapitre CXVII
Chapitre CXVIII
Chapitre CXIX
Chapitre CXX
Chapitre CXXI
Chapitre CXXII
Épilogue
Annexe
Pages de garde
Cartes
Photographies et portraits
Dédicace à S.A.
Je t'aimais, alors j'ai attiré ces marées d'hommes dans mes mains et j'ai écrit mon testament à travers le ciel en étoiles Pour te gagner la Liberté, la maison digne à sept piliers, afin que tes yeux puissent briller pour moi Quand nous sommes venus.
La mort semblait mon serviteur sur la route, jusqu'à ce que nous soyons proches et que nous te voyions attendre : Quand tu as souri, il m'a devancé et t'a séparée dans une triste jalousie : Dans sa tranquillité.
L'amour, le fatigué, a tâtonné vers ton corps, notre bref salaire, le nôtre pour l'instant Avant que la douce main de la terre n'explore ta forme, et que les vers aveugles ne s'engraissent sur ta substance.
Les hommes m'ont prié d'ériger notre œuvre, la maison inviolée, en souvenir de toi. Mais pour un monument convenable, je l'ai brisée, inachevée, et maintenant les petites choses se faufilent pour s'aménager des masures dans l'ombre ternie de ton don.
Remerciements
M. Geoffrey Dawson a persuadé le All Souls College de me donner le loisir, en 1919-1920, d'écrire sur la révolte arabe. Sir Herbert Baker m'a permis de vivre et de travailler dans ses maisons de Westminster.
Le livre ainsi écrit est passé en 1921 en épreuve ; où il a eu la chance d'avoir des amis qui l'ont critiqué. Il doit en particulier ses remerciements à M. et Mme Bernard Shaw pour d'innombrables suggestions de grande valeur et diversité : et pour tous les points-virgules actuels.
Il ne prétend pas être impartial. Je me battais pour ma main, sur mon propre terrain. Je vous prie de le considérer comme une narration personnelle tirée de mes souvenirs. Je n'ai pas pu prendre de notes correctes : en effet, j'aurais manqué à mon devoir envers les Arabes si j'avais cueilli ces fleurs pendant qu'ils se battaient. Mes officiers supérieurs, Wilson, Joyce, Dawnay, Newcombe et Davenport pourraient chacun raconter une histoire similaire. Il en va de même pour Stirling, Young, Lloyd et Maynard, pour Buxton et Winterton, pour Ross, Stent et Siddons, pour Peake, Homby, Scott-Higgins et Garland, pour Wordie, Bennett et MacIndoe, pour Bassett, Scott et Goslett : Bassett, Scott, Goslett, Wood et Gray : Hinde, Spence et Bright : Brodie et Pascoe, Gilman et Grisenthwaite, Greenhill, Dowsett et Wade : Henderson, Leeson, Makins et Nunan.
Et il y a eu beaucoup d'autres chefs ou combattants solitaires à qui ce portrait autoritaire n'est pas juste. Il est encore moins juste, bien sûr, comme tous les récits de guerre, pour les soldats du rang qui ne sont pas nommés et qui n'ont pas leur part de mérite, comme ils doivent le faire, jusqu'à ce qu'ils puissent écrire les dépêches.
T. E. S. Cranwell, 15.8.26
Chapitre introductif
Le récit qui suit a d'abord été rédigé à Paris pendant la Conférence de la Paix, à partir de notes prises quotidiennement en marche, renforcées par quelques rapports envoyés à mes chefs au Caire. Par la suite, à l'automne 1919, ce premier jet et une partie des notes ont été perdus. Il m'a semblé historiquement nécessaire de reproduire ce récit, car peut-être personne d'autre que moi dans l'armée de Feisal n'avait pensé à écrire à l'époque ce que nous ressentions, ce que nous espérions, ce que nous essayions. C'est donc avec beaucoup de répugnance qu'il a été reconstruit à Londres au cours de l'hiver 1919-1920, à partir de mes souvenirs et des notes que j'avais conservées. L'enregistrement des événements ne s'était pas émoussé en moi et peut-être que peu d'erreurs réelles s'étaient glissées - sauf dans les détails des dates ou des nombres - mais les grandes lignes et la signification des choses avaient perdu de leur tranchant dans la brume des nouveaux intérêts.
Les dates et les lieux sont corrects, dans la mesure où mes notes les ont conservés, mais les noms de personnes ne le sont pas. Depuis l'aventure, certains de ceux qui ont travaillé avec moi se sont enterrés dans la tombe peu profonde du devoir public. Leurs noms ont été utilisés librement. D'autres se possèdent encore et gardent le secret. Il est arrivé qu'un seul homme porte plusieurs noms. Cela peut cacher l'individualité et faire du livre un éparpillement de marionnettes sans traits, plutôt qu'un groupe de personnes vivantes : mais une fois le bien est dit d'un homme, et une autre fois le mal, et certains ne me remercieraient ni pour le blâme ni pour l'éloge.
Cette image isolée, qui me met en vedette, est injuste pour mes collègues britanniques. Je regrette surtout de ne pas avoir raconté ce qu'ont fait nos sous-officiers. Ils ont été merveilleux, surtout si l'on tient compte du fait qu'ils n'avaient pas la motivation, la vision imaginative de la fin, qui soutenait les officiers. Malheureusement, ma préoccupation était limitée à cette fin, et le livre n'est qu'une procession de la liberté arabe de La Mecque à Damas. Il est destiné à rationaliser la campagne, afin que chacun puisse voir à quel point le succès était naturel et inévitable, à quel point il dépendait peu de la direction ou du cerveau, et encore moins de l'aide extérieure des quelques Britanniques. Il s'agissait d'une guerre arabe menée et dirigée par des Arabes pour un objectif arabe en Arabie.
La part qui m'incombait était mineure, mais grâce à une plume fluide, une parole libre et une certaine habileté cérébrale, je me suis arrogé, comme je l'ai dit, une fausse primauté. En réalité, je n'ai jamais exercé aucune fonction parmi les Arabes, je n'ai jamais été chargé de la mission britannique auprès d'eux. Wilson, Joyce, Newcombe, Dawnay et Davenport étaient tous au-dessus de ma tête. Je me suis flatté d'être trop jeune, non pas qu'ils aient eu plus de cœur ou d'esprit à l'ouvrage, mais j'ai fait de mon mieux. Wilson, Newcombe, Dawnay, Davenport, Buxton, Marshall, Stirling, Young, Maynard, Ross, Scott, Winterton, Lloyd, Wordie, Siddons, Goslett, Stent Henderson, Spence, Gilman, Garland, Brodie, Makins, Nunan, Leeson, Hornby, Peake, Scott-Higgins, Ramsay, Wood, Hinde, Bright, MacIndoe, Greenhill, Grisenthwaite, Dowsett, Bennett, Wade, Gray, Pascoe et les autres ont également fait de leur mieux.
Il serait impertinent de ma part de les louer. Lorsque je souhaite dire du mal de quelqu'un d'autre que nous, je le fais, bien que cela soit moins fréquent que dans mon journal, car le passage du temps semble avoir blanchi les taches des hommes. Lorsque je souhaite faire l'éloge de personnes extérieures, je le fais, mais nos affaires familiales sont les nôtres. Nous avons fait ce que nous avions prévu de faire et nous avons la satisfaction de le savoir. Les autres ont la liberté de raconter un jour leur histoire, une histoire parallèle à la mienne, mais qui ne parle pas plus de moi que je ne parle d'eux, car chacun d'entre nous a fait son travail tout seul et à sa guise, ne voyant guère ses amis.
Dans ces pages, l'histoire n'est pas celle du mouvement arabe, mais celle de mon rôle dans ce mouvement. Il s'agit d'un récit de la vie quotidienne, d'événements anodins, de petites gens. Il n'y a pas de leçons pour le monde, pas de révélations pour choquer les peuples. Il est rempli de choses insignifiantes, d'une part pour que personne ne prenne pour de l'histoire les ossements à partir desquels un jour un homme pourra faire de l'histoire, et d'autre part pour le plaisir que j'avais à me souvenir de la camaraderie de la révolte. Nous étions attachés l'un à l'autre, à cause de l'étendue des espaces ouverts, du goût des grands vents, de la lumière du soleil et des espoirs dans lesquels nous travaillions. La fraîcheur morale du monde à venir nous enivrait. Nous étions animés par des idées inexprimables et vaporeuses, mais pour lesquelles il fallait se battre. Nous avons vécu de nombreuses vies dans ces campagnes tourbillonnantes, sans jamais nous épargner : pourtant, lorsque nous avons réussi et que le nouveau monde s'est levé, les vieux hommes sont revenus et ont pris notre victoire pour la refaire à l'image de l'ancien monde qu'ils avaient connu. La jeunesse pouvait gagner, mais elle n'avait pas appris à se maintenir, et elle était pitoyablement faible face à l'âge. Nous avons balbutié que nous avions travaillé pour un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ils nous ont gentiment remerciés et ont fait la paix.
Tous les hommes rêvent, mais pas tous de la même manière. Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit se réveillent le jour pour constater que ce n'était que vanité ; mais les rêveurs du jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent réaliser leur rêve les yeux ouverts, afin de le rendre possible. C'est ce que j'ai fait. J'avais l'intention de créer une nouvelle nation, de restaurer une influence perdue, de donner à vingt millions de Sémites les fondations sur lesquelles construire un palais de rêve inspiré de leurs pensées nationales. Un objectif aussi élevé a fait ressortir la noblesse inhérente à leur esprit et les a incités à jouer un rôle généreux dans les événements : mais lorsque nous avons gagné, on m'a accusé d'avoir rendu douteuses les redevances pétrolières britanniques en Mésopotamie et d'avoir ruiné la politique coloniale française au Levant.
Je crains de l'espérer. Nous payons ces choses trop cher en honneur et en vies innocentes. J'ai remonté le Tigre avec cent Territoriaux du Devon, des jeunes gens propres et charmants, pleins de joie et capables de rendre heureux les femmes et les enfants. Grâce à eux, on voyait clairement à quel point il était formidable d'être leur parent et d'être anglais. Et nous les jetions par milliers au feu pour leur infliger la pire des morts, non pas pour gagner la guerre, mais pour que le maïs, le riz et l'huile de Mésopotamie nous reviennent. La seule nécessité était de vaincre nos ennemis (dont la Turquie), ce qui fut finalement fait dans la sagesse d'Allenby avec moins de quatre cents morts, en retournant à notre profit les mains des opprimés en Turquie. De mes trente combats, je suis le plus fier de n'avoir fait couler aucun de nos propres sangs. Pour moi, toutes nos provinces soumises ne valaient pas un seul Anglais mort.
Il nous a fallu trois ans pour mener à bien cet effort et j'ai dû retenir beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas encore été dites. Malgré cela, certaines parties de ce livre seront nouvelles pour presque tous ceux qui le liront, et beaucoup chercheront des choses familières et ne les trouveront pas. Une fois, j'ai fait un rapport complet à mes chefs, mais j'ai appris qu'ils me récompensaient sur la base de mes propres preuves. Ce n'était pas normal. Les honneurs peuvent être nécessaires dans une armée professionnelle, comme tant de mentions emphatiques dans les dépêches, et en nous enrôlant, nous nous étions mis, volontairement ou non, dans la position de soldats réguliers.
Pour mon travail sur le front arabe, j'avais décidé de ne rien accepter. Le Cabinet a incité les Arabes à se battre pour nous en leur promettant clairement l'autonomie par la suite. Les Arabes croient aux personnes, pas aux institutions. Ils ont vu en moi un agent libre du gouvernement britannique et ont exigé de moi que je souscrive à ses promesses écrites. J'ai donc dû me joindre à la conspiration et, pour ce que ma parole valait, j'ai assuré aux hommes leur récompense. Au cours de nos deux années de collaboration sous le feu, ils s'habituèrent à me croire et à penser que mon gouvernement, comme moi-même, était sincère. Dans cet espoir, ils ont accompli de belles choses, mais, bien sûr, au lieu d'être fier de ce que nous avons fait ensemble, j'en ai eu amèrement honte.
Il était évident dès le début que si nous gagnions la guerre, ces promesses ne seraient plus que du papier, et si j'avais été un conseiller honnête des Arabes, je leur aurais conseillé de rentrer chez eux et de ne pas risquer leur vie en se battant pour de telles choses : mais je me suis sauvé avec l'espoir qu'en menant ces Arabes follement à la victoire finale, je les établirais, les armes à la main, dans une position si assurée (sinon dominante) que l'opportunisme conseillerait aux Grandes Puissances un règlement équitable de leurs réclamations. En d'autres termes, je présumais (ne voyant aucun autre dirigeant ayant la volonté et le pouvoir) que je survivrais aux campagnes et que je serais capable de vaincre non seulement les Turcs sur le champ de bataille, mais aussi mon propre pays et ses alliés dans la salle du conseil. C'était une présomption démesurée : on ne sait pas encore si j'ai réussi, mais il est clair que je n'avais pas l'ombre d'une permission pour engager les Arabes, sans le savoir, dans un tel danger. J'ai risqué la fraude, convaincu que l'aide des Arabes était nécessaire à notre victoire rapide et peu coûteuse en Orient, et qu'il valait mieux gagner et manquer à notre parole que perdre.
Le renvoi de Sir Henry McMahon confirma ma conviction de notre manque de sincérité, mais je ne pouvais pas m'expliquer ainsi avec le général Wingate tant que durait la guerre, puisque j'étais nominalement sous ses ordres, et qu'il ne semblait pas se rendre compte de la fausseté de sa propre position. La seule chose qui me restait à faire était de refuser des récompenses pour avoir réussi à tromper les gens et, pour éviter ce désagrément, j'ai commencé à dissimuler dans mes rapports la véritable histoire des choses et à persuader les quelques Arabes qui étaient au courant d'une réticence égale. Dans ce livre aussi, pour la dernière fois, j'ai l'intention de juger moi-même de ce qu'il convient de dire.
Introduction. Les fondements de la révolte
CHAPITRES I À VII
Certains Anglais, dont Kitchener était le chef, pensaient qu'une rébellion des Arabes contre les Turcs permettrait à l'Angleterre, tout en combattant l'Allemagne, de vaincre simultanément son alliée la Turquie.
Leur connaissance de la nature, de la puissance et du pays des peuples de langue arabe leur a fait penser que l'issue d'une telle rébellion serait heureuse : elle en a indiqué le caractère et la méthode.
Ils l'ont donc laissée commencer, après avoir obtenu des assurances formelles d'aide de la part du gouvernement britannique. Néanmoins, la rébellion du shérif de La Mecque a surpris la plupart des Alliés, qui se sont trouvés mal préparés. Elle suscita des sentiments contradictoires et fit de puissants amis et de puissants ennemis, dont les jalousies s'entrechoquèrent et dont les affaires commencèrent à se gâter.
Chapitre I
Une partie du mal de mon récit est peut-être inhérente à notre situation. Pendant des années, nous avons vécu tant bien que mal les uns avec les autres dans le désert nu, sous un ciel indifférent. Le jour, le soleil brûlant nous faisait fermenter, et le vent battant nous étourdissait. La nuit, nous étions tachés par la rosée et humiliés par les innombrables silences des étoiles. Nous étions une armée égocentrique, sans parade ni geste, dévouée à la liberté, la deuxième des croyances de l'homme, un but si vorace qu'il dévorait toutes nos forces, un espoir si transcendant que nos ambitions antérieures s'évanouissaient dans son éclat.
Au fil du temps, notre besoin de lutter pour l'idéal s'est transformé en une possession inconditionnelle, qui a surmonté nos doutes à coups d'éperons et de rênes. Bon gré mal gré, il est devenu une foi. Nous nous sommes vendus comme esclaves, nous nous sommes enchaînés les uns aux autres, nous nous sommes prosternés pour servir sa sainteté avec tout ce que nous avons de bon et de mauvais. La mentalité des esclaves humains ordinaires est terrible - ils ont perdu le monde - et nous avions abandonné, non seulement le corps, mais aussi l'âme à l'avidité dominante de la victoire. De notre propre fait, nous avons été vidés de toute moralité, de toute volonté, de toute responsabilité, comme des feuilles mortes dans le vent.
L'éternel combat nous ôtait le souci de notre vie et de celle des autres. Nous avions des cordes autour du cou et sur la tête, des prix qui montraient que l'ennemi nous réservait d'affreux supplices s'il nous attrapait. Chaque jour, certains d'entre nous passaient, et les vivants se savaient n'être que des marionnettes sensibles sur la scène de Dieu : en effet, notre maître d'œuvre était impitoyable, impitoyable, tant que nos pieds meurtris pouvaient avancer en titubant sur la route. Les faibles enviaient ceux qui étaient assez fatigués pour mourir, car le succès semblait si lointain, et l'échec une libération proche et certaine, bien que brutale, du labeur. Nous vivions toujours dans l'étirement ou l'affaissement des nerfs, sur la crête ou dans le creux des vagues de sentiments. Cette impuissance nous était amère et nous poussait à ne vivre que pour l'horizon visible, sans nous soucier du mal que nous infligions ou que nous endurions, puisque les sensations physiques se montraient mesquinement éphémères. Des bouffées de cruauté, de perversions, de convoitises couraient légèrement à la surface sans nous troubler ; car les lois morales qui avaient semblé couvrir ces accidents stupides devaient être des mots encore plus ténus. Nous avions appris qu'il y avait des douleurs trop vives, des chagrins trop profonds, des extases trop fortes pour que notre être fini puisse les enregistrer. Lorsque l'émotion atteint ce niveau, l'esprit s'étouffe et la mémoire devient blanche jusqu'à ce que les circonstances redeviennent banales.
Une telle exaltation de la pensée, en même temps qu'elle laissait l'esprit à la dérive et lui donnait licence dans des airs étranges, lui faisait perdre l'ancienne et patiente domination sur le corps. Le corps était trop grossier pour ressentir le maximum de nos peines et de nos joies. C'est pourquoi nous l'avons abandonné comme un déchet : nous l'avons laissé marcher en dessous de nous, comme un simulacre respirant, à son propre niveau, sans aide, soumis à des influences auxquelles, en temps normal, nos instincts auraient reculé. Les hommes étaient jeunes et robustes ; la chair chaude et le sang réclamaient inconsciemment un droit en eux et tourmentaient leurs ventres avec d'étranges désirs. Nos privations et nos dangers attisaient cette chaleur virile, dans un climat aussi rude que possible. Nous n'avions pas d'endroits fermés où rester seuls, pas de vêtements épais pour cacher notre nature. L'homme, en toutes choses, vivait franchement avec l'homme.
L'Arabe était par nature un continent, et l'usage du mariage universel avait presque aboli les cours irrégulières dans ses tribus. Les femmes publiques des rares colonies que nous avons rencontrées au cours de nos mois d'errance n'auraient rien représenté pour nous, même si leur viande radiée avait été appétissante pour un homme en bonne santé. Horrifiés par ce commerce sordide, nos jeunes commencèrent à satisfaire avec indifférence les rares besoins des uns et des autres dans leur propre corps - une froide commodité qui, en comparaison, semblait dépourvue de sexe et même pure. Plus tard, certains commencèrent à justifier ce processus stérile et jurèrent que des amis frémissant ensemble dans le sable cédant, les membres intimes et chauds dans une étreinte suprême, trouvaient là, caché dans l'obscurité, un coefficient sensuel de la passion mentale qui soudait nos âmes et nos esprits dans un effort enflammé. Plusieurs, assoiffés de punir des appétits qu'ils ne pouvaient pas complètement empêcher, ont pris un orgueil sauvage à dégrader le corps, et se sont offerts férocement dans n'importe quelle habitude qui promettait la douleur physique ou la saleté.
J'ai été envoyé à ces Arabes comme un étranger, incapable de penser leurs pensées ou de souscrire à leurs croyances, mais chargé par le devoir de les conduire en avant et de développer au maximum tout mouvement de leur part profitable à l'Angleterre dans sa guerre. Si je ne pouvais pas assumer leur caractère, je pouvais au moins dissimuler le mien, et passer parmi eux sans friction évidente, ni discorde, ni critique, mais une influence inaperçue. Puisque j'ai été leur compagnon, je ne serai pas leur apologiste ou leur défenseur. Aujourd'hui, dans mes vieux vêtements, je pourrais jouer le spectateur, obéissant aux sensibilités de notre théâtre .... ... mais il est plus honnête de dire que ces idées et ces actions étaient alors naturelles. Ce qui nous paraît aujourd'hui déraisonnable ou sadique semblait sur le terrain inévitable, ou tout simplement une routine sans importance.
Nous avions toujours du sang sur les mains : nous y étions autorisés. Blesser et tuer semblaient des douleurs éphémères, tant la vie était brève et douloureuse chez nous. La douleur de vivre étant si grande, la douleur du châtiment devait être impitoyable. Nous vivions pour le jour et mourions pour lui. Lorsqu'il y avait une raison et un désir de punir, nous écrivions notre leçon avec un fusil ou un fouet, immédiatement dans la chair renfrognée de celui qui souffrait, et l'affaire était sans appel. Le désert n'offrait pas les peines lentes et raffinées des tribunaux et des prisons.
Bien sûr, nos récompenses et nos plaisirs ont été aussi soudains que nos problèmes, mais, pour moi en particulier, ils étaient moins importants. Les coutumes bédouines étaient dures même pour ceux qui y avaient été élevés, et pour les étrangers, elles étaient terribles : une mort dans la vie. Lorsque la marche ou le travail se terminait, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour enregistrer les sensations, et tant qu'elles duraient, je n'avais pas le loisir de voir les beautés spirituelles qui nous arrivaient parfois en chemin. Dans mes notes, c'est le cruel plutôt que le beau qui a trouvé sa place. Nous avons sans doute apprécié davantage les rares moments de paix et d'oubli, mais je me souviens davantage de l'agonie, des terreurs et des erreurs. Notre vie ne se résume pas à ce que j'ai écrit (il y a des choses qui ne doivent pas être répétées de sang-froid pour des raisons de honte) ; mais ce que j'ai écrit était dans et de notre vie. Priez Dieu pour que les hommes qui lisent cette histoire n'aillent pas, par amour de l'éclat de l'étrangeté, se prostituer et mettre leurs talents au service d'une autre race.
L'homme qui se laisse posséder par des étrangers mène une vie de Yahoo, ayant troqué son âme contre un maître brutal. Il n'est pas des leurs. Il peut s'opposer à eux, se persuader d'une mission, les battre et les tordre en quelque chose qu'ils n'auraient pas été de leur propre chef. Il exploite alors son ancien environnement pour les pousser à sortir du leur. Ou, selon mon modèle, il peut les imiter si bien qu'ils l'imitent à leur tour de manière fallacieuse. Dans ce cas, il abandonne son propre environnement : il fait semblant d'être dans le leur, et les faux-semblants sont des choses creuses et sans valeur. Dans les deux cas, il ne fait rien de lui-même, ni rien de si propre qu'il puisse être le sien (sans penser à la conversion), laissant les autres agir ou réagir à leur guise à partir de l'exemple silencieux.
Dans mon cas, les efforts déployés pendant ces années pour vivre dans la tenue des Arabes et pour imiter leurs fondements mentaux m'ont débarrassé de mon moi anglais et m'ont permis de regarder l'Occident et ses conventions d'un œil nouveau : ils ont tout détruit pour moi. En même temps, je ne pouvais pas sincèrement prendre la peau arabe : c'était seulement une affectation. On peut facilement devenir infidèle, mais on peut difficilement se convertir à une autre foi. J'avais abandonné une forme sans prendre l'autre, et j'étais devenu comme le cercueil de Mahomet dans notre légende, avec pour conséquence un sentiment de solitude intense dans la vie et un mépris, non pas pour les autres hommes, mais pour tout ce qu'ils font. Un tel détachement se manifestait parfois chez un homme épuisé par un effort physique prolongé et par l'isolement. Son corps avançait mécaniquement, tandis que son esprit raisonnable le quittait et, de l'extérieur, le regardait d'un œil critique, se demandant ce que faisait ce bois futile et pourquoi. Parfois, ces deux moi conversaient dans le vide ; la folie était alors très proche, comme je crois qu'elle serait proche de l'homme qui pouvait voir les choses à travers les voiles à la fois de deux coutumes, de deux éducations, de deux environnements.
Chapitre II
L'une des premières difficultés du mouvement arabe a été de dire qui étaient les Arabes. Comme il s'agit d'un peuple fabriqué, son nom a changé de sens lentement, d'année en année. Autrefois, il signifiait "Arabe". Il y avait un pays appelé Arabie, mais cela n'avait rien à voir. Il y avait une langue, l'arabe, et c'est en elle que résidait le test. C'était la langue courante de la Syrie et de la Palestine, de la Mésopotamie et de la grande péninsule appelée Arabie sur la carte. Avant la conquête musulmane, ces régions étaient habitées par des peuples divers, parlant des langues de la famille arabe. On les appelait sémites, mais (comme pour la plupart des termes scientifiques) à tort. Cependant, l'arabe, l'assyrien, le babylonien, le phénicien, l'hébreu, l'araméen et le syriaque étaient des langues apparentées ; et les indications d'influences communes dans le passé, ou même d'une origine commune, étaient renforcées par le fait que nous savions que les apparences et les coutumes des peuples arabophones actuels d'Asie, bien qu'aussi variées qu'un champ rempli de coquelicots, avaient une ressemblance égale et essentielle. Nous pourrions à juste titre les qualifier de cousins - et des cousins certainement, bien que tristement, conscients de leur propre lien de parenté.
En ce sens, les régions arabophones d'Asie formaient un parallélogramme approximatif. Le côté nord s'étendait d'Alexandrette, sur la Méditerranée, à travers la Mésopotamie vers l'est jusqu'au Tigre. Le côté sud était le bord de l'océan Indien, d'Aden à Mascate. À l'ouest, il était délimité par la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge jusqu'à Aden. À l'est, le Tigre et le golfe Persique jusqu'à Mascate. Ce carré de terre, aussi grand que l'Inde, constituait la patrie de nos Sémites, sur laquelle aucune race étrangère n'avait pu s'implanter durablement, bien que les Égyptiens, les Hittites, les Philistins, les Perses, les Grecs, les Romains, les Turcs et les Francs s'y soient essayés à plusieurs reprises. Tous ont fini par se briser, et leurs éléments épars se sont noyés dans les fortes caractéristiques de la race sémite. Les Sémites ont parfois été poussés en dehors de cette zone, et ont eux-mêmes été noyés dans le monde extérieur. L'Égypte, Alger, le Maroc, Malte, la Sicile, l'Espagne, la Cilicie et la France ont absorbé et anéanti des colonies sémitiques. Ce n'est qu'à Tripoli, en Afrique, et dans le miracle éternel de la juiverie, que les sémites éloignés ont conservé une partie de leur identité et de leur force.
L'origine de ces peuples est une question académique ; mais pour comprendre leur révolte, leurs différences sociales et politiques actuelles sont importantes et ne peuvent être saisies qu'en examinant leur géographie. Ce continent se divise en quelques grandes régions, dont les différences physiques flagrantes imposent des habitudes différentes à leurs habitants. À l'ouest, le parallélogramme était encadré, d'Alexandrette à Aden, par une ceinture de montagnes appelée (au nord) Syrie, puis, progressivement vers le sud, Palestine, Madian, Hejaz et, enfin, Yémen. Elle avait une hauteur moyenne d'environ trois mille pieds, avec des sommets de dix à douze mille pieds. Elle était orientée vers l'ouest, bien arrosée par les pluies et les nuages venant de la mer et, en général, bien peuplée.
Une autre chaîne de collines habitées, faisant face à l'océan Indien, constituait le bord sud du parallélogramme. La frontière orientale était d'abord une plaine alluviale appelée Mésopotamie, puis, au sud de Bassorah, un littoral plat, appelé Kuweit, et Hasa, jusqu'à Gattar. Une grande partie de cette plaine était peuplée. Ces collines et ces plaines habitées encadraient un golfe de désert assoiffé, au cœur duquel se trouvait un archipel d'oasis arrosées et peuplées, appelées Kasim et Aridh. C'est dans ce groupe d'oasis que se trouve le véritable centre de l'Arabie, la réserve de son esprit natif et de son individualité la plus consciente. Le désert l'enveloppait et le préservait de tout contact.
Le désert qui remplissait cette grande fonction autour des oasis, et qui faisait ainsi le caractère de l'Arabie, variait dans sa nature. Au sud des oasis, il apparaissait comme une mer de sable sans chemin, s'étendant presque jusqu'à l'escarpement populeux du rivage de l'océan Indien, l'excluant de l'histoire arabe et de toute influence sur la morale et la politique arabes. L'Hadhramaut, comme on appelait cette côte méridionale, faisait partie de l'histoire des Indes néerlandaises, et sa pensée influençait Java plutôt que l'Arabie. À l'ouest des oasis, entre celles-ci et les collines du Hejaz, se trouvait le désert du Nejd, une zone de gravier et de lave, avec peu de sable. À l'est de ces oasis, entre elles et Kuweit, s'étendait une étendue similaire de gravier, mais avec de grandes étendues de sable mou, ce qui rendait la route difficile. Au nord des oasis s'étendait une ceinture de sable, puis une immense plaine de gravier et de lave, remplissant tout ce qui se trouvait entre la limite orientale de la Syrie et les rives de l'Euphrate, là où commençait la Mésopotamie. La praticabilité de ce désert du nord pour les hommes et les voitures a permis à la révolte arabe de remporter un succès immédiat.
Les collines de l'ouest et les plaines de l'est ont toujours été les parties de l'Arabie les plus peuplées et les plus actives. À l'ouest en particulier, les montagnes de Syrie et de Palestine, du Hejaz et du Yémen, sont entrées à maintes reprises dans le courant de notre vie européenne. D'un point de vue éthique, ces collines fertiles et saines se trouvaient en Europe et non en Asie, tout comme les Arabes regardaient toujours vers la Méditerranée et non vers l'Océan Indien pour leurs sympathies culturelles, pour leurs entreprises et en particulier pour leurs expansions, car le problème des migrations était la force la plus importante et la plus complexe en Arabie, et il lui était général, même s'il pouvait varier dans les différentes régions arabes.
Dans le nord (Syrie), le taux de natalité était faible dans les villes et le taux de mortalité élevé, en raison de l'insalubrité et de la vie trépidante menée par la majorité. Par conséquent, les paysans excédentaires trouvaient des débouchés dans les villes et y étaient engloutis. Au Liban, où l'hygiène avait été améliorée, l'exode des jeunes vers l'Amérique s'intensifiait chaque année, menaçant (pour la première fois depuis l'époque grecque) de modifier l'image de tout un quartier.
Au Yémen, la solution était différente. Il n'y avait pas de commerce extérieur, ni d'industries de masse pour accumuler la population dans des endroits insalubres. Les villes n'étaient que des bourgs, aussi propres et simples que des villages ordinaires. La population s'est donc lentement accrue, le niveau de vie a été abaissé à un niveau très bas et une congestion du nombre de personnes a été généralement ressentie. Ils ne pouvaient pas émigrer outre-mer, car le Soudan était un pays encore pire que l'Arabie, et les quelques tribus qui s'y aventuraient étaient obligées de modifier profondément leur mode de vie et leur culture sémitique pour pouvoir exister. Elles ne pouvaient pas se déplacer vers le nord le long des collines, car celles-ci étaient barrées par la ville sainte de La Mecque et son port de Jidda : une ceinture étrangère, continuellement renforcée par des étrangers venus de l'Inde, de Java, de Bokhara et d'Afrique, très forte en vitalité, violemment hostile à la conscience sémite, et maintenue en dépit de l'économie, de la géographie et du climat, par le facteur artificiel d'une religion mondiale. L'engorgement du Yémen, devenu extrême, n'a donc trouvé son soulagement qu'à l'est, en forçant les agrégations les plus faibles de sa frontière à descendre et à descendre les pentes des collines le long du Widian, le district à demi-détruit des grandes vallées aquifères de Bisha, Dawasir, Ranya et Taraba, qui s'étendent vers les déserts du Nejd. Ces clans plus faibles devaient continuellement échanger de bonnes sources et des palmiers fertiles contre des sources plus pauvres et des palmiers plus maigres, jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone où une vie agricole convenable devenait impossible. Ils commencèrent alors à vivre de l'élevage précaire de moutons et de chameaux et finirent par dépendre de plus en plus de ces troupeaux pour leur subsistance.
Enfin, sous l'effet d'une dernière impulsion donnée par la population qui s'étire derrière eux, les populations frontalières (aujourd'hui presque entièrement pastorales) ont été chassées des oasis les plus éloignées pour se retrouver en nomades dans les régions sauvages encore inexplorées. Ce processus, que l'on peut observer aujourd'hui dans les familles et les tribus individuelles dont les marches peuvent être nommées et datées avec précision, a dû se dérouler depuis le premier jour de la colonisation complète du Yémen. Le Widian, en dessous de la Mecque et de Taif, est encombré des souvenirs et des noms de lieux d'une demi-centaine de tribus qui sont parties de là, et que l'on retrouve aujourd'hui dans le Nejd, dans le Djebel Sham-mar, dans le Hamad, et même aux frontières de la Syrie et de la Mésopotamie. Là était la source des migrations, la fabrique des nomades, la source du golfe des errants du désert.
En effet, les habitants du désert étaient aussi peu statiques que les habitants des collines. La vie économique du désert était basée sur l'approvisionnement en chameaux, qui étaient mieux élevés dans les pâturages rigoureux des hautes terres avec leurs épines puissantes et nutritives. Les Bédouins vivaient de cette industrie qui, à son tour, façonnait leur vie, répartissait les zones tribales et faisait tourner les clans grâce à la rotation des pâturages de printemps, d'été et d'hiver, les troupeaux récoltant à tour de rôle les maigres plantes de chaque région. Les marchés aux chameaux de Syrie, de Mésopotamie et d'Égypte déterminaient la population que les déserts pouvaient accueillir et régulaient strictement leur niveau de vie. De même, le désert se surpeuplait à l'occasion, et il y avait alors des poussées et des soulèvements de la part des tribus entassées qui jouaient des coudes pour se rapprocher de la lumière par des voies naturelles. Elles ne pouvaient pas aller vers le sud, vers le sable ou la mer inhospitalière. Ils ne pouvaient pas non plus se diriger vers l'ouest, car les collines escarpées du Hejaz étaient bordées par des peuples montagnards qui profitaient pleinement de leur position défensive. Parfois, ils se dirigeaient vers les oasis centrales d'Aridh et de Kasim et, si les tribus à la recherche de nouveaux foyers étaient fortes et vigoureuses, ils pouvaient réussir à en occuper certaines parties. Mais si le désert n'avait pas cette force, ses habitants étaient progressivement poussés vers le nord, entre Médine du Hejaz et Kasim du Nejd, jusqu'à ce qu'ils se trouvent à la croisée de deux routes. Ils pouvaient se diriger vers l'est, par Wadi Rumh ou Jebel Sham-mar, pour suivre éventuellement le Batn jusqu'à Shamiya, où ils deviendraient des Arabes riverains du Bas-Euphrate ; ou ils pouvaient gravir, par lentes étapes, l'échelle des oasis occidentales - Henakiya, Kheibar, Teima, Jauf et Sirhan - jusqu'à ce que le destin les voie approcher de Jebel Druse, en Syrie, ou abreuver leurs troupeaux autour de Tadmor, dans le désert du nord, en route vers Alep ou l'Assyrie.
La pression n'a pas cessé pour autant : l'inexorable tendance vers le nord s'est poursuivie. Les tribus se sont retrouvées à la limite des cultures en Syrie ou en Mésopotamie. La chance et leur ventre les persuadèrent de l'intérêt de posséder des chèvres, puis des moutons ; enfin, ils commencèrent à semer, ne serait-ce qu'un peu d'orge pour leurs animaux. Ils n'étaient plus des Bédouins et commençaient à souffrir, comme les villageois, des ravages des nomades de l'arrière. Insensiblement, ils font cause commune avec les paysans déjà présents sur le sol et découvrent qu'ils sont eux aussi des paysans. Nous voyons donc des clans, nés sur les hauts plateaux du Yémen, poussés par des clans plus forts dans le désert, où, malgré eux, ils sont devenus nomades pour survivre. Nous les voyons errer, se déplacer chaque année un peu plus au nord ou un peu plus à l'est, selon que le hasard les a envoyés sur l'un ou l'autre des chemins de traverse de la région sauvage, jusqu'à ce que, finalement, cette pression les pousse à nouveau du désert vers les terres ensemencées, avec la même réticence que lors de leur première expérience de la vie nomade, qui s'est révélée de plus en plus difficile. Telle était la circulation qui maintenait la vigueur dans le corps sémitique. Il y avait peu de Sémites du Nord, si tant est qu'il y en ait eu un seul, dont les ancêtres n'étaient pas passés par le désert à une époque sombre. La marque du nomadisme, cette discipline sociale des plus profondes et des plus mordantes, était sur chacun d'eux à son degré.
Chapitre III
Si les membres des tribus et les citadins de l'Asie arabophone n'étaient pas des races différentes, mais simplement des hommes à des stades sociaux et économiques différents, on pouvait s'attendre à un air de famille dans le fonctionnement de leur esprit, et il n'était donc que raisonnable que des éléments communs apparaissent dans le produit de tous ces peuples. Dès le début, lors de la première rencontre avec eux, on a trouvé une clarté ou une dureté de croyance universelle, presque mathématique dans sa limitation et repoussante dans sa forme antipathique. Les Sémites n'avaient pas de demi-teintes dans leur registre de vision. C'était un peuple de couleurs primaires, ou plutôt de noir et de blanc, qui voyait toujours le monde dans ses contours. C'était un peuple dogmatique, méprisant le doute, notre moderne couronne d'épines. Ils ne comprenaient pas nos difficultés métaphysiques, nos interrogations introspectives. Ils ne connaissaient que la vérité et le mensonge, la croyance et l'incrédulité, sans notre suite hésitante de nuances plus fines.
Ce peuple était noir et blanc, non seulement dans la vision, mais dans l'ameublement le plus intime ; noir et blanc non seulement dans la clarté, mais dans l'apposition. Leurs pensées n'étaient à l'aise que dans les extrêmes. Ils habitaient les superlatifs par choix. Parfois, les incohérences semblaient les posséder en même temps, mais ils ne transigeaient jamais : ils poursuivaient la logique de plusieurs opinions incompatibles jusqu'à des fins absurdes, sans en percevoir l'incongruité. La tête froide et le jugement tranquille, imperturbablement inconscients de la fuite, ils oscillaient d'asymptote en asymptote.
C'était un peuple limité, à l'esprit étroit, dont l'intelligence inerte restait en jachère dans une résignation incurieuse. Leur imagination était vive, mais pas créative. Il y avait si peu d'art arabe en Asie qu'on pouvait presque dire qu'ils n'avaient pas d'art, même si leurs classes étaient des mécènes libéraux et avaient encouragé les talents en architecture, en céramique ou dans d'autres domaines de l'artisanat de leurs voisins et de leurs esclaves. Ils ne s'occupaient pas non plus de grandes industries : ils n'avaient pas d'organisation de l'esprit ou du corps. Ils n'ont inventé aucun système philosophique, aucune mythologie complexe. Ils se dirigeaient entre les idoles de la tribu et celles de la grotte. Peuple le moins morbide, ils avaient accepté le don de la vie sans poser de questions, comme une évidence. Pour eux, c'était une chose inévitable, une obligation pour l'homme, un usufruit, incontrôlable. Le suicide était une chose impossible, et la mort n'était pas un chagrin.
C'était un peuple de spasmes, de bouleversements, d'idées, la race du génie individuel. Leurs mouvements étaient d'autant plus choquants qu'ils contrastaient avec la quiétude de chaque jour, leurs grands hommes plus grands qu'ils contrastaient avec l'humanité de leur foule. Leurs convictions étaient instinctives, leurs activités intuitives. Leur plus grande production était celle des croyances : ils étaient presque les monopoleurs des religions révélées. Trois de ces efforts avaient perduré parmi eux : deux d'entre eux s'étaient également exportés (sous des formes modifiées) vers des peuples non sémites. Le christianisme, traduit dans les divers esprits des langues grecques, latines et teutoniques, avait conquis l'Europe et l'Amérique. L'islam, sous diverses formes, a assujetti l'Afrique et certaines parties de l'Asie. Ce sont là des réussites sémitiques. Leurs échecs, ils les ont gardés pour eux. Les franges de leurs déserts étaient parsemées de croyances brisées.
Il est significatif que ce fléau des religions déchues se trouve à la rencontre du désert et de l'ensemencement. Cela indiquait la génération de toutes ces croyances. Il s'agissait d'affirmations et non d'arguments ; il fallait donc un prophète pour les exposer. Les Arabes disaient qu'il y avait eu quarante mille prophètes ; nous avons des traces d'au moins quelques centaines d'entre eux. Aucun d'entre eux n'avait vécu dans le désert, mais leur vie était conforme à un modèle. Leur naissance les a placés dans des lieux très fréquentés. Un désir passionné et inintelligible les poussait dans le désert. Ils y ont vécu plus ou moins longtemps dans la méditation et l'abandon physique, puis ils sont revenus avec leur message imaginé et articulé, pour le prêcher à leurs anciens associés, qui doutaient maintenant. Les fondateurs des trois grandes croyances ont accompli ce cycle : leur coïncidence possible a été prouvée comme une loi par les histoires de vie parallèles des myriades d'autres, les malheureux qui ont échoué, que nous pourrions juger d'une profession non moins vraie, mais pour qui le temps et la désillusion n'ont pas entassé des âmes sèches prêtes à s'enflammer. Pour les penseurs de la ville, l'impulsion vers Nitria a toujours été irrésistible, non pas probablement parce qu'ils y trouvaient la demeure de Dieu, mais parce que dans sa solitude, ils entendaient plus sûrement la parole vivante qu'ils apportaient avec eux.
La base commune de toutes les croyances sémitiques, gagnantes ou perdantes, était l'idée toujours présente de l'inutilité du monde. Leur profonde réaction à la matière les a conduits à prêcher le dépouillement, le renoncement, la pauvreté ; et l'atmosphère de cette invention a étouffé impitoyablement les esprits du désert. Une première connaissance de leur sens de la pureté de la raréfaction m'a été donnée dans mes jeunes années, lorsque nous avions chevauché dans les plaines ondulantes de la Syrie du Nord jusqu'à une ruine de l'époque romaine qui, selon les Arabes, avait été construite par un prince de la frontière pour servir de palais du désert à sa reine. L'argile de sa construction aurait été pétrie, pour plus de richesse, non pas avec de l'eau, mais avec les précieuses huiles essentielles des fleurs. Mes guides, reniflant l'air comme des chiens, me conduisaient de pièce en pièce en disant : "Voici la jessamine, cette violette, cette rose".
Mais enfin, Dahoum m'a attiré : "Viens sentir le parfum le plus doux de tous", et nous sommes entrés dans le bâtiment principal, jusqu'aux fenêtres béantes de sa façade orientale, et nous avons bu, la bouche ouverte, le vent sans effort, vide et sans fin du désert, qui palpitait dans le passé. Ce souffle lent était né quelque part au-delà du lointain Euphrate et s'était frayé un chemin à travers de nombreux jours et nuits d'herbe morte, jusqu'à son premier obstacle, les murs construits par l'homme de notre palais brisé. À leur sujet, il semblait s'inquiéter et s'attarder, murmurant dans un langage d'enfant. Ceci, me disaient-ils, est le meilleur : il n'a pas de goût. Mes Arabes tournaient le dos aux parfums et au luxe pour choisir des choses dans lesquelles l'homme n'avait eu aucune part.
Le Bédouin du désert, né et ayant grandi dans le désert, avait embrassé de toute son âme cette nudité trop dure pour les volontaires, pour la raison, ressentie mais inarticulée, qu'il s'y trouvait indubitablement libre. Il avait perdu les attaches matérielles, les conforts, tous les superfluités et autres complications pour atteindre une liberté personnelle qui hantait la famine et la mort. Il ne voyait aucune vertu dans la pauvreté elle-même : il jouissait des petits vices et des luxes - le café, l'eau fraîche, les femmes - qu'il pouvait encore conserver. Dans sa vie, il y avait de l'air et des vents, du soleil et de la lumière, des espaces ouverts et un grand vide. Il n'y avait pas d'effort humain, pas de fécondité dans la nature : seulement le ciel en haut et la terre intacte en bas. C'est là qu'inconsciemment il s'est approché de Dieu. Pour lui, Dieu n'était pas anthropomorphe, pas tangible, pas moral ni éthique, pas concerné par le monde ou par lui, pas naturel : mais l'être αχρωματος, ασχηματιστος, αναφης ainsi qualifié non par dessaisissement mais par investiture, un Être compréhensif, l'œuf de toute activité, la nature et la matière n'étant qu'un verre qui le reflète.
Le Bédouin ne pouvait pas chercher Dieu en lui : il était trop sûr d'être en Dieu. Il ne pouvait concevoir quoi que ce soit qui soit ou ne soit pas Dieu, qui seul était grand ; pourtant, il y avait une familiarité, une quotidienneté de ce Dieu arabe climatique, qui était leur repas, leur combat et leur désir, la plus commune de leurs pensées, leur ressource familière et leur compagnon, d'une manière impossible à ceux dont le Dieu leur est si désirablement voilé par le désespoir de leur indignité charnelle à son égard et par le décorum du culte formel. Les Arabes ne voyaient aucune incongruité à faire entrer Dieu dans les faiblesses et les appétits de leurs causes les moins honorables. Il était le plus familier de leurs mots ; et en effet, nous avons perdu beaucoup d'éloquence en faisant de Lui le plus court et le plus laid de nos monosyllabes.
Ce credo du désert semblait inexprimable en mots, et même en pensée. Elle était facilement ressentie comme une influence, et ceux qui allaient dans le désert assez longtemps pour oublier ses grands espaces et son vide étaient inévitablement poussés vers Dieu comme seul refuge et rythme d'existence. Le Bedawi pouvait être un sunnite nominal, ou un wahabi nominal, ou n'importe quoi d'autre dans la boussole sémitique, et il le prenait très à la légère, un peu à la manière des gardiens de la porte de Sion qui buvaient de la bière et riaient à Sion parce qu'ils étaient sionistes. Chaque nomade avait sa religion révélée, non pas orale, ni traditionnelle, ni exprimée, mais instinctive en lui-même ; et c'est ainsi que nous avons obtenu toutes les croyances sémitiques qui mettent l'accent (dans leur caractère et leur essence) sur le vide du monde et la plénitude de Dieu ; et selon le pouvoir et l'opportunité du croyant, l'expression de ces croyances était possible.
L'habitant du désert ne pouvait pas s'attribuer le mérite de sa croyance. Il n'avait jamais été ni évangéliste ni prosélyte. Il est arrivé à cette condensation intense de lui-même en Dieu en fermant les yeux sur le monde et sur toutes les possibilités complexes latentes en lui que seul le contact avec les richesses et les tentations pouvait faire naître. Il a atteint une confiance sûre et puissante, mais dans un domaine si étroit ! Son expérience stérile l'a privé de compassion et a perverti sa bonté humaine à l'image du gâchis dans lequel il se cachait. C'est ainsi qu'il s'est fait du mal, non seulement pour se libérer, mais aussi pour se faire plaisir. Il s'ensuivit une jouissance de la douleur, une cruauté qui était pour lui plus qu'un bien. L'Arabe du désert n'a pas trouvé de joie comme celle de se retenir volontairement. Il trouvait le luxe dans l'abnégation, le renoncement, la retenue. Il a rendu la nudité de l'esprit aussi sensuelle que la nudité du corps. Il a sauvé son âme, peut-être, et sans danger, mais dans un dur égoïsme. Son désert devint une glacière spirituelle, dans laquelle fut conservée, intacte mais non améliorée, pour tous les âges, la vision de l'unité de Dieu. Les chercheurs du monde extérieur pouvaient parfois s'y réfugier pour une saison et y observer avec détachement la nature de la génération qu'ils voulaient convertir.
Cette foi du désert était impossible dans les villes. Elle était à la fois trop étrange, trop simple, trop impalpable pour être exportée et utilisée couramment. L'idée, la croyance fondamentale de toutes les croyances sémitiques attendait là, mais elle devait être diluée pour nous être compréhensible. Le cri d'une chauve-souris était trop strident pour beaucoup d'oreilles : l'esprit du désert s'est échappé à travers notre texture plus grossière. Les prophètes sont revenus du désert avec leur vision de Dieu, et à travers leur support taché (comme à travers un verre sombre), ils ont montré quelque chose de la majesté et de l'éclat dont la pleine vision nous aveuglerait, nous assourdirait, nous réduirait au silence, nous servirait comme elle avait servi le Bédouin, le rendant grossier, un homme à part.
Les disciples, en s'efforçant de se dépouiller et de dépouiller leurs voisins selon la parole du Maître, ont trébuché sur les faiblesses humaines et ont échoué. Pour vivre, le villageois ou le citadin doit se remplir chaque jour des plaisirs de l'acquisition et de l'accumulation, et devenir, par rebondissement, le plus grossier et le plus matériel des hommes. Le mépris éclatant de la vie qui conduit les autres à l'ascétisme le plus strict l'a conduit au désespoir. Il se gaspillait sans compter, comme un dépensier ; il épuisait son héritage de chair dans un désir hâtif d'en finir. Le juif du Metropole de Brighton, l'avare, l'adorateur d'Adonis, le débauché des ragoûts de Damas étaient autant de signes de l'aptitude sémitique à la jouissance et d'expressions du même nerf qui nous a donné à l'autre pôle l'abnégation des Esséniens, ou des premiers chrétiens, ou des premiers khalifes, trouvant le chemin du ciel le plus beau pour les pauvres d'esprit. Le Sémite oscillait entre la luxure et l'abnégation.
Les Arabes pouvaient se balancer sur une idée comme sur une corde, car l'allégeance sans réserve de leur esprit faisait d'eux des serviteurs obéissants. Aucun d'entre eux n'échappait à ce lien jusqu'à ce que le succès arrive, et avec lui les responsabilités, les devoirs et les engagements. Alors l'idée disparaissait et le travail se terminait - en ruines. Sans croyance, on pouvait les emmener aux quatre coins du monde (mais pas au ciel) en leur montrant les richesses de la terre et ses plaisirs ; mais si, sur la route, conduits de cette manière, ils rencontraient le prophète d'une idée, qui n'avait nulle part où reposer la tête et qui dépendait pour sa nourriture de la charité ou des oiseaux, alors ils abandonneraient tous leur richesse pour son inspiration. C'étaient des enfants incorrigibles de l'idée, des êtres sans cervelle et sans couleur, pour qui le corps et l'esprit étaient à jamais et inévitablement opposés. Leur esprit était étrange et sombre, plein de dépressions et d'exaltations, dépourvu de règles, mais plus ardent et plus fertile en croyances que n'importe quel autre au monde. C'était un peuple de commencements, pour qui l'abstrait était le motif le plus fort, le processus d'un courage et d'une variété infinis, et la fin rien. Ils étaient aussi instables que l'eau, et comme l'eau, ils finiraient peut-être par l'emporter. Depuis l'aube de la vie, par vagues successives, ils s'étaient heurtés aux côtes de la chair. Chaque vague était brisée, mais, comme la mer, elle usait toujours un peu du granit sur lequel elle s'échouait, et un jour, dans des temps immémoriaux, elle pourrait rouler sans entrave sur l'endroit où le monde matériel avait été, et Dieu se déplacerait sur la face de ces eaux. J'ai soulevé une de ces vagues (et non des moindres) et je l'ai fait rouler sous le souffle d'une idée, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa crête et qu'elle se renverse et tombe à Damas. Le flot de cette vague, repoussé par la résistance des choses acquises, fournira la matière de la vague suivante, lorsque, dans la plénitude des temps, la mer sera à nouveau soulevée.
Chapitre IV
La première grande ruée autour de la Méditerranée avait montré au monde la puissance d'un Arabe excité pour une courte période d'activité physique intense ; mais une fois l'effort épuisé, le manque d'endurance et de routine de l'esprit sémite devint tout aussi évident. Les provinces qu'ils avaient envahies, ils les négligèrent, par pur dégoût du système, et durent demander l'aide de leurs sujets conquis, ou d'étrangers plus vigoureux, pour administrer leurs empires mal ficelés et inchoatifs. Ainsi, au début du Moyen Âge, les Turcs ont pris pied dans les États arabes, d'abord en tant que serviteurs, puis en tant qu'auxiliaires, et enfin en tant que parasites qui ont étouffé la vie de l'ancien corps politique. La dernière phase fut celle de l'inimitié, lorsque les Hulagus ou Timurs assouvirent leur soif de sang en brûlant et en détruisant tout ce qui les irritait avec une prétention de supériorité.
Les civilisations arabes étaient de nature abstraite, morales et intellectuelles plutôt qu'appliquées, et leur manque d'esprit public rendait futiles leurs excellentes qualités privées. Ils ont eu de la chance à leur époque : L'Europe était tombée dans la barbarie et le souvenir des études grecques et latines s'effaçait de l'esprit des hommes. En revanche, l'exercice d'imitation des Arabes semblait cultivé, leur activité mentale progressive, leur état prospère. Ils avaient rendu un véritable service en préservant quelque chose d'un passé classique pour un avenir médiéval.
Avec l'arrivée des Turcs, ce bonheur n'est plus qu'un rêve. Par étapes, les Sémites d'Asie passèrent sous leur joug et y trouvèrent une mort lente. Ils furent dépouillés de leurs biens et leurs esprits se ratatinèrent sous l'effet de l'haleine engourdissante d'un gouvernement militaire. Le régime turc était un régime de gendarmes, et la théorie politique turque était aussi grossière que sa pratique. Les Turcs enseignèrent aux Arabes que les intérêts d'une secte étaient supérieurs à ceux du patriotisme, que les petites préoccupations de la province l'emportaient sur la nationalité. Par de subtiles dissensions, ils les amènent à se méfier les uns des autres. Même la langue arabe fut bannie des tribunaux et des bureaux, des services gouvernementaux et des écoles supérieures. Les Arabes ne pouvaient servir l'État qu'en sacrifiant leurs caractéristiques raciales. Ces mesures ne sont pas acceptées sans réagir. La ténacité sémite s'est manifestée dans les nombreuses rébellions de Syrie, de Mésopotamie et d'Arabie contre les formes les plus grossières de la pénétration turque ; et la résistance s'est également manifestée contre les tentatives d'absorption les plus insidieuses. Les Arabes n'ont pas voulu abandonner leur langue riche et souple au profit d'un turc rudimentaire : ils ont au contraire rempli le turc de mots arabes et se sont accrochés aux trésors de leur propre littérature.
Ils ont perdu leur sens géographique et leurs souvenirs raciaux, politiques et historiques, mais ils se sont encore plus accrochés à leur langue et en ont fait presque une patrie à part entière. Le premier devoir de tout musulman était d'étudier le Coran, le livre sacré de l'islam et, accessoirement, le plus grand monument littéraire arabe. Le fait de savoir que cette religion était la sienne et qu'il était le seul à pouvoir la comprendre et la pratiquer donnait à chaque Arabe un critère pour juger les réalisations banales du Turc.
Puis vint la révolution turque, la chute d'Abdul Hamid et la suprématie des Jeunes Turcs. L'horizon s'élargit momentanément pour les Arabes. Le mouvement Jeune-Turc est une révolte contre la conception hiérarchique de l'Islam et les théories panislamiques du vieux sultan, qui avait aspiré, en se faisant le directeur spirituel du monde musulman, à être aussi (sans appel) son directeur dans les affaires temporelles. Ces jeunes politiciens se sont rebellés et l'ont jeté en prison, sous l'impulsion des théories constitutionnelles d'un État souverain. Ainsi, à une époque où l'Europe occidentale commençait à peine à sortir de la nationalité pour entrer dans l'internationalité et à se lancer dans des guerres loin des problèmes de race, l'Asie occidentale commençait à sortir du catholicisme pour entrer dans la politique nationaliste et à rêver de guerres pour l'autonomie et la souveraineté, au lieu de guerres pour la foi ou le dogme. Cette tendance s'était manifestée d'abord et le plus fortement au Proche-Orient, dans les petits États balkaniques, et les avait soutenus à travers un martyre presque sans pareil jusqu'à leur objectif de séparation d'avec la Turquie. Plus tard, il y eut des mouvements nationalistes en Égypte, en Inde, en Perse et finalement à Constantinople, où ils furent fortifiés et rendus plus pointus par les nouvelles idées américaines en matière d'éducation : des idées qui, lorsqu'elles étaient libérées dans l'ancienne atmosphère orientale élevée, formaient un mélange explosif. Les écoles américaines, qui enseignent selon la méthode de l'enquête, encouragent le détachement scientifique et le libre échange de points de vue. Sans le vouloir, elles enseignaient la révolution, car il était impossible pour un individu d'être moderne en Turquie et en même temps loyal, s'il était né d'une des races soumises - Grecs, Arabes, Kurdes, Arméniens ou Albanais - sur lesquelles les Turcs ont été si longtemps aidés à garder la domination.
Les Jeunes Turcs, forts de leur premier succès, se laissèrent emporter par la logique de leurs principes et, pour protester contre le panislam, prêchèrent la fraternité ottomane. Les sujets crédules - bien plus nombreux que les Turcs eux-mêmes - croient qu'ils sont appelés à coopérer à l'édification d'un nouvel Orient. S'attelant à la tâche (pleines d'Herbert Spencer et d'Alexander Hamilton), elles ont élaboré des plates-formes d'idées radicales et ont salué les Turcs comme des partenaires. Les Turcs, terrifiés par les forces qu'ils avaient libérées, ont éteint le feu aussi soudainement qu'ils l'avaient attisé. La Turquie est devenue turque pour les Turcs -Yeni-turan- est devenu le cri. Plus tard, cette politique les orientera vers le sauvetage de leurs irrédentis - les populations turques soumises à la Russie en Asie centrale - mais, tout d'abord, ils doivent purger leur Empire des races sujettes irritantes qui résistent à l'emprise du pouvoir. Il faut d'abord s'occuper des Arabes, la plus grande composante étrangère de la Turquie. En conséquence, les députés arabes sont dispersés, les sociétés arabes interdites, les notables arabes proscrits. Les manifestations arabes et la langue arabe ont été réprimées par Enver Pacha plus sévèrement que par Abdul Hamid avant lui.