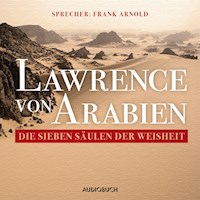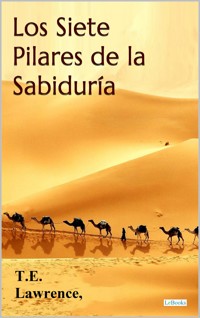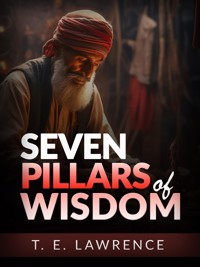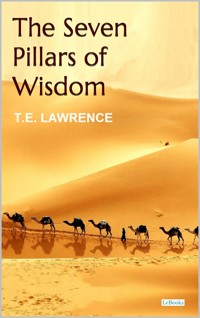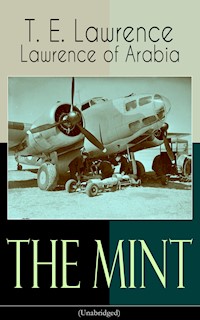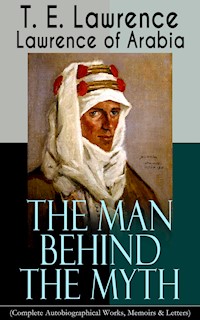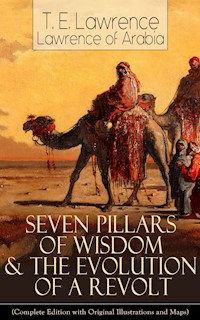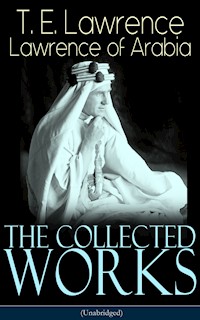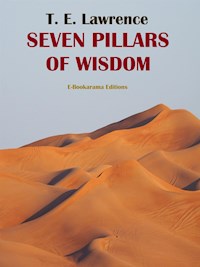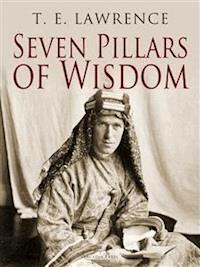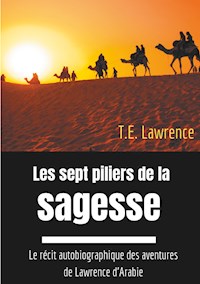
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Les sept piliers de la sagesse" est un récit autobiographique captivant de T.E. Lawrence, connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. L'ouvrage relate ses expériences pendant la révolte arabe contre l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Lawrence, en tant qu'officier de liaison britannique, joue un rôle essentiel dans la coordination des efforts arabes pour déstabiliser les forces ottomanes. Le texte, riche en détails et en réflexions personnelles, offre une perspective unique sur les complexités politiques et culturelles de la région. Lawrence décrit avec précision les paysages arides du désert, les batailles stratégiques et les interactions intenses avec les chefs arabes comme le prince Fayçal. Le livre explore également les dilemmes moraux et éthiques auxquels Lawrence est confronté, tiraillé entre ses devoirs envers l'Empire britannique et ses sympathies croissantes pour la cause arabe. "Les sept piliers de la sagesse" n'est pas seulement un récit de guerre, mais aussi une méditation sur la loyauté, l'identité et le pouvoir. À travers une prose poétique et introspective, Lawrence plonge le lecteur dans une époque charnière de l'histoire du Moyen-Orient, tout en révélant ses propres vulnérabilités et convictions. Cette oeuvre est un témoignage intemporel de la complexité des relations humaines en temps de conflit, et une exploration profonde de l'esprit humain face à l'adversité. L'AUTEUR : Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de T.E. Lawrence, est né le 16 août 1888 au Pays de Galles. Il est surtout célèbre pour son rôle durant la révolte arabe de 1916-1918, où il a servi comme officier de liaison britannique. Lawrence a étudié l'archéologie à l'Université d'Oxford, ce qui l'a conduit à voyager au Moyen-Orient avant la Première Guerre mondiale. Ces expériences ont enrichi sa compréhension des cultures arabes, une connaissance qui s'est avérée cruciale pendant le conflit. Après la guerre, Lawrence a contribué à la conférence de paix de Paris, mais il a été déçu par l'échec des puissances occidentales à tenir leurs promesses envers les Arabes. En dehors de ses exploits militaires, Lawrence était un écrivain prolifique et un intellectuel. Son oeuvre majeure, "Les sept piliers de la sagesse", est reconnue pour sa profondeur narrative et sa richesse descriptive. Malgré sa renommée, Lawrence a cherché à échapper à la célébrité, adoptant des pseudonymes et menant une vie relativement anonyme dans l'armée de l'air britannique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1317
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
INTRODUCTION - BASE DE LA RÉVOLTE
LIVRE 1 - DÉCOUVERTE DE FAYÇAL
LIVRE II - LE DÉBUT DE L’OFFENSIVE ARABE
LIVRE III - DIVERSION SUR LE CHEMIN DE FER
LIVRE IV - AKABA
NOTES
V - NOUS MARQUONS LE PAS
VI - LE RAID SUR LES PONTS
VII - CAMPAGNE DE LA MER MORTE
VIII - LA RUINE DU PLUS HAUT ESPOIR
IX - L’ÉLAN POUR LE DERNIER EFFORT
X - ON ACHÈVE LA MAISON
ÉPILOGUE
INTRODUCTION - BASE DE LA RÉVOLTE
Quelques Anglais - dont Kitchener était le principal - crurent qu’une révolte des Arabes contre les Turcs permettrait à l’Angleterre, tout en luttant contre l’Allemagne, de battre son alliée la Turquie.
L’esprit des peuples de langue arabe que ces hommes connaissaient bien, leur puissance et la configuration de leur pays, rendaient probable le succès de la révolte et permettaient d’en préciser le caractère et la méthode.
Ils laissèrent donc le Mouvement naître et s’étendre, après avoir obtenu, du Gouvernement britannique, la promesse formelle d’un secours. Cette révolte du chérif de La Mecque n’en fut pas moins une surprise pour beaucoup, car les Alliés n’avaient pas été préparés à l’événement. Elle suscita des sentiments mêlés, créa de fortes amitiés, des inimitiés non moins fortes, et, dans le choc des jalousies, ne tarda pas à faire fausse route.
1
Du mal que contient cette histoire, une partie au moins fut sans doute imputable aux circonstances. Pendant des années nous avons vécu côte à côte, dans un désert nu sous un ciel indifférent. Le chaud soleil, pendant le jour, nous faisait fermenter et les rafales de vent nous rendaient ivres. La nuit nous étions tachés de rosée et l’innombrable silence des étoiles nous faisait honte de notre petitesse. Nous étions une armée concentrée sur elle-même, sans parade ni geste, toute dévouée à la liberté, la seconde des croyances humaines : but si vorace qu’il engloutit notre force, espoir si transcendant que nos précédentes ambitions se fanèrent à son éclat.
Peu à peu, le désir de nous battre pour cet idéal crût en nous jusqu’à devenir une hantise incontestée, domptant bridant, éperonnant nos doutes. Bon gré mal gré nous y trouvâmes une foi. Nous nous étions vendus pour ses esclaves, nous nous étions nous -mêmes enchaînés à sa chaine, courbés pour servir, satisfaits ou non, mais pleinement, sa cause sainte. La mentalité des esclaves ordinaires est terrible : et ils n’ont perdu que le monde; nous avions livré non seulement notre corps, mais notre âme à cet appétit dominateur de victoire. De par notre propre volonté nous étions vidés de volition libre, de moralité, de responsabilité, comme des feuilles mortes dans le vent.
Une guerre sans arrêt nous dépouillait du souci de notre vie ou de celle des autres. Nous avions autour de nos cous des cordes, et sur nos têtes des prix, qui montraient bien à quelles atroces tortures nous étions voués si l’ennemi s’emparait de nos personnes. Chaque jour l’un de nous disparaissait et les vivants connaissaient leur sort de marionnettes humaines jouant sur la scène de Dieu. Sans merci était notre maitre, en vérité; sans merci tant que nos pieds las pouvaient encore trébucher sur la route. Les faibles enviaient leurs compagnons assez fatigués pour mourir; car le succès apparaissait lointain et l’échec offrait un repos assuré, quoique atroce. Nous vivions, les nerfs toujours tendus ou brisés, tantôt sur la crête et tantôt au creux de vagues émotives. Une telle faiblesse nous était amère; nous en arrivions à vivre seulement pour l’horizon visible, en casse-cous, insouciants des souffrances infligées ou subies puisque toute sensation physique apparaissait petitement passagère. Des bouffées de cruauté, de perversion, de luxure couraient à la surface de notre vie sans la troubler : car les lois morales qui élevaient naguère leurs barrières autour d’accidents puérils apparaissaient comme des mots plus faibles encore que les sensations. Il y avait, apprenions-nous, des chocs trop aigus, des souffrances trop profondes, des extases trop hautes pour que nos « moi » finis les enregistrassent. A cette acuité d’émotion l’esprit perdait haleine et la mémoire pâlissait jusqu’au retour de circonstances plus banalement quotidiennes.
Une telle exaltation de la pensée, laissant l’esprit aller à la dérive et lui donnant licence en d’étranges climats, lui faisait perdre en même temps sa vieille autorité sur le corps. Le corps se montrait trop grossier pour ressentir l’extrême de nos chagrins et de nos joies. En conséquence, nous mimes le corps au rebut; nous le laissâmes audessous de nous pour aller en avant, simulacre animé, abandonné à son propre niveau, soumis à des influences que nos instincts eussent évitées en temps normal. Les hommes étaient jeunes et forts; la chair et le sang qui brûlaient en eux réclamaient inconsciemment leurs droits, tourmentaient leurs ventres d’étranges désirs. Privations et dangers, sous un climat aussi torturant qu’on puisse imaginer, attisaient encore cette ardeur virile. Nous n’avions point d’endroit clos pour la solitude, ni de vêtement discret pour la pudeur. En toute chose, l’homme vivait candidement à la vue de l’homme.
L’Arabe est par nature continent; et l’usage d’un mariage universel a presque aboli dans ses tribus les errements irréguliers. Les femmes publiques des rares centres humains que nous rencontrions dans nos mois d’errance n’auraient rien été pour notre foule, en admettant que leur chair harassée fût acceptable pour un homme sain. L’horreur d’un commerce aussi sordide nous fit user avec indifférence, afin d’éteindre nos rares ardeurs réciproques, de nos corps jeunes et lavés - commodité froide qui, par comparaison, apparaissait asexuelle et presque pure. Plus tard quelques-uns d’entre nous se mirent à justifier cet acte stérile, et affirmèrent que deux amis, frissonnant dans un creux de sable à l’enlacement intime de leurs corps brûlants, trouvaient, caché dans l’ombre, un adjuvant sensuel à la passion mentale qui soudait nos esprits et nos âmes en un seul effort flamboyant. Plusieurs enfin, heureux de châtier en eux des appétits qu’ils ne pouvaient dompter, trouvèrent une satisfaction orgueilleuse et sauvage à dégrader leur corps et s’offrirent farouchement à n’importe quelle habitude qui promettait au corps quelque souffrance ou quelque salissure.
Je fus mandé vers ces Arabes en étranger, incapable de penser leurs pensées ou de souscrire à leurs croyances, obligé seulement par devoir de les entrainer et d’assurer le succès de tous leurs mouvements quand ils seraient conformes à l’intérêt de l’Angleterre en guerre. Si je ne pouvais pas acquérir leur personnalité, je pouvais au moins leur cacher la mienne, et, sans friction ni protestation ni critique, me mêler à eux pour exercer une influence qu’ils ne sentiraient même pas. Mais puisque j’ai été leur compagnon, je ne songe maintenant ni à les louer ni à les défendre. J’ai repris aujourd’hui mes vieux habits; il me serait facile de jouer au spectateur obéissant aux délicatesses conventionnelles de notre propre théâtre. il est plus honnête de me souvenir que l’idée et les actions du moment me parurent toutes naturelles. Ce qui me semble maintenant cruel ou sadique, je le jugeai alors inévitable ou sans importance.
Nous avions toujours du sang sur les mains; on nous en avait donné licence. Blesser, tuer, semblaient des douleurs éphémères, si brève et si meurtrie était la vie que nous possédions. La peine d’exister était si grande que la peine de punir devait être impitoyable. Nous vivions pour le jour présent et mourions de même. Aussitôt qu’apparaissaient quelque raison et quelque désir de punir, nous inscrivions le châtiment sans retard avec la balle ou le fouet dans la chair gonflée du patient, et le jugement était sans appel. Le désert ne permettait pas les châtiments longs et raffinés des tribunaux et des geôles.
Récompenses et plaisirs nous balayaient, il est vrai, aussi soudainement que les souffrances, mais, pour moi en particulier, ils avaient moins de poids. La vie bédouine est dure même pour ceux qui y sont accoutumés, terrible pour les étrangers : une mort vivante. Quand la marche ou le labeur cessaient, je n’avais plus assez d’énergie pour rappeler à moi la moindre sensation; et je n’avais aucun loisir, pendant qu’ils durâient, pour contempler quelque douceur spirituelle rencontrée parfois sur notre chemin. Dans mes notes, la cruauté plutôt que la beauté trouve sa place. Sans doute nous jouissions d’autant plus des rares moments de paix et d’oubli; mais je me souviens davantage des angoisses, des terreurs et des fautes. Notre vie n’est pas toute dans ce que j’ai écrit (il y a des choses que le moins honteux ne peut se répéter de sang-froid); mais ce que j’ai écrit fut dans notre vie, fait de notre vie. Plaise à Dieu que les hommes ayant lu cette histoire n’aillent pas, par amour de l’étrange et de son flamboiement, prostituer au service d’une autre race leurs talents et leur être même.
L’homme qui accepte d’être possédé par des étrangers mène la pire vie de yahoo1 parce qu’il a vendu son âme à une brute. Lui-même n’est pas l’un de ces étrangers. Il peut donc s’opposer à eux, croire à sa mission, tordre et forger cette matière humaine, lui donner une forme qu’elle n’eût jamais prise seule : dans ce cas il se sert des forces de son propre milieu naturel pour faire sortir du leur ces étrangers. Ou bien il peut, comme je l’ai fait, les imiter si bien qu’à leur tour ils l’imitent. L’homme qui agit ainsi abandonne son propre milieu : il prétend à celui d’autrui; et les prétentions sont vaines. Mais ni dans un cas ni dans l’autre il ne fait quelque chose de lui-même; il ne crée pas non plus une œuvre assez nette pour être sienne (sans souci de conversion), laissant l’étranger agir ou réagir à son gré devant cet exemple silencieux.
Dans mon cas particulier, un effort, prolongé pendant des années, pour vivre dans le costume des Arabes et me plier à leur moule mental m’a dépouillé de ma personnalité anglaise : j’ai pu ainsi considérer l’Occident et ses conventions avec des yeux neufs - en fait, cesser d’y croire. Mais comment se faire une peau arabe ? Ce fut, de ma part, affectation pure. Il est aisé de faire perdre sa foi à un homme, mais il est difficile, ensuite, de le convertir à une autre. Ayant dépouillé une forme sans en acquérir de nouvelle, j’étais devenu semblable au légendaire cercueil de Mohammed. Le résultat devait être un sentiment d’intense solitude accompagné de mépris non pour les autres, mais pour tout ce qu’ils font. Épuisé par un effort physique et un isolement également prolongés, un homme a connu ce détachement suprême. Pendant que son corps avançait comme une machine, son esprit raisonnable l’abandonnait pour jeter sur lui un regard critique en demandant le but et la raison d’un tel fatras. Parfois même ces personnages engageaient une conversation dans le vide : la folie, alors, était proche. Elle est proche, je crois, de tout homme qui peut voir simultanément l’univers à travers les voiles de deux coutumes, de deux éducations, de deux milieux.
2
La première difficulté du Mouvement arabe fut de définir les Arabes. Le nom de ce peuple artificiel a toujours changé de sens d’année en année. Il désignait autrefois les Arabesques, habitants d’un pays appelé l’Arabie. Mais ceci n’avait plus de sens pour nous. La véritable définition était fournie par le langage. L’arabique forme la langue courante de la Syrie, de la Palestine, de la Mésopotamie, et de la grande péninsule nommée Arabie sur la carte. Avant la conquête musulmane, ces contrées étaient habitées par des peuples divers parlant différents idiomes d’une même famille. Nous les appelons sémitiques, d’un terme incorrect comme beaucoup de termes en science. Quoi qu’il en soit, les langues arabiques - assyrienne, babylonienne, phénicienne, hébraïque, araméenne et syriaque - étaient voisines : certaines marques d’influences communes, voire même d’une commune origine, sont renforcées encore par le fait connu que les peuples actuels de langue arabe en Asie, pourtant aussi variés qu’un champ de fleurs, offrent, dans leur apparence physique et leurs coutumes, des ressemblances essentielles. Nous pourrions, d’un terme parfaitement propre, les appeler cousins - et cousins tristement avertis de leurs liens de parenté.
Cette définition admise, les régions de langue arabe,en Asie dessinent vaguement un parallélogramme. Le côté Nord va d’Alexandrette sur la Méditerranée à travers la Mésopotamie à l’Est, jusqu’au Tigre. Le côté Sud suit le bord de l’Océan Indien d’Aden à Muscat. La frontière Ouest est marquée par la Méditerranée, le Canal de Suez et la Mer Rouge jusqu’à Aden; celle à l’Est par le Tigre et le Golfe Persique jusqu’à Muscat. Ce rectangle, aussi vaste que l’ Inde, composait la patrie des Sémites : aucune race étrangère n’a pu y prendre pied définitivement quoi que les Égyptiens, les Hittites, les Philistins, les Perses, les Grecs, les Romains, les Turcs et les Francs aient tour à tour essayé de le faire. Tous ont été brisés à la longue, leurs éléments dispersés, engloutis par les fortes caractéristiques de la race autochtone. Les Sémites, en revanche, ont quelquefois tenté de passer leurs frontières, mais se sont dissous à leur tour dans le monde extérieur. L’Égypte, Alger, le Maroc, Malte, la Sicile, l’Espagne, la Cilicie et la France ont absorbé et fait disparaître des colonies sémites. C’est seulement à Tripoli, en Afrique, et par le miracle persistant de la Juiverie, que les anciens Sémites ont gardé quelque chose de leur identité et de leur force.
L’origine de ces peuples était pour nous une question académique; mais, pour l’intelligence de la Révolte, leurs différences présentes, sociales et politiques, offraient le plus grand intérêt. La géographie, d’ailleurs, les commande. Le continent arabe se divise en grandes régions naturelles dont la diversité physique impose aux indigènes des mœurs très variées. A l’Ouest notre parallélogramme est encadré, d’Alexandrette à Aden, par une chaîne montagneuse qui compose au Nord la Syrie, puis successivement du Nord au Sud la Palestine, le Madian, le Hedjaz et enfin le Yémen. La hauteur moyenne de cette chaîne est d’environ mille mètres avec des pics de trois à quatre mille. Elle est tournée vers l’Ouest, arrosée par les pluies qui viennent de la mer, en général largement peuplée.
Une autre chaîne de montagnes peuplées, face à l’Océan Indien, forme le bord Sud du parallélogramme. Le bord Est comporte en premier lieu une plaine d’alluvions, la Mésopotamie, puis, au Sud de Bassora, un littoral bas appelé Koweït et Hassa jusqu’à Gattar. La plus grande partie de cette plaine est aussi peuplée. Par contre, collines et plaines encadrent une cuvette désertique, laquelle présente, en son centre, un archipel d’oasis populeuses, Kassim et Riadh. Dans ce groupe d’oasis était, découvrîmes-nous, le cœur de l’Arabie, la source de son esprit natif et son individualité la plus consciente. Le désert qui le conservait dans son sein le gardait pur de tout contact étranger, donnant ainsi au pays son caractère.
Le désert lui-même, d’ailleurs, accomplissant cette grande fonction, est de nature variée. Au Sud des oasis il apparaît comme une mer de sable, sans une seule piste. Cette solitude s’étend presque jusqu’au pied de l’escarpement populeux qui borde l’Océan Indien, et le coupe de l’histoire arabe en interdisant toute influence réciproque, morale ou politique. Hadhramaout (tel est le nom donné à la côte Sud) fait historiquement partie des Indes Néerlandaises; sa civilisation a plus touché Java que l’Arabie. A l’Ouest des oasis, dans la direction du Hedjaz montagneux, s’ouvre le désert du Nedjed, aire de gravier et de lave sans beaucoup de sable. A l’Est des oasis, dans la direction de Koweït, s’étend de même une aire de gravier, mais traversée par de larges bandes d’un sable mou qui rend difficile les communications. Enfin, au Nord des oasis, le voyageur rencontre une ceinture de sable, puis une immense plaine de gravier et de lave comblant l’espace entre le bord oriental de la Syrie et l’Euphrate, frontière de la Mésopotamie. Le fait que ce désert du Nord est praticable aux hommes et aux automobiles a permis le succès de la Révolte Arabe.
Les montagnes de l’Ouest et les plaines de l’Est ont toujours été les parties de l’Arabie les plus peuplées comme les plus actives. A l’Ouest en particulier les montagnes de Syrie et de Palestine, du Hedjaz et du Yémen sont entrées maintes fois dans le courant de notre histoire européenne. Moralement, ces hauteurs fertiles et saines appartiennent à l’Europe plutôt qu’à l’Asie; les Arabes ont toujours tourné les yeux vers la Méditerranée plutôt que vers l’Océan Indien pour y trouver soit des sympathies culturelles, soit des buts d’entreprise guerrière, soit enfin des terrains d’expansion, cette dernière recherche étant d’ailleurs la plus pressante depuis l’époque où les courants d’émigration sont devenus en Arabie la force la plus grande, la plus complexe et la plus générale aussi, encore qu’elle varie beaucoup suivant les différents districts.
A cette époque, dans les villes du Nord (Syrie), le taux des naissances était bas, la mortalité, par contre, élevée, à cause des mauvaises conditions d’hygiène et de la vie épuisante que mène la majorité de la population. En conséquence, le surplus de la paysannerie trouvait une issue dans les villes. Dans le Liban, où l’état sanitaire avait été amélioré, un exode chaque année plus considérable entraînait la jeunesse vers l’Amérique, menaçant (pour la première fois depuis les Grecs) de modifier les visées extérieures d’un pays entier.
La solution du problème était différente dans le Yémen. Il n’y avait là ni commerce extérieur ni industrie massive comprimant la population dans des centres malsains. Les villes étaient simplement des lieux de marchés aussi propres et simples que de petits villages. La population avait crû; le niveau de vie s’était abaissé; les effets d’une congestion lente étaient généralement ressentis. Les hommes du Yémen ne pouvaient pas franchir la mer; car le Soudan est pire que l’Arabie et les quelques tribus qui s’y sont aventurées ont dû, pour continuer à vivre, modifier profondément leurs mœurs et leur culture sémites. Ils ne pouvaient pas non plus émigrer vers le Nord le long des montagnes : car ils trouvaient là, devant eux, la ville sainte de La Mecque avec son port, Djeddah, - incise étrangère,ceinture sans cesse renfoncée par l’immigration de l’Inde, de Java, de Bokhara et de l’Afrique; cette population, de vitalité très forte, violemment hostile à la conscience sémite, se maintenait là en dépit des lois économiques, de la géographie et du climat, par le seul artifice d’une religion universelle. La congestion du Yémen, par suite, lorsqu’elle devenait extrême, trouvait sa seule issue à l’Est : sa population, repoussant les petits groupes plus faibles de la frontière, les contraignait à descendre les pentes des montagnes vers le Widian, province à moitié déserte où de grandes vallées (Bisha, Daouasir, Ranya et Taraba) mènent les eaux se perdre dans le désert du Nedjed. Ces clans plus faibles des frontières devaient sans cesse abandonner de bonnes sources et de fertiles palmeraies pour des sources plus pauvres et des palmeraies plus maigres. Rejetés dans une région où la vie agricole proprement dite devenait impossible, ils ne pouvaient dès lors assurer une existence précaire qu’en élevant des moutons et des chameaux; et peu à peu l’élevage devenait leur seule ressource.
Enfin, sous une poussée ultime de la population ! toujours croissante derrière eux, les peuplades des frontières (désormais presque uniquement pastorales), repoussées des dernières misérables oasis, entraient dans le désert et devenaient nomades. Ce processus, observable encore aujourd’hui sur des familles individuelles et sur des tribus dont on peut nommer et dater exactement les étapes, a dû se poursuivre depuis le premier jour où le Yémen fut pleinement peuplé. Le Widian, entre La Mecque et Taif, est plein des souvenirs de cinquante tribus qui sont parties de là et que l’on retrouve aujourd’hui dans le Nedjed, le Djébel Chammar, le Hamad et jusque sur les frontières de Syrie ou de Mésopotamie. C’est là qu’il faut chercher le point de départ des migrations arabes, l’usine à nomades, la source du Gulf-Stream errant dans le désert.
Car la population du désert est aussi peu statique que celle des montagnes. La vie économique y est basée sur la « production » de chameaux qui trouvent leur meilleure nourriture dans les sévères pâturages des Hauts-Plateaux, avec leurs plantes épineuses, mais charnues et nutritives. Les Bédouins vivent de cette production qui modèle en retour leur existence, préside à la distribution des zones entre chaque tribu, entretient la révolution des transhumances, à mesure que les troupeaux rasent les pousses des pâturages de printemps, d’été puis d’hiver. Les marchés de chameaux en Syrie, en Mésopotamie et en Égypte déterminent la population du désert, fixent strictement son niveau de vie. Ainsi le désert, à son tour, put être parfois surpeuplé : d’où les soulèvements et les poussées de tribus trop nombreuses jouant des coudes vers la lumière. Le Sud leur était interdit, sable ou mer inhospitaliers. Elles ne pouvaient se tourner vers l’Ouest; les pentes raides du Hedjaz étaient ourlées par rangs épais de populations montagnardes qui tiraient un plein avantage de leur position défensive. Elles refluaient parfois vers les oasis centrales de Riadh et de Kassim, et, si leurs hommes étaient vigoureux et bien armés, elles pouvaient réussir à les occuper en partie. Mais si le désert avait mal nourri leurs forces, ces peuples nomades étaient poussés graduellement vers le Nord entre Médine, dans le Hedjaz, et Kassim, dans le Nedjed. Enfin ils se trouvaient à la fourche de deux routes. Ils pouvaient s’avancer vers l’Est par l’ouadi Roum ou le Djébel Chammar, suivre le Batn vers Shamiya et devenir, peut-être, des riverains du bas Euphrate; ou bien ils pouvaient remonter petit à petit l’échelle des oasis occidentales - Hénakiya, Kheibar, Teima, Jauf et le Sirhan - et laisser le destin les conduire aux alentours du Djébel Druse en Syrie, à moins qu’ils n’aillent abreuver leurs troupeaux près de Tadmor dans le désert septentrional, sur la route d’Alep ou celle d’Assyrie.
La pression, d’ailleurs, ne cessait pas pour cela; l’inexorable poussée vers le Nord continuait. Les tribus se trouvaient entraînées jusqu’au bord même des champs cultivés en Syrie ou en Mésopotamie. L’occasion et le cri de leur ventre affamé leur suggéraient de posséder des chèvres, puis des moutons; un jour ils semaient, ne fût-ce qu’un peu d’orge pour leurs animaux. Dès lors, cessant d’être des Bédouins, ils commençaient, comme les villageois, à souffrir des nomades qui montaient derrière eux. Insensiblement, ils liaient partie avec les paysans établis déjà sur le sol; enfin ils étaient paysans eux-mêmes.
Ainsi nous voyons certains clans, nés sur les hauteurs du Yémen, rejetés par d’autres plus forts, entrer dans le désert où ils adoptent contre leur gré, mais contraints et forcés, une existence de nomades. Nous les voyons errer à l’aventure, chaque année un peu plus au Nord ou un peu plus à l’Est suivant que le hasard les dirige sur l’une ou sur l’autre des routes jalonnées de puits. Puis la même pression inexorable les chasse du désert où elle les avait poussés, et, de ces hommes transformés en nomades malgré eux, refait, malgré eux, des agriculteurs. Telle est la circulation qui a gardé sa vigueur au corps sémite. Rares sont les Sémites du Nord, en admettant qu’il en existe, dont les ancêtres n’ont pas, dans quelque moyen-âge, traversé le désert. La plus mordante et la plus profonde des disciplines sociales, le nomadisme, les a tous marqués à quelque degré.
3
Si l’homme de la ville et l’homme de la tribu, en Asie de langue arabe, ne sont pas des races différentes mais seulement des hommes dans des situations sociales et économiques différentes, quelque ressemblance de famille peut bien être présagée dans le fonctionnement de leur esprit; il est raisonnable, par suite, de rechercher les éléments communs de leurs activités spirituelles. Dès l’abord éclate, en effet, chez eux, je ne sais quelle universelle netteté ou dureté de croyance, quasi mathématique dans ses limites et repoussante dans sa forme par son absence de sympathie. Le clavier visuel des Sémites n’a pas de demitons. Ce peuple voit le monde sous des couleurs primaires ou, mieux encore, en contours découpés, noir sur blanc. Son esprit dogmatique méprise le doute, notre moderne couronne d’épines. Il n’entend rien à nos hésitations métaphysiques, à nos anxiétés introspectives. Il connaît simplement la vérité et la non-vérité, la croyance et la non-croyance, sans l’indécise continuité de nos nuances plus subtiles.
Ce noir et blanc de la vision arabe, nous le retrouvons dans l’esprit et son ameublement. Du noir et blanc ce peuple aime la clarté, mais aussi le contraste. Sa pensée n’est à l’aise que dans les extrêmes. Par goût elle se loge dans les superlatifs. Parfois, à quelque articulation de la pensée, deux contradictoires s’emparent des Arabes au même instant; ils n’acceptent pas pour cela de compromis. Sans percevoir la moindre incongruité, ils poussent à l’absurde, avec logique, leurs opinions incompatibles. La tête froide, le jugement tranquille, dans une imperturbable inconscience de leur oscillation, ils volent d’asymptote à asymptote.
Ce peuple à l’esprit étroitement limité peut laisser en friche son intelligence avec une résignation dépourvue de curiosité. Son imagination est vive; elle n’est pas créatrice. Il y a si peu d’art arabe en Asie qu’on peut presque le négliger; et cependant les hommes riches y sont des patrons libéraux qui encouragent volontiers en architecture, en céramique ou dans tout autre industrie, les talents de leurs voisins et de leurs esclaves. La grande industrie leur est étrangère : il n’y a pas en Arabie d’organisations pour le corps ou pour l’esprit. Ils n’ont pas inventé non plus de systèmes philosophiques ! ou des mythologies complexes. Ils ont toujours poursuivi leur course étroite entre les idoles de la tribu et celles de la grotte. Le moins morbide des peuples, ils ont accepté le don de la vie comme un axiome incontestable. L’existence est à leurs yeux un usufruit imposé à l’homme et qu’un destin hors de notre contrôle accorde ou reprend à son gré. Le suicide, dès lors, est inimaginable et la mort cesse d’être un mal.
Peuple de convulsions, de soulèvements, d’illuminations mentales; race du génie individuel. Leurs mouvements subits confondent d’autant plus qu’ils s’opposent à une quiétude quotidienne; leurs grands hommes sont d’autant plus grands qu’ils se détachent sur la simple humanité d’une foule. L’instinct règle leurs convictions; l’intuition, leurs activités. La plus grande industrie des Arabes est la fabrication des croyances : ils ont presque le monopole des religions révélées. Trois de ces élans se sont affermis chez eux, et deux sur trois ont supporté l’exportation (sous une forme modifiée) chez les peuples non sémitiques. Le christianisme, traduit en Grec, en Latin, en Teuton suivant l’esprit de ces langues diverses, a conquis l’Europe et l’Amérique. L’Islam, en différentes métamorphoses, soumet encore l’Afrique et quelques parties de l’Asie. Ce sont là les succès des Sémites. Ils gardent pour eux leurs échecs. La frange des déserts arabes est jonchée de croyances brisées.
C’est un fait plein de sens que ces épaves religieuses gisent toutes dans la zone de rencontre du désert et des terres cultivées. Car l’origine des croyances s’en éclaire. Affirmations plutôt que raisonnements, elles ont besoin d’un prophète qui les répande. Les Arabes prétendent avoir fourni au monde quarante mille prophètes : nous possédons des témoignages historiques de quelques centaines au moins. Leurs vies ont toutes le même dessin. Ils naissent, non pas dans la sollitude, mais au cœur d’une foule humaine. Un élan passionné et inintelligible les en chasse vers le désert. Ils passent là un temps plus ou moins long, dans la méditation et le mépris des exigences corporelles. Enfin, leur inspiration ayant pris forme, ils s’en reviennent l’insuffler à leurs vieux compagnons assaillis de doutes.
Les fondateurs des trois grandes croyances ont parcouru ce cycle : et ce qui pourrait n’être qu’une coïncidence prend force de loi si l’on considère les existences parallèles d’une multitude d’autres prophètes infortunés qui n’ont pas réussi. Les messages de ceux-là n’étaient peutêtre pas moins authentiques, mais le temps et les désillusions n’avaient pas accumulé pour eux des amas d’âmes sèches prêtes à l’incendie. L’appel du désert, pour les penseurs de la ville, a toujours été irrésistible : je ne crois pas qu’ils y trouvent Dieu, mais qu’ils entendent plus distinctement dans la solitude le verbe vivant qu’ils y apportent avec eux.
Le trait commun à toutes les croyances sémites, heureuses ou malheureuses, fut toujours et partout le mépris du monde terrestre. Une violente réaction contre la matière entrainait les prophètes à prêcher la nudité, le renoncement et la pauvreté. Une pareille atmosphère mentale enivrait implacablement de ses fumées l’esprit des hommes du désert. Les Arabes ont un sens aigu de cette pureté qui naît de la raréfaction. Je m’en avisai pour la première fois, voici des années, un jour où nous avions chevauché très loin par les plaines mouvantes du Nord de la Syrie jusqu’à une ruine de la période romaine. C’étaient, dirent mes compagnons, les restes d’un palais bâti dans le désert pour une reine par son époux, seigneur de la région limitrophe. Ils ajoutèrent que l’argile de cette construction avait été, pour plus de richesse, pétrie non pas avec de l’eau, mais avec de précieuses essences de fleurs. Reniflant l’air comme des chiens, mes guides me conduisaient de salle croulante en salle croulante disant : « Voici le jasmin, voici la violette, voici la rose »,
A la fin Dahoum m’entraîna : « Venez sentir le parfum le plus doux»; nous entrâmes dans le corps du logis, et là, dans l’embrasure des fenêtres béantes sur sa façade orientale, nous pûmes aspirer à pleine bouche le souffle sans effort ni tourbillon qui palpitait en frôlant les murailles. Il était né, ce souffle vide du désert, quelque part au-delà du lointain Euphrate; et pendant des jours et des nuits il s’était traîné sur une herbe morte : rencontrant son premier obstacle en ce palais ruiné élevé par la main des hommes, il paraissait s’attarder alentour avec de puérils murmures. « Voilà bien le meilleur parfum, dirent mes guides : il n’a pas de goût ». Senteurs et luxe ne valaient pas pour eux une pureté où l’homme n’avait point de part.
Le Bédouin né et grandi dans le désert accueille de toute son âme cette nudité trop âpre pour les bonnes volontés étrangères : c’est que là seulement il se découvre libre; et s’il ne dit pas cela, il le sent. Délié de tout bien matériel, confort, superflu et autres complications analogues, il atteint à une liberté personnelle absolue, fréquemment visitée par la faim et la mort. Non pas qu’il fasse une vertu de la pauvreté elle-même : le Bédouin jouit des petits vices et des luxes - café, eau fraîche, femmes - qui lui restent permis. Mais il possède l’air, les vents, le soleil, la lumière, les espaces découverts et un immense vide. Il ne voit plus dans la nature ni effort humain ni fécondité : simplement le ciel au-dessus et, au-dessous, la terre immaculée. C’est là qu’il approche inconsciemment de son Dieu. Car Dieu n’est pour lui ni anthropomorphique, ni tangible, ni moral, ni éthique, ni préoccupé du monde ou de lui-même, ni naturel enfin : il est l’être qualifié non par dépouillement mais par investiture, l’Être qui embrasse tout, l’œuf de toute activité; nature et matière ne sont qu’un miroir pour le refléter.
Le Bédouin ne saurait chercher Dieu à l’intérieur de lui-même : il est trop sûr d’être à l’intérieur de Dieu. Il ne peut même rien concevoir qui soit ou ne soit pas Lui. Cependant il trouve dans ce Dieu arabe, qui seul est grand, mais qui est aussi sa façon de manger, de se battre, de faire l’amour, sa pensée la plus familière, son appui et son compagnon, certaine qualité raciale, domestique, quotidienne, incompréhensible aux hommes toujours séparés de la Divinité qu’ils adorent par le désespoir d’une indignité charnelle et le décorum d’un culte formel. Les Arabes ne jugent nullement indécent de faire descendre Dieu au sein de leurs faiblesses ou de leurs désirs les moins honorables. Il est le plus familier de leurs mots; et nous avons perdu en vérité beaucoup d’éloquence en faisant de Lui le plus court et le plus laid des monosyllabes de la langue anglaise (God).
Cette foi du désert paraît inexprimable en mots et même, il faut l’avouer, en pensée. Mais on la sent aisément comme une influence. Ceux qui passent dans le désert assez de temps pour oublier son espace et son vide sont rejetés fatalement vers Dieu comme vers l’unique refuge et rythme de l’existence. Le Bédouin peut être nommément Sunni, ou Ouahabi, occuper en fait n’importe quel point de la rose des vents arabes, il prendra la chose fort légèrement, un peu comme les gardes aux grilles de Sion qui buvaient de la bière et riaient d’être sionistes. Chaque nomade individuel a sa religion révélée, non point orale, ni traditionnelle, ni même exprimée mais instinctive en lui. Ainsi sont nées toutes les croyances sémites avec, toujours, dans leur caractère et leur essence, un accent sur la vanité du monde et la plénitude divine. Quant à leur expression elle a varié suivant la puissance du prophète et les hasards de sa destinée.
L’habitant du désert ne peut tirer de sa croyance aucun crédit humain. Jamais il ne fut évangéliste ou prosélyte. Il ne parvient à se confondre intensément avec son Dieu qu’en fermant les yeux au monde, en négligeant les possibilités latentes qu’un contact avec les richesses et les tentations aurait pu faire épanouir en lui. Il atteint ainsi, sans nul doute, une position spirituelle sûre et puissante : mais combien étroite ! Son expérience stérile le dépouille de compassion, détourne sa bonté humaine au profit d’une image dépeuplée, celle du désert cruel où il se cache. Il se fait donc souffrir lui-même non pas simplement pour être plus libre, mais par goût. D’où un plaisir dans la souffrance, cruauté plus précieuse que tous les biens abandonnés. Pour l’Arabe du désert aucune joie n’égale celle de s’abstenir. Il trouve dans l’abnégation, le renoncement et la pénitence volontaire une volupté qui finit par rendre la nudité de l’esprit aussi sensuelle pour lui que la nudité du corps. Peutêtre sauve-t-il ainsi son âme sans danger, mais non sans dur égoïsme. Le désert est transformé en une sorte de glacière spirituelle où se conserve pour l’éternité, pure de tout contact mais aussi de toute amélioration, la vision de l’unité divine. C’est là que de temps à autre les chercheurs détachés du monde extérieur peuvent s’échapper pour une saison et contempler avec détachement la nature des hommes qu’ils devront convertir.
La foi du désert est impossible dans les villes. Elle est à la fois trop étrange, trop simple, trop impalpable pour l’exportation et l’usage commun. L’idée essentielle, la croyance fondamentale de toutes les religions sémites reste déposée là; mais il faut la diluer pour nous la rendre compréhensible. Ce cri de chauve-souris sonne trop aigu pour les oreilles de la foule. Notre étoffe grossière laisse échapper l’esprit subtil. Les prophètes, retournant de la solitude éblouis par un seul regard jeté sur Dieu, montrent à travers leur propre noirceur (comme à travers un verre fumé) quelque chose de la majesté éclatante dont la pleine vision nous laisserait muets, aveugles et sourds, réduits, en vérité, à cette condition sauvage, étrange, singulière qui est celle même du Bédouin.
Les disciples cependant, dans leur zèle à se dépouiller et à dépouiller leurs voisins suivant la parole du maitre, heurtent les faiblesses humaines et perdent la partie. L’Arabe de la ville, du village, pour vivre, doit s’abandonner chaque jour au plaisir d’acquérir et d’accumuler; par un choc fatal en retour, il devient le plus grossier et le plus matériel des hommes. Le mépris éblouissant de l’existence qui conduisait les autres à une nudité ascétique l’entraîne, lui, au désespoir. Il se dissipe comme un prodigue, et pour en finir au plus tôt, jette à tous les vents son héritage charnel. Le Juif dans la métropole à Brighton, l’avare, l’adorateur d’Adonis, le libidineux de Damas révèlent tous la capacité de jouissance sémite; en eux s’épanouit la même force qui donne, renversée, l’ardent renoncement des Esséniens, des Chrétiens primitifs ou des premiers Califes jugeant l’accès du ciel plus facile aux pauvres d’esprit. Le Sémite a toujours oscillé entre la luxure et la macération.
On peut lier les Arabes à une idée comme à une longe : la libre allégeance de leurs esprits en fait des serviteurs fidèles et soumis. Aucun d’eux n’essaie d’échapper avant le succès. Mais avec lui viennent les responsabilités, les devoirs, les engagements; l’idée meurt et l’œuvre s’achève - en ruines. On entraînerait les Sémites, il est vrai, aux quatre coins du monde (mais non au ciel) sans croyance, rien qu’en leur montrant les richesses et les plaisirs de la terre. Mais qu’ils rencontrent sur leur route le prophète d’une idée, sans toit pour abriter sa tête et sans moyen de subsistance que la chasse ou la charité, et ils le suivront aussitôt en abandonnant leurs richesses. Ce sont d’incorrigibles enfants idéalistes, aveugles aux couleurs comme aux nuances, et pour qui le corps et l’esprit seront toujours fatalement opposés. Leur esprit est étrange et sombre, riche en affaissements comme en exaltations, sans mesure, mais plus ardent et fertile en croyances que n’importe quel autre au monde. Peuple des beaux départs : entraîné le plus follement par le concept le plus abstrait, déployant dans la lutte un courage et une invention sans limites, et indifférent à la fin; peuple aussi instable que l’eau, mais, précisément, comme l’eau, assuré peut-être, à la fin, de la victoire. Depuis l’aurore de la vie, ses vagues, tout à tour, se brisent sur les falaises de la chair. Chacune d’elles est retombée arrachant cependant un peu du granit qui l’arrête. Peut-être un jour une lame semblable roulera-t-elle sans obstacle sur le lieu où le monde matériel aura cessé d’exister, et peut-être l’esprit de Dieu planera-t-il alors sur le visage de ces eaux. C’est une de ces vagues (et non la moindre) que j’ai pu soulever en Arabie. Au souffle d’une idée abstraite elle a roulé, grossissant toujours davantage jusqu’au moment où, incurvant sa crête, elle est retombée à Damas. Son reflux écumeux, repoussé par la fixité des puissances matérielles, composera le corps de la vague suivante, lorsque le temps sera venu où la mer doit se soulever une fois encore.
4
La première grande invasion autour de la Méditerranée avait montré au monde, le temps d’une flambée, la puissance physique de cette race; l’enthousiasme éteint, son manque de persévérance et d’esprit organisateur apparut aussi clairement. Les provinces conquises furent négligées, par pure haine du système, et les Arabes, pourl’administration de leur empire chaotique, durent recourir aux offices soit de leurs sujets mêmes, soit d’étrangers plus vigoureux. Aussi, très tôt au cours du Moyen-Age, les Turcs prirent pied dans les États arabes, d’abord comme serviteurs, puis comme associés; enfin leur réseau parasite étouffa le vieux corps administratif. La dernière phase de cette évolution fut une guerre ouverte où l’on vit Hulagus ou Timurs assouvir leurs instincts sanguinaires, brûlantet détruisant ce qui les heurtait par une prétention de supériorité.
Les civilisations arabes ont été de nature abstraite, intellectuelle et morale plutôt que pratique; et l’absence d’esprit public de la race dominante y a bientôt rendu inutiles d’excellentes qualités privées. Le seul bonheur de la civilisation arabe fut son époque; l’Europe était tombée dans la barbarie et le souvenir de la culture grecque et latine s’effaçait peu à peu des esprits. Par contraste, les copies des Arabes parurent cultivées, leur activité mentale fructueuse, et leur état politique prospère. Ils ont rendu un réel service à l’humanité en conservant, pour un futur moyenâgeux, quelque chose d’un passé classique.
L’invasion turque transforma ce bonheur en songe. Successivement tous les Sémites d’Asie durent se plier au joug turc : pour eux c’était une mort lente. Leurs biens leur furent arrachés; leur esprit se ratatina aux souilles glacés de la servitude militaire. La loi turque était une loi policière, et la politique turque aussi crue en théorie qu’en pratique. Les Turcs apprirent aux Arabes à mettre les intérêts de la secte plus haut que ceux de la patrie et les soucis mesquins de la province au-dessus de la nationalité. Par des dissensions subtiles, ils semèrent entre eux la méfiance. La langue arabe même fut bannie des tribunaux, des services officiels, des écoles supérieures. Un Arabe ne pouvait plus désormais servir l’État qu’en sacrifiant ses caractéristiques de race. De telles mesures ne furent pas acceptées sans protestations. La ténacité sémite s’illustra dans les nombreuses révoltes de Syrie, de Mésopotamie et d’Arabie contre les formes les plus grossières de la pénétration turque. Les tentatives plus insidieuses d’absorption n’allèrent pas non plus sans résistance. Les Arabes refusèrent d’abandonner leur propre langue, riche et flexible, pour la grossièreté du turc; fidèles au trésor de leur littérature, ils emplirent au contraire le turc de mots arabes.
Ils avaient perdu leur sens géographique, leurs souvenirs raciaux, politiques, historiques; mais ils se cramponnèrent au langage; ils l’érigèrent presque en une sorte de patrie. Le premier devoir d’un Musulman est d’étudier le Coran, livre sacré de l’Islam, et, incidemment, le plus grand monument littéraire arabe. La conscience que cette religion lui appartenait, que lui seul avait qualité pour la comprendre et la pratiquer parfaitement, fournit à chaque Arabe un étalon pour juger la banalité des œuvres turques.
Puis vinrent la révolution, la chute d’Abdul Hamid, le triomphe des Jeunes-Turcs. L’horizon s’élargit momentanément pour les Arabes. Le Mouvement Jeune-Turc fut une révolte contre la conception hiérarchique de l’ Islam et contre les théories pan-islamiques du vieux sultan. Abdul Hamid avait tenté de se constituer chef spirituel du monde musulman pour être aussi le maitre (sans appel) de ses affaires temporelles. Il fut jeté en prison. La révolution Jeune-Turque se fit sous la poussée des théories constitutionnelles. A l’époque même où l’Europe occidentale, gravissant un nouvel échelon politique, dépassait les problèmes nationaux pour s’attaquer aux internationaux et retentissait de rumeurs guerrières où la voix des races n’avait plus de part, l’Asie occidentale, au contraire, passait d’une politique religieuse universelle à une politique nationaliste et rêvait de combats établissant, à la place des dogmes, des gouvernements constitutionnels et des souverainetés nationales. Cette tendance apparut d’abord violemment dans les petits États balkaniques qu’une foi nouvelle avait soutenus dans le martyre presque sans exemple de leur libération. D’autres mouvements nationalistes éclatèrent plus tard en Égypte, dans les Indes, en Perse, et enfin à Constantinople même. Ce dernier trouva une arme puissante dans les nouvelles théories américaines sur l’éducation qui, répandues dans la vieille atmosphère des hautes classes orientales y composaient une sorte de mélange explosif. Les écoles américaines enseignaient les méthodes expérimentales, prônaient le détachement scientifique et le libre échange des points de vue. A leur insu, elles enselgnaient du même coup la révolution, puisqu’il était impossible à un sujet turc d’être à la fois moderne et loyal s’il faisait partie des races soumises - grecque, arabe, kurde, arménienne ou albanaise.
Les Jeunes-Turcs, enhardis par leurs premiers succès, furent entraînés par la logique de leurs principes : en protestation contre le pan-islamisme ils prêchèrent la fraternité ottomane. Les races sujettes - bien supérieures aux Turcs par le nombre - crurent naïvement qu’on les appelait à créer en commun un Orient nouveau. La tête pleine d’Herbert Spencer et d’Alexandre Hamilton, ils se ruèrent à l’ouvrage, établirent des projets de réformes radicales et saluèrent les Turcs comme des collaborateurs. Ceux-ci, terrifiés devant les forces ainsi libérées, reculèrent aussi promptement qu’ils s’étaient avancés. Leur cri devint Yeni-Turati - «aux Turcs la Turquie faite turque », - La même politique devait les incliner plus tard vers leurs irredenti - sujets de la Russie en Asie centrale; mais la première tâche était de courber au joug de l’Empire les races sujettes et de mettre fin à leur résistance irritante. Les Arabes, qui formaient en Turquie la population étrangère la plus importante, devaient être mis à la raison les premiers. Les assemblées arabes furent dispersées, les sociétés arabes supprimées, les notables arabes proscrits. La langue et les manifestations arabes interdites par Enver Pacha avec une sévérité qu’Abdul Hamid, avant lui, n’avait jamais atteinte.
Cependant les Arabes avaient tâté de la liberté : leurs idées ne pouvaient changer aussi vite que leur conduite, et les esprits les plus fermes parmi eux ne devaient pas être matés si aisément. S’ils lisaient les exhortations patriotiques des journaux ils voyaient, à la place de « Turc », « Arabe ». La répression les bourra de violence malsaine. Privé d’issue constitutionnelle, leur patriotisme devint révolutionnaire. Les sociétés arabes se firent souterraines; les clubs libéraux réunirent des conspirateurs. Quand l’Akhua, société-mère, eut été publiquement dissoute, elle fut remplacée en Mésopotamie par la très dangereuse Ahad, fraternité secrète qui groupait presque uniquement des officiers arabes de l’armée turque. Ses adhérents juraient d’acquérir la science militaire de leurs maltres et de la retourner contre eux le moment venu.
L’Ahad possédait une base sûre dans la partie presque déserte de l’Irak méridional où Sayid Taleb, le jeune John Wilkes du Mouvement arabe, détenait un pouvoir exercé sans vergogne. Soixante-dix pour cent des officiers nés en Mésopotamie appartenaient au Mouvement et le secret était si bien gardé que certains membres de l’Ahad occupèrent jusqu’à la fin des postes dans le haut commandement turc. Quand Allenby traversa Armageddon et que la Turquie s’écroula, un des vice-présidents de la société commandait les débris de l’armée de Palestine en retraite; un autre commandait les forces turques au delà du Jourdain dans la région de Amman. Plus tard encore, après l’armistice, de hauts postes de l’administration turque restaient aux mains d’hommes prêts à se tourner contre leurs maîtres officiels sur un mot de leurs chefs arabes. A la plupart d’entre eux le mot ne fut jamais donné; ces sociétés, en effet, n’avaient en vue que l’indépendance arabe et, doutant de nos promesses, ne voyaient aucun avantage à soutenir les Alliés plutôt que les Turcs. La plupart d’entre elles, il faut le dire, eussent préféré une Arabie unie sous le joug turc à une Arabie indolente et divisée sous le contrôle plus facile de diverses puissances européennes se partageant des zones d’influence.
Plus vaste encore que l’Ahad était la Fétah, société pour la liberté de la Syrie. Elle groupait des propriétaires terriens, des écrivains, des docteurs, de hauts fonctionnaires unis par la foi du serment, avec des mots de passe, des signes de reconnaissance, une presse et un trésor commun : leur but était de ruiner l’Empire turc. Avec la facilité bruyante des Syriens - peuple simiesque, vif à la manière des Japonais, mais superficiel - ils avaient rapidement édifié une organisation formidable. Ils cherchaient des secours au dehors, espérant la liberté de négociations plutôt que de sacrifices. Leurs contacts étaient nombreux avec l’Égypte, l’Ahad (dont les membres, en vrais Mésopotamiens, les méprisaient), le Chérif de La Mecque, la Grande-Bretagne : en fait avec tous les alliés possibles pour la réalisation de leurs projets. Eux aussi gardaient un secret-absolu; et le gouvernement, quoiqu’il soupçonnât l’existence de leur organisation, ne put jamais l’établir sur un témoignage honorable ni découvrir ses chefs. Il dut donc s’abstenir de frapper dans la crainte de choquer les diplomates français et anglais qui jouaient alors en Turquie le rôle d’opinion publique moderne. La guerre de 1914 éloigna ces fonctionnaires et laissa le gouvernement turc libre de sévir.
La mobilisation donna tout le pouvoir aux membres les plus impitoyables, les plus logiques et les plus ambitieux à la fois des Jeunes-Turcs - Enver, Talaat et Djémal. Ayant résolu d’écraser définitivement dans l’État les tendances anti-turques et particulièrement les nationalismes arabe et arménien, ils trouvèrent d’abord une arme spécieuse mais fort appropriée dans la correspondance secrète d’un consul français de Syrie, lequel avait laissé en partant, dans son consulat, les copies de certaines lettres (sur l’indépendance arabe) échangées avec un Club Arabe. Ce dernier n’était pas relié à la Fétah mais groupait l’ intelligentsia, plus bavarde et moins redoutable, de la côte syrienne. Les Turcs furent naturellement charmés de cette découverte; car l’agression « coloniale» de l’Afrique du Nord avait donné aux Français, dans le monde musulman de langue arabe, une réputation détestable. Il était fort utile pour Djémal de pouvoir montrer à ses coreligionnaires que ces nationalistes arabes étaient assez infidèles pour préférer la France à la Turquie.
En Syrie, naturellement, de pareilles révélations ne surprenaient personne. Mais les membres de la société étaient connus et respectés, quoique d’un caractère un peu académique. Leur arrestation, puis leur jugement, et l’avalanche de déportations, d’exils et d’exécutions qui fut la conséquence de leur procès, émurent le pays jusque dans ses profondeurs. Les Arabes de la Fétah apprirent que le sort des Arméniens leur était réservé s’ils ne profitaient pas de la leçon. Les Arméniens étaient armés et bien organisés; mais leurs chefs les avaient trahis. Les Turcs les avaient désarmés et tués les uns après les autres : une fois les hommes massacrés, les femmes avaient été poussées, avec leurs enfants, en troupeaux sur les routes, en plein hiver, nues, affamées, offertes à tous les passants jusqu’au moment où elles étaient mortes de fatigue. Les Jeunes-Turcs avaient exterminé les Arméniens non parce qu’ils étaient chrétiens, mais parce qu’ils étaient Arméniens. Pour une raison analogue ils entassaient aujourd’hui dans les mêmes prisons musulmans et chrétiens arabes et les pendaient côte à côte aux mêmes gibets. Djémal Pacha, sous la pression d’une misère et d’un péril communs, fit en Syrie l’unité de toutes les classes, de toutes les conditions et de toutes les croyances. Dès lors une révolte générale devenait possible.
Les Turcs, soupçonnant les unités arabes de leur armée, espéraient adopter contre elles la tactique d’encadrement employée contre les Arméniens. Certaines difficultés de transport au début de la guerre créèrent une dangereuse concentration de divisions arabes (presque un tiers de l’armée turque d’origine parlait arabe) dans le Nord de la Syrie, au début de 1915. Les Turcs fragmentèrent ces divisions et dispersèrent leurs débris en Europe, aux Dardanelles, vers le Caucase ou sur le Canal de Suez - n’importe où, en fait, pourvu que ces troupes fussent mises rapidement sur la ligne de feu, loin de la vue et des secours possibles de leurs compatriotes. La Guerre Sainte fut proclamée pour donner à la bannière « Union et Progrès », aux yeux des vieux éléments cléricaux, la sainteté traditionnelle des croisades du Calife; et le chérif de La Mecque reçut l’invitation - ou plutôt l’ordre - de faire écho à ce cri vénérable.
5
La position du chérif de La Mecque était depuis longtemps anormale. Le titre de chérif est accordé seulement aux descendants de Fatma et de Hassan, fille et fils aîné du Prophète Mahomet. Les chérifs authentiques sont inscrits sur l’Arbre Généalogique - immense rouleau conservé à La Mecque, sous la garde de l’émir de La Mecque, élu chérif des chérifs comme le plus âgé et le plus noble de tous. La famille du Prophète a gouverné effectivement La Mecque pendant neuf siècles et compte environ deux mille personnes.
Le gouvernement ottoman considérait autrefois ce clan de pairs religieux avec un mélange de respect et de méfiance : ils étaient trop forts pour être écrasés. Le sultan sauvait sa dignité en confirmant solennellement l’élection de l’émir. Cette approbation, d’abord sans valeur, acquit quelque dignité par une longue habitude : un moment vint où le nouvel élu sentit qu’elle mettait à son élection une sorte de sceau définitif. Enfin les Turcs éprouvèrent le besoin de maintenir le Hedjaz sous leur autorité indiscutée pour fournir un décor religieux convenable à leur théorie nouvelle du pan-islamisme. L’ouverture du Canal de Suez leur permit, par hasard, d’établir une garnison dans les villes saintes. Ils projetèrent alors de construire le chemin de fer du Hedjaz et affermirent l’influence turque sur les tribus par l’argent, l’intrique et les armes.
Le sultan prit ainsi l’habitude d’affirmer toujours davantage son autorité jusque dans La Mecque à côté de celle du chérif; il lui arriva même de déposer un chérif trop magnifique à son gré pour faire élire à sa place un successeur choisi dans une famille rivale du même clan, avec l’espoir de retirer de ces dissensions les avantages ordinaires. Enfin Abdul Hamid osa emmener quelques membres de la famille à Constantinople où ils étaient l’objet d’une surveillance honorable. Tel Iut le sort d’Hussein-ibn-Ali, futur Émir de la Révolte; gardé prisonnier pendant dix-huit ans il en profita pour faire donner à ses fils - Ali, Abdullah, Fayçal et Zeid - l’éducation moderne et l’apprentissage du monde qui devaient leur permettre de conduire au succès les armées arabes.
Après la chute d’Abdul Hamid les Jeunes-Turcs adoptèrent la politique inverse : ils renvoyèrent le chérif Hussein à La Mecque comme émir. Aussitôt celui-ci se mit au travail pour rétablir sur ses vieilles bases la puissance de l’Émirat, tout en gardant avec Constantinople un contact amical par l’intermédiaire de ses fils, Abdullah vice-président du Parlement turc et Fayçal député de Djeddah. Ces derniers le tinrent au courant de l’opinion politique dans la capitale jusqu’au moment où la guerre éclata : ils retournèrent alors en hâte à La Mecque.
La déclaration de guerre atteignit durement le Hedjaz. Le pèlerinage arrêté, tout le mouvement d’affaires et, par suite, les revenus des villes saintes se tarissaient. On avait des raisons de craindre que les bateaux arrivant des Indes chargés de nourriture ne passent désormais leur chemin (puisque le chérif devenait officiellement sujet ennemi); et comme la province ne produisait presque rien, elle allait se trouver dans une dépendance étroite vis-à-vis des Turcs qui pourraient désormais l’affamer en coupant le trafic sur le chemin de fer du Hedjaz. Hussein n’avait jamais été auparavant à la merci des Turcs; et cette dépendance survenait au moment où ils avaient précisément besoin de son appui pour leur « Jehad », Guerre Sainte des Musulmans contre les Chrétiens.
Pour devenir populaire, en effet, la Guerre Sainte devait être consacrée par La Mecque; cette consécration risquait de noyer l’Orient dans le sang. Hussein était un homme d’honneur, ferme, bon politique et profondément pieux. Il comprit que la Guerre Sainte était doctrinalement incompatible avec une guerre d’agression, et de plus, absurde, puisqu’on la faisait avec un allié chrétien, l’Allemagne. Repoussant donc la demande turque, il fit aux Alliés un appel plein de dignité, leurs demandant de ne pas réduire sa province à la famine pour une faute qui n’était nullement la sienne. Les Turcs, en réponse, organisèrent sans tarder un blocus partiel du Hedjaz en contrôlant le trafic de la ligne. Les Anglais, de leur côté, laissèrent la côte ouverte à un service de ravitaillement spécialement organisé.
La demande turque, cependant, ne fut pas la seule que le chérif reçut. En janvier 1915, Yisin, chef des officiers de Mésopotamie, Ali Riza, chef des officiers de Damas, et Abd-el-Ghanl-el-Areisl, délégué par les fonctionnaires syriens, lui firent des propositions concrètes pour une révolte militaire en Syrie. Le peuple opprimé de Mésopotamie et de Syrie, les comités directeurs de l’Ahad et de la Fétah faisaient appel à l’émir de La Mecque, Père des Arabes, Musulman des Musulmans, leur plus grand prince, leur plus vieux notable, le suppliant de les protéger contre les sinistres desseins de Talaat et de Djémal.
Hussein, en sa multiple qualité de prince, de musulman, de moderniste et de nationaliste, devait prêter l’oreille à cet appel. Il envoya Fayçal, son troisième fils, le représenter à Damas en le chargeant de discuter les projets de révolte et de lui en faire un rapport. Il envoya Ali, son fils aîné, à Médine avec l’ordre de lever des troupes dans les villages et les tribus du Hedjaz (sous le prétexte qu’il jugerait le meilleur) et de les tenir prêtes à l’action si Fayçal les appelait. Enfin Abdullah, son second fils, devait sonder les Anglais par lettres et rechercher quelle serait leur attitude envers une révolte éventuelle des Arabes contre les Turcs.
Fayçal fit son rapport en janvier 1915. Les conditions locales, dit-il, étaient bonnes, mais la situation internationale ne favorisait guère leurs espoirs. A Damas trois divisions de troupes arabes étaient prêtes à la révolte. A Alep, deux autres divisions, bourrées de nationalistes, se joindraient sûrement au mouvement. Comme il y avait seulement une division turque de ce côté-ci du Taurus, les rebelles devaient s’emparer de la Syrie au premier effort. L’opinion publique, par contre, était moins préparée à des mesures extrêmes; les cercles militaires ne doutaient pas de la victoire allemande et d’une victoire rapide. Si pourtant les Alliés faisaient débarquer leur Corps Australien (qui se préparait en Égypte) à Alexandrette, couvrant ainsi le flanc de la Syrie, on pouvait sans risque courir cette chance et la nécessité de conclure une paix séparée avec les Turcs.
Un certain retard s’ensuivit, les Alliés ayant débarqué aux Dardanelles et non à Alexandrette. Fayçal les y suivit pour recueillir sur les événements de Gallipoli des renseignements de première main : une défaite turque eût en effet déclenché la révolte arabe. Mais la campagne dura des mois : le retard devint de la stagnation. Dans l’abattoir des Dardanelles, cependant, ce qui restait de l’armée turque de première ligne s’était peu à peu fondu. Tant de pertes accumulées constituaient pour la Turquie un tel désastre que Fayçal revint en Syrie, jugeant le moment favorable. Alors il trouva que pendant son absence la situation locale avait tourné.
Les chefs syriens étaient arrêtés ou traqués et leurs amis pendus par douzaines sous des chefs d’accusation politiques. Les divisions arabes sympathisantes avaient été soit exilées vers des fronts lointains, soit découpées en détachements et encadrées d’unités turques. Le service militaire turc tenait solidement la paysannerie arabe, et la Syrie pliait l’échine devant l’impitoyable Djémal Pacha. Les atouts de Fayçal avaient disparu.
Il écrivit à son père pour lui conseiller d’attendre encore : on lancerait le Mouvement quand l’Angleterre serait prête et la Turquie à bout de souffle. Par malheur l’Angleterre était à ce moment dans une situation déplorable. Ses forces reculaient, brisées, des Dardanelles. La longue agonie de Kut assiégée touchait à sa fin, et le soulèvement des Senoussis, coïncidant avec l’entrée en guerre de la Bulgarie, menaçait sur de nouveaux fronts la puissance britannique.
La position de Fayçal lui-même était des plus dangereuses. A chaque instant il pouvait être vendu par quelque membre de la société secrète qu’il avait présidée avant la guerre. Il dut pourtant aller vivre à Damas dans la demeure même de Djémal Pacha et prétendre améliorer ses connaissances militaires; son frère Ali, en effet, levait alors des troupes dans le Hedjaz sous le prétexte que lui et Fayçal les emploieraient à attaquer le Canal de Suez pour soulager les Turcs. Ainsi Fayçal, bon Ottoman et officier de l’armée turque, ne pouvait moins faire que de vivre au Grand Quartier Général où il devait écouter sans mot dire les insultes et les outrageantes accusations que le rude Djémal ne manquait pas de lui faire avaler en abondance.
Djémal, parfois, mandait Fayçal et l’emmenait voir pendre ses amis syriens. Les victimes qui connaissaient les véritables sentiments du chérif n’osaient rien en laisser voir; lui-même n’osait trahir ce qu’il pensait : un mot, un regard malheureux eût condamné au même sort sa famille et peut-être sa race entière. Une fois seulement son indignation l’emporta; il dit à Djémal que ces exécutions précipiteraient ce qu’il voulait empêcher. L’Intercession de ses amis de Constantinople, tous notables de la Turquie, lui évita tout juste de payer chèrement ces paroles imprudentes.
A elle seule la correspondance de Fayçal avec son père était une aventure dangereuse. De vieux serviteur de leur famille, hommes au-dessus de tout soupçon, allaient et venaient sur le chemin de fer du Hedjaz, portant les lettres dans un pommeau d’épée ou dans des gâteaux, cousues parfois entre les semelles de leurs sandales ou écrites à l’encre invisible sur l’emballage de paquets innocents. Toutes celles de Fayçal contenaient des rapports décourageants et suppliaient l’émir Hussein de remettre l’action à une époque plus favorable.
Hussein, de son côté, n’était nullement gagné par ce découragement. Les Jeunes-Turcs n’étaient à ses yeux que des athées, félons à la religion de leur race comme à leur devoir humain, traîtres à l’esprit de l’époque et aux plus hauts intérêts de l’Islam. Quoique âgé de soixante-cinq ans, il était allégrement déterminé à soutenir contre eux une guerre : la justice divine ne manquerait pas d’en couvrir les frais. Sa confiance en Dieu affaiblit à tel point son sens militaire qu’il crut le Hedjaz capable de vaincre la Turquie dans un duel loyal. Il manda donc à Fayçal, par l’intermédiaire d’Abd-el-Kader-el-Adbu, que tout était prêt à Médine et qu’on n’attendait plus que son inspection avant le départ des troupes pour le front. Fayçal en informa Djémal et lui demanda la