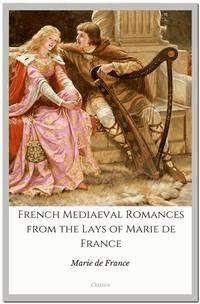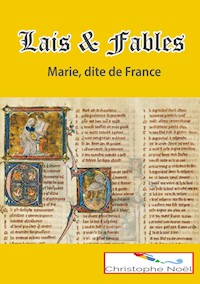
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Avertissement : Libre à vous de choisir des fac-similés de piètre qualité ; le présent ouvrage a été entièrement recomposé, revu, corrigé et annoté au besoin, l'orthographe modernisée, car déchiffrer et interpréter ralentit et gâche le plaisir de lire ; bref, tout a été fait pour rendre votre lecture plus accessible et agréable, et à un prix équivalent, sinon moins cher par rapport à l'existant. En français moderne, non inclusif, pour une lecture plus facile et agréable. Les Lais, courts récits en vers octosyllabiques, sont ici une adaptation en langue d'oïl de la matière de Bretagne (ensemble des textes écrits autour des légendes de l'actuelle Armorique, notamment ceux du cycle Arthurien). A peu près synonyme de Fabliau, le Lai est plus empreint de sensibilité et de mélancolie que le premier, plutôt tourné vers la verve et la gauloiserie. Les huit principaux manuscrits qui nous sont parvenus sont des copies postérieures à sa mort, rédigées tantôt en anglo-normand, tantôt en francien, voire en picard. Aux 12 Lais bien connus, Roquefort (que j'ai repris ici) à ajouté ceux de Graelent et de l'Epine. Ses Fables sont essentiellement inspirées d'Esope pour un tiers, mais aussi de Phèdre, un tiers à peu près étant de construction personnelle. Sur les 104 qui nous sont parvenues, j'en ai retenu environ 68, les plus représentatives à mon sens. Ma source en a été Legrand d'Aussy - principalement. Mais Marie a également écrit le Purgatoire de St Patrice et la Vie de Ste Audrey, qui n'entrent pas dans le cadre de mes études. En effet, dans ma quête des sources Nasreddiniennes, Marie m'a paru intéressante, parce que femme dans un univers hyper-masculin, elle a su laisser son empreinte, faisant entendre des revendications sociales inattendues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
1) Marie, dite de France - biographie
2) Les Lais
3) Les Fables
4) Ma sélection
5) Pourquoi Marie ?
Les Lais de Marie de France
Prologue
Lai de Gugemer
Lai d’Equitan
Lai du Frêne
Lai du Bisclavaret
Lai de Lanval
Lai des deux amants
Lai d’Ywenec
Lai du Laüstic ou du Rossignol
Lai de Milon
Lai du Chaitivel
Lai du Chèvrefeuille
Lai d’Eliduc
Lai de Graelent
Lai de L’Épine
Les Fables de Marie de France
L’abeille et la Mouche
L’aigle, l’autour et les pigeons
L’âne et le chien
L’arpenteur et sa perche
L’autour et le hibou
La biche, le faon et le chasseurs
Les corbeaux
Le blaireau et les cochons
Le bouc et le cheval
Le chameau et la puce
Le chat, le mulot et la souris
Le chevalier et le vieillard
Le corbeau et le loup
L’escarbot
Une femme et sa poule
La guenon et l’ours
La grue
L’homme et les deux cerfs
L’homme, le renard et le serpent
Le lièvre et le destin
L’assemblée des lièvres
Le lion, le loup et le renard
Le loup devenu roi
Les deux loups
Le loup et la guêpe
Le loup et le hérisson
Le loup et le pigeon
Le loup qui avait fait un vœu
Le médecin et la fille enceinte
Le milan et le geai
les oiseaux se choisissant un roi
Le prêtre et le loup
Du prud’homme qui vit sa femme avec un amant
Le renard et le chat
Le renard et le coq
Le renard et l’ourse
Le renard et le pigeon
Le villain et le follet
Le villain et ses bœufs
Le villain et son cheval
Le villain et la chouette
Le villain et le dragon
Le villain et l’escarbot
Le villain et l’ermite
Le villain et le loup
Le villain qui donna ses bœufs au loup
Le villain et le serpent
Les deux villains
Le voleur et les moutons
Le lion et la souris
Le loup et l’agneau
Le chien et la brebis
L’aigle et la corneille
Le coq et la gemme
Le lion malade
Le grillon et la fourmi
Le goupil et l’aigle
Le renard et l’ombre de la lune
La chienne qui allair mettre bas
L’âne et le lion
Le cerf se mirant dans l’eau
Le forgeron et la cognée
Le lion chassant
Le loup et le chien
Le ventre et les membres
L’hirondelle et le semeur de lin
Le singe empereur
Le loup et la grue
INTRODUCTION
1) Marie, dite de France – Biographie
Marie de France est une poétesse de la « Renaissance du XII° siècle1 », la première femme de lettres en Occident à écrire en langue vernaculaire, c’est-à-dire en anglo-normand2. Elle appartient à la seconde génération des auteurs qui ont inventé l’amour courtois. Pour l’encyclopédie Universalis, elle serait née en 1154 pour sa naissance et morte en 1189.
On ne sait quasiment rien d’elle, si ce n’est ce qu’elle dit d’elle-même dans l’épilogue de ses Fables :
Al finement de cest escrit
Au terme de cet écrit,
qu’en Romanz ai traitié e dit
Qu’en roman j’ai tourné et dit,
me numerai pur remembrance
Je me nommerai pour la postérité :
Marie ai num si sui de France
Marie est mon nom et je suis de France.
Comme le souligne Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort (17771834), dans l’introduction de ses Poésies de Marie de France3 : « on remarquera, dit-il, que son nom n’était pas Marie de France comme l’affirment tous les biographes et bibliographes. Elle dit seulement qu’elle se nomme et qu’elle est née en France. » Il reprend en cela Claude Fauchet45, dans son Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans : « Marie de France ne porte ce surnom pour ce qu’elle fut du sang des Rois6, mais pour ce qu’elle était native de France ». En opposition avec sa place, à la Cour de Londres.
Le terme de France, au XII° siècle, est ambigu. Le plus souvent, dans un cadre politique, il désigne le domaine propre des Capétiens, l’Île-de- France et l’Orléanais, mais peut aussi être utilisé pour désigner la totalité du Royaume, territoires des grands vassaux inclus. Il est donc difficile d’en déduire l’origine exacte de la poétesse.
Contemporaine de la comtesse de Champagne nommée également Marie de France, notre Marie pourrait être originaire d’Île-de-France, s’il faut entendre en ce sens sa propre déclaration, ou peut-être de Normandie, seule région dont elle donne des détails, à savoir Pîtres et la côte des Deux-Amants. Certains l’assimilent à Marie de Compiègne ; à Marie de Boulogne, abbesse ; à la demi-sœur illégitime d’Henri II, devenue abbesse du monastère de Shaftesbury vers 1181 ; à l’abbesse du monastère de Reading ; à la sœur de Thomas Beckett, abbesse de Barking ; à Adèle de France. Enfin, l’historien allemand Richard Baum considère que Marie de France n’est qu’un mythe entourant une variété d’auteurs anonymes. Bref, les suppositions vont bon train.
Plusieurs7 (dont Bernard Sergent8) ont suggéré qu’elle pourrait être Marie de Beaumont, cette fille de Galéran IV, comte de Meulan9 (et de Worcester), et d’Agnès de Monfort ; elle épousa Hugues Talbot vers 1170, et alla vivre avec lui sur ses terres anglaises.
Quoi qu’il en soit, on constate qu’elle est lettrée. Par ses connaissances littéraires, elle occupe un rang supérieur parmi les femmes mais aussi, par son talent d’écrivain, parmi tous les poètes anglo-normands de son siècle. Elle s’en distingue par l’audace de son propos sur l’amour. Elle a lu et étudié les auteurs de l’Antiquité enseignés à l’époque, Ovide et Phèdre certainement, Horace, Cicéron, Pline, Virgile, Tertullien, peutêtre, mais aussi les écrivains de la génération précédente, Wace, Thomas de Bretagne, etc. Or, n’oublions pas que les livres, copiés à l’époque par des moines sur parchemin, étaient donc manuscrits, rares et chers.
Les huit principaux manuscrits qui la font connaître au chartiste contemporain sont des copies postérieures à sa mort, rédigées tantôt en anglonormand, principale langue littéraire du XII° siècle après la langue d’oc, tantôt en francien, voire en picard10.
Marie précise dans son prologue qu’elle a hésité longtemps à s’adonner à la poésie, qu’auparavant elle avait entrepris de traduire du latin plusieurs sujets tirés de l’histoire ancienne (dont le roi Alfred, traducteur lui-même du roi Romulus ; ou encore des extraits du cycle arthurien).
Ambitieuse et soucieuse de se distinguer, elle ne pouvait pas se résoudre à suivre la mode mais souhaitait être reconnue par un prince11. C’est pourquoi elle abandonna ce projet pour se consacrer entièrement à la transposition des lais bretons, qu’elle avait entendus et dont elle avait gardé le souvenir, bien que, ou parce que cette langue lui sera restée totalement mystérieuse comme en témoignent ses erreurs dans les transcriptions dont elle abuse parfois pour ajouter à l’exotisme.
C’est toutefois à la traduction latine qu’elle revient, la réforme grégorienne s’employant à ne pas laisser trop de liberté aux femmes, en écrivant des fables, qui font d’elle la première fabuliste française, puis, après 1189, une ou deux légendes démarquées d’une hagiographie plus conforme à l’ordre moral imposé par l’Église catholique12. Elle aurait vécu alors, veuve ou célibataire, sous la protection d’un prudhomme.
Conteuse de talent, Marie de France ajoute une tonalité courtoise et poétique à la magie de la matière de Bretagne13. Une discrète émotion se dégage de récits où l’auteur privilégie la pitié et la compassion pour ses personnages. Son style, à la différence des autres auteurs de cour habitués aux longs monologues, présente une remarquable économie de moyens. Il se reconnaît facilement à la sobriété dans la composition du récit, à un art très sûr de la mise en scène et à l’efficacité d’une langue simple et limpide.
2) Les lais
Ses courts récits en vers, appelés Lais de Marie de France, sont une adaptation en langue d’oïl de la matière de Bretagne. Ils ont rencontré un immense succès de son vivant dans toutes les cours de France et d’Angleterre dont ils célèbrent l’idéal chevaleresque, puis, la mode de la chevalerie expirant durant la guerre de Cent Ans14, ils ont été oubliés.
D’origine celtique, le lai, en littérature, désigne un petit poème narratif, de type musical, apparu au XI°-XII° siècle, en vers octosyllabiques, inspiré de sujets sérieux ou passionnés, empruntés le plus souvent à d’anciennes légendes. L’origine du lai et de son nom est peut-être née d’anciens souvenirs littéraires celtiques (llais en gallois ou laoith en gaélique) car les vieilles légendes de la matière de Bretagne y tiennent une grande place, mais on y trouve toujours aussi la matière de France et la matière de Rome.
Au XI° siècle, le lai, en France, prend plusieurs sens pour désigner un court poème narratif, un poème lyrique, ou plus généralement un chant. Il se rattache intimement aux romans d’aventures, dont il diffère surtout par une moindre étendue. Il n’en est, à proprement parler, que la réduction. Comme précurseur du genre, on trouve Robert Biket, auteur du Lai de l’ombre, écrit en hexasyllabes ; le lai d’Haveloc, par Gaimar, le Lai d’Ignauré, les divers lais sur Tristan et Iseut, etc. et qui sont les récits abrégés d’une légende amoureuse et dramatique ou d’un de ses épisodes. Selon Michel Stanesco15, « Marie de France a lancé plutôt la mode du lai qu’elle ne l’a inventée ».
Le lai est alors à peu près synonyme de fabliau, à cette différence que le lai était empreint de sensibilité et de mélancolie, tandis que le fabliau s’ouvrait plus volontiers à la verve et à la gauloiserie. À ce titre, le lai narratif est considéré parmi les précurseurs du genre littéraire de la nouvelle.
D’une longueur variant entre une centaine de vers (Le Chèvrefeuille) et un millier (Éliduc), les Lais de Marie de France ont pour thème une histoire d’amour confrontée à de multiples péripéties, avec çà et là des exploits ayant trait à la chevalerie et à la légende du roi Arthur. Ils ont tous pour sujet une aventure, un événement imprévu, surnaturel ou non, qui n’arrive qu’à des êtres prédestinés.
L’art de la poétesse est de mettre en vers des récits qu’elle a recueillis de la bouche de bardes ou de harpistes bretons, souvent d’inspiration arthurienne, en atténuant le féerique primitif, en exaltant le sentiment de l’amour, qui, débarrassé des conventions sociales, étranger aux différences de rang, se distingue de l’amour courtois, et trouve sa fin et sa justification en lui-même.
Se défendant de toute intention moralisante, Marie fonde sa morale sur sa conception de l’amour, qui est plénitude, constance et clarté. Usant avec parcimonie du merveilleux, elle introduit des aspects « psychologiques », des indications géographiques qui ancrent ses récits dans un cadre breton, ou encore des usages et des pratiques propres au monde courtois et aristocratique, qui créent un univers poétique constamment maintenu à mi-distance entre le réel et l’imaginaire.
La morale chrétienne n’en est toutefois pas absente, comme dans le lai d’ Éliduc où le chevalier laisse sa mie à moitié morte pour retrouver son épouse légitime, laquelle demande le divorce pour se retirer en un cloître ; l’époux suivra le même chemin, tout comme la donzelle.
J’ai, en revanche, été interpelé, dans le lai de Graelent, par le viol de la fée (c’est du moins ainsi que j’ai compris la chose), et le fait qu’elle lui ait pardonné parce qu’elle l’aurait prévu… amour courtois, vraiment ?
1 Les renaissances médiévales sont des périodes du Moyen Âge occidental qui se caractérisent par un renouveau culturel significatif à l'échelle européenne. On recense essentiellement trois phases de renaissances médiévales, connues sous le nom de renaissance carolingienne (VIII° et IX° siècle), de renaissance ottonienne (X° siècle) et de renaissance du XII° siècle.
Le terme est utilisé par de nombreux médiévistes depuis le XIX° siècle, par analogie avec le concept historiographique de renaissance. Novateur car en rupture avec la vision d'un Moyen Âge obscurantiste, et sur la pertinence du rapprochement avec la césure traditionnelle que constitue la Renaissance du XVI° siècle.
2 L’anglo-normand est la variété de français parlée et écrite en Angleterre du XIIᵉ au XIVᵉ siècle inclus. Après la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie (1066) et l’avènement des Plantagenêts (1154), le français vint s’ajouter au latin et à l’anglais.
3 Recueil paru à Paris, en 1820, chez Chasseriau, libraire.
4 Claude Fauchet, né à Paris en 1530, mort en 1602, est un magistrat, humaniste et historien français.
5 Selon Anne Paupert, membre de la Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR), ce serait Claude Fauchet lui-même qui aurait forgé ce surnom. Voir aussi : https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-marie-de-france.
6 A ne pas confondre donc avec Marie de France, fille de Louis VII et d’Aliénor d’Aqui - taine, aussi connue sous le nom de Marie de Champagne, (1145-1198).
7 Dans les Cahiers de civilisation médiévale, 38ᵉ année (n°152), Octobre-décembre 1995. pp. 353-361, Yolande de Pontfarcy soutient que Marie de France était Marie de Beaumont de Meulan, épouse de Hugues de Talbot, comte de Shrewsbury, baron de Cleuville ; écartant son identification à Marie de Champagne et Marie de Compiègne. Exclues également la version de l’abbesse de Shaftsbury, et celle de Marie de Boulogne.
8 Bernard Sergent, né le 23 février 1946, est un historien français, chercheur au CNRS et président de la Société de mythologie française.
9 Dans les actuelles Yvelines (77).
10 Elle parle de langue vulgaire « romane » (voir extrait supra).
11 Les Lais sont dédiés à Henri II Plantagenêt ; les Fables, probablement à Guillaume de Mandeville, comte d’Essex, mort comme le roi en 1189
12 Elle signe ainsi l’Espurgatoire seint Patriz après 1189. Une autre œuvre, la Vie Seinte Audree, est signée en termes très semblables, mais seuls quelques critiques (dont June Hall McCash, de la Middle Tennessee State University, en 2006) pensent qu’il pourrait s’agir de la même Marie, nous dit Anne Paupert (cf note 4)
13 La matière de Bretagne désigne l’ensemble des textes écrits au Moyen Âge autour des légendes de l’île de Bretagne, de l’Armorique actuelle, et dans une moindre mesure de la Gaule du Nord-ouest, notamment celles du cycle arthurien. Elle représente la tradition celtique, par opposition à la tradition carolingienne de la matière de France et aux traditions latines et antiques de la matière de Rome.
14 La guerre de Cent Ans a duré de 1337 à 1453.
15 Michel Stanesco (1942-2008) était un historien médiéviste français qui occupait la chaire de littérature médiévale de l’université de Strasbourg.
3) Les Fables
Ses fables inspirées d’Ésope (le Dit d’Ysopet) ont été lues sans discontinuer du XII° au XVIII° siècle, en raison d’une vivacité caractéristique qui a été imitée, en particulier par La Fontaine. Ce sont, à la suite d’une première traduction en anglais, le mouvement romantique et l’engouement pour les études de l’ancien français qui ont fait redécouvrir au XIX° siècle ses contes tirés de lais bretons, qui sont aujourd’hui des classiques.
Les Fables seraient, déclare l’autrice elle-même, une traduction de l’Ysopet qui aurait appartenu au roi Alfred Le Grand. Elles ont été écrites entre 1167 et 1189. Elles offrent la première version en français des fables dites d’Ésope. Elles ont été retrouvées dispersées dans trentetrois manuscrits rédigés entre le XIII° siècle et la fin du XV° siècle. Aucun de ces recueils tardifs n’est complet ; c’est-à-dire que certaines fables manquent dans l’un ou l’autre, mais tous présentent celles-ci comme une collection. Elles ont été éditées pour la première fois en 1820 par Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort.
En effet, si ces dernières s’inspirent incontestablement de la tradition ésopique16, elle s’éloigne un peu de ce vieux poète, dont la morale est fondamentalement personnelle et inter-personnelle17, pour adopter un tour plus social, plus revendicatif. En un sens, et toutes proportions gardées bien sûr, elle serait une sorte de crypto-communiste avant l’heure, tout comme le fut Jésus – ou du moins l’en taxa-t-on –, dont le discours s’est trouvé quelque peu dévoyé par Église devenue avec le temps plus temporelle que spirituelle.
Selon leur traductrice et éditrice Françoise Morvan, le nombre de manuscrits retrouvés et leur qualité – « certains d’entre eux sont des chefs d’œuvre de l’enluminure » – prouvent que Marie de France fut d’abord renommée au Moyen Âge pour ses fables.
Le recueil en comprend 10418 : une quarantaine est d’origine gréco-latine, puisant notamment dans les fables ésopico-phédriennes, principalement à partir du manuscrit du Romulus de Nilant19, d’autres sont empruntées à la littérature arabe et à la mythologie celtique, ou encore de la propre invention de Marie de France.
L’originalité de ces fables, selon Françoise Morvan, tient au fait que « l’oppression des pauvres est dénoncée avec virulence », sans pour autant tomber dans le manichéisme. Marie de France y dénonce les abus des puissants, et « fait une création esthétique au sens plein, exprimant une vision critique de la société, et portant une conception politique d’autant plus audacieuse en ce temps qu’exprimée par une femme ».
D’après Baptiste Laïd20 enfin, depuis Phèdre, aucun poète « en plus de mille ans d’histoire, n’avait proposé avant Marie un traitement si radical, si vaste et si inventif de la matière ésopique ». Elle est la première à faire passer les fables d' « une langue antique à une langue moderne, d’un style prosaïque à un style poétique, caractérisé par le vers et la rime, et en bouleversant son horizon éthique par une réinterprétation de ses morales dans un contexte féodal ». Plus qu’une traduction et une adaptation, Marie de France fait œuvre de “réinvention”.
4) Ma sélection
Dans le manuscrit n° 978 d’origine de la Bibliothèque Harléiène, datant du milieu du XIII° siècle, figurent douze lais – les douze premiers –, rédigés en anglo-normand. Un recueil d’à peu près la même époque, n’en présente que neuf.
Roquefort, dans son introduction au Tome 1 des Poésies de Marie de France, publié en 1820 à Paris, parle de « manuscrits de France », sans plus de précisions. Il aurait donc ajouté, à la liste que l’on trouve communément, ceux de Graelent et de l’Epine, ce qui nous fait un total de quatorze. Ils sont intégralement retranscrits ici, dans un français un peu épousseté.
Passons sur les querelles de chapelles ; j’ai lu – je ne me souviens plus où21- que Graelent ne serait pas de Marie. Pour les uns, « représentant un état plus ancien que le poème de Marie » ; pour d’autres « Graelent était une œuvre inspirée de Lanval, avec des morceaux empruntés encore à d’autres lais de Marie ». Quoi qu’il en soit, cela expliquerait certaines proximités dans les narratifs.
Peut-être en est-il de même avec le manuscrit de l’Epine. Les emprunts étaient relativement fréquents à l’époque ; c’est pourquoi, ai-je lu, que Marie avait tenu à signer de son nom son premier lai de Gugemer.
Par ailleurs, Philippe Walter se demande : Marie « de France » a-t-elle écrit des « Lais »22 ? Qu’en pensez-vous ?
Pour ce qui est des fables, il semble avéré qu’elles sont majoritairement tirées de sources plus anciennes. Elle les avait elle-même intitulées le Dit d’Ysopet. Mais Esope n’était pas son seul inspirateur : on y a trouvé du Phèdre, du Romulus, ainsi que des extraits du roi Alfred…
Pour les fables, je me suis fié à la traduction de Pierre Jean-Baptiste Legrand d’Aussy (1737-1800), souvent cité d’ailleurs par Roquefort, dans son recueil Fabliaux ou Contes des douzième et treizième siècles, traduits ou extraits d’après les manuscrits, Paris, 1779, 3 vol. in-8°. Legrand d’Aussy en a retenu 43 (sur 103 ou 104). J’ai porté ma sélection au chiffre de 68.
Mon but n’étant pas d’être exhaustif sur le sujet, mais de montrer une autre facette de Marie, pleine d’humour, avec parfois quelques passages lestes, et mêmes scatologiques par moments (la Grue, le villain et l’es carbot). Mais, comme je l’ai relevé dans le texte, autres temps, autres mœurs : on ne rechignait pas à l’époque à utiliser parfois la langue verte.
5) Pourquoi Marie ?
On serait fondé à se demander pourquoi ce choix de textes de Marie, sa place, sa congruité avec le reste de mon œuvre.
Il y a plusieurs raisons à cela.
a) La première raison en est que je souhaitais donner une place aux femmes dans mes travaux, d’autant plus que ce n’est pas par pure complaisance. J’ai constaté en effet que peu de femmes étaient citées dans l’histoire, et notamment celle des Lettres ; du moins avant la période classique des Mmes de Scudéry, de Sévigné et autres Ninon de Lenclos. Par ailleurs, j’ai toujours le remords de n’avoir pu, pour des motifs bassement matériels, éditer un texte de la communarde Louise Michel.
Hormis Hypatie23, Héloïse24, et Hildegarde von Bingen25, c’est le désert des Tartares. A l’instar de Christine de Pizan26 qui lui succédera deux siècles plus tard, elle a pourtant plainement sa place dans la République des Lettres. Dans mon œuvre personnelle, elle rejoint ainsi Mme Ulrich, dont j’ai publié La Folle Enchère, dans un contexte un peu différent.
b) En second lieu, comme pour Louise Michel que je viens de citer (les autres aussi, mais surtout elle, en raison d’une certaine communauté d’idées), j’ai une grande admiration pour les femmes qui se dressent et revendiquent de façon constructive contre ce système fait par et pour les hommes, osant parfois braver la « bienséance », en une sorte de protoféminisme avant la lettre. Il s’agit donc d’une sorte d’hommage.
c) Troisièmement, ceux qui me suivent savent que j’ai réservé une place de choix dans ma vie au personnage oriental populaire de Nasr Eddin Hodja, avec déjà plusieurs volumes.
Or, pour les Grecs – qui ont la fâcheuse tendance (mais sont-ils les seuls ?) à toujours tout ramener à eux et à leur gloire passée – ce héros populaire tient d’Ésope27, et ses fables ou mythes.
Ainsi, d’une part, le volet Fables de Marie rejoindra les quelques déjà ouvrages parus pour illustrer la matière, avec Ésope lui-même, mais aussi, Phèdre, Babrios, Avianus et Aphtone, mais également, bien plus tard : Abstemius, Perret, Benserade, Iriarte et Florian28.
Or, d’autre part, dans mon ouvrage Nasr Eddin rencontre Diogène, j’ai pu démontrer les similarités entre les deux hommes, et que les sources étaient donc bien plus diverses. Au cours de mes travaux, j’ai trouvé des traces un peu partout. Notamment chez Abstémius déjà cité, Le Pogge, mais aussi chez des auteurs comme Bonaventure des Périers, Noël du Fail, d’Ouville, Chappuys, etc. Mais aussi dans les fabliaux du Moyen-Âge ou le Roman de Renart…
Les fabliaux étant prévus au programme des publications, il se trouve qu’un certain nombre d’entre eux sont des parodies des lais, dont ceux de Marie. En les publiant, je ne fais ainsi que remettre à la bonne place les bœufs devant la charrue, justement. C’était, par conséquent, un passage obligé dans notre cheminement intellectuel. Et puis, au vrai, ils ne sont pas désagréables, ces contes !
Je vous en souhaite une très agréable lecture !
Christophe Noël
16 Voir mes autres publications de Fables : Esope, Avianus, Phèdre, Babrios, etc. – chez BOD éditions.
17 J’ai lu un article fort intéressant, expliquant que, si Ésope a essentiellement mis en scène des animaux, c’est peut-être pour l’aspect ludo-didactique ainsi qu’on nous l’enseigne sur les bancs de l’école certes, mais aussi, et principalement parce que, esclave, il se sentait mal fondé à enseigner la morale en son nom propre à des ci - toyens libres – qui auraient pu rejeter donc ses principes au nom d’un principe de classe. A noter toutefois que l’origine de ses fables se trouve dans des contes orientaux, les plus anciens étant Sumériens, ou dans l’Inde de Bildpaï.
18 Certaines sources en énumèrent 99, d’autres parlent de 110. Enfin, le site geudersherman.wordpress.com affirme : Marie de France écrit à la cour de Henri III roi d’Angleterre son Ysopet, recueil de 300 fables, la plupart imitées du grec et du latin (sic).
19 D’après le nom de l’éditeur Nilant.
20 Docteur de langue et de littérature françaises du Moyen Âge, Université Paris-Est Créteil
21 Très vraisemblablement dans le Recueil de Travaux offert à M. Clovis Brunel, Paris, Société de l’Ecole des Chartes, 1955. Mais encore : Cesare Segre, Lanval, Graelent, Guingamor, 1957. In : Romania, tome 79 n°313, 1958. pp. 131-135.
22 Philippe Walter, « Marie « de France » a-t-elle écrit des « Lais » ? Questions de terminologie littéraire au XIIᵉ siècle », Acta Litt&Arts [En ligne], Acta Litt&Arts, Les “Lais” de Marie de France : transmettre et raconter, mis à jour le : 29/01/2019, URL : http:// ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/actalittarts/469-marie-de-france-a-t-elleecrit-des-lais-questions-de-terminologie-litteraire-au-xiie-siecle.
23 Hypatie (Ὑπατία, née entre 355 et 370 selon les sources et assassinée par des chrétiens en 415) est une philosophe néoplatonicienne, astronome et mathématicienne grecque d’Alexandrie.
24 Héloïse (en grec Έλούσα, née vers 1092 et morte le 16 mai 1164), est une intellectuelle du Moyen Âge, épouse d’Abélard et première abbesse du Paraclet. Chantre de l’amour libre, elle est la deuxième femme de lettres d’Occident dont le nom soit resté et le premier écrivain à affirmer et définir la spécificité du désir féminin.
25 Hildegarde de Bingen, née en 1098 en Hesse rhénane et morte le 17 septembre 1179 à Rupertsberg, près de Bingen, est une moniale bénédictine mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, fondatrice et prédicatrice franconienne,
26 Christine de Pizan ou, dans des textes plus anciens, Christine de Pisan, née en 1364 à Venise et morte vers 1430 au monastère de Poissy, est une philosophe et poétesse italienne de naissance vénitienne. Elle est considérée comme la première femme de lettres de langue française ayant vécu de sa plume.
27 Ésope (en grec ancien Αἴσωπος / Aísôpos, VIIᵉ – VIᵉ siècle av. J.-C.) est un écrivain grec d’origine phrygienne, à qui l’on a attribué la paternité de la fable.
28 Tous disponible chez l’éditeur BOD au format électronique, en attendant une réédition papier.
Les LAIS de Marie de France
PROLOGUE DES LAIS
Ceux à qui le ciel a départi le talent oratoire, loin de cacher leur science, doivent au contraire révéler leur doctrine et la propager. L’homme qui publie les bons exemples est alors bien digne d’estime ; aussi est-il loué de tous dès l’instant où il les met en pratique.
D’après le témoignage de Priscien1, on voit qu’il était d’usage parmi les écrivains de l’antiquité, de placer parfois dans leurs ouvrages des passages obscurs, dans le dessein d’embarrasser ceux qui, par la suite, voulaient les étudier et les interpréter.
C’est par cette raison que les philosophes qui les entendent parfaitement, parce qu’ils ont consacré leur temps à cette étude, s’attachent à commenter et à expliquer ce qui pourrait paraître diffus. Les philosophes savent se garantir de faire ce qui est mal, et ceux qui désirent marcher sur leurs traces doivent étudier et s’instruire, se donner de la peine pour en recueillir le fruit.
D’après les exemples qui viennent d’être rapportés, j’avais eu d’abord l’intention de traduire quelque bonne histoire du latin en français ; mais je m’aperçus bientôt que beaucoup d’autres écrivains avaient entrepris un semblable travail, et que le mien offrirait un faible intérêt. C’est alors que je me déterminai à mettre en vers d’anciens Lais que j’avais entendu raconter.
Je savais, à n’en pouvoir douter, que nos aïeux les avaient écrits ou composés pour garder le souvenir des aventures qui s’étaient passées de leur temps. J’en ai entendu réciter plusieurs, que je ne veux pas laisser perdre ; c’est pour cela que j’ai entrepris de les mettre eu vers, travail qui m’a coûté bien des veilles.
C’est par vos ordres, noble Prince2, si preux et si courtois, vous qui possédez toutes les qualités du cœur et de l’esprit, que j’ai rassemblé les Lais que j’ai traités. Aussi la reconnaissance me fait-elle un devoir de vous en faire l’hommage ; je n’éprouverai jamais de plaisir plus grand, si vous daignez l’accepter, et ne perdrai jamais le souvenir de cette faveur. Veuillez ne pas m’accuser de présomption, si j’ose vous offrir mon travail, et daignez en écouter le commencement.
1 Priscien de Césarée, grammairien du VI° siècle. Il semblerait bien que c’est de lui dont il s’agit, puisqu’on parle de trivium (La grammaire était l’une des disciplines du trivium qui, avec le quadrivium, formait les arts libéraux, base de l’éducation au Moyen Âge.)
2 Henri II, roi d’Angleterre. Selon Roquefort, Marie écrivait plus particulièrement pour les Anglais ; il cite comme exemple le Lai du Frêne, où, lorsqu’elle est embarrassée, elle emploie des mots anglais pour exprimer son idée ou compléter un vers.
Les Lais sont dédiés à Henri II Plantagenêt ; les Fables, probablement à Guillaume de Mandeville, comte d'Essex, mort comme le roi en 1189.
LAI DE GUGEMER
Je vous avouerai, Sire, qu’en traitant une bonne matière, je crains toujours de manquer mon sujet, c’est l’avis de Marie ; elle pense qu’il n’appartient de faire parler de grands personnages qu’à celui qui n’a pas cessé d’être vertueux. Lorsque dans un pays il existe une personne respectable de l’un ou de l’autre sexe, elle trouve des envieux, qui, par des rapports calomnieux, cherchent à lui nuire et à ternir sa réputation. Ces jaloux ressemblent au mauvais chien qui mord en traître les honnêtes gens. Je veux démasquer et poursuivre ces misérables, qui ne veulent et ne disent que du mal des autres. Le conte suivant, dont les Bretons ont fait un Lai, est de la plus grande vérité ; je le rapporte entièrement d’après les écrits de ces peuples, et en prévenant que cette aventure arriva fort anciennement dans la Petite-Bretagne.
Au temps du règne d’Arthur3, souvent en paix, souvent en guerre, ce prince eut parmi ses vassaux un Baron appelé Oridial, qui était seigneur de Léon. Le roi l’estimait fort pour sa vaillance. De son mariage étaient nés deux enfants, un fils et une fille, nommés Gugemer4 et Noguent. Doués d’une figure charmante, ils étaient l’idole de leurs parents. Quand Oridial vit son fils en âge, il l’envoya auprès d’Arthur pour apprendre le métier des armes. Le jeune homme se distingua tellement par sa valeur et par la franchise de son caractère, qu’il mérita d’être armé chevalier par le grand Arthur, qui, en cette occasion, lui fit présent d’une superbe armure.
Gugemer veut aller chercher des aventures, et avant son départ il fait de riches présents à toutes les personnes de sa connaissance. Il se rend en Flandre pour faire ses premières armes, parce que ce pays était presque toujours en guerre. J’ose assurer d’avance qu’à cette époque, on ne pou vait trouver un meilleur chevalier dans la Lorraine, la Bourgogne, la Gascogne et l’Anjou. Il avait néanmoins un défaut, c’était de n’avoir pas encore songé à aimer. Cependant il n’y avait ni dame ni demoiselle qui, s’il en eût témoigné le désir, ne se fût fait honneur d’être sa mie ; quoique même plusieurs d’entre elles lui eussent, sur cet objet, fait des avances, cependant il n’aima point. Personne ne pouvait concevoir pourquoi Gugemer ne voulait point céder à l’amour, aussi chacun craignait-il qu’il ne lui arrivât malheur.
Après nombre de combats, d’où il sortit toujours avec avantage, Gugemer voulut retourner dans sa famille, qui depuis longtemps désirait le revoir. Après un mois de séjour, il eut envie d’aller chasser dans la forêt de Léon. Dans ce dessein, il appelle ses chevaliers, ses veneurs, et à l’aube du jour ils étaient dans le bois. S’étant mis à la poursuite d’un grand cerf, les chiens sont découplés, les chasseurs prennent les devants, et Gugemer, dont un jeune homme portait l’arc, les flèches et la lance, voulait lui porter le premier coup. Entraîné par l’ardeur de son coursier, il perd la chasse, et dans l’épaisseur d’un buisson il aperçoit une biche toute blanche, ornée de bois, laquelle était accompagnée de son faon. Quelques chiens qui l’avaient suivi attaquent la biche ; Gugemer bande son arc, lance sa flèche, blesse l’animal au pied et le fait tomber.
Mais la flèche retournant sur elle-même vient frapper Gugemer à la cuisse, si violemment, que la force du coup le jette à bas de cheval. Étendu sur l’herbe auprès de la biche qui exhalait ses plaintes, il lui entend prononcer ces paroles :
« Ah Dieu ! Je suis morte, et c’est toi, vassal5, qui en es la cause. Je désire que dans ta situation tu ne trouves jamais de remède à tes maux, ni de médecin pour soigner ta blessure ; je veux que tu ressentes autant de douleurs que tu en fais éprouver aux femmes, et tu n’obtiendras de guérison que lorsqu’une amie aura beaucoup souffert pour toi. Elle endurera des souffrances inexprimables, et telles qu’elles exciteront la surprise des amants de tous les âges. Au surplus, retire-toi et me laisse en re - pos. »
Gugemer, malgré sa blessure, est bien étonné de ce qu’il vient d’entendre ; il réfléchit et délibère sur le choix de l’endroit où il pourrait se rendre, afin d’obtenir sa guérison. Il ne sait à quoi se résoudre, ni à quelle femme il doit adresser ses vœux et ses hommages. Il appelle son varlet6, lui ordonne de rassembler ses gens et de venir ensuite le retrouver. Dès qu’il est parti, le chevalier déchire sa chemise, et bande étroitement sa plaie ; puis remontant sur son coursier, il s’éloigne de ce lieu fatal, sans vouloir qu’aucun des siens l’accompagne. Après avoir traversé le bois, il parcourt une plaine et arrive sur une falaise au bord de la mer. Là était un havre où se trouvait un seul vaisseau dont Gugemer reconnut le pavillon. Ce bâtiment, qui était d’ébène, avait les voiles et les cordages en soie.
Le chevalier fut très surpris de rencontrer une nef dans un lieu où il n’en était jamais arrivé. Il descend de cheval, et monte ensuite avec beaucoup de peine sur le bâtiment où il comptait rencontrer les hommes de l’équipage, et où il ne trouva personne. Dans une des chambres était un lit enrichi de dorures, de pierres précieuses, de chiffres7 en ivoire. Il était couvert d’un drap d’or, et la grande couverture faite en drap d’Alexandrie était garnie de martre-zibeline. La pièce était éclairée par des bougies que portaient deux candélabres d’or garnis de pierreries d’un prix considérable. Fatigué de sa blessure, Gugemer se met sur le lit ; après avoir pris quelques instants de repos, il veut sortir ; mais il s’aperçoit que le vaisseau, poussé par un vent propice, était en pleine mer. Inquiet de son sort, souffrant de sa blessure, il invoque l’Eternel, et le prie de le conduire à bon port. Le chevalier se couche et s’endort pour ne se réveiller qu’aux lieux où il doit trouver un terme à ses maux.
Il arrive vers une ville ancienne, capitale d’un royaume dont le souverain, homme fort âgé, avait épousé une jeune femme. Craignant certain accident, il était extrêmement jaloux. Tel est l’arrêt de la nature que tous vieillards soient jaloux, et que lorsqu’ils épousent de jeunes femmes, on ne soit nullement étonné de ce qu’elles leur soient infidèles. Sous le donjon était un verger fermé par une muraille en marbre vert, et bordé par la mer. La seule porte qui servait d’entrée était gardée nuit et jour. On ne pouvait y entrer du côté du rivage qu’au moyen d’un bateau. Pour que sa femme fût plus exactement surveillée, le jaloux lui avait fait construire un appartement dans la tour. Sur les murs, on avait peint Vénus, déesse de l’amour, et représenté comment doivent se comporter les amants heureux ; d’un autre côté la déesse jetait dans les flammes le livre où Ovide enseigne le remède pour guérir d’amour8. Déclarant avec indignation qu’elle ne favoriserait jamais ceux qui liraient cet ouvrage et qui en pratiqueraient la morale.
La dame avait près d’elle sa nièce, jeune personne qu’elle aimait beaucoup ; celle-ci accompagnait sa tante toutes les fois qu’il lui prenait envie de sortir, et la reconduisait ensuite au logis. Un vieux prêtre aux cheveux blancs avait seul la clef de la tour, et indépendamment de son âge, il se trouvait hors d’état d’alarmer un jaloux, autrement il n’eût pas été accepté ; outre la messe qu’il disait tous les jours, notre prêtre servait encore à table. À l’issue de son dîner, la dame voulant se promener, emmena sa nièce avec elle. Tournant les yeux du côté de la mer qui baignait le bord du jardin, elle aperçoit le vaisseau qui cinglait à pleines voiles de son côté. Ne voyant personne sur le pont, elle fut effrayée et voulut prendre la fuite ; mais la jeune personne naturellement plus hardie et plus courageuse que sa tante, parvint à la rassurer ; lorsque le vaisseau fut arrêté, elle ôte son manteau et descend dans la nef. Elle n’aperçoit personne à l’exception de Gugemer étendu sur le lit, où il dormait encore. À la pâleur de son teint, au sang dont il était couvert, elle s’arrête, et le croit mort.