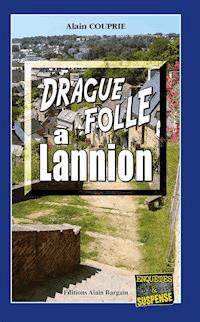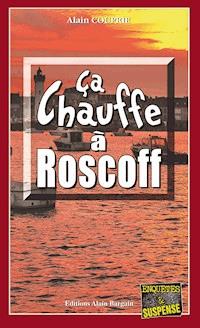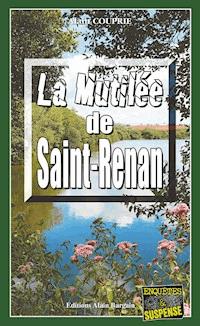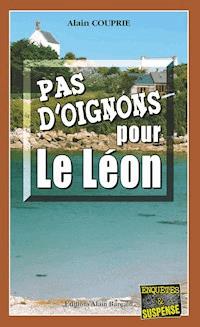
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissaire Morand
- Sprache: Französisch
Une étrange malédiction s'abat sur le Léon...
Les oignons roses, les “Johnnies” : le patrimoine et l’histoire de Roscoff. Mais oignons de Roscoff et primeurs du Léon, tout, soudain, pourrit sur pied. Comme si la terre, révoltée, refusait désormais de produire ! “L’accident climatique” qui sévit sur le Finistère explique-t-il tout ? Un suicide qui pourrait ne pas en être un, d’étranges signaux, de mystérieux coups de feu et des empoisonnements bizarres incitent le commissaire Morand à en douter. Son enquête épargnera-t-elle le Léon de l’apocalypse ?
Malédiction ou préméditation..? Découvrez le dénouement inattendu du second tome des enquêtes du commissaire Morand !
EXTRAIT
Cela faisait maintenant cinq jours qu’il n’y avait presque plus d’aurore. Les mêmes nuages noirs et bas semblaient arrimés à la terre qu’ils détrempaient de leur pluie fine et obstinée. Des traînées grises enveloppaient les arbres et les toitures, donnant au paysage un aspect cotonneux et informe.
Debout sur le seuil de sa maison, Jean-Yves Guillevic cherchait du regard une trouée bleuâtre qui annoncerait une percée du soleil. Mais de Roscoff, à l’est, jusque du côté de Tevenn, à l’ouest, ce n’était qu’une masse sombre et immobile. La pointe de Perharidy se confondait avec la plaque, sans écume, de la mer. Seuls ses lampadaires et son phare encore allumés permettaient de localiser l’île de Batz.
À sept heures du matin ! Un 30 mars ! De mémoire de Finistérien, Jean-Yves Guillevic n’avait jamais vu ça. Même les mouettes avaient disparu, comme effrayées.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1945,
Alain Couprie est professeur émérite des Universités. Auteur de biographies et d’ouvrages sur le XVIle siècle ainsi qu’en collaboration de dictionnaires, il partage aujourd’hui son temps de retraite entre la banlieue parisienne, la Bourgogne et la Bretagne.
Ce sont d’ailleurs des amitiés bretonnes et de réguliers séjours en Bretagne qui lui ont donné l’idée d’y camper l’action de ses romans policiers.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« DÉCOUVREZ UN PRODUIT HISTORIQUE ! »
« Depuis plus de 300 ans, l’oignon de Roscoff est sélectionné et cultivé par les légumiers de la côte nord-finistérienne. Son histoire est principalement marquée par le phénomène “Johnny” qui débuta en 1828, lorsqu’un jeune paysan de Roscoff, Henri Ollivier, décida d’aller vendre ses oignons en Grande-Bretagne. Chaque année plus nombreux, les paysans quittaient le port de Roscoff après le pardon de Sainte-Barbe, pour aller vendre leurs oignons outre-Manche, au porte-à-porte, à pied et à vélo. Les oignons étaient tressés pour mieux les transporter mais aussi mieux les conserver. […]En 2009, l’oignon de Roscoff a été reconnu en AOC. L’appellation d’origine contrôlée est une garantie de qualité et de typicité qui résulte d’un terroir délimité dans lequel interagissent les facteurs naturels, climatiques, physiques et humains. »
Extrait du dépliant Goûtez la différence ! émis par le Syndicat de l’AOC Oignon de Roscoff et gracieusement disponible à l’Office du Tourisme de Roscoff.
I
Cela faisait maintenant cinq jours qu’il n’y avait presque plus d’aurore. Les mêmes nuages noirs et bas semblaient arrimés à la terre qu’ils détrempaient de leur pluie fine et obstinée. Des traînées grises enveloppaient les arbres et les toitures, donnant au paysage un aspect cotonneux et informe.
Debout sur le seuil de sa maison, Jean-Yves Guillevic cherchait du regard une trouée bleuâtre qui annoncerait une percée du soleil. Mais de Roscoff, à l’est, jusque du côté de Tevenn, à l’ouest, ce n’était qu’une masse sombre et immobile. La pointe de Perharidy se confondait avec la plaque, sans écume, de la mer. Seuls ses lampadaires et son phare encore allumés permettaient de localiser l’île de Batz.
À sept heures du matin ! Un 30 mars ! De mémoire de Finistérien, Jean-Yves Guillevic n’avait jamais vu ça. Même les mouettes avaient disparu, comme effrayées.
« Cette fois, ils nous ont détraqué le temps ! », pensa-t-il.
La météo n’annonçait pas d’amélioration avant plusieurs jours.
La fermeture Éclair de sa combinaison remontée jusqu’au cou, dos courbé sous la pluie, Jean-Yves Guillevic traversa au plus vite la cour de sa ferme. Les semelles de ses bottes clappèrent dans la pellicule d’eau et de boue. Sous le hangar où il garait son tracteur, il se redressa et s’essuya le visage de son avant-bras.
Le tracteur démarra dès la première impulsion, sans même tousser sous l’humidité. Encore heureux ! Un tracteur tout neuf, acheté il y a deux ans à crédit, comme la maison d’ailleurs, construite dans le style du pays avec un prêt remboursable sur vingt ans du Crédit Immobilier de Bretagne. Une belle maison aux ouvertures en pierres de taille apparentes, avec vue sur la mer. Victoire y procédait au rituel du lever, les jours de classe, passant d’abord dans la chambre de Luc, toujours prompt à paresser dans son lit, puis dans celle d’Annie. La fenêtre de la chambre de Luc s’éclaira quand Jean-Yves Guillevic quitta sa ferme du Palud.
Il n’avait guère plus d’un kilomètre à parcourir jusqu’à ses champs d’oignons et ses cultures de primeurs entre Le Pouldu, Poulmavic et, plus bas, vers l’intérieur, Traon-Meur. Il s’engagea prudemment dans un chemin creux, fangeux et sinueux, de peur de ne pas percevoir à temps quelque chose ou quelqu’un surgir de l’écran de pluie qu’il avait devant les yeux. À en juger au loin par la procession lumineuse de leurs phares, les automobilistes qui, sur la grandroute, se rendaient à leur travail sur Roscoff ou Saint-Pol-de-Léon, n’allaient pas non plus très vite.
Jean-Yves Guillevic rangea son tracteur en contrebas de l’un de ses champs, en descendit, manqua de glisser et comprit en un éclair.
Il se baissa pour saisir une motte de terre. Une pâte fangeuse lui colla aux doigts, sous laquelle les semis avaient déjà étouffé. Censées protéger les bulbes d’oignons du mildiou, les bâches en plastique les noyaient sous le poids de l’eau de pluie, qu’elles retenaient en de petits lacs. Il n’y avait plus ni rang ni sillon, mais des éboulis de boue, des mottes en dissolution.
Toute sa récolte était mort-née.
À moins que, peut-être, sur le haut, le ruissellement eût causé moins de dégâts…
Jean-Yves Guillevic remonta à grand-peine son champ. Ses semelles clappèrent de nouveau dans la boue, firent par endroits exploser les bulles d’air qui se trouvaient encore sous les bâches.
Le haut n’avait pas davantage été épargné. C’était même pire. La terre avait perdu sa texture et sa couleur. Une vomissure verdâtre se répandait jusqu’à mi-pente, s’effilochait en traînées qui, à leur tour, se morcelaient en salissures de plus en plus minces et tirant sur le jaunâtre.
« Ils ont même pourri la terre ! »
Les pieds dans la boue, les cheveux trempés, insensible à la pluie qui redoublait, Jean-Yves Guillevic demeura un long moment à contempler cette désolation grise qui, au loin, lui masquait sa maison et la mer. Ses yeux s’embuèrent de pluie et de larmes mêlées. Sa main lui servit de mouchoir.
Il ne récolterait rien cette année, ni oignons roses de Roscoff, ni primeurs, ni…
Rien de rien.
Le découragement le saisit, il voulut appeler sa femme sur son portable et se ravisa. Que lui dire ? Que tout était fichu, perdu, foutu ? Elle l’apprendrait bien assez tôt. À cette heure, Victoire devait faire petit-déjeuner les enfants ou achever de les habiller ou vérifier leur cartable. Jean-Yves Guillevic ne savait plus vraiment.
Puis le besoin de parler, d’expulser hors de lui toute la souffrance qui lui tenaillait le ventre et le cerveau, de savoir ce qu’il en était ailleurs lui fit appeler amis et connaissances.
— Pierre ? Jean-Yves…
Chez Pierre, sur la commune de Santec, la situation n’était pas meilleure. Erwan, dans sa ferme de Tréflez, essayait de sauver ce qui pouvait encore l’être, c’est-à-dire pas grand-chose. À Kerlouan, c’était pire encore. Sur Mespaul et Plouénan, au sud de Saint-Polde-Léon, c’était la même désolation. Il fallait s’éloigner des communes du littoral et s’enfoncer dans l’intérieur des terres pour avoir un bilan plus réconfortant. Sur Lanhouarneau, c’était juste, mais si le temps voulait enfin y mettre du sien… Ce n’était vraiment qu’à partir des communes de Plougar et de Plouvorn que les dégâts étaient minimes, même avec un soleil qui continuait de se dérober.
Jean-Yves Guillevic redescendit vers son tracteur. Ses bottes déchirèrent les bâches, écrasèrent les rares bulbes d’oignons qui n’étaient pas encore pourris.
Qu’est-ce que ça pouvait bien faire maintenant ?
* * *
Il fit un crochet par Kergompez et la Chambre d’Agriculture qui abritait dans ses locaux le syndicat de l’AOC des Oignons de Roscoff. Il y retrouva une petite dizaine d’agriculteurs qui, sans s’être concertés, étaient venus comme lui aux nouvelles. La météo maintenait ses prévisions à quatre jours. L’énorme dépression continuerait de stagner sur la Manche, sur les côtes anglaises et celles du Nord-Finistère. Une autre dépression, venue de Sibérie celle-là, risquait à moyen terme de la renforcer ou de prendre sa place. Ce serait donc toujours ciel bas, nuages lourds, pluie et peut-être chutes de grêle ici et là.
Le désastre en perspective.
Entre cigarettes et gobelets de café, chacun calculait déjà ce qu’il lui en coûterait. Quant aux solutions…
L’état de catastrophe naturelle n’aurait aucun effet immédiat. Le temps d’évaluer les préjudices, de monter les dossiers, de voir les aides arriver…
— Encore faudrait-il qu’il soit déclaré, cet état… et que, pour une fois, le gouvernement bouge son cul !
— Et aussi le préfet !
On hocha la tête. Les cendriers se remplirent, les gobelets se vidèrent.
— Ce serait plus rapide avec des prêts bonifiés, suggéra un autre.
— Bonifiés ou pas, des prêts, ça doit toujours se rembourser, répondit Jean-Yves Guillevic. Et rembourser, moi je peux pas. Je suis ric-rac. Sans mes primeurs et mes trois tonnes d’oignons, je passe même pas l’été !
— Moi non plus, laissa tomber un plus âgé. Mais comme je suis à la retraite à la fin de l’année, je m’arrangerai pour tenir jusque-là. Tandis que toi, Jean-Yves… je te plains, t’es trop jeune.
— Raison de plus pour ne pas crever, répliqua Marc Ambreville. Ce n’est pas la première fois qu’on a des problèmes. Et on s’en est toujours sortis. En 1990, souvenons-nous, plus personne ne pariait sur l’oignon de Roscoff et…
— V’là t’y pas que le Parisien va nous apprendre ce qu’on a fait, l’interrompit une voix agacée. T’avais quel âge, à l’époque ? T’étais encore en culotte courte et t’avais p’t-être jamais mis les pieds en Bretagne, sauf pour les vacances, à la rigueur, entre papa et maman…
Il y eut des sourires, un ricanement, puis une certaine gêne.
Marc Ambreville cumulait les méfiances : jeune encore dans une profession vieillissante, néorural dans un milieu d’exploitants de père en fils, adepte d’une agriculture biologique bousculant traditions et pratiques, et surtout parisien de naissance, pas même de parents bretons montés à la capitale.
— Toi, ne m’emmerde pas avec ça ! répliqua-t-il. La Bretagne, je n’y suis pas né, c’est vrai, mais je l’ai choisie, j’y vis comme vous, j’y travaille. Mon choix vaut bien ta naissance.
— Tu as raison, voisin ! lança la voix claire de Victoire.
Bien que personne ne l’eût vue arriver, nul ne s’étonna de sa présence.
Victoire était de toutes les réunions, de toutes les joies et de toutes les difficultés du métier. Une énergie à ne rechigner devant aucune tâche ni responsabilité, et dont on pouvait se demander où elle la puisait.
Victoire était plutôt mince, d’une taille moyenne et d’apparence fragile. Brune, sans vraie beauté mais au charme évident, surtout lorsqu’elle souriait. Et Victoire souriait souvent : elle avait vingt-huit ans, Jean-Yves pour mari et deux enfants.
— Ça fait trois ans que Marc a repris l’exploitation du père Henri, poursuivit-elle. Son bio, il l’a monté sans rien demander à personne, pas même à nous qui sommes pourtant juste à côté.
— Ça va, Victoire, ça va, dit une voix diplomate, ne t’énerve pas !
— Je ne m’énerve pas, mais ça m’agace qu’on critique quelqu’un sur ses origines. D’autant que des travailleurs comme lui, j’en connais pas beaucoup. Et seul de plus !
— Je te remercie Victoire, répliqua Marc Ambreville, mais je sais me défendre au besoin. Ce n’est pas le problème. Comme mes serres sont de petites maisons en plastique dur, mes semis n’ont pas souffert. Si la météo s’améliore, il sera encore temps de replanter. Deux, trois semaines de retard, ce n’est pas très grave. Je suis prêt à partager mes semis et mes bulbes d’oignons avec ceux qui en auront le plus besoin.
— C’est chic de ta part, lui répondit Jean-Yves. Mais ça ne nous mènera pas très loin. Ce n’est pas en partageant la misère qu’on devient plus riche.
— Les enfants ! s’écria Victoire. Il va être midi ! Faut que je file les chercher à l’école !
* * *
Avec sa casquette de marin, son pantalon de velours et les mains dans les poches de son caban, André Morand ressemblait plus au retraité qu’il serait dans six mois qu’au commissaire de police qu’il était encore. Allant et venant sur le quai du vieux port de Roscoff, il attendait le retour du dernier des quatre bateaux de pêche partis le matin même. Morand s’était pris de passion pour cette ville comme pour aucune autre de ses affectations précédentes et il s’inquiétait du sort de ces hommes, bien que l’organisation des secours en mer ne relevât pas de son domaine de compétence. Une corne de brume et bientôt l’apparition d’un fanal le rassurèrent.
Morand consulta sa montre : 14 heures. Il reviendrait dans un peu plus de deux heures surveiller le retour des quelques lycéens sur l’île de Batz où ils habitaient. Du moins, si le bateau assurant la navette entre l’île et le continent allait pouvoir prendre la mer. Rien n’était moins sûr avec ce temps pourri et cette faible visibilité. L’extrémité de l’estacade où accostait la navette par marée basse, émergeait à peine du crachin. En cas de trop mauvais temps, ces lycéens passeraient la nuit dans l’internat de fortune prévu à cet effet et installé dans le collège de la ville.
« S’informer de sa mise en place », pensa Morand.
Il remonta à pied la rue Amiral Réveillère, presque déserte, et regagna son commissariat, rue Armand Rousseau, près de l’Hôtel de Ville. Quand il pénétra dans son bureau, il n’eut pas même le temps de s’asseoir que le téléphone sonna.
— Commissaire ? Marc Ambreville à l’appareil. Venez vite. Il s’est suicidé.
— Qui “il” ?
— Guillevic. Au Palud.
Quinze minutes plus tard, Morand était sur place, avec deux de ses hommes. Visage pétrifié, gestes et démarche d’un automate, Victoire les conduisit au bureau de son mari. Jean-Yves Guillevic s’était pendu à l’une des poutres apparentes du plafond. Ses yeux exorbités, ses lèvres cyanosées, sa langue retournée dans sa gorge ne laissaient à l’évidence aucun espoir. Ses pieds reposaient sur une chaise dressée sur le bureau.
— Elle était renversée quand je suis arrivé, expliqua Marc Ambreville. Il a dû monter dessus et la repousser d’un coup de pied. Je l’ai redressée pour que le corps ne se balance plus. Pour le reste, je n’ai rien touché. Sauf le nœud que j’ai desserré, mais c’était trop tard. Et j’ai prévenu un médecin.
— Qui ?
— Le docteur Gouesnou.
Morand acquiesça : il connaissait le docteur Gouesnou* ; Marie-Thérèse était une femme remarquable.
Des papiers s’étalaient sur le bureau : des factures, des traites à rembourser, des injonctions du fisc, des rappels de l’URSSAF. Les tiroirs étaient ouverts. L’un d’eux était renversé à terre.
— Il ne faut pas que les enfants voient leur père comme ça, dit lentement Victoire. Marc, prends-les avec toi…
Marc Ambreville hésita un court instant, moins par refus que par embarras. Célibataire, il ne savait pas trop comment on s’occupait de jeunes enfants. Morand perçut son hésitation, appela sa femme qui coupa court à toute explication. Elle s’occuperait évidemment des enfants de Victoire qu’elle connaissait bien pour lui acheter ses légumes, le mercredi au marché. Elle irait chercher Luc et Annie à l’école, à quatre heures et demie.
Morand, les deux policiers et Marc Ambreville ne furent pas de trop pour dépendre Jean-Yves Guillevic et l’allonger à terre sans le faire tomber comme un sac. Le docteur Gouesnou confirma que le décès avait dû intervenir dans la minute à peine qui avait suivi la pendaison.
Jusqu’à l’arrivée de l’ambulance qui transporta le corps à la morgue de Morlaix, Victoire resta droite, somnambule et muette.
*Voir Ça chauffe à Roscoff, même auteur, même collection.
II
— Crois-tu vraiment à un coup de folie ? demanda le soir Catherine Morand à son mari.
Il était près de vingt-deux heures et ni l’un ni l’autre, attablés dans leur cuisine, n’avaient envie de dîner.
— Pourquoi me poses-tu cette question ?
— Je ne sais pas, dit Catherine. Mais il me semble que lorsqu’on a une femme comme Victoire et deux magnifiques bambins, on ne se suicide pas comme ça…
— Il s’est senti piégé, incapable de financièrement faire face. Personne ne sait où il est allé quand il a quitté la Chambre d’Agriculture. Et il n’est pas rentré déjeuner chez lui. Victoire ne s’en est pas inquiétée. Elle devait faire déjeuner les enfants, les reconduire à l’école. Ce n’est qu’à son retour, qu’elle l’a découvert… Il a dû errer pendant tout ce temps, paniquer.
— Tout de même, ça ne lui ressemble pas, ce suicide…
— D’après les statistiques, la profession d’agriculteurs est celle où l’on se suicide le plus. Corde ou fusil de chasse.
— Pauvre Victoire… Un coup de folie et hop, huit ans de bonheur détruits… Je ne parviens pas à le croire… Des coups durs, tu en as connu, toi aussi, dans ta carrière… tu ne t’es pas pour autant suicidé…
— C’est aussi courant chez les flics que chez les agriculteurs. Arme de service chez nous… Mais, moi, je t’avais, murmura Morand.
— Tu… tu… vois… bégaya Catherine. Sais-tu ce qu’Annie m’a dit quand je suis allée la coucher dans notre chambre d’amis : de quoi mon papa il est mort ? Son frère, lui, s’intéressait à la maquette de bateau… Les hommes, décidément…
Morand refusa la tranche de jambon que sa femme lui proposait. Des morts, il en avait vu des dizaines et des dizaines durant sa carrière, forcément pour dresser les constats, des morts par armes à feu, par armes blanches, par pendaison, par écrabouillement dans un accident de voiture. Mais plus il vieillissait, moins il s’y habituait.
Il croqua un fruit, passa dans le salon, alluma la télévision pour le journal télévisé de 22 heures 30 sur France 3 Bretagne. La météo en restait le sujet majeur : reportages, prévisions, interviews de spécialistes, cartes détaillées pour les prochains jours, impacts économiques…
On sonna à la porte des Morand : Victoire ? Ambreville ?
C’était le docteur Gouesnou.
Son divorce l’avait rajeunie. Entre la clientèle de son cabinet privé à Saint-Pol et ses consultations au Centre de Thalasso de Roscoff, elle débordait d’activité et d’enthousiasme.
— Entrez, je vous prie, lui dit Catherine. Un café ? Une tisane ? Avez-vous seulement dîné, Marie-Thérèse ?
— Un café, oui, je veux bien, merci. André, dit-elle en se tournant vers le commissaire, je suis très… perplexe. Dans l’ambulance, j’ai poursuivi l’examen de son cou. À la base de la nuque, à hauteur du trou occipital, j’ai repéré un hématome, pas très gros mais net.
— Et vous en concluez ? demanda Morand, soudain tendu.
— Un doute. Stupide sûrement. D’après le légiste à qui je l’ai montré, c’est du classique, ce genre d’hématome. Un pendu, c’est vrai, ça gigote beaucoup et tourne dans tous les sens avant que l’asphyxie ne le raidisse comme un fil à plomb. Lorsque Guillevic a repoussé la chaise d’un coup de pied, son corps a oscillé. Sa tête a pu heurter quelque chose, une autre poutre, la corniche d’un meuble ou le mur. C’est possible… Je souhaite en tout cas que ça se soit passé comme ça.
— Pourquoi ?
— Parce que par le trou occipital passe l’axe cérébro-spinal. S’il est atteint, c’est la paralysie assurée. Ou la mort.
— Peut-on savoir si, d’après la couleur ou l’état des chairs, cet hématome est antérieur ou concomitant à la strangulation ? questionna Morand, de plus en plus intéressé.
— C’est impossible à diagnostiquer. S’il est antérieur, ce n’est que de très peu.
— Sauf que si cet hématome est antérieur à la strangulation, cela veut dire que Guillevic ne s’est pas pendu, mais qu’il a été pendu…
— Guillevic, je ne le connaissais pas vraiment, mais un peu tout de même, reprit le docteur Gouesnou. Ce n’était pas un garçon dépressif, plutôt du genre à faire face. On ne se suicide pas comme ça, sur un coup de folie. Ou alors il faut une bonne raison.
Catherine regarda son mari.
— Il en faut une aussi, murmura celui-ci, de bonne raison pour qu’on vous pende…
— En tout cas, voilà, dit le docteur Gouesnou, je suis peut-être en train de devenir une vieille folle, mais cette histoire d’hématome me turlupine. Ce n’est pas le cas, encore une fois, du légiste qui va délivrer dès demain le permis d’inhumer. C’est vrai qu’il a plus l’habitude que moi des pendus…
À son tour, Morand regarda sa femme. Il remercia Marie-Thérèse Gouesnou, l’assura qu’elle avait très bien fait de lui faire part de sa perplexité, la raccompagna jusqu’à sa voiture. Dehors, on n’y voyait pratiquement rien, pas même les nuages bas et lourds qui épaississaient davantage encore la nuit. La capitainerie du port avait interdit tout départ en mer jusqu’à nouvel ordre. Les lycéens de l’île de Batz en seraient peut-être quitte pour une seconde nuit d’internat. Mais c’était sagesse avec ce temps exécrable. La lumière des lampadaires dessinait des traits verticaux de pluie.
— Faites attention à vous, dit-il en refermant la portière de la voiture du docteur.
— Je ne risque pas grand-chose. Avec ce temps d’épouvante, il n’y a personne dans les rues.
Morand attendit devant chez lui que la voiture disparût à l’angle de rue.
— Que comptes-tu faire ? lui demanda Catherine quand il rentra trempé.
— Rien, naturellement, répondit-il en s’essuyant les pieds sur le tapis-brosse du vestibule. Contre le permis d’inhumer du légiste, je ne peux rien, juridiquement rien. Marie-Thérèse se raconte des histoires.
* * *
À 2 heures 08 très exactement, le téléphona réveilla Morand. Un habitant de l’île de Batz venait de faire un malaise cardiaque. L’infirmier de l’île lui avait donné les premiers soins. L’évacuation s’imposait. Vu le temps et l’état de la mer, aucun bateau ne pouvait toutefois en prendre le risque : il se fracasserait sur les rochers de la passe avant même d’atteindre la côte.
En moins de dix minutes, Morand déclencha les procédures d’alerte sanitaire : pompiers bénévoles et policiers furent mobilisés, les médecins de garde du Centre de Perharidy et de la Clinique du Roc avertis. Centres de rééducation plus qu’hôpitaux à part entière, ces établissements n’en possédaient pas moins le matériel et les compétences nécessaires pour effectuer des actes approfondis avant tout transfert sur l’hôpital de Morlaix ou de Brest. Déjà le médecin de Perharidy indiquait par téléphone à l’infirmier le protocole à suivre, tandis que son collègue de la Clinique du Roc se rendait sur l’immense parking du port de Bloscon où il arriva peu avant l’hélicoptère de la Croix-Rouge.
— Je monte avec vous, hurla Morand dans le vent et le vacarme du rotor.
L’hélicoptère redécolla sitôt les deux hommes embarqués. Le médecin se faufila à l’arrière de l’appareil pour vérifier le matériel : bonbonne d’oxygène, masque respiratoire, flacons de sérum physiologique, ampoules de stimulant cardiaque, défibrillateur, tensiomètre électronique. Tout était prêt. Son stéthoscope pendait déjà à son cou.
Morand, lui, se tenait à l’avant de l’appareil, debout ou plutôt voûté, tant l’espace était réduit. L’hélicoptère volait à très basse altitude, à quelques mètres seulement au-dessus des flots. Morand avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait quasiment rien. La mer, il la devinait plus qu’il ne la discernait dans cette mélasse obscure. Mais il en ressentait presque la violence des courants qui étaient comme coincés entre l’île et le continent. Au-dessus de lui, à droite, à gauche, ce n’était qu’une boue de nuages. Son estomac tangua au rythme des coups de butoir du vent qui ballottaient l’appareil. Le pilote était, lui, à son affaire.
Soudain, le débarcadère de Porz Kernok s’illumina. Dès que s’était répandue la nouvelle de l’évacuation par hélicoptère de l’un des leurs, les îliens, solidaires, s’étaient relevés en pleine nuit et avaient disposé en un vaste cercle leurs voitures et tracteurs qui, tous phares allumés, balisaient la zone d’atterrissage. Le pilote s’y posa presque comme en plein jour.
Le médecin courut auprès du malade, allongé sur une civière, déjà enveloppé d’une couverture de survie. Morand donna au maire des nouvelles des lycéens restés en internat forcé à Roscoff, s’informa pour la forme de ses éventuels besoins, la population de l’île étant habituée à vivre en autarcie les jours de grande tempête. Mais ce n’était vraiment pas de chance que cette évacuation de nuit et par un temps pareil ! Le maire n’avait pas vu de météo aussi dégueulasse depuis quarante ans… Le tout ne dura que quelques minutes.
Le malade fut embarqué. Le médecin lui pratiqua une seconde injection, tout en vérifiant l’écran du tensiomètre et en téléphonant à la Clinique du Roc diagnostic, données médicales et nature de ses premiers actes. Quand il fut au-dessus des maisons du port, l’hélicoptère opéra un demi-cercle et se dirigea droit sur Roscoff.
La nuit parut à Morand encore plus épaisse qu’à l’aller. Était-ce de passer brutalement d’une zone éclairée à l’obscurité la plus totale ? Derrière eux, les phares de Porz Kernok s’éteignirent progressivement. Au loin, devant, les projecteurs du port de Bloscon s’allumèrent à leur tour. Entre les deux, c’était le potau-noir. Heureusement qu’aucun obstacle naturel ne se dressait entre l’île et le continent !
Le pilote poussa un énorme juron, déporta violemment son appareil sur la gauche, lui fit prendre de l’altitude aussi vite qu’il le put. Le brancard alla buter contre la paroi intérieure. Agenouillé près de son malade, le médecin roula à terre, retint d’une main sa trousse, de l’autre, un flacon de sérum. Morand cogna contre la carlingue. Il n’eut que le temps d’entrevoir avec effarement une masse, quelque chose qui volait et qui les frôla, tous feux éteints.
III
La nuit fut courte et le lever très matinal : dès cinq heures, Morand était debout ou, plus exactement, assis sur le rebord de son lit, jambes pendantes, avant-bras plantés sur ses cuisses et tête enfouie dans ses mains. Lentement, il se massa le visage, se frotta les yeux, fourragea dans ses cheveux de moins en moins épais et de plus en plus blancs. Puisqu’il lui était impossible de dormir, autant se lever plutôt que de rester couché, les yeux ouverts, sans bouger, de crainte de réveiller Catherine.
À son habitude, dès qu’il mit les pieds par terre, il lista mentalement ses obligations de la journée. Morand les classait en deux catégories : celles qui relevaient de la routine d’un commissaire de police en poste dans une cité balnéaire et celles qu’une raison ou une autre rendait exceptionnelles. Cette dernière catégorie s’était considérablement étoffée depuis vingt-quatre heures. « Dans l’ordre », se dit-il :
« 1 : prendre des nouvelles de l’évacué sanitaire et rédiger un rapport.
2 : parler avec le légiste de cette histoire d’hématome.
3 : passer à la ferme des Guillevic, à tout hasard, inspecter plus en détail le bureau, s’informer de la date et de la nature des obsèques.
4 : voir comment aider Victoire et ses enfants. En parler avec Catherine et cet Ambreville.
5 : contacter l’adjoint au maire chargé des questions scolaires et la capitainerie pour savoir s’il serait possible de rapatrier ce soir les collégiens de l’île de Batz. Sinon, décider des dispositions à prendre. »
Sans compter évidemment avec une troisième et dernière catégorie, celle des imprévus.
Satisfait d’avoir remis en marche ses neurones, Morand se redressa prestement. Le matelas en sursauta.
— Quelle heure est-il ? demanda Catherine.
Morand s’en voulut de sa maladresse. Il fit le tour du lit, se pencha vers sa femme, releva une mèche de ses cheveux, lui caressa la joue, contempla son visage encore à demi ensommeillé. Comme lui, elle avait vieilli. Comme lui, elle avait des rides.
Il pensa : « Quel con j’aurais été de ne pas l’épouser ! » et il répondit :
— Tout juste cinq heures. Tu as encore du temps.
Cela faisait bientôt quarante ans qu’ils étaient mariés. Morand regretta de n’avoir pas encore quarante ans à vivre avec cette femme.
— À sept heures, je réveillerai les enfants et je m’occuperai d’eux, lui répondit-elle.
* * *