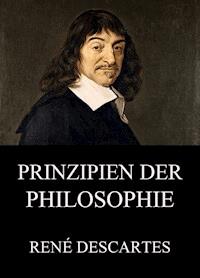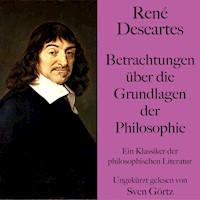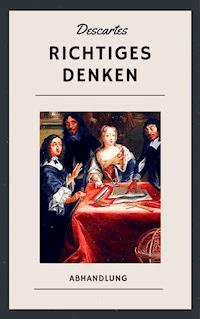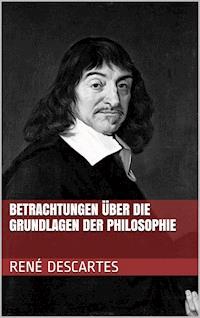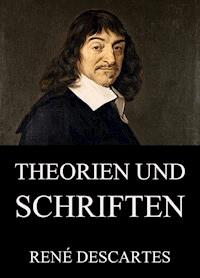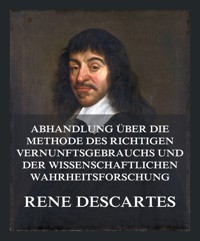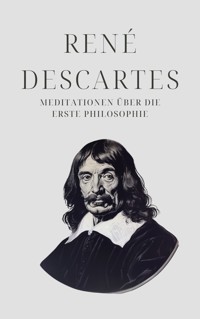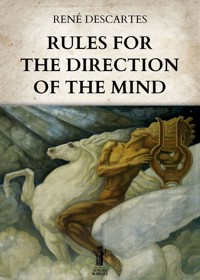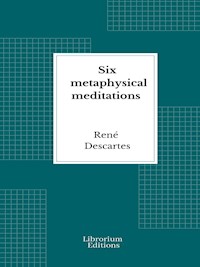Règles pour la direction de l'esprit suivi de Recherche de la Vérité par les lumières naturelles, le Monde ou Traité de la Lumière, L'Homme,Méditations Métaphysiques E-Book
Rene Descartes
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: RENE DESCARTES
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Les REGLES POUR LA DIRECTION DE L'ESPRIT est un ouvrage de jeunesse de Descartes, qu'il a retravaillé tout au long de sa vie et qui n'est paru qu'à titre posthume. Descartes y énonce les différentes règles d'une méthode universelle permettant d'orienter la pensée lorsque celle ci cherche à atteindre la vérité. L'ouvrage contient des règles pour diriger son esprit. Parmi les 21 règles énoncées, seules les 18 premières sont commentées par l'auteur. La recherche de la Vérité par la lumière naturelle est un dialogue philosophique inachevé de Descartes. Il imagine alors une conversation entre trois personnages: Eudoxe, Polyandre et Epistémon. Eudoxe est doué d'un esprit ordinaire, mais dont le jugement n'est gâté par aucune fausse opinion, et qui possède toute sa raison intacte, telle qu'il l'a reçue de la nature; il reçoit dans sa maison la visite de deux hommes du plus grand esprit, et des plus distingués du siècle: Polyandre qui n'a jamais rien étudié et Epistémon qui sait très bien tout ce qu'on peut apprendre dans les écoles.... Le Monde ou Traité de la Lumière est l'une des dernières oeuvres qu'écrivit Descartes dans le domaine scientifique. L'Homme est un traité inachevé de Descartes publié de manière posthume. Il y aborde les fonctions principales de la machine corporelle: la digestion, la nutrition, la respiration, la circulation du sang, le mouvement, les sens extérieurs et intérieurs, et la structure cérébrale. Les Méditations Métaphysiques est une oeuvre philosophique. Il y soutient qu'en dépit des arguments sceptiques contre la vérité et la certitude, il y a des connaissances légitimes. Aussi, il présente l'homme comme ayant une substance essentiellement pensante (le cogito) qui s'oppose à son corps, qui lui est une substance matérielle (voir dualisme de substances). Ce livre est illustré de 74 dessins
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Avant-Propos
REGLES pour LA DIRECTION DE L'ESPRIT
Règle première
Règle deuxième
Règle troisième
Règle quatrième
Règle cinquième
Règle sixième
Règle septième
Règle huitième
Règle neuvième
Règle dixième
Règle onzième
Règle douzième
Règle treizième
Règle quatorzième
Règle quinzième
Règle seizième
Règle dix septième
Règle dix-huitième
Règle dix-neuvième
Règle vingtième
Règle vingt et unième
Recherche DE LA VÉRITÉ par les LUMIÈRES NATURELLES
Préambule
POLYANDRE, ÉPISTEMON, EUDOXE
LE MONDE ou TRAITE DE LA LUMIERE
CHAPITRE PREMIER
De la différence qui est entre nos sentiments et les choses qui les produisent.
CHAPITRE II
En quoi consiste la chaleur et la lumière du feu
CHAPITRE III
De la dureté et de la liquidité
CHAPITRE IV
Du vide; et d'où vient que nos sens n'aperçoivent pas certains corps
CHAPITRE V
du nombre des éléments et de leurs qualités.
CHAPITRE VI
Description d'un nouveau monde, et des qualités de la matière dont il est composé
CHAPITRE VII
Des lois de la nature de ce nouveau monde
CHAPITRE VIII
De la formation ou soleil et des étoiles de ce nouveau monde
CHAPITRE IX
De l'origine et du cours des planètes et des comètes en général, et en particulier des comètes
CHAPITRE X
Des planètes en général, et en particulier de la terre et de la lune
CHAPITRE XI
De la pesanteur.
CHAPITRE XII
Du flux et du reflux de la mer.
CHAPITRE XIII
De la lumière.
CHAPITRE XIV
Des propriétés de la lumière
CHAPITRE XV
Que la face du ciel de ce nouveau monde doit paraître à ses habitants toute semblable à celle du nôtre
L'HOMME
Première partie
De la machine de son corps
Seconde partie
Comment se meut la machine de son corps
Troisième partie
Des feux extérieurs de cette machine et comment ils se rapportent aux nôtres
Quatrième partie
Des feux intérieurs qui se trouvent en cette machine.
Cinquième partie
De la structure du cerveau de cette machine ; et comment les esprits s'y distribuent pour causer ses mouvements et ses sentiments
MEDITATIONS METAPHYSIQUES
Préface
Abrégé des six méditations suivantes
Avant-Propos
Les deux ouvrages qui suivent, savoir, les Règles pour la direction de l'esprit, et la Recherche de la vérité par les lumières naturelles, égalent en force et surpassent peut-être en lucidité les Méditations et le Discours sur la méthode. On y voit encore plus à découvert le but fondamental de Descartes et l'esprit de cette révolution qui a créé la philosophie moderne et placé à jamais dans la pensée le principe de toute certitude, le point de départ de toute recherche régulière. On les dirait écrits d'hier, et composés tout exprès pour les besoins de notre époque.
Cependant ces deux monuments admirables n'ont pas même été aperçus d'un seul historien de la philosophie, et restaient ensevelis dans des Opera posthuma Cartesii, qui parurent à Amsterdam en 1701, cinquante ans après la mort de Descartes. Ils y sont en latin, comme tout le reste. Mais était-ce là leur forme première ? De qui les tient le libraire qui les a publiés ? Pourquoi M. Clerselier, qui se chargea de mettre au jour les papiers de Descartes, et auquel on doit le Traité de la lumière, le Traité de l'homme et les Lettres, s'il trouva ces deux ouvrages dans les papiers que lui remit l'ambassadeur de France à Stockholm, ne les a-t-il pas publiés lui-même, ou du moins ne les a-t-il pas mentionnés quelque part ? Assurément leur authenticité n'est pas plus douteuse que celle des Méditations, et la main de Descartes y est empreinte à chaque ligne. Mais on aurait désiré plus de lumières et de détails positifs sur deux ouvrages aussi importants. Nous en sommes réduits à quelques mots de Baillet ; c'est la seule autorité que cite l'éditeur hollandais, nous la rapportons textuellement :
« Parmi les ouvrages que les soins de M. Chanut ont fait échoir à M. Clerselier, il n'y eu a point de plus considérable, ni peut-être de plus achevé que le traité latin qui contient des règles pour conduire notre esprit dans la recherche de la vérité. C'est celui des manuscrits de M. Descartes à l'impression duquel il semble que le public ait le plus d'intérêt... Il divise en deux classes tous les objets à notre connaissance : il appelle les uns propositions simples et les autres questions. Les maximes relatives aux propositions simples consistent en douze règles. Les questions sont de deux sortes ; celles que l'on conçoit parfaitement, quoiqu'on en ignore la solution, et celles que l'on ne conçoit qu'imparfaitement. Il avait entrepris d'expliquer les premières en douze règles, comme il avait fait des propositions simples, et les dernières en douze autres règles ; de sorte que tout son ouvrage divisé en trois parties devait être composé de trente-six règles pour nous conduire dans la recherche de la vérité. Mais en perdant l'auteur, on a perdu toute la dernière partie de cet ouvrage et la moitié de la seconde. »
« Nous avons aussi le commencement d'un ouvrage (côté Q à l'inventaire) écrit en français, trouvé parmi les papiers que M. Descartes avait portés en Suède sous le titre de la Recherche de la vérité par la lumière naturelle, qui, toute pure et sans emprunter le secours de la religion ni de la philosophie, détermine les opinions que doit avoir un honnête homme sur toutes les choses qui peuvent occuper sa pensée. C'est un dialogue dont l'auteur avait dessein de nous donner deux livres... Dans le premier livre, on s'entretenait de toutes les choses qui sont au monde, les considérant en elles-mêmes ; dans le second, l'on devait s'entretenir de toutes les choses, selon qu'elles se rapportent à nous et qu'elles peuvent être regardées comme vraies ou Suisses, comme bonnes ou mauvaises. »
Baillet dit donc positivement que les Règles pour la direction de l'esprit étaient en latin, comme on pouvait le conjecturer d'après un passage de cet ouvrage1 ; mais que le traité sur la recherche de la vérité par les lumières naturelles était en français. Et en effet, il semble presque nécessaire qu'un traité présenté sous la forme du dialogue, pour être plus familier et plus vulgaire, ait été écrit en langue vulgaire ; le contraire eut été une espèce de contre-sens. Mais comment Baillet savait-il cela ? avait-il vu le manuscrit français, et qu'est devenu ce manuscrit ? Le libraire hollandais, qui faisait une édition toute latine, a-t-il détruit le manuscrit pour donner plus de valeur à la traduction qu'il publiait, ou ce manuscrit est-il encore enfoui quelque part dans les cartons de quelque libraire d'Amsterdam ? Ce sont là des questions que nous laisserons résoudre au hasard et au temps.
Après les deux ouvrages précédents viennent quelques pensées sur la génération des animaux et les saveurs, l'éditeur dit qu'il les donne en latin, comme on les lui a remis ; quant à leur authenticité, il avoue qu'il n'a pas d'autre raison d'y croire que la parole de la personne de laquelle il les tient, sans dire quelle est cette personne, et un passage de la lettre de Descartes (I. 53 du t. III de l'ancienne édition}, où il dit qu'il s'occupe d'un traité sur les animaux, qu'il n'a pas encore achevé. Pour nous, nous n'hésitons pas à rejeter l'authenticité de ce fragment plus que médiocre, où les idées les plus communes et souvent les plus fausses se font à peine jour à travers un style sans clarté et sans grandeur. Le texte est corrompu en beaucoup d'endroits, et nos efforts pour en tirer un sens raisonnable ont presque toujours échoué contre l'obscurité ou l'absurdité de l'original, tout-à-fait indigne d'être attribué à Descartes.
Sur le fragment d'algèbre qui termine ce volume, il n'y a pas plus de lumières que sur les écrits précédents ; mais il a été trouvé authentique par des juges habiles. Bien des fautes le déparaient, que nous avons corrigées, sans en avertir, quand elles étaient évidentes ; nous en avons signalé quelques unes quand elles étaient plus importantes ; nous en aurions découvert davantage, si nous eussions voulu vérifier avec plus de scrupule tous les calculs de Descartes. Chaque mathématicien qui voudra étudier ce précieux fragment du père de la géométrie moderne le sera pour son compte; nous nous sommes borné à reproduire le texte déjà donné.
Enfin, pour satisfaire cette curiosité si naturelle qui recherche les moindres traces d'un homme de génie, et croit retrouver quelque chose de lui jusque dans son écriture, nous publions le fac-simile d'un billet autographe de Descartes, que nous devons à l'amitié de l'un de ses plus proches descendants, M. le marquis de Château-Giron, et nous espérons que cette attention ne sera pas mal reçue par les amateurs d'autographes, car ce billet, en lui-même insignifiant, est pourtant la seule trace qui reste de l'écriture de Descartes.
Ce onzième volume est le dernier. Notre travail est terminé, et la France a enfin une édition françoise des Œuvres complètes de celui qui a tant fait pour sa gloire. Puisse ce monument, consacré à Descartes et à la France, servir à rappeler mes compatriotes à l'étude de la vraie philosophie, de cette philosophie dont Descartes a été, dans l'humanité, un des plus illustres interprètes, qui, sévère et hardie en même temps, sans sortir des limites de l'observation et de l'induction, atteint si haut et si loin, et qui partant de la conscience de l'homme, c'est-à-dire de la pensée, ne l'abandonne plus et la retrouve partout, dans la nature comme dans l'âme, dans les moindres détails comme dans les plus grands phénomènes de l'existence universelle :
« Je pense, donc je suis ».
Paris, ce 20 septembre 1826.
VICTOR COUSIN.
1 «Je considère seule ment quel sens ces mots ont en latin».
REGLES
pour
LA DIRECTION DE L'ESPRIT
Règle première
Le but des études doit être de diriger l'esprit de manière à ce qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui.
Toutes les fois que les hommes aperçoivent une ressemblance entre deux choses, ils sont dans l'habitude d'appliquer à l'une et à l'autre, même en ce qu'elles offrent de différent, ce qu'ils ont reconnu vrai de l'une des deux. C'est ainsi qu'ils comparent, mal à propos, les sciences qui consistent uniquement dans le travail de l'esprit, avec les arts qui ont besoin d'un certain usage et d'une certaine disposition corporelle. Et comme ils voient qu'un seul homme ne peut suffire à apprendre tous les arts à la fois, mais que celui-là seul y devient habile qui n'en cultive qu'un seul, parce que les mêmes mains peuvent difficilement labourer la terre et toucher de la lyre, et se prêter en même temps à des offices aussi divers, ils pensent qu'il en est ainsi des sciences ; et les distinguant entre elles par les objets dont elles s'occupent, ils croient qu'il faut les étudier à part et indépendamment l'une de l'autre. Or c'est là une grande erreur ; car comme les sciences toutes ensemble ne sont rien autre chose que l'intelligence humaine, qui reste une et toujours la même quelle que soit la variété des objets auxquels elle s'applique, sans que cette variété apporte à sa nature plus de changements que la diversité des objets n'en apporte à la nature du soleil qui les éclaire, il n'est pas besoin de circonscrire l'esprit humain dans aucune limite ; en effet, il n'en est pas de la connaissance d'une vérité comme de la pratique d'un art; une vérité découverte nous aide à en découvrir une autre, bien loin de nous faire obstacle. Et certes il me semble étonnant que la plupart des hommes étudient avec soin les plantes et leurs vertus, le cours des astres, les transformations des métaux, et mille objets semblables, et qu'à peine un petit nombre s'occupe de l'intelligence ou de cette science universelle dont nous parlons ; et cependant si les autres études ont quelque chose d'estimable, c'est moins pour elles-mêmes que pour les secours qu'elles apportent à celle-ci. Aussi n'est-ce pas sans motif que nous posons cette règle à la tête de toutes les autres ; car rien ne nous détourne davantage de la recherche de la vérité que de diriger nos efforts vers des buts particuliers, au lieu de les tourner vers cette fin unique et générale. Je ne parle pas ici des buts mauvais et condamnables, tels que la vaine gloire et la recherche d'un gain honteux ; il est clair que le mensonge et les petites ruses des esprits vulgaires y mèneront par un chemin plus court que ne le pourrait faire une connaissance solide du vrai. J'entends ici parler des buts honnêtes et louables; car ils sont pour nous un sujet d'illusions dont nous avons peine à nous défendre. En effet, nous étudions les sciences utiles ou pour les avantages qu'on en retire dans la vie, et pour ce plaisir qu'on trouve dans la contemplation du vrai, et qui, dans ce monde, est presque le seul bonheur pur et sans mélange. Voilà deux objets légitimes que nous pouvons nous proposer dans l'étude des sciences ; mais si au milieu de nos travaux nous venons à y penser, il se peut faire qu'un peu de précipitation nous fasse négliger beaucoup de choses qui seraient nécessaires à la connaissance des autres, parce qu'au premier abord elles nous paraîtront ou peu utiles ou peu dignes de notre curiosité. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que les sciences sont tellement liées ensemble qu'il est plus facile de les apprendre toutes à la fois que d'en détacher une seule des autres. Si donc on veut sérieusement chercher la vérité, il ne faut pas s'appliquer à une seule science; elles se tiennent toutes entre elles et dépendent mutuellement l'une de l'autre. Il faut songer à augmenter ses lumières naturelles, non pour pouvoir résoudre telle ou telle difficulté de l'école, mais pour que l'intelligence puisse montrer à la volonté le parti qu'elle doit prendre dans chaque situation de la vie. Celui qui suivra cette méthode verra qu'en peu de temps, il aura fait des progrès merveilleux et bien supérieurs à ceux des hommes qui se livrent aux études spéciales, et que, s'il n'a pas obtenu les résultats que ceux-ci veulent atteindre, il est parvenu à un but plus élevé, et auquel leurs vœux n'eussent jamais osé prétendre.
Règle deuxième
// ne faut nous occuper que des objets dont notre esprit parait capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable.
Toute science est une connaissance certaine et évidente ; et celui qui doute de beaucoup de choses n'est pas plus savant que celui qui n'y a jamais songé, mais il est moins savant que lui, si sur quelques unes de ces choses il s'est formé des idées fausses. Aussi vaut-il mieux ne jamais étudier que de s'occuper d'objets tellement difficiles, que dans l'impossibilité de distinguer le vrai du faux, on soit obligé d'admettre comme certain ce qui est douteux ; on court en effet plus de risques de perdre la science qu'on a, que de l'augmenter. C'est pourquoi nous rejetons par cette règle toutes ces connaissances qui ne sont que probables ; et nous pensons qu'on ne peut se fier qu'à celles qui sont parfaitement vérifiées, et sur lesquelles on ne peut élever aucun doute. Et quoique les savants se persuadent peut-être que les connaissances de cette espèce sont en bien petit nombre, parce que sans doute, par un vice naturel à l'esprit humain, ils ont négligé de porter leur attention sur ces objets, comme trop faciles et à la portée de tous, je ne crains pas cependant de leur déclarer qu'elles sont plus nombreuses qu'ils ne pensent, et qu'elles suffisent pour démontrer avec évidence un nombre infini de propositions, sur lesquelles ils n'ont pu émettre jusqu'ici que des opinions probables, opinions que bientôt, pensant qu'il était indigne d'un savant d'avouer qu'il ignore quelque chose, ils se sont habitués à parer de fausses raisons, de telle sorte qu'ils ont fini par se les persuader à eux-mêmes, et les ont débitées comme choses avérées.
Mais si nous observons rigoureusement notre règle, il restera peu de choses à l'étude desquelles nous puissions nous livrer. Il existe à peine dans les sciences une seule question sur laquelle des hommes d'esprit n'aient pas été d'avis différents. Or, toutes les fois que deux hommes portent sur la même chose un jugement contraire, il est certain que l'un des deux se trompe. Il y a plus, aucun d'eux ne possède la vérité ; car s'il en avait une vue claire et nette, il pourrait l'exposer à son adversaire, de telle sorte qu'elle finirait par forcer sa conviction. Nous ne pouvons donc pas espérer d'obtenir la connaissance complète de toutes les choses sur lesquelles on n'a que des opinions probables, parce que nous ne pouvons sans présomption espérer de nous plus que les autres n'ont pu faire. Il suit de là que si nous comptons bien, il ne reste parmi les sciences faites que la géométrie et l'arithmétique, auxquelles l'observation de notre règle nous ramène.
Nous ne condamnons pas pour cela la manière de philosopher à laquelle on s'est arrêté jusqu'à ce jour, ni l'usage des syllogismes probables, armes excellentes pour les combats de la dialectique. En effet, ils exercent l'esprit des jeunes gens, et éveillent en eux l'activité de l'émulation. D'ailleurs, il vaut mieux former leur esprit à des opinions, même incertaines, puisqu'elles ont été un sujet de controverse entre les savants, que de les abandonner à eux-mêmes libres et sans guides ; car, alors ils courraient risque de tomber dans des précipices ; mais tant qu'ils suivent les traces qu'on leur a marquées, quoiqu'ils puissent quelquefois s'écarter du vrai, toujours est-il qu'ils s'avancent dans une route plus sûre, au moins en ce qu'elle a été reconnue par des plus habiles. Et nous aussi nous nous félicitons d'avoir reçu autrefois l'éducation de l'école ; mais comme maintenant nous sommes déliés du serment qui nous enchaînait aux paroles du maître, et que, notre âge étant devenu assez mûr, nous avons soustrait notre main aux coups de la férule, si nous voulons sérieusement nous proposer des règles, à l'aide desquelles nous puissions parvenir au faîte de la connaissance humaine, mettons au premier rang celle que nous venons d'énoncer, et gardons-nous d'abuser de notre loisir, négligeant, comme font beaucoup de gens, les études aisées, et ne nous appliquant qu'aux choses difficiles. Ils pourront, il est vrai, former sur ces choses des conjectures subtiles et des systèmes probables ; mais, après beaucoup de travaux, ils finiront par s'apercevoir qu'ils ont augmenté la somme des doutes, sans avoir appris aucune science.
Mais comme nous avons dit plus haut que, parmi les sciences faites, il n'existe que l'arithmétique et la géométrie qui soient entièrement exemptes de fausseté ou d'incertitude, pour en donner la raison exacte, remarquons que nous arrivons à la connaissance des choses par deux voies, c'est à savoir, l'expérience et la déduction. De plus, l'expérience est souvent trompeuse ; la déduction, au contraire, ou l'opération par laquelle on infère une chose d'une autre, peut ne pas se faire, si on ne l'aperçoit pas, mais n'est jamais mal faite, même par l'esprit le moins accoutumé à raisonner. Cette opération n'emprunte pas un grand secours des liens dans lesquels la dialectique embarrasse la raison humaine, en pensant la conduire ; encore bien que je sois loin de nier que ces formes ne puissent servir à d'autres usages. Ainsi, toutes les erreurs dans lesquelles peuvent tomber, je ne dis pas les animaux, mais les hommes, viennent, non d'une induction fausse, mais de ce qu'on part de certaines expériences peu comprises, ou qu'on porte des jugements hasardés et qui ne reposent sur aucune base solide.
Tout ceci démontre comment il se fait que l'arithmétique et la géométrie sont de beaucoup plus certaines que les autres sciences, puisque leur objet à elles seules est si clair et si simple, qu'elles n'ont besoin de rien supposer que l'expérience puisse révoquer en doute, et que toutes deux procèdent par un enchaînement de conséquences que la raison déduit l'une de l'autre. Aussi sont-elles les plus faciles et les plus claires de toutes les sciences, et leur objet est tel que nous le désirons ; car, à part l'inattention, il est à peine supposable qu'un homme s'y égare. Il ne faut cependant pas s'étonner que beaucoup d'esprits s'appliquent de préférence à d'autres études ou à la philosophie. En effet, chacun se donne plus hardiment le droit de deviner dans un sujet obscur que dans un sujet clair, et il est bien plus facile d'avoir sur une question quelconque quelques idées vagues, que d'arriver à la vérité même sur la plus facile de toutes. De tout ceci, il faut conclure, non que l'arithmétique et la géométrie soient les seules sciences qu'il faille apprendre, mais que celui qui cherche le chemin de la vérité ne doit pas s'occuper d'un objet dont il ne puisse avoir une connaissance égale à la certitude des démonstrations arithmétiques et géométriques.
Règle troisième
Il faut chercher sur l'objet de notre étude, non pas ce qu'en ont pensé les autres, ni ce que nous soupçonnons nous-mêmes, mais ce que nous pouvons voir clairement et avec évidence, ou déduire d'une manière certaine. C'est le seul moyen d'arriver à la science.
Nous devons lire les ouvrages des anciens, parce que c'est un grand avantage de pouvoir user des travaux d'un si grand nombre d'hommes, premièrement pour connaître les bonnes découvertes qu'ils ont pu faire, secondement pour être averti de ce qui reste encore à découvrir. Il est cependant à craindre que la lecture trop attentive de leurs ouvrages ne laisse dans notre esprit quelques erreurs qui y prennent racine malgré nos précautions et nos soins. D'ordinaire, en effet, toutes les fois qu'un écrivain s'est laissé aller par crédulité ou irréflexion à une opinion contestée, il n'est pas de raisons, il n'est pas de subtilités qu'il n'emploie pour nous amener à son sentiment. Au contraire, s'il a le bonheur de trouver quelque chose de certain et d'évident, il ne nous le présente que d'une manière obscure et embarrassée ; craignant sans doute que la simplicité de la forme ne diminue la beauté de la découverte, ou peut-être parce qu'il nous envie la connaissance distincte de la vérité.
Il y a plus, quand même les auteurs seraient tous francs et clairs, et ne nous donneraient jamais le doute pour la vérité, mais exposeraient ce qu'ils savent avec bonne foi ; comme il est à peine une chose avancée par l'un dont on ne puisse trouver le contraire soutenu par l'autre, nous serions toujours dans l'incertitude auquel des deux ajouter foi, et il ne nous servirait de rien de compter les suffrages, pour suivre l'opinion qui a pour elle le plus grand nombre. En effet, s'agit-il d'une question difficile, il est croyable que la vérité est plutôt du côté du petit nombre que du grand. Même quand tous seraient d'accord, il ne nous suffirait pas encore de connaître leur doctrine ; en effet, pour me servir d'une comparaison, jamais nous ne serons mathématiciens, encore bien que nous sachions par cœur toutes les démonstrations des autres, si nous ne sommes pas capables de résoudre par nous-mêmes toute espèce de problème. De même, eussions-nous lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote, nous n'en serons pas plus philosophes, si nous ne pouvons porter sur une question quelconque un jugement solide. Nous paraîtrions en effet avoir appris non une science, mais de l'histoire.
Prenons garde en outre de jamais mêler aucune conjecture à nos jugements sur la vérité des choses.
Cette remarque est d'une grande importance ; et si dans la philosophie vulgaire on ne trouve rien de si évident et de si certain qui ne donne matière à quelque controverse, peut-être la meilleure raison en est-elle que les savants, non contents de reconnaître les choses claires et certaines, ont osé affirmer des choses obscures et inconnues qu'ils n'atteignaient qu'à l'aide de conjectures et de probabilités ; puis, y ajoutant successivement eux-mêmes une entière croyance, et les mêlant sans discernement aux choses vraies et évidentes, ils n'ont pu rien conclure qui ne parût dériver plus ou moins de quelqu'une de ces propositions incertaines, et qui partant ne fût incertain.
Mais, pour ne pas tomber dans la même erreur, rapportons ici les moyens par lesquels notre entendement peut s'élever à la connaissance sans crainte de se tromper. Or il en existe deux, l'intuition et la déduction. Par intuition j'entends non le témoignage variable des sens, ni le jugement trompeur de l'imagination naturellement désordonnée, mais la conception d'un esprit attentif, si distincte et si claire qu'il ne lui reste aucun doute sur ce qu'il comprend ; ou, ce qui revient au même, la conception évidente d'un esprit sain et attentif, conception qui naît de la seule lumière de la raison, et est plus sûre parce qu'elle est plus simple que la déduction elle-même, qui cependant, comme je l'ai dit plus haut, ne peut manquer d'être bien faite par l'homme. C'est ainsi que chacun peut voir intuitivement qu'il existe, qu'il pense, qu'un triangle est terminé par trois lignes, ni plus ni moins, qu'un globe n'a qu'une surface, et tant d'autres choses qui sont en plus grand nombre qu'on ne le pense communément, parce qu'on dédaigne de faire attention à des choses si faciles.
Mais, de peur qu'on ne soit troublé par l'emploi nouveau du mot intuition, et de quelques autres que dans la suite je serai obligé d'employer dans un sens détourné de l'acception vulgaire, je veux avertir ici en général que je m'inquiète peu du sens que, dans ces derniers temps, l'école a donné aux mots ; il serait très difficile en effet de se servir des mêmes termes, pour représenter des idées toutes différentes ; mais que je considère seulement quel sens ils ont en latin, afin que, toutes les fois que l'expression propre me manque, j'emploie la métaphore qui me parait la plus convenable pour rendre ma pensée.
Or cette évidence et cette certitude de l'intuition doit se retrouver non seulement dans une énonciation quelconque, mais dans tout raisonnement. Ainsi quand on dit deux et deux font la même chose que trois et un, il ne faut pas seulement voir par intuition que deux et deux égalent quatre, et que trois et un égalent quatre, il faut encore voir que de ces deux propositions, il est nécessaire de conclure cette troisième, savoir, qu'elles sont égales.
On pourrait peut-être se demander pourquoi à l'intuition nous ajoutons cette autre manière de connaître par déduction, c'est-à-dire par l'opération, qui d'une chose dont nous avons la connaissance certaine, tire des conséquences qui s'en déduisent nécessairement. Mais, nous avons dû admettre ce nouveau mode ; car il est un grand nombre de choses qui, sans être évidentes par elles-mêmes, portent cependant le caractère de la certitude, pourvu qu'elles soient déduites de principes vrais et incontestés par un mouvement continuel et non interrompu de la pensée, avec une intuition distincte de chaque chose ; tout de même que nous savons que le dernier anneau d'une longue chaîne tient au premier, encore que nous ne puissions embrasser d'un coup d'œil les anneaux intermédiaires, pourvu qu'après les avoir parcourus successivement, nous nous rappelions que, depuis le premier jusqu'au dernier, tous se tiennent entre eux. Aussi distinguons-nous l'intuition de la déduction, en ce que dans l'une on conçoit une certaine marche ou succession, tandis qu'il n'en est pas ainsi dans l'autre, et en outre que la déduction n'a pas besoin d'une évidence présente comme l'intuition, mais qu'elle emprunte en quelque sorte toute sa certitude de la mémoire ; d'où il suit que l'on peut dire que les premières propositions, dérivées immédiatement des principes, peuvent être, suivant la manière de les considérer, connues tantôt par intuition, tantôt par déduction ; tandis que les principes eux-mêmes ne sont connus que par intuition, et les conséquences éloignées que par déduction.
Ce sont là les deux voies les plus sûres pour arriver à la science ; l'esprit ne doit pas en admettre davantage ; il doit rejeter toutes les autres comme suspectes et sujettes à l'erreur ; ce qui n'empêche pas que les vérités de la révélation ne soient les plus certaines de toutes nos connaissances, car la foi qui les fonde est, comme dans tout ce qui est obscur, un acte non de l'esprit, mais de la volonté, et si elle a dans l'intelligence humaine un fondement quelconque, c'est par l'une des deux voies dont j'ai parlé qu'on peut et qu'on doit le trouver, ainsi que je le montrerai peut-être quelque jour avec plus de détails.
Règle quatrième
Nécessité de la méthode dans la recherche de la vérité.
Les hommes sont poussés par une curiosité si aveugle, que souvent ils dirigent leur esprit dans des voies inconnues, sans aucun espoir fondé, mais seulement pour essayer si ce qu'ils cherchent n'y serait pas ; à peu près comme celui qui, dans l'ardeur insensée de découvrir un trésor, parcourrait perpétuellement tous les lieux pour voir si quelque voyageur n'y en a pas laissé un ; c'est dans cet esprit qu'étudient presque tous les chimistes, la plupart des géomètres, et bon nombre de philosophes. Et certes, je ne disconviens pas qu'ils n'aient quelquefois le bonheur de rencontrer quelque vérité ; mais je n'accorde pas qu'ils en soient pour cela plus habiles, mais seulement plus heureux. Aussi vaut-il bien mieux ne jamais songer à chercher la vérité que de le tenter sans méthode ; car il est certain que les études sans ordre et les méditations confuses obscurcissent les lumières naturelles et aveuglent l'esprit. Ceux qui s'accoutument ainsi à marcher dans les ténèbres s'affaiblissent tellement la vue, qu'ils ne peuvent plus supporter la lumière du jour ; ce que confirme l'expérience, puisque nous voyons des hommes, qui jamais ne se sont occupés de lettres, juger d'une manière plus saine et plus sûre de ce qui se présente que ceux qui ont passé leur vie dans les écoles. Or, par méthode, j'entends des règles certaines et faciles, qui, suivies rigoureusement, empêcheront qu'on ne suppose jamais ce qui est faux, et feront que sans consumer ses forces inutilement, et en augmentant graduellement sa science, l'esprit s'élève à la connaissance exacte de tout ce qu'il est capable d'atteindre.
Il faut bien noter ces deux points, ne pas supposer vrai ce qui est faux, et tâcher d'arriver à la connaissance de toutes choses. En effet, si nous ignorons quelque chose de tout ce que nous pouvons savoir, c'est que nous n'avons jamais remarqué aucun moyen qui pût nous conduire à une pareille connaissance, ou parce que nous sommes tombés dans l'erreur contraire. Or, si la méthode montre nettement comment il faut se servir de l'intuition pour éviter de prendre le faux pour le vrai, et comment la déduction doit s'opérer pour nous conduire à la science de toutes choses, elle sera complète à mon avis, et rien ne lui manquera, puisqu'il n'y a de science qu'avec l'intuition et la déduction, ainsi que je l'ai dit plus haut. Toutefois, elle ne peut pas aller jusqu'à apprendre comment se font ces opérations, parce qu'elles sont les plus simples et les premières de toutes ; de telle sorte que, si notre esprit ne les savait faire d'avance, il ne comprendrait aucune des règles de la méthode, quelque faciles qu'elles fussent. Quant aux autres opérations de l'esprit, que la dialectique s'efforce de diriger à l'aide de ces deux premiers moyens, elles ne sont ici d'aucune utilité ; il y a plus, on doit les mettre au nombre des obstacles ; car on ne peut rien ajouter à la pure lumière de la raison, qui ne l'obscurcisse en quelque manière.
Comme l'utilité de cette méthode est telle que se livrer sans elle à l'étude des lettres soit plutôt une chose nuisible qu'utile, j'aime à penser que depuis longtemps les esprits supérieurs, abandonnés à leur direction naturelle, l'ont en quelque sorte entrevue. En effet, l'âme humaine possède je ne sais quoi de divin où sont déposés les premiers germes des connaissances utiles, qui, malgré la négligence et la gêne des études mal faites, y portent des fruits spontanés. Nous en avons une preuve dans les plus faciles de toutes les sciences, l'arithmétique et la géométrie. On a remarqué en effet que les anciens géomètres se servaient d'une espèce d'analyse, qu'ils étendaient à la solution des problèmes, encore bien qu'ils en aient envié la connaissance à la postérité. Et ne voyons-nous pas fleurir une certaine espèce d'arithmétique, l'algèbre, qui a pour but d'opérer sur les nombres ce que les anciens opéraient sur les figures ? Or, ces deux analyses ne sont autre chose que les fruits spontanés des principes de cette méthode naturelle, et je ne m'étonne pas qu'appliquées à des objets si simples, elles aient plus heureusement réussi que dans d'autres sciences où de plus grands obstacles arrêtaient leur développement ; encore bien que même, dans ces sciences, pourvu qu'on les cultive avec soin, elles puissent arriver à une entière maturité.
C'est là le but que je me propose dans ce traité. En effet, je ne ferais pas grand cas de ces règles, si elles ne servaient qu'à résoudre certains problèmes dont les calculateurs et les géomètres amusent leurs loisirs. Dans ce cas, que ferais-je autre chose que de m'occuper de bagatelles avec plus de subtilité peut-être que d'autres ? Aussi quoique, dans ce traité, je parle souvent de figures et de nombres, parce qu'il n'est aucune science à laquelle on puisse emprunter des exemples plus évidents et plus certains, celui qui suivra attentivement ma pensée verra que je n'embrasse ici rien moins que les mathématiques ordinaires, mais que j'expose une autre méthode, dont elles sont plutôt l'enveloppe que le fond. En effet, elle doit contenir les premiers rudiments de la raison humaine, et aider à faire sortir de tout sujet les vérités qu'il renferme ; et, pour parler librement, je suis convaincu qu'elle est supérieure à tout autre moyen humain de connaître, parce qu'elle est l'origine et la source de toutes les vérités. Or je dis que les mathématiques sont l'enveloppe de cette méthode, non que je veuille la cacher et l'envelopper, pour en éloigner le vulgaire, au contraire, je veux la vêtir et l'orner, de manière qu'elle soit plus à la portée de l'esprit.
Quand j'ai commencé à m'adonner aux mathématiques, j'ai lu la plupart des ouvrages de ceux qui les ont cultivées, et j'ai étudié de préférence l'arithmétique et la géométrie, parce qu'elles étaient, disait-on, les plus simples, et comme la clef de toutes les autres sciences ; mais, je ne rencontrais dans l'une ni l'autre, un auteur qui me satisfit complètement. J'y voyais diverses propositions sur les nombres dont, calcul fait, je reconnaissais la vérité ; quant aux figures, on me mettait, pour ainsi dire, beaucoup de vérités sous les yeux, et on en concluait quelques autres par analogie ; mais on ne me paraissait pas dire assez clairement à l'esprit pourquoi les choses étaient comme on les montrait, et par quels moyens on parvenait à leur découverte. Aussi, je ne m'étonnais plus de ce que des hommes habiles et savants abandonnassent ces sciences, après les avoir à peine effleurées, comme des connaissances puériles et vaines, ou, d'autre part, tremblassent de s'y livrer, comme à des études difficiles et embarrassées. En effet, il n'y a rien de plus vide que de s'occuper de nombres et de figures imaginaires, comme si on voulait s'arrêter à la connaissance de pareilles bagatelles ; et de s'appliquer à ces démonstrations superficielles que le hasard découvre plus souvent que l'art, de s'y appliquer, dis-je, avec tant de soins, qu'on désapprouve, en quelque sorte, de se servir de sa raison ; sans compter qu'il n'y a rien de plus difficile que de dégager, par cette méthode, les difficultés nouvelles qui se présentent pour la première fois, de la confusion des nombres qui les enveloppent. Mais quand, d'autre part, je me demandai pourquoi donc les premiers inventeurs de la philosophie voulaient n'admettre à l'étude de la sagesse que ceux qui avaient étudié les mathématiques, comme si cette science eût été la plus facile de toutes et la plus nécessaire pour préparer et dresser l'esprit à en comprendre de plus élevées, j'ai soupçonné qu'ils reconnaissaient une certaine science mathématique différente de celle de notre âge. Ce n'est pas que je croie qu'ils en eussent une connaissance parfaite : leurs transports insensés et leurs sacrifices pour les plus minces découvertes, prouvent combien ces études étaient alors dans l'enfance. Je ne suis point non plus touché des éloges que prodiguent les historiens à quelques unes de leurs inventions ; car, malgré leur simplicité, on conçoit qu'une multitude ignorante et facile à étonner les ait louées comme des prodiges. Mais je me persuade que certains germes primitifs des vérités que la nature a déposées dans l'intelligence humaine, et que nous étouffons en nous à force de lire et d'entendre tant d'erreurs diverses, avaient, dans cette simple et naïve antiquité, tant de vigueur et de force, que les hommes éclairés de cette lumière de raison qui leur faisait préférer la vertu aux plaisirs, l'honnête à l'utile, encore qu'ils ne sussent pas la raison de cette préférence, s'étaient fait des idées vraies et de la philosophie et des mathématiques, quoiqu'ils ne pussent pas encore pousser ces sciences jusqu'à la perfection. Or, je crois rencontrer quelques traces de ces mathématiques véritables dans Pappus et Diophante, qui, sans être de la plus haute antiquité, vivaient cependant bien des siècles avant nous. Mais je croirais volontiers que les écrivains eux-mêmes en ont, par une ruse coupable, supprimé la connaissance ; semblables à quelques artisans qui cachent leur secret, ils ont craint peut-être que la facilité et la simplicité de leur méthode, en les popularisant, n'en diminuât l'importance, et ils ont mieux aimé se faire admirer en nous laissant, comme produit de leur art, quelques vérités stériles subtilement déduites, que de nous enseigner cet art lui-même, dont la connaissance eût fait cesser toute notre admiration. Enfin quelques hommes d'un grand esprit ont, dans ce siècle, essayé de relever cette méthode ; car elle ne parait autre que ce qu'on appelle du nom barbare d'algèbre, pourvu qu'on la dégage assez de cette multiplicité de chiffres et de ces figures inexplicables qui l'écrasent, pour lui donner cette clarté et cette facilité suprême qui, selon nous, doit se trouver dans les vraies mathématiques. Ces pensées m'ayant détaché de l'étude spéciale de l'arithmétique et de la géométrie, pour m'appeler à la recherche d'une science mathématique en général, je me suis demandé d'abord ce qu'on entendait précisément par ce mot mathématiques, et pourquoi l'arithmétique et la géométrie seulement, et non l'astronomie, la musique, l'optique, la mécanique et tant d'autres sciences, passaient pour en faire partie : car ici il ne suffit pas de connaître l'étymologie du mot. En effet, le mot mathématiques ne signifiant que science, celles que j'ai nommées ont autant de droit que la géométrie à être appelées mathématiques ; et cependant, il n'est personne qui, pour peu qu'il soit entré dans une école, ne puisse distinguer sur-le-champ ce qui se rattache aux mathématiques proprement dites, d'avec ce qui appartient aux autres sciences. Or, en réfléchissant attentivement à ces choses, j'ai découvert que toutes les sciences qui ont pour but la recherche de l'ordre et de la mesure, se rapportent aux mathématiques, qu'il importe peu que ce soit dans les nombres, les figures, les astres, les sons ou tout autre objet qu'on cherche cette mesure, qu'ainsi, il doit y avoir une science générale qui explique tout ce qu'on peut trouver sur l'ordre et la mesure, prises indépendamment de toute application à une matière spéciale, et qu'enfin cette science est appelée d'un nom propre, et depuis longtemps consacré par l'usage, savoir les mathématiques, parce qu'elle contient ce pourquoi les autres sciences sont dites faire partie des mathématiques. Et une preuve qu'elle surpasse de beaucoup les sciences qui en dépendent, en facilité et en importance, c'est que, d'abord, elle embrasse tous les objets auxquels celles-ci s'appliquent, plus un grand nombre d'autres ; et qu'ensuite, si elle contient quelques difficultés, elles existent dans les autres, lesquelles en ont elles-mêmes de spéciales qui naissent de leur objet particulier, et qui n'existent pas pour la science générale. Maintenant, quand tout le monde connaît le nom de cette science, quand on en conçoit l'objet, même sans y penser beaucoup, d'où vient qu'on recherche péniblement la connaissance des autres sciences qui en dépendent, et que personne ne se met en peine de l'étudier elle-même ? Je m'en étonnerais assurément, si je ne savais que tout le monde la regarde comme fort aisée, et si je n'avais remarqué, depuis quelque temps, que toujours l'esprit humain, laissant de côté ce qu'il croit facile, se hâte de courir à des objets nouveaux et plus élevés. Pour moi, qui ai la conscience de ma faiblesse, j'ai résolu d'observer constamment, dans la recherche des connaissances, un tel ordre que, commençant toujours par les plus simples et les plus faciles, je ne fisse jamais un pas en avant pour passer à d'autres, que je ne crusse n'avoir plus rien a désirer sur les premières. C'est pourquoi j'ai cultivé jusqu'à ce jour, autant que je l'ai pu, cette science mathématique universelle, de sorte que je crois pouvoir me livrer à l'avenir à des sciences plus élevées, sans craindre que mes efforts soient prématurés. Mais, avant d'en sortir, je chercherai à rassembler et à mettre en ordre ce que j'ai recueilli de plus digne de remarque dans mes études précédentes, tant pour pouvoir les retrouver au besoin dans ce livre, à l'âge où la mémoire s'affaiblit, que pour en décharger ma mémoire elle-même, et porter dans d'autres études un esprit plus libre.
Règle cinquième
Toute la méthode consiste dans l'ordre et dans la disposition des objets sur lesquels l'esprit doit tourner ses efforts pour arriver à quelques vérités. Pour la suivre, il faut ramener graduellement les propositions embarrassées et obscures à de plus simples, et ensuite partir de l'intuition de ces dernières pour arriver, par les mêmes degrés, à la connaissance des autres.
C'est en ce seul point que consiste la perfection de la méthode, et cette règle doit être gardée par celui qui veut entrer dans la science, aussi fidèlement que le fil de Thésée par celui qui voudrait pénétrer dans le labyrinthe. Mais, beaucoup de gens ou ne réfléchissent pas à ce qu'elle enseigne, ou l'ignorent complètement, ou présument qu'ils n'en ont pas besoin ; et souvent, ils examinent les questions les plus difficiles avec si peu d'ordre, qu'ils ressemblent à celui qui d'un saut, voudrait atteindre le faite d'un édifice élevé, soit en négligeant les degrés qui y conduisent, soit en ne s'apercevant pas qu'ils existent. Ainsi font tous les astrologues, qui, sans connaître la nature des astres, sans même en avoir soigneusement observé les mouvements, espèrent pouvoir en déterminer les effets. Ainsi font beaucoup de gens qui étudient la mécanique sans savoir la physique, et fabriquent au hasard de nouveaux moteurs ; et la plupart des philosophes, qui, négligeant l'expérience, croient que la vérité sortira de leur cerveau comme Minerve du front de Jupiter.
Or, c'est contre cette règle qu'ils pèchent tous ; mais parce que l'ordre qu'on exige ici est assez obscur et assez embarrassé pour que tous ne puissent reconnaître quel il est, il est à craindre qu'en voulant le suivre, on ne s'égare, à moins qu'on n'observe soigneusement ce qui sera exposé dans la règle suivante.
Règle sixième
Pour distinguer les choses les plus simples de celles qui sont enveloppées, et suivre cette recherche avec ordre, il faut, dans chaque série d'objets, où de quelques vérités, nous avons déduit d'autres vérités, reconnaître quelle est la chose la plus simple, et comment toutes les autres s'en éloignent plus ou moins, ou également.
Quoique cette règle ne paraisse apprendre rien de nouveau, elle contient cependant tout le secret de la méthode, et il n'en est pas de plus utile dans tout ce Traité. Elle nous apprend que toutes les choses peuvent se classer en diverses séries, non en tant qu'elles se rapportent à quelque espèce d'être (division qui rentrerait dans les catégories des philosophes), mais en tant qu'elles peuvent être connues l'une par l'autre, en sorte qu'à la rencontre d'une difficulté, nous puissions reconnaître s'il est des choses qu'il soit bien d'examiner les premières, quelles elles sont, et dans quel ordre il faut les examiner. Or, pour le faire convenablement, il faut remarquer d'abord que les choses, pour l'usage qu'en veut faire notre règle, qui ne les considère pas isolément, mais les compare entre elles pour connaître l'une par l'autre, peuvent être appelées ou absolues ou relatives.
J'appelle absolu tout ce qui est l'élément simple et indécomposable de la chose en question, comme, par exemple, tout ce qu'on regarde comme indépendant, cause, simple, universel, un, égal, semblable, droit, etc. ; et je dis que ce qu'il y a de plus simple est ce qu'il y a de plus facile, et ce dont nous devons nous servir pour arriver à la solution des questions.
J'appelle relatif ce qui est de la même nature, ou du moins y tient par un côté par où l'on peut le rattacher à l'absolu, et l'en déduire. Mais ce mot renferme encore certaines autres choses que j'appelle des rapports, tel est tout ce qu'on nomme dépendant, effet, composé, particulier, multiple, inégal, dissemblable, oblique, etc. Ces rapports s'éloignent d'autant plus de l'absolu qu'ils contiennent un plus grand nombre de rapports qui leur sont subordonnés, rapports que notre règle recommande de distinguer les uns des autres, et d'observer, dans leur connexion et leur ordre mutuel, de manière que, passant par tous les degrés, nous puissions arriver successivement à ce qu'il y a de plus absolu. Or tout l'art consiste à chercher toujours ce qu'il y a de plus absolu. En effet, certaines choses sont sous un point de vue plus absolues que sous un autre, et envisagées autrement, elles sont plus relatives. Ainsi l'universel est plus absolu que le particulier, parce que sa nature est plus simple ; mais en même temps il peut être dit plus relatif, parce qu'il faut des individus pour qu'il existe. De même encore certaines choses sont vraiment plus absolues que d'autres, mais ne sont pas les plus absolues de toutes. Si nous envisageons les individus, l'espèce est l'absolu ; si nous regardons le genre, elle est le relatif. Dans les corps mesurables, l'absolu c'est l'étendue ; mais dans l'étendue, c'est la longueur, etc. Enfin, pour mieux faire comprendre que nous considérons ici les choses, non quant à leur nature individuelle, mais quant aux séries dans lesquelles nous les ordonnons pour les connaître l'une par l'autre, c'est à dessein que nous avons mis au nombre des choses absolues la cause et l'égal, quoique de leur nature elles soient relatives ; car, dans le langage des philosophes, cause et effet sont deux termes corrélatifs. Cependant, si nous voulons trouver ce que c'est que l'effet, il faut d'abord connaître la cause, et non pas l'effet avant la cause. Ainsi, les choses égales se correspondent entre elles ; mais pour connaître l'inégal, il faut le comparer à l'égal.
Il faut noter, en second lieu, qu'il y a peu d'éléments simples et indispensables que nous puissions voir en eux-mêmes, indépendamment de tous autres, je ne dis pas seulement de prime abord, mais même par des expériences et à l'aide de la lumière qui est en nous. Aussi je dis qu'il faut les observer avec soin ; car ce sont là ceux que nous avons appelés les plus simples de chaque série. Tous les autres ne peuvent être perçus qu'en les déduisant de ceux-ci, soit immédiatement et prochainement, soit après une ou deux conclusions, ou un plus grand nombre, conclusions dont il faut encore noter le nombre, pour reconnaître si elles sont éloignées par plus ou moins de degrés de la première et de la plus simple proposition ; tel doit être partout l'enchaînement qui peut produire ces séries de questions, auxquelles il faut réduire toute recherche pour pouvoir l'examiner avec méthode. Mais, parce qu'il n'est pas aisé de les rappeler toutes et qu'il faut moins les retenir de mémoire que savoir les reconnaître par une certaine pénétration de l'esprit, il faut former les intelligences à pouvoir les retrouver aussitôt qu'elles en auront besoin. Or, pour y parvenir, j'ai éprouvé que le meilleur moyen était de nous accoutumer à réfléchir avec attention aux moindres choses que nous avons précédemment déterminées.
Notons, en troisième lieu, qu'il ne faut pas commencer notre étude par la recherche des choses difficiles ; mais, avant d'aborder une question, recueillir au hasard et sans choix les premières vérités qui se présentent, voir si de celles-là on peut en déduire d'autres, et de celles-ci d'autres encore, et ainsi de suite. Cela fait, il faut réfléchir attentivement sur les vérités déjà trouvées, et voir avec soin pourquoi nous avons pu découvrir les unes avant les autres, et plus facilement, et reconnaître quelles elles sont. Ainsi, quand nous aborderons une question quelconque, nous saurons par quelle recherche il nous faudra d'abord commencer. Par exemple, je vois que le nombre 6 est le double de 3 ; je chercherai le double de 6, c'est-à-dire 12 ; je chercherai encore le double de celui-ci, c'est-à-dire 24, et de celui-ci ou 48 ; et de là je déduirai, ce qui n'est pas difficile, qu'il y a la même proportion entre 3 et 6 qu'entre 6 et 12, qu'entre 12 et 24, etc.; et qu'ainsi les nombres 3, 6, 12, 24, 48, sont en proportion continue. Quoique toutes ces choses soient si simples qu'elles paraissent presque puériles, elles m'expliquent, lorsque j'y réfléchis attentivement, de quelle manière sont enveloppées toutes les questions relatives aux proportions et aux rapports des choses, et dans quel ordre il faut en chercher la solution, ce qui contient toute la science des mathématiques pures.
D'abord, je remarque que je n'ai pas eu plus de peine à trouver le double de 6 que le double de 3, et que de même, en toutes choses, ayant trouvé le rapport entre deux grandeurs quelconques, je peux en trouver un grand nombre d'autres qui sont entre elles dans le même rapport ; que la nature de la difficulté ne change pas, que l'on cherche trois ou quatre, ou un plus grand nombre de ces propositions, parce qu'il faut les trouver chacune à part, et indépendamment les unes des autres. Je remarque ensuite, qu'encore bien qu'étant données les grandeurs 3 et 6, j'en trouve facilement une troisième en proportion continue ; il ne m'est pas si facile, étant donnés les deux extrêmes 3 et 12, de trouver la moyenne 6. Cela m'apprend qu'il y a ici un autre genre de difficulté toute différente de la première ; car, si on veut trouver la moyenne proportionnelle, il faut penser en même temps aux deux extrêmes et au rapport qui est entre eux, pour en tirer un nouveau par la division ; ce qui est tout différent de ce qu'il faut faire, lorsqu'étant données deux quantités, on veut en trouver une troisième qui soit avec elles en proportion continue. Je poursuis, et j'examine si, étant données les grandeurs 3 et 24, les deux moyennes proportionnelles auraient pu être trouvées aussi facilement l'une que l'autre. Et ici je rencontre un autre genre de difficulté plus embarrassante que les précédentes ; car il ne faut pas penser seulement à un ou deux nombres à la fois, mais à trois, afin d'en découvrir un quatrième. On peut aller plus loin, et voir si, étant donnés 3 et 48, il serait encore plus difficile de trouver une des trois moyennes proportionnelles 6, 12, 24 ; ce qui paraitra au premier coup d'œil ; mais on voit aussitôt que la difficulté peut se diviser, et ainsi se simplifier, si l'on cherche d'abord une seule moyenne entre 3 et 48, savoir 24 ; une autre entre 3 et 12, savoir 6 ; puis une autre entre 12 et 48, savoir 24 ; et qu'ainsi on est ramené à la seconde difficulté déjà exposée. De tout ce qui précède, je remarque comment on peut arriver à la connaissance d'une même chose par deux voies diverses, dont l'une est plus difficile et plus obscure que l'autre. Par exemple, pour trouver ces quatre nombres en proportion continue, 3, 6, 12, 24, si on donne les deux conséquents 3 et 6, ou bien 6 et 12, 12 et 24, rien ne sera plus facile que de trouver les autres nombres à l'aide de ceux-là. Dans ce cas, je dis que la difficulté à résoudre est examinée directement. Si on prend deux termes alternativement, 3 et 12, 6 et 24, pour trouver les autres, je dis que la difficulté est examinée indirectement de la première manière. Si on prend les deux extrêmes, 3 et 24, pour trouver les moyens 6 et 12, je dis que la difficulté est examinée indirectement de la seconde manière. Je pourrais poursuivre ces remarques plus loin, et tirer de ce seul exemple beaucoup d'autres conséquences ; mais cela suffit pour montrer au lecteur ce que j'entends, quand je dis qu'une proposition est déduite directement ou indirectement, et pour lui apprendre que les choses les plus faciles et les plus élémentaires, bien connues, peuvent même dans les autres études fournir à l'homme qui met de l'attention et de la sagacité dans ses recherches, un grand nombre de découvertes.
Règle septième
Pour compléter la science il faut que la pensée parcoure, d'un mouvement non interrompu et suivi, tous les objets qui appartiennent au but qu'elle veut atteindre, et qu'ensuite, elle les résume dans une énumération méthodique et suffisante.
L'observation de la règle ici proposée est nécessaire pour qu'on puisse placer au nombre des choses certaines ces vérités qui, comme nous l'avons dit plus haut, ne dérivent pas immédiatement de principes évidents par eux-mêmes. On y arrive en effet par une si longue suite de conséquences, qu'il n'est pas facile de se rappeler tout le chemin qu'on a fait. Aussi disons-nous qu'il faut suppléer à la faculté de la mémoire par un exercice continuel de la pensée. Si, par exemple, après diverses opérations, je trouve quel est le rapport entre les grandeurs A et B, ensuite entre B et C, puis entre C et D, enfin entre D et E, je ne vois pas pour cela le rapport des grandeurs A et E, et je ne puis le conclure avec précision des rapports connus, si ma mémoire ne me les représente tous. Aussi j'en parcourrai la suite de manière que l'imagination à la fois en voie une et passe à une autre, jusqu'à ce que je puisse aller de la première à la dernière avec une telle rapidité que, presque sans le secours de la mémoire, je saisisse l'ensemble d'un coup d'œil. Cette méthode, tout en soulageant la mémoire, corrige la lenteur de l'esprit et lui donne de l'étendue.
J'ajoute que la marche de l'esprit ne doit pas être interrompue ; souvent, en effet, ceux qui cherchent à tirer de principes éloignés des conclusions trop rapides, ne peuvent pas suivre avec tant de soin la chaîne des déductions intermédiaires qu'il ne leur en échappe quelqu'une. Et cependant, dès qu'une conséquence, fût-elle la moins importante de toutes, a été oubliée, la chaîne est rompue, et la certitude de la conclusion ébranlée.
Je dis de plus que la science a besoin pour être complète de l'énumération. En effet, les autres préceptes servent à résoudre une infinité de problèmes ; mais l'énumération seule peut nous rendre capables de porter sur l'objet quelconque auquel nous nous appliquons un jugement sur et fondé, conséquemment de ne laisser absolument rien échapper, et d'avoir sur toutes choses des lumières certaines.
Or, ici l'énumération, ou l'induction, est la recherche attentive et exacte de tout ce qui a rapport à la question proposée. Mais cette recherche doit être telle que nous puissions conclure avec certitude que nous n'avons rien omis à tort. Quand donc nous l'aurons employée, si la question n'est pas éclaircie, au moins serons-nous plus savants, en ce que nous saurons qu'on ne peut arriver à la solution par aucune des voies à nous connues ; et si, par aventure, ce qui a lieu assez souvent, nous avons pu parcourir toutes les routes ouvertes à l'homme pour arriver à la vérité, nous pourrons affirmer avec assurance que la solution dépasse la portée de l'intelligence humaine.
Il faut remarquer en outre que, par énumération suffisante ou induction, nous entendons ce moyen qui nous conduit à la vérité plus sûrement que tout autre, excepté l'intuition pure et simple. En effet, si la chose est telle que nous ne puissions la ramener à l'intuition, ce n'est pas dans des formes syllogistiques, mais dans l'induction seule que nous devons mettre notre confiance. Car toutes les fois que nous avons déduit des propositions immédiatement l'une de l'autre, si la déduction a été évidente, elles seront ramenées à une véritable intuition. Mais si nous déduisons une proposition d'autres propositions nombreuses, disjointes et multiples, souvent la capacité de notre intelligence n'est pas telle, qu'elle puisse en embrasser l'ensemble d'une seule vue : dans ce cas, la certitude de l'induction doit nous suffire. C'est ainsi que, sans pouvoir d'une seule vue distinguer tous les anneaux d'une longue chaîne, si cependant nous avons vu l'enchaînement de ces anneaux entre eux, cela nous permettra de dire comment le premier est joint au dernier.
J'ai dit que cette opération devait être suffisante, car souvent elle peut être défectueuse, et ainsi sujette à l'erreur. Quelquefois, en effet, en parcourant une suite de propositions de la plus grande évidence, si nous venons à en oublier une seule, fût-ce la moins importante, la chaîne est rompue, notre conclusion perd toute sa certitude. D'autres fois, nous n'oublions rien dans notre énumération, mais nous ne distinguons pas nos propositions l'une de l'autre, et nous n'avons du tout qu'une connaissance confuse.
Or quelquefois cette énumération doit être complète, d'autres fois distincte, quelquefois elle ne doit avoir aucun de ces deux caractères, aussi ai-je dit qu'elle doit être suffisante. En effet, si je veux prouver par énumération combien il y a d'êtres corporels, ou qui tombent sous les sens, je ne dirai pas qu'il y en a un tel nombre, ni plus ou moins, avant de savoir avec certitude que je les ai rapportés tous et distingués les uns des autres. Mais si je veux, par le même moyen, prouver que l'âme rationnelle n'est pas corporelle, il ne sera pas nécessaire que l'énumération soit complète ; mais il suffira que je rassemble tous les corps sous quelques classes, pour prouver que l'âme ne peut se rapporter à aucune d'elles. Si enfin je veux montrer par énumération que la surface d'un cercle est plus grande que la surface de toutes les figures dont le périmètre est égal, je ne passerai pas en revue toutes les figures, mais je me contenterai de faire la preuve de ce que j'avance sur quelques figures, et de le conclure par induction pour toutes les autres.