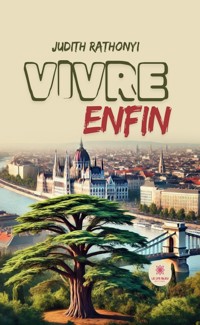
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Une jeune fille hongroise, éprouvée par la vie et les déchirements familiaux, revisite son passé. À travers ses souvenirs, d’abord enfantins, puis adultes, elle raconte la petite histoire de sa famille, de sa ville et de son pays. Elle observe avec espoir le réveil de sa nation sous la chape de plomb soviétique, relatant des jours sombres, gris et parfois heureux. Sa rencontre avec un homme va transformer sa vie, lui permettant de s’épanouir en tant que femme libre. Découvrez ce récit poignant et laissez-vous emporter par une histoire de résilience et de renaissance.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Née à Budapest, en Hongrie,
Judith Rathonyi prend la plume pour peindre ce qu’a été son existence au fil des années. Vivre enfin est sa première œuvre publiée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judith Rathonyi
Vivre enfin
© Lys Bleu Éditions – Judith Rathonyi
ISBN : 979-10-422-3958-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À la mémoire d’Alain
À mes fils : Patrick et Stéphane,
À ma petite sœur, Katalin Gillemot,
Et à ma correctrice, Lola Sorrenti, auteure et écrivaine.
Sans leur encouragement affectueux,
Ce récit n’aurait pas existé
Préface
L’écriture est solitaire. Et pourtant l’écriture est une rencontre.
Il est de ces rencontres d’écriture qui façonnent et pour cela nul besoin d’être au début, au milieu ou à la fin de sa vie.
La rencontre est toujours une surprise. Elle ne s’annonce pas. C’est pour cela qu’elle marque. Les mots qui l’ont fait advenir restent. Une grappe de syllabes, une sensation, le frappement des mots dans la phrase. Une rencontre. Presque rien en somme. Comme une ride à la surface de l’eau, une preuve discrète que le temps n’est pas immobile.
Une rencontre subtile et impatiente autour de l’écriture. Judith Rathonyi est l’une d’elles.
Un jour, cette femme élégante, qui avait déjà vécu bien plus d’aventures que je ne connaissais encore, m’a conté, avec ses mots, sa Hongrie. Le doux-amer de son enfance.
La langue adorée et les premiers vers sur le papier.
La frustration aussi de n’avoir pu embrasser pleinement sa trajectoire d’écrivaine jusqu’à aujourd’hui, devant vous. Alors c’est un honneur, de pouvoir préparer la page avant de la tourner et de lire Vivre enfin.
Albert Camus disait : « Créer, c’est vivre deux fois ».
À toutes les époques, vivre effraie. À toutes les époques, l’écriture peut sauver.
L’écriture dit le monde depuis un regard, une perception. De ces faisceaux-là, la littérature est puissante.
L’écriture lie les êtres et les mondes. L’écriture les fait dialoguer.
L’écriture est le chemin, inlassablement, à dénouer.
L’écriture peut pardonner.
Judith Rathonyi n’a eu peur ni de vivre ni de créer. Devant vous, elle écrit et elle vit. Enfin.
Lola Sorrenti
Avant-propos
D’aussi loin que je me souvienne, mes rimes venaient en marchant dans la rue. Plongée profondément dans mes pensées, je réalisai que mes pas les rythmaient jusqu’à former des vers puis des strophes avec une mélodie jamais entendue. À la minute où je franchis la porte de la petite garçonnière partagée avec mon père, je m’assis près de ma machine à écrire portative et mes mots commencèrent à vivre leur vie en autonomie. J’avais une bonne dizaine de poèmes. Tous parlaient de qui j’étais et de ce que je voulais devenir.
Je voulais écrire depuis ma plus tendre enfance. Je ne savais pas si je pourrai donner à la littérature autant qu’elle m’avait donnée, mais j’aimais la facilité avec laquelle les mots embellissaient mon existence.
Mon père, un journaliste renommé, n’avait que faire de la littérature. Sa réputation était fondée sur des articles écrits dans les magazines, tantôt à sensation, tantôt de nouvelles fraîches. Il amusait ses amis par des anecdotes souvent entendues, jamais renouvelées, qu’il recueillait dans les anciens journaux d’avant-guerre, et gardait précieusement. Je n’arrivais à lire aucun de ses articles, son style ampoulé me rebutait.
Il n’y avait que mes meilleures amies qui me réclamèrent d’autres poèmes. Je leur écrivis des acrostiches pour leurs anniversaires. À côté de mes sonnets mélancoliques, je prenais le temps de leur faire aussi des traductions de Victor Hugo, de Sully Prudhomme. Même pendant mon travail au bureau, lorsque je n’avais pas un contrat à taper à la machine, je tapais l’une de mes nouvelles.
Un jour en prenant le café après le travail, ma meilleure amie me dit qu’elle avait parlé de moi à l’un de nos poètes et traducteurs nationaux, le fils d’Áprily Lajos. Il s’appelait Jékely Zoltán, il m’attendait chez lui avec mes écrits. Il suffisait de lui téléphoner pour fixer un rendez-vous. Je ne voulus pas croire que je puisse montrer ces poèmes, que je ne trouvais plus assez bien. J’étais pleine d’appréhension et de fierté aussi lorsqu’il m’ouvrit sa porte. Nous bavardâmes surtout de ma vie, de mes désirs d’écrire, en un mot, il fut curieux de mes attentes. Je lui laissai le dossier contenant des dizaines et des dizaines de feuilles écrites à la machine, ou manuscrites. Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait vraiment le cœur de les lire. Puis un jour il me fixa encore un rendez-vous chez lui. En me tendant le dossier, il me dit :
Je sortis de chez lui dans un état second. J’étais comblée, car ce n’était pas un avis d’ami affectueux, mais un critique fiable. Je ne pensai pas avoir de ses nouvelles de sitôt. Cependant il prit la peine de téléphoner à mon père, et l’exhorta à m’ouvrir une voie littéraire.
La réponse de mon père, telle qu’on me l’avait rapporté, fut sans équivoque :
Venir au monde
Je suis née pendant la Seconde Guerre mondiale en Hongrie. Mes souvenirs de cette époque sont ceux qu’on m’a rapportés. J’ai des souvenirs qui ne sont peut-être pas les miens, mais je les ai absorbés comme tels. Je ne me souviens pas de notre appartement qui, selon ma mère, fut touché par un éclat d’obus à Noël 1944 tandis que nous étions dans l’abri avec les voisins. L’appartement vola en éclats, il ne resta qu’un coin avec l’arbre de Noël, décoré. Miracle ! Quant à mon nain « Joyeux » du conte de Walt Disney, lui, il fut éjecté sur le trottoir, intact. Mon père me le ramena aussitôt. On m’avait raconté que Maman et Papa n’ont rien emporté dans leurs valises que des haricots secs et des cigarettes, et pas de nourriture pour bébé, et que ce sont des voisins qui collectèrent pour moi de quoi manger. Je ne me souviens pas de l’intrusion des soldats soviétiques, qui menacèrent ma mère avec leurs mitrailleuses pour la faire sortir, et ce fut une femme militaire russe gradée cachée par ma mère, qui les fit s’enfuir. On m’avait raconté que lors de notre sortie pour prendre l’air, un soldat m’avait offert une assiettée de friandises, que je jetai par terre. Les combats de rue cessèrent, et ce fut la fin de la guerre, nous sortîmes comme des taupes de nos souterrains, nous découvrîmes nos appartements démolis. Le pays était en ruine, et sa capitale était la plus touchée. Bombardée par les Allemands, les Anglais et les Russes, les immeubles édentés, aveugles et muets assistaient indifférents aux gens qui en émergeaient. Mon père m’en avait parlé tellement souvent que je voyais la scène vraiment. Un jour de l’été 1945, une des plus anciennes pâtisseries ouvrit sur la place Vörösmarty. Elle demeurait toujours la plus réputée, et la plus élégante. Étonnamment à part quelques lustres tombés par terre et le présentoir du comptoir qui eut la vitre brisée, la cuisine n’avait pas souffert. Mon père nous y emmena, mes cousins et moi, en voiture. Je croyais encore entendre claquer régulièrement les sabots d’un cheval que nous dépassions sur les chaussées défoncées. Je sentais la fine poussière qui se levait sous ses pas pour déposer une couche sur ma langue. C’était merveilleux de rouler dans la voiture de Papa, une Ford-T, qu’un courant d’air parcourait par les vitres ouvertes. À la pâtisserie, mes cousins assaillirent le comptoir, en regardant, bouche bée, les quelques gâteaux préparés avec un ersatz de margarine et des œufs en poudre, mais baignés dans la crème fouettée. Tandis qu’ils s’empiffraient de ces tartelettes succulentes, moi, assise dans mon coin, mon regard s’évadait vers l’autre côté de la place où une boucherie chevaline était en train d’ouvrir. Dans sa vitrine, comme des colliers, étaient suspendus des saucissons de cheval, rouge de paprika, mais plus encore de honte d’oser rivaliser avec les merveilles de la pâtisserie. Mon père me demanda pourquoi je ne me choisissais pas un gâteau comme mes cousins ? Je répondis que je voulais bien un morceau de ce saucisson de cheval, là-bas.
Réminiscence
Elle s’appelait Elsa. Elle était pour moi ce qu’on appelait couramment en Hongrie ma « mademoiselle ». Dans les familles bourgeoises, il fallait engager une mademoiselle pour apprendre une langue aux enfants.
Nous marchions main dans la main, Elsa ma « mademoiselle » et moi, sur la longue artère qui longeait les rails tordus et défoncés. Elle devait me parler en français. Je revois la scène comme par une loupe grossissante, avec une telle netteté, que l’on pourrait penser : c’était hier. J’avais quatre ans et nous étions en route vers le square, le seul endroit qui était à peu près intact. Pourtant nous faisions un détour par la place Móricz Zsigmond, où elle avait rendez-vous avec son amoureux. J’adorais cet endroit, car au milieu trônait la statue du prince Saint Emeric de Hongrie, dont la beauté me fait penser au prince charmant de Blanche Neige. Je suppose que j’étais déjà amoureuse à ma façon, infantile. Je collai mon visage au marbre lisse du monument et je ressentis immédiatement un bien-être profond. La nuit aussi je pliai mon petit oreiller pour avoir toujours un coin frais sous ma joue, cela me rappelait la fraîcheur du marbre, ainsi je pouvais rêver que le prince était à côté de moi et mon sommeil devenait agréable. J’avais gardé cette habitude, aussi il me fut impossible de dormir serrée contre un corps chaud, même en plein hiver je cherchais un point de fraîcheur.
Nous marchions vers le square, le copain d’Elsa nous accompagnait. J’étais vêtue d’une petite robe à volants qui n’était pas très conseillée en ces temps d’après-guerre, les enfants portaient plutôt des haillons, mais ma mère aimait m’habiller en poupée. Pour elle je devais être digne d’aller dans un salon de thé. À mon cou une petite croix avec un rubis incrusté au milieu. Comme c’est drôle que cela me revienne tout d’un coup, alors que je n’avais même pas le souvenir de posséder ce bijou. Je crus voir la pierre qui jetait des reflets profonds, rouge sang, et la croix battait contre mon cou tandis que je m’élançai vers le bac à sable.
Elsa m’appela et je dus chanter pour son ami « Frère Jacques » puis « Ainsi font, font, font » et satisfaite elle m’envoya jouer avec les autres enfants. Nous nous bombardions avec les petites boules de la haie qui encadraient le square. L’éclatement de ces boules nous amusait, elles faisaient « splash » en atterrissant sur nous. Tout d’un coup, Elsa me dit de revenir et décrocha ma chaînette pour la garder dans son cabas, elle craignait que je la perde dans le bac à sable, mais je la vis en train de la montrer à son amoureux.
Le soir arriva vite, et nous rentrions dans la maigre lumière du crépuscule. À la maison elle me prépara le bain et elle m’habilla en pyjama pour le dîner que je prenais seule, comme d’habitude. Ma mère rentra un peu plus tard et elle me questionna sur mon après-midi. Je savais que je ne devais pas parler de notre détour par la place Móricz Zsigmond ni de l’amoureux d’Elsa, parce que ma mère lui avait interdit de m’y amener à cause des cratères des bombes et des obus non explosés. Puis elle chercha la chaînette autour de mon cou. Je lui dis que c’était Elsa qui l’avait, elle l’avait rangé dans son sac. Ma mère la lui demanda, puis se fâcha, car elle ne l’avait plus et Elsa m’accusa de l’avoir perdue, car j’étais désobéissante et menteuse. Je fus donc punie, et je dus aller dans ma chambre sans bisous et sans un conte de fées pour m’endormir. Je me couchai en serrant contre moi mon grand nain Joyeux, un cadeau de Noël, qui faisait deux fois ma taille, et j’avais le sentiment que je ne connaissais pas jusqu’alors, d’une injustice. Je voyais Elsa pour la dernière fois.
Elsa partit définitivement, ce fut mon père qui prit sa place dans la chambre de bonne. À compter de ce jour, c’était une cousine de mon père qui venait chaque jour s’occuper de moi. Tante Mitzi faisait très bien la cuisine, mais elle n’aimait pas jouer avec les enfants, aussi j’étais condamnée à rester dans ma chambre. Le soir, quand mon père rentrait, nous nous amusions beaucoup. Il m’inventait des histoires rigolotes, comme la famille à la bouche tordue. À la lumière des bougies, car il y avait souvent des coupures d’électricité, il me racontait :
Mon père jouait tous les rôles et je riais aux éclats, ce qui faisait venir ma mère. C’était le signal de la fin des réjouissances, je devais quitter mon père, pour aller au lit. Je me réveillai et je les entendais crier et s’insulter. Là, je sortis de mon lit pour m’accroupir au fond d’un fauteuil au milieu du salon, mais ma présence ne faisait que jeter de l’huile sur le feu, ils me prenaient dans les bras en m’arrachant à tour de rôle, en s’invectivant, et moi, comme une plume je ne pouvais guère empêcher qu’ils en viennent aux mains.
L’ambiance était tellement tendue, que je ne sortis plus de ma chambre. Ma chambre, je la voyais encore, meublée de chaises, d’une table ainsi qu’une armoire, un lit et une commode bleu foncé avec des médaillons peints de tulipes jaunes et rouges au milieu de chaque porte et des tiroirs, et sur chacun des dossiers des chaises. Mes poupées étaient adossées au mur sur mon lit et je jouais et rejouais l’histoire de « Blanche Neige » en attendant que mon prince charmant vienne me délivrer. J’associais ma tante Mitzi à la méchante sorcière et je me sentais de plus en plus seule. Fini les promenades et le square, maman s’absentait très souvent et le soir les discussions recommencèrent à voix feutrées surtout en allemand, pour que je ne comprenne pas, mais dès que j’entendais « nicht for dem kind »1, je savais qu’une chose grave se préparait, et je me faisais toute petite dans mon coin. Pendant l’après-midi mon père travaillait dans sa chambre de bonne, il écrivait des histoires pour la radio, et moi, j’étais obligée de faire la sieste. Pourtant cette fois, tout habillée je sortis sur la pointe des pieds et je partis. Il faisait froid dehors, mais je me disais que j’étais de trop, j’embêtais tout le monde, et en plus je devais être vraiment une méchante fille si mes parents se disputaient à cause de moi. Je descendis par l’escalier, j’ouvris le portail qui menait à la rue et je marchai sans but, peut-être vers le square où j’avais passé des moments pleins de jeux et de rires. La rue était presque vide, il n’y avait que des ouvriers qui travaillaient sur la ligne du tramway, personne ne me posa des questions : où allais-je ? Prenant une direction qui m’éloignait de ma maison, d’une fenêtre j’entendis des rires et des cris d’enfants. Je levai la tête vers la fenêtre entrebâillée et j’attendis qu’ils m’aperçoivent. « Je peux venir jouer ? » leur demandai-je. « Mais oui, monte », crièrent-ils ensemble. Leur maman devait me connaître, car elle ne me demanda pas qui j’étais et elle me tendit une tartine de confiture. Nous jouions, jusqu’à en oublier que le soir tombait, mais je n’étais pas pressée de m’en aller. Un moment pourtant j’entendis notre signal sifflé, notre signal de reconnaissance, dans la rue, c’était encore une idée de mon père. À contrecœur, je pris congé de mes nouveaux amis et je rejoignis mon père qui arpentait les rues à ma recherche. Je craignis une fessée, mais rien ne vint. Il serra les dents et me ramena à la maison où ma mère nous attendait et dans sa main la cuillère en bois ne me disait rien de bon. Je fus donc condamnée à rester dans ma chambre, après une bonne raclée.
Quelquefois, tante Mitzi me prenait par la main et m’amenait en ville. Les tramways roulaient de nouveau, remplis de gens hagards et mal vêtus. Là, j’appris encore que je ne devais pas parler des choses que j’entendais à la maison, car voyant les hommes assis et nous debout, je disais à haute voix : « pourquoi tous ces sales gens ne me laissent pas m’asseoir ? » Tante Mitzi me tapa sur la bouche, et nous descendîmes au plus vite du tramway. Maman travaillait dans un petit cabaret, elle avait des répétitions pour un spectacle où elle dansait avec sa sœur, Tante Ica sur une musique que plus tard je reconnaissais : le Boléro de Ravel. Mon cœur battait au rythme de la musique, tam, tam, tam, tata tam ! Pendant qu’elles dansaient, une jeune femme m’offrait mon plat préféré, une assiettée de lentilles.
Bientôt c’était Noël. J’attendais avec impatience, car ce jour-là mon père m’amenait faire une promenade, pour admirer les rares vitrines déjà illuminées, et sentir la neige fraîchement tombée toute blanche craquer sous nos pas. Dès que nous rentrâmes, le salon s’illumina, des bougies éclairèrent l’arbre magnifique, et en dessous il s’y trouvait un superbe château fort, et surtout le prince charmant sur son cheval blanc ! Malheureusement mon père ne resta pas avec nous pour le dîner, ce qui assombrit un peu ma joie.
Les jours passèrent et de plus en plus souvent ma cousine Georgica venait l’après-midi pour jouer avec moi, car ma tante, la sœur de maman avait trouvé du travail. J’avais moins d’occasions d’entendre mes parents se disputer, d’autant plus que mon père s’était installé chez son frère, le « communiste » comme disait ma mère, mais psitt ! encore une de ces choses, qu’il ne fallait pas répéter. C’était la pire insulte que maman avait pu trouver pour vexer mon père, qui n’était pas du tout communiste.
Quelquefois, quand ma tante venait pour chercher Georgica, je l’entendais parler d’un pays, où elle partirait bientôt. Ma mère espérait aussi partir vers ce pays, où les oranges poussent sur l’arbre, et où il faisait toujours chaud même en hiver. Elle disait à mon père, qu’elle en avait assez de rester ici, là-bas elle avait des amis qui l’hébergeraient. De tout mon cœur, je voulais moi aussi connaître ce pays de conte de fées, mais personne ne me demanda mon avis. Je n’étais qu’un objet de chantage. Mon père se déchaîna et cria : « tu ne partiras pas avec mon enfant ! J’ai le droit de la voir quand je veux ! Tu peux partir, mais seule, elle reste avec moi ! » J’étais partagée entre l’envie de partir et celle de rester, d’autant plus qu’il inventait à ce moment-là pour moi de merveilleuses histoires : comment un pauvre homme était devenu riche grâce à sa puce, qu’il entraînait pour faire des acrobaties, ou encore l’homme invisible qui veillait sur sa petite fille ? Je nous voyais marcher main dans la main, et il me racontait comment cet homme était devenu invisible à cause de la malédiction d’une méchante sorcière, mais cela lui donnait le pouvoir d’accompagner son enfant partout. J’aimais bien cette histoire, il me fallait aussi un père invisible, qui soit tout le temps à mes côtés. Maman racontait à ma tante ces scènes en chuchotant, pour que je n’entende pas, mais je compris que mon père ne la laissait pas établir son passeport si ce n’était sans moi. Elle ne voulait pas partir en me laissant à mon père, et cela la mettait dans tous ses états.
Ces souvenirs sont gravés en moi. Je me souviens quand ma Tante Ica et ma cousine Georgica fuirent la Hongrie, en laissant ma mère seule avec moi.
Les souvenirs sont comme les champs fraîchement labourés, dont la charrue fait affleurer des racines jamais vues. Je les accrochais sur la pointe de ma plume au fur et à mesure qu’ils me parvenaient.
Balbutiements
Lorsque Maman m’emmena dans le lieu où elle dansait, je la regardai et je décidai aussitôt que je serai danseuse moi aussi. Puis nous allâmes dans un petit restaurant où l’on me servit une assiettée de lentilles. Maman, elle ne mangea pas, mais elle fuma et but du café. Quand nous rentrâmes, elle se coucha dans sa chambre et Tante Miczi m’ordonna de rester sage et de jouer toute seule. Alors je me blottis contre mon nain, le « Joyeux » de Blanche Neige, en mousse. Il était plus grand que moi, doux et je pouvais lui raconter tout, car il m’écoutait, lui. Lorsque Maman n’était pas à la maison, j’écoutais la radio, souvent je réussissais à entendre des contes ou bien les chansons de « Jean le Preux », mon personnage préféré. Ce conte pour enfants avait été écrit par notre poète national Petöfi Sándor. Jean, le héros, traversait mille aventures pour retrouver sa bien-aimée. Kacsóh Pongrác mit les vers en musique dont je connaissais tous les airs par cœur.
Un jour nous partîmes. Je n’avais plus mes jolis meubles bleus avec de grandes tulipes peintes sur les tiroirs, je n’avais plus le château enchanté avec mes poupées : le prince et Blanche Neige, il ne me resta que le Joyeux, que je pris contre moi dans la grande voiture qui portait nos affaires. L’appartement où nous arrivâmes n’avait qu’une grande chambre et une petite cuisine. Dans un grand lit, contre le mur, nous dormions Maman et moi ensemble. Tante Miczi était encore avec nous. Quand Maman n’était pas là, Tante Miczi cuisinait ou allait faire les courses, ou encore elle bavardait avec les voisines en m’enfermant dans la chambre. Il ne me restait qu’à regarder par la fenêtre, et à saluer les passants. J’inventais beaucoup d’histoires, que je racontais quelquefois à Maman, mais elle ne m’écoutait pas ou à peine, elle était toujours fatiguée. Pourtant de temps à autre elle était gaie, elle jouait avec moi, et elle avait des idées bizarres comme lancer une assiette plate comme un chapeau de paille façon boomerang, attendant qu’elle revienne. Naturellement l’assiette se cognait contre la porte où elle se cassait en miettes. Nous riions aux éclats pendant que Tante Miczi nous regardait avec un air de reproche : « il n’en reste que quatre », disait-elle.
Puis, nous déménageâmes encore. Cette fois ce fut pour une ville poussiéreuse où une petite maison nous attendait avec un jardin. Nous n’étions pas seules. Dans un petit appentis, il y avait déjà une famille avec deux petits garçons. J’étais contente qu’il y eût quelqu’un avec qui je puisse jouer. Et Maman m’annonça une grande nouvelle : dans un mois j’allais aller à l’école. Maman m’acheta un joli cartable, un porte-plume dont le couvercle était coulissant, des crayons de couleur que j’essayai aussitôt sur le cahier. Tante Miczi me cria dessus, car le cahier était pour l’école et Maman se fâcha, elle prît mon « Joyeux » et le donna à un chiffonnier qui passait devant la maison pour me punir. Je pleurai, inconsolable ; après mon père maintenant mon nain disparaissait aussi.
J’allais à l’école seule, ce n’était pas loin à pied. Je me réjouissais de rencontrer d’autres enfants, mais j’étais plutôt timide, et surtout je ne comprenais pas pourquoi ils m’évitaient. Il était vrai que j’avais de jolies chaussures vernies et des rubans dans mes tresses alors qu’eux, pour la plupart, ne portaient que des sandales sur leurs pieds nus et ils n’étaient pas bien coiffés. J’allais aussi au catéchisme avec le petit garçon d’à côté. Il était plus jeune que moi, et je me sentais fière de le prendre par la main pour traverser la rue jusqu’au presbytère. Là, le père Pierre nous faisait réciter les dix commandements, et j’apprenais que je vivais dans le péché, car je n’allais pas à l’église chaque dimanche. Aussi, je demandai Maman de m’y accompagner, mais le dimanche, dit-elle, elle se reposait. Tante Miczi me regarda de travers, elle n’avait pas du tout envie d’aller à l’Église, elle non plus. Je me consolai donc avec mes livres de contes que je savais déjà par cœur, et j’appris à lire en déchiffrant les mots que je reconnaissais.
L’éveil
Noël approchait. D’habitude c’était mon père qui m’emmenait regarder les vitrines, mais Papa n’était pas là, et Maman m’envoya jouer chez les voisins. Lorsque je rentrai, je vis l’arbre de Noël tout scintillant, je m’approchai voir mes cadeaux, quand on frappa à la porte. C’était le père Noël, il m’apporta un bonnet rouge à pompon plein de marrons grillés. Ce fut tellement bon et tellement chaud, que ce ne fut qu’après y avoir goûté que je levai mes yeux vers le père Noël, et malgré la grosse moustache et la longue barbe, je reconnus mon père. Pour une fois nous passions une soirée en famille, mais mon père s’en alla, en m’assurant que bientôt je le reverrai avec une dame qui serait ma deuxième maman, elle s’appelait Thérèse. Moi, je ne voulais pas d’elle comme maman, j’en avais déjà une et je n’en voulais pas d’une autre.
Un soir, Maman ne rentra pas à la maison. Je l’attendis, anxieuse, seule dans mon lit. Le temps passait et elle n’était toujours pas là ! Je commençai à hurler à m’en déchirer les cordes vocales : je veux ma maman ! Cela n’était pas la peur, mais la crainte de l’abandon. Je hurlai de toutes mes forces : « reviens maman, je serai sage, reviens ! » La dame de la petite maison d’à côté accourut, me prit dans les bras, je me débattis, finalement avec l’aide de son mari elle réussit à m’immobiliser et à me transporter chez elle. Je terminai ma nuit dans le lit d’un des petits garçons.
Le matin Tante Miczi vint me chercher, et me gronda : « qu’est-ce que c’est que ce cirque ? Tu n’as pas honte de réveiller tout le monde ? » me dit-elle en me raccompagnant chez nous. Maman était rentrée, elle dormait, et il ne fallait pas faire de bruit. Je pris ma tartine et mon verre de lait en silence, puis j’allai à l’école.
Après ma première communion, où mon père vint en prenant des photos de moi pour les montrer à Thérèse, nous déménagions encore. Nous nous installâmes à Budapest, l’immeuble n’était pas loin du Danube, moi, je dormais sur un matelas au coin de la chambre. Maman avait un lit, et au milieu de la pièce nous avions deux fauteuils et une petite table basse. De mon lit, par la grande baie vitrée, je voyais l’immeuble d’en face et le tramway jaune qui sonnait au virage pour avertir les gens qui traversaient les rails. Les fenêtres d’en face étaient encore bâchées, là où le soir il n’y avait pas de lumière. Beaucoup de monde trouvait des logements dans des magasins vides, ou des caves. On aurait dit des fantômes lorsqu’ils émergèrent à la lumière du jour. Ils me faisaient peur, habillés souvent de haillons, quelquefois ils étaient sales et sentaient la boisson. J’avais peur aussi pour Maman, quand elle partait travailler, seule, et bien habillée. Nous mangions dans la cuisine dont la fenêtre donnait sur un terrain vague où jouait un garçon. Il était blond et il souriait en me voyant, et moi de même. Il était le fils de la concierge, je pouvais jouer avec lui après l’école. À cette époque, Maman travaillait pour la municipalité, dans la cave d’une maison encore en ruine. Elle collectait du métal et des objets que les gens lui vendaient, pour quelques fillérs2. La collecte de métaux de toutes sortes avait été décidée par le gouvernement afin de soutenir l’industrie. Elle collectait aussi des livres qu’elle me ramenait. C’étaient des livres, pour la plupart interdits par les autorités, mais je les lisais avidement, car ils me faisaient oublier la monotonie de notre quotidien. J’allais à pied l’école qui était un peu loin, il fallait traverser les rails du tramway, puis contourner la grande place. La première fois Tante Miczi m’accompagna, pour que je ne me perde pas, puis j’y allais toute seule. Je n’aimais pas trop ma maîtresse, elle était sévère, vieille et moche.





























