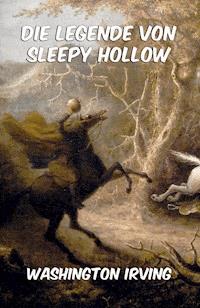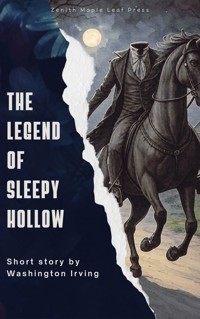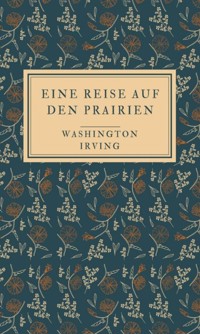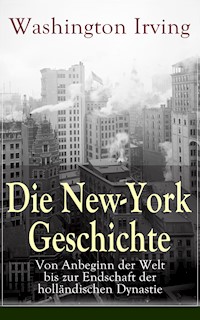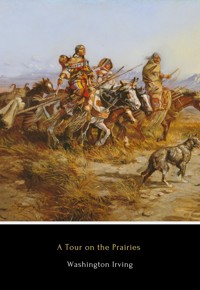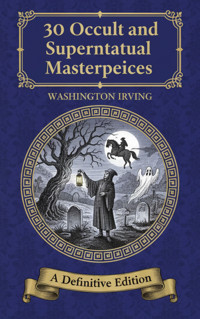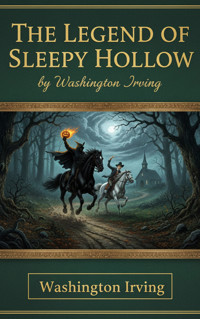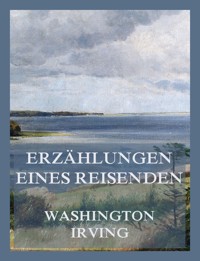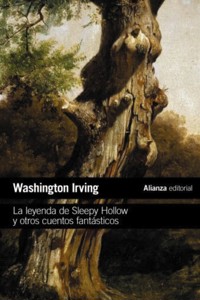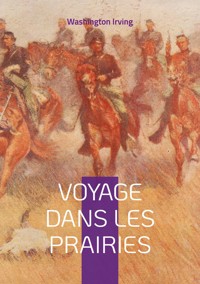
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Voyage dans les prairies à l'ouest des États-Unis » de Washington Irving est un récit de voyage qui explore le Far West américain du début du XIXe siècle. Dans cet ouvrage, Irving relate son expédition de 1832 à travers les étendues de l'Oklahoma et du Kansas, offrant un témoignage sur la vie à la frontière américaine. L'auteur, connu pour ses oeuvres de fiction, observe et décrit les paysages des prairies, la faune et les rencontres avec les tribus indiennes. Irving se joint à un groupe de rangers pour une expédition de chasse au bison, partageant les aspects de cette aventure. Le récit inclut des descriptions de la nature sauvage, des campements improvisés et des défis quotidiens des pionniers et explorateurs. Irving offre des observations sur les Indiens d'Amérique qu'il rencontre, décrivant leurs coutumes et leur mode de vie. « Voyage dans les prairies » se classe dans les catégories « Récits de voyages », « Histoire de l'Ouest américain » et « Littérature classique américaine » sur les plateformes de vente en ligne. Irving utilise son talent littéraire pour offrir une perspective sur une période de l'histoire américaine. L'ouvrage aborde des thèmes comme la confrontation entre la civilisation et la nature sauvage, l'esprit d'aventure des pionniers et la transformation du paysage américain. À travers des anecdotes et des réflexions, Irving présente un témoignage sur l'Amérique en expansion, tout en évoquant des questions sur le rapport de l'homme à la nature.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIÈRES.
CHAPITRE PREMIER.
Territoires de chasse dans les prairies. — Mes compagnons de voyage. — le commissaire du gouvernement. — Le virtuose universel. — L’amateur d’aventures. — Le Gil-Blas des frontières — Jouissances par anticipation d’un jeune homme romanesque.
CHAPITRE II
Espérances déçues. — Nouveaux plans. — préparatifs pour nous joindre à une expédition d’exploration. — Départ de Fort Gibson. — Passage à gué du Verdegris. — Un cavalier indien.
CHAPITRE III
.
Une agence indienne. — Riflemen (corps de rôdeurs ou batteurs de pays.) — usages. — Cricks — Chasseurs. — Chiens, — Chevaux. — Métis. — Beatte-le-chasseur.
CHAPITRE IV
.
Le départ
CHAPITRE V
.
Scènes de frontières. — Le Lycurgue des confins. — Loi de Lynchs. — Danger de trouver un cheval. — Le jeune Osage
CHAPITRE VI
.
On trouve la trace des chasseurs osages. — Départ du comte et de son compagnon. — Camp de guerriers abandonné. — Chien errant. — Le campement
CHAPITRE VII
.
Nouvelles du corps d’armée. — Le comte et son écuyer sauvage. — Halte dans les bois. — Scène de forêt. — Village osage. — Visite des Osages à notre camp
CHAPITRE VIII
.
Le camp des Rangers (Rôdeurs)
CHAPITRE IX
.
Chasse aux abeilles
CHAPITRE X
.
Amusemens du camp — Un conseil. — Pitance ordinaire et dessert du chasseur. — Scènes du soir. — Musique nocturne. — Sort funeste d’un hibou mélomane
CHAPITRE XI
.
Nous plions bagage : — Marche pittoresque. — Chasse. — Scènes de camp. — Triomphe d’un jeune chasseur. — Mauvais succès des vétérans. — Vil assassinat d’un chafoin
CHAPITRE XII
.
Traversée de l’Arkansas
CHAPITRE XIII
.
Le camp du vallon. — Les Pawnies. — Leurs mœurs et leur manière de combattre. — Aventure d’un chasseur. — Chevaux retrouvés et hommes perdus
CHAPITRE XIV
.
Chasse au daim. — Vie des Prairies. — Beau campement. — Bonne fortune d’un chasseur. — Anecdotes des Delawares. — Leurs superstitions
CHAPITRE XV
.
Le camp des élans
CHAPITRE XVI
Maladie au camp. — Marche. — Le cheval hors de service. — Le vieux Ryan et les traîneurs. — Symptômes de changement de temps, et changement d’humeur
CHAPITRE XVII
.
Orage sur les Prairies. — Campement d’orage. — Scène de nuit. — Histoires de sauvages. — Cheval effrayé.
CHAPITRE XVIII
.
Une grande Prairie. — Château de Rochers. — Traces de buffles. — Daim chassé par des loups. — Forêts transversales
CHAPITRE XIX
.
Espérances des chasseurs. — Gué dangereux. — Cheval sauvage
CHAPITRE XX
.
LE CAMP DU CHEVAL SAUVAGE.
Contes de chasseurs. — Chevaux sauvages. — Le métis et sa prise. — Chasse au cheval. — Animal sauvage dompté.
CHAPITRE XXI
.
Gué de la Fourche Rouge. — Arides forêts. — Buffles.
CHAPITRE XXII
.
LE CAMP DE L’ALARME.
Feu. — Indiens sauvages
CHAPITRE
XXIII.
Digue de castors. — Traces de buffles et de chevaux sauvages. — Sentier frayé par les Pawnies. — Chevaux sauvages. — L’ours et le jeune chasseur
CHAPITRE XXIV
.
Disette de pain. — On rencontre des buffles. — Dindons sauvages. — Mort d’un taureau-buffle.
CHAPITRE
XXV.
Le cercle des chevaux sauvages
CHAPITRE
XXVI.
Passage à gué de la Fourche-Nord. — Tristes paysages des forêts transversales. — Fuite de chevaux pendant la nuit. — Parti d’Osages guerriers. — Effets d’une harangue pacifique. — Buffle. — Cheval sauvage
CHAPITRE
XXVII.
Campement de pluie. — Anecdotes de la chasse aux ours. — Idées superstitieuses des Indiens sur les présages. — Scrupules concernant les morts
CHAPITRE
XXVIII.
Expédition secrète. — Stratagème pour prendre les daims. — Balles enchantées.
CHAPITRE
XXIX.
La grande Prairie. — Chasse au buffle
CHAPITRE
XXX.
Un camarade perdu. — Recherche du campement. — Le commissaire, le cheval sauvage et le buffle. — Sérénade de loups
CHAPITRE
XXXI.
Expédition pour chercher notre compagnon perdu.
CHAPITRE XXXII
.
Une république de chiens de prairie.
CHAPITRE XXXIII
.
Conseil. — Motifs pour reprendre le chemin de la frontière. — Chevaux perdus. — Nous partons avec un détachement. — Terres marécageuses. — Cheval sauvage. — Scène de nuit. — Le hibou précurseur de l’aurore
CHAPITRE XXXIV
.
Ancien campement des Cricks. — Rareté de vivres. — temps. — Marche pénible. — Pont de chasseurs.
CHAPITRE
XXXV.
On voit terre. — Marche difficile. — Campement affamé. — Ferme frontière. — Arrivée à la garnison
PREFACE.
L’auteur a l’intention de faire paraître les contenus accumulés de son portefeuille, et les produits subséquens de sa plume, en petits volumes détachés, publiés à des intervalles plus ou moins longs suivant les circonstances.
On l’a beaucoup encouragé à donner une relation de son Voyage aux Prairies qui joignent nos frontières de l’ouest, et diverses publications sur ce sujet ont été annoncées, comme de lui, avant qu’il eût songé à mettre ses observations en ordre. Pour répondre autant qu’il le peut à l’attente ainsi excitée, il présente dans ce volume, une partie de cette tournée comprenant une course à travers les prairies des Buffles. C’est une simple exposition de faits qui ne peut avoir d’autre mérite que la vérité ; si ces esquisses sont accueillies, l’auteur offrira dans les volumes suivans d’autres scènes de notre nouveau monde.
VOYAGE DANS LES PRAIRIES
À L’OUEST
DES ÉTATS-UNIS.
CHAPITRE PREMIER.
Territoires de chasse dans les prairies. — Mes compagnons de voyage. — le commissaire du gouvernement. — Le virtuose universel. — L’amateur d’aventures. — Le Gil-Blas des frontières — Jouissances par anticipation d’un jeune homme romanesque.
Dans ces régions sur lesquelles nos frontières de l’ouest avancent tous les jours, dans ces régions tant vantées et si imparfaitement connues, s’étend, à plusieurs centaines de milles au-delà du Mississipi, un immense espace de terre inculte où l’on ne voit ni la cabane du Blanc, ni le wigwam de l’Indien. Ce désert se compose de plaines coupées par des forêts, des bosquets ou des bouquets d’arbres, et arrosées par l’Arkansas, la Grande-Rivière Canadienne, la Rivière Rouge et leurs tributaires. Sur ces terres verdoyantes, l’élan, le buffle, le cheval sauvage, errent encore dans leur primitive liberté, et les tribus indigènes de l’ouest ont dans ces parages leurs divers territoires dédiasse. Là se rendent les Osages, les Cricks, les Delawares et d’autres nations qui se sont liées en quelque sorte à la civilisation, et vivent dans le voisinage des établissemens des Blancs. Là se rendent aussi les Pawnies, les Comanches, et d’autres peuples belliqueux et encore indépendans, nomades des prairies ou habitans des montagnes de rochers. La région dont je parle est un terrain disputable entre ces tribus guerrières et vindicatives ; aucune d’elles ne s’arroge le droit de se fixer dans ses limites ; mais leurs chasseurs, leurs braves, y vont en troupes nombreuses dans la saison de la chasse, forment leur léger campement de branches d’arbres et de peaux, se hâtent d’abattre, parmi les innombrables troupeaux qui broutent la prairie, de quoi se charger de butin, et se retirent au plus vite de ce dangereux voisinage. Ces expéditions sont toujours armées et préparées pour la guerre, comme pour la chasse. Le chasseur se tient prêt à l’attaque ou à la défense et doit avoir une vigilance continuelle. S’ils rencontrent dans leurs excursions les chasseurs d’une tribu ennemie, il en résulte un combat acharné ; de plus, les campemens sont sujets à être surpris par des guerriers errans, et les chasseurs dispersés à la poursuite du gibier à être pris ou massacrés par des ennemis embusqués. Des crânes, des squelettes desséchés au fond des ravins obscurs, marquent le théâtre de faits sanguinaires et montrent au voyageur la nature dangereuse de la contrée qu’il traverse. Les pages suivantes contiendront le narré d’une excursion d’un mois dans ces territoires de chasse, dont une partie n’a pas encore été explorée par les Blancs.
Au commencement d’octobre 1832 j’arrivai à Fort Gibson, un poste de notre extrême frontière de l’ouest situé sur la Grande-Rivière, près de son confluent avec l’Arkansas. Depuis un mois je voyageais avec une petite compagnie : nous étions allés de Saint-Louis aux rives du Missouri, et le long de la ligne d’agences et de missions, qui s’étend du Missouri à l’Arkansas. À la tête de notre bande était un commissaire chargé, par le gouvernement des États-Unis, d’inspecter l’établissement des tribus indiennes qui émigrent de l’est à l’ouest du Mississipi. Les devoirs de sa charge le conduisaient à visiter divers postes avancés de la civilisation ; et ici le lecteur me permettra de rendre hommage au mérite de notre digne conducteur. Il était né dans une des villes du Connecticut, et une vie passée dans la pratique des lois et les affaires administratives n’avait pu altérer la candeur, la bienveillance innée de son cœur. La plus grande partie de ses jours s’était écoulée au sein de sa famille et dans la société d’hommes vénérables, diacres, anciens, ou pasteurs évangéliques, des bords paisibles du Connecticut, quand il fut appelé soudain à monter son destrier, à prendre son mousquet, et à se mêler parmi les rudes chasseurs, les hardis planteurs, les sauvages nus, à travers les solitudes, sans chemins tracés, qui s’étendent au loin à l’occident de nos provinces nouvelles.
Un autre de mes compagnons était M. L...., Anglais de naissance, mais d’origine étrangère, et doué de toute la vivacité d’esprit et de toute la facilité de caractère d’un naturel du continent européen. Ses voyages en divers pays en avaient fait, à certain degré, un citoyen du monde, prêt à se conformer à tous les changemens exigés par les différentes mœurs, les différentes localités au milieu desquelles il se trouvait. C’était un homme universel : botaniste, géologue, chasseur aux scarabées et aux papillons, amateur de musique, dessinateur très au-dessus du médiocre, bref, virtuose général et spécial, et de plus chasseur infatigable, sinon toujours heureux. Jamais homme n’eut à la fois plus de fers au feu, par conséquent jamais homme ne fut plus affairé et plus satisfait. Mon troisième compagnon avait suivi le second d’Europe en Amérique, c’était le Télémaque de notre virtuose, et à l’instar de son prototype, il donnait parfois un peu d’embarras et d’inquiétude au sage Mentor. C’était un jeune comte suisse à peine âgé de vingt-un ans, plein de talens et d’esprit, mais entreprenant, aventureux à l’excès, et prêt à s’engager dans les pas les plus dangereux pour l’amour du mouvement, de la nouveauté. Après avoir parlé de mes camarades, je ne dois pas omettre de citer un personnage de rang inférieur, mais d’une importance prédominante ; l’écuyer, le groom, le cuisinier, le constructeur de tentes, et en un mot le factotum et je puis ajouter la commère de notre compagnie. C’était un petit Créole français, maigre, jaune, tanné, aux membres souples et grêles, nommé Antoine, et familièrement Tony ; une sorte de Gil-Blas de la frontière, qui avait passé sa vie errante tour à tour parmi les Blancs et parmi les Indiens ; tantôt employé par les marchands, les missionnaires ou les agens, tantôt se mêlant avec les chasseurs Osages. Nous le prîmes à Saint-Louis, près duquel il a une petite ferme, une femme indienne et une couvée d’enfans métis ; cependant il a, de son aveu, une femme dans chaque tribu, et si l'on croyait tout ce que ce petit vagabond dit de lui-même, il serait sans moralité, sans foi, sans loi, sans culte, sans patrie, et on peut ajouter sans langage, car il parle un jargon babylonique, mêlé de français, d’anglais et d’osage : avec tout cela c’était un rodomont achevé et un menteur du premier ordre. Il était fort drôle de l’entendre gasconner sur ses formidables exploits et sur les périls atroces auxquels il avait miraculeusement échappé. Au milieu de sa volubilité, il éprouvait parfois un spasme des mâchoires très singulier : on eût dit qu’elles se démantibulaient, qu’elles se décrochaient de leurs gonds. Quant à moi, je suis porté à croire que cet accident était causé par quelque gros mensonge qui avait peine à passer par son gosier, car je remarquai généralement qu’immédiatement après ce mouvement convulsif il nous lâchait une exorbitante hablerie.
Notre voyage avait été extrêmement agréable ; nous avions pris occasionnellement nos quartiers dans les établissemens des missionnaires, placés à de grandes distances les uns des autres ; mais en général nous passions la nuit sous des tentes, dans les bosquets qui bordent les ruisseaux. À la fin de notre tournée nous pressâmes le pas, dans l’espoir d’arriver au fort Gibson à temps pour nous joindre aux chasseurs Osages, dans leur visite d’automne aux prairies des Buffles. Déjà l’imagination du jeune comte s’était enflammée à ce sujet. Les vastes paysages, les habitudes sauvages des prairies, lui tournaient la tête ; et les histoires que le petit Tony lui contait des braves Indiens et des beautés indiennes, de la chasse au buffle, de la manière de se saisir des chevaux sauvages, l’avaient rendu avide de devenir lui-même sauvage. Il était bon et hardi cavalier, et mourait d’envie d’explorer les territoires de chasse. Rien n’était plus amusant que ses espérances juvéniles sur tout ce qu’il devait voir et faire, sur tous les plaisirs qu’il goûterait en se mêlant parmi les Indiens et en partageant leurs rudes et dangereux exercices ; mais il n’était pas moins curieux d’entendre les gasconnades de Tony, qui s’engageait à lui servir d’écuyer dans toutes ses entreprises, qui devait lui enseigner à jeter le lacet au cheval sauvage, à abattre le buffle, à gagner les doux sourires des princesses indiennes.
« Et si nous pouvions seulement voir une prairie en feu ! s’écriait le jeune comte. — Par cette âme, j’en incendierai une moi-même ! » répondit le petit Français.
CHAPITRE II.
Espérances déçues. — Nouveaux plans. — Préparatifs pour nous joindre à une expédition d’exploration. — Départ de Fort Gibson. — Passage à gué du Verdegris. — Un cavalier indien.
Les vives et flatteuses espérances d’un jeune homme sont assez souvent suivies du désappointement. Malheureusement pour les plans de campagne sauvage du comte, avant la fin de notre course, les chasseurs Osages étaient partis pour les territoires des Buffles. Le jeune Suisse ne voulut pas en avoir le démenti ; il se détermina à suivre leurs traces et à s’efforcer de les rejoindre ; et dans cette vue il s’arrêta, un peu avant Fort Gibson, à l’agence des Osages. Son compagnon, M. L..., demeura avec lui, et le commissaire et moi poursuivîmes notre route, suivis du fidèle et véridique Tony. Je touchai quelques mots à ce dernier sur ses promesses d’accompagner le comte dans ses campagnes ; mais je trouvai le petit homme parfaitement éclairé sur ses propres intérêts. Il comprenait fort bien que le commissaire resterait long-temps dans le pays pour remplir les devoirs de sa charge, tandis que le séjour du comte y serait simplement passager. Les gasconnades du petit bravache finirent donc subitement ; il ne parla plus au jeune comte des Indiens, des buffles, des chevaux sauvages, mais se plaçant silencieusement au milieu des gens du commissaire, il marcha derrière nous sans desserrer les dents jusqu’au fort. Arrivés là, une autre chance de croisière dans les prairies s’offrit à nous. On nous dit qu’une compagnie de cavaliers explorateurs ou riflemen était partie, trois jours auparavant, pour faire une tournée de l’Arkansas à la Rivière-Rouge, en y comprenant une partie du territoire de chasse des Pawnies, où les Blancs n’avaient pas encore pénétré. C’était une heureuse occasion de parcourir des régions intéressantes et périlleuses sous la sauvegarde d’une puissante escorte, et de plus, protégé par la présence du commissaire, qui pouvait, en vertu de son office, réclamer les services de ce nouveau corps de riflemen (cavaliers armés de carabine) ; la contrée qu’ils allaient reconnaître étant destinée à l’établissement de tribus émigrantes.
Bientôt notre plan fut arrêté et mis à exécution : on dépêcha de Fort Gibson une couple d’indiens cricks, pour atteindre les explorateurs et leur dire de faire halte jusqu’à ce que le commissaire et sa troupe les eussent rejoints. Comme nous avions trois ou quatre journées à faire dans un pays inhabité, avant de regagner les cavaliers, on nous donna une escorte de quatorze hommes commandés par un lieutenant.
Nous envoyâmes un exprès à l’agence des Osages, pour faire part au jeune comte et à son ami de notre nouveau projet, et les inviter à nous accompagner. Cependant le comte ne pouvait chasser de sa pensée les délices qu’il s’était promises en menant une vie absolument sauvage. Il répondit qu’il consentait à marcher avec nous jusqu’à ce que nous eussions trouvé les traces des chasseurs Osages, et alors sa ferme résolution était de s’enfoncer, à leur poursuite, dans les déserts ; son fidèle Mentor, tout en grondant un petit, avait accédé à cette proposition extravagante. Un rendez-vous général fut indiqué pour le lendemain matin à l’agence, et chacun prit ses arrangemens pour un prompt départ. Un petit waggon avait jusqu’alors porté nos bagages ; mais nous allions être obligés de nous frayer une route à travers un pays inhabité, coupé de rivières, de bois, de ravins, où cette sorte de voiture eût été impossible à traîner après nous. Il nous fallait voyager à cheval, à la manière des chasseurs, avec le moins de charge possible ; nous nous réduisîmes donc au plus strict nécessaire. Une paire de sacoches suspendue à nos selles contenait notre succincte garderobe, et le grand manteau était roulé derrière nous. Le reste du matériel fut chargé sur des chevaux de somme. Chacun de nous avait une peau d’ours et une couple de couvertures de laine pour servir de lit et nous avions une tente pour nous abriter en cas de maladie ou de mauvais temps. Nous eûmes soin de nous pourvoir d’une assez bonne provision de farine, de café et de sucre, avec un peu de porc salé pour les cas urgens, notre principale subsistance devant être tirée de la chasse.
Nous prîmes ceux de nos chevaux qui n’étaient pas trop fatigués de notre précédente course pour en faire des chevaux de bât, ou de ressource ; mais ayant à faire un long et pénible voyage, pendant lequel nous serions obligés de chasser et peut-être d’avoir des rencontres avec des sauvages ennemis, le choix de bons chevaux était essentiel à notre sûreté. Je m’en procurai un très beau et très fort, gris d’argent, un peu rétif, mais ardent et solide ; et je retins aussi un poney vigoureux que j’avais monté jusqu’alors, et qui demeura libre au milieu des bêtes de somme, pour se refaire, et se trouver prêt en cas de besoin à en remplacer un autre.
Tous les arrangemens faits, nous quittâmes le fort dans la matinée du 10 octobre, et traversant la rivière en face nous prîmes le chemin de l’agence. Une course de quelques milles nous conduisit au gué du Verdegris, site de rochers entremêlés d’arbres forestiers de l’aspect le plus agreste. Nous descendîmes sur le bord de la rivière et la traversâmes en formant une ligne prolongée et chancelante. Les chevaux allaient avec précaution d’un rocher à l’autre, et semblaient tâter le terrain avant de poser le pied dans ces ondes bouillonnantes.
Notre petit Français, Tony, qui formait l’arrière-garde avec les chevaux de bât, avait la joie au cœur, ayant obtenu une sorte d’avancement. Dans la première partie de notre voyage il avait conduit le waggon, emploi qu’il semblait regarder comme très inférieur ; et maintenant il était à la tête de la cavalerie, grand connétable, si vous voulez. Notre homme, perché comme un singe, derrière les paquets, sur l’un des chevaux, chantait, criait, aboyait à la façon des Indiens, et de temps à autre il blasphémait contre les bêtes paresseuses.
Tandis que nous passions le gué, nous vîmes sur la rive opposée un Indien crick à cheval, qui s’était arrêté, pour nous reconnaître, sur le bord d’un rocher élevé : sa figure était un objet pittoresque parfaitement d’accord avec le paysage qui l’entourait. Il portait une chemise de chasse d’un bleu clair, bordée de franges écarlates, un mouchoir de couleurs vives et tranchantes était tourné autour de sa tête, à peu près comme un turban, l’un des bouts retombant sur son oreille ; et avec son long fusil il ressemblait à un Arabe en embuscade. Notre petit Français, loquace et toujours disposé à se mêler de tout, le héla dans son jargon babylonique, mais le sauvage ayant vu ce qu’il voulait voir, agita sa main en l’air, tourna bride, et galopant le long du rivage, disparut en un instant parmi les arbres.
CHAPITRE III.
Une agence indienne. — Riflemen (corps de rôdeurs ou batteurs de pays.) — Osages. — Cricks — Chasseurs. — Chiens. — Chevaux. — Métis. — Beatte-le-chasseur.
Quand nous eûmes passé la rivière, nous atteignîmes bientôt l’agence où le colonel Choteau tient ses bureaux et ses magasins pour l’expédition des affaires avec les Indiens et la distribution des présens, des subsides et des provisions nécessaires à ceux qui visitent les prairies. L’établissement, composé d’un petit nombre de maisons de bois (log-houses) construites sur le bord de la rivière, présentait le bizarre mélange d’une scène de frontières : là nous attendaient les hommes de notre escorte, quelques uns à cheval, d’autres se promenant ou s’amusant à tirer au blanc, d’autres encore assis sur des arbres tombés ; c’était une troupe vraiment hétérogène. Plusieurs avaient des habits taillés dans des couvertures de laine verte, d’autres portaient des chemises de chasse en cuir, mais la plupart étaient couverts de vêtemens merveilleusement usés et mal faits, évidemment endossés pour épargner à de meilleures hardes un rude service.
Près de ces hommes était un groupe d’Osages, à la mine imposante, aux formes classiques, simples et graves dans leur costume et leur maintien. Ils ne portaient aucun ornement, et tout leur habillement consistait en blankets (couvertures de laine) et en mocassins (brodequins). Ils avaient la tête nue, et les cheveux coupés très court, à l’exception d’une raie sur le sommet du crâne, qui faisait l’effet du cimier d’un casque, et d’une longue mèche à scalper, qui tombait par-derrière. La coupe de leurs traits était celle dite romaine, et comme leurs blankets était généralement tournées autour de leurs reins, de manière à laisser le buste et les bras nus, ils ressemblaient à de belles statues de bronze. Les Osages sont les Indiens les plus beaux et les mieux faits que j’aie jamais vus dans les régions de l’Ouest. Ils n’ont pas encore cédé à l’influence de la civilisation au point de quitter leurs habitudes de chasseurs et de guerriers, et leur pauvreté les empêche de déployer aucune espèce de luxe.
En parfait contraste avec ceux-ci paraissait, à quelque distance, un parti de Cricks, dans un brillant appareil. Au premier coup d’œil les hommes de cette tribu ont un aspect tout-à-fait oriental. Ils portent des chemises de chasse en calicot de couleurs vives et variées, ornées de franges, et serrées autour du corps par de larges ceintures enrichies de verroteries ; des guêtres de peau de daim préparée ou de drap écarlate ou vert, terminées par des jarretières brodées et des glands ; enfin des brodequins très curieusement travaillés, et ajustent avec assez de grâce autour de leur tête des mouchoirs de toutes sortes de nuances éclatantes.
Là se trouvait encore une foule bigarrée de chasseurs au piège et au tir, de métis, de nègres de tous les degrés, depuis l’octavon jusqu’au noir complet, enfin de toutes les autres espèces d’êtres sans nom, qui fourmillent autour des frontières entre la vie civilisée et la vie sauvage, de même que les chauves-souris, ces oiseaux équivoques, planent sur les confins de la lumière et des ténèbres.
Tout le petit hameau de l’agence était en mouvement. Le hangar du forgeron, en particulier, offrait une scène d’activité extraordinaire. Un nègre ferrait un cheval ; deux métis fabriquaient des cuillers de fer dans lesquelles on devait fondre le plomb pour faire des balles. Un vieux chasseur, en veste de cuir et en mocassin, avait posé son fusil contre l’établi, et contait ses exploits tout en surveillant l’opération. Plusieurs chiens énormes flânaient dans la forge et en dehors, ou dormaient au soleil, et un petit roquet, la tête penchée de côté et une oreille dressée, examinait avec la curiosité ordinaire aux petits chiens les procédés du maréchal, comme s’il avait eu l’envie d’apprendre son métier, ou qu’il eût attendu son tour pour être ferré.
Nous trouvâmes le comte et son compagnon le virtuose prêts à marcher : comme ils avaient l’intention de regagner les Osages et de passer quelque temps à chasser au buffle et au cheval sauvage, ils avaient ajouté à leurs montures de voyage, des chevaux de la meilleure espèce qu’on devait mener en lesse et ne monter que pour la chasse.
Ils avaient de plus engagé à leur service un métis français-osage, sorte de maître Jacques propre à la chasse, à la cuisine, à prendre soin des chevaux ; mais il joignait à ces talens variés une propension irrésistible à ne rien faire, commune à cette race mêlée, engendrée et nourrie autour des missions. Par-dessus tout cela, c’était un joli garçon, un Adonis de la frontière ; il était fier de ses avantages personnels, et plus encore d’être, à ce qu’il croyait, hautement allié, sa sœur étant la maîtresse d’un riche négociant blanc.
De notre côté, nous désirions aussi, le commissaire et moi, ajouter à notre suite un homme accoutumé aux courses dans les bois, et capable de nous servir comme chasseur ; car notre petit créole, chargé de la cuisine pendant les haltes et de la conduite des chevaux de bât pendant les marches, avait assez à faire. Un individu tel qu’il nous le fallait se présenta, ou plutôt nous fut recommandé dans la personne d’un certain Pierre Beatte, de race croisée d’Osage et de Français. On nous assura qu’il connaissait parfaitement le pays, l’ayant traversé dans toutes les directions en participant à des expéditions de chasse ou de guerre. Il pouvait nous être également utile comme guide et comme interprète, et passait pour un chasseur habile et déterminé.
Cependant sa mine me déplut quand il me fut d’abord désigné, tandis qu’il rôdait dans le hameau, vêtu d’une vieille veste de chasse avec des guêtres ou métusses, de peau de daim crasseuses, tachées, presque vernissées par un frottement longuement prolongé. Il n’annonçait pas plus de trente-six ans, et sa structure était carrée et forte ; ses traits n’étaient point mal, puisqu’ils étaient à peu près dans la forme de ceux de Napoléon : seulement les hautes pommettes indiennes donnaient à ceux-ci un caractère moins noble. Peut-être la teinte d’un jaune verdâtre de ce visage le faisait ressembler encore davantage à un buste en bronze de l’Empereur que j’avais vu autrefois ; mais à tout prendre sa physionomie était sombre et sournoise, et cette expression peu agréable était renforcée par un vieux chapeau de laine rabattu sur ses yeux, et des mèches de cheveux emmêlées qui retombaient le long de ses oreilles.
Telle était l’apparence de l’homme, et ses manières n’avaient rien de plus engageant : il était froid, laconique, ne faisait aucune promesse, ne se vantait d’aucun talent. Il nous dit à quelles conditions il consentirait à nous engager ses services et ceux de son cheval ; nous les trouvâmes dures ; mais il ne parut nullement disposé à en rabattre, et nullement empressé de s’assurer l’emploi qui s’offrait à lui. Il tenait un peu plus de l’homme rouge que du blanc, et j’avais appris depuis long-temps à me défier des métis, race inconstante et sans foi. Je me serais donc volontiers dispensé de la coopération de Pierre Beatte ; mais nous n’avions pas le temps de chercher une autre personne, et il fallut s’arranger avec lui sur-le-champ. Alors il nous dit qu’il allait faire ses préparatifs pour le voyage, et promit de nous rejoindre à notre campement du soir.
Une chose essentielle manquait à mon équipage pour les prairies : c’était un cheval sûr et docile. Je n’étais pas monté selon mon goût ; l’animal que j’avais acheté était fort, de bon service, mais sa bouche et son allure étaient dures. Au dernier moment, je réussis dans mes vues, et je me procurai une excellente bête, un bai brun, vif, généreux, puissant, et en très bon état. Je le montai en triomphe, et transférai le gris d’argent au petit Tonny, qui fut dans une extase complète de se voir en parfait cavalier.
CHAPITRE IV.
Le Départ.
Les notes prolongées d’un cor de chasse donnèrent le signal du départ. Les cavaliers défilaient un à un, formant une ligne serpentaire à travers les bois» Nous fûmes bientôt à cheval, et les suivîmes ; mais nous étions sans cesse arrêtés dans notre marche par l’irrégularité des mouvemens de nos bêtes de somme. Elles n’étaient pas accoutumées à garder leur rang, et s’écartaient de côté et d’autre dans les bosquets en dépit des juremens et des exécrations de Tony, qui, monté sur son gris d’argent avec un long fusil sur l’épaule, leur courait après en vomissant une surabondance d’injures auxquelles il joignait une surabondance de coups.
Nous perdîmes donc assez vite la vue de notre escorte ; mais nous tâchâmes de rester sur ses traces. Nous traversâmes de majestueuses forêts, des taillis presque impénétrables, et nous vîmes çà et là des wigwams indiens et des huttes de nègres, jusque vers le soir, où nous arrivâmes à une ferme frontière, propriété d’un colon nommé Berryhill. Cette ferme était située sur une colline au pied de laquelle nos cavaliers étaient campés dans un bosquet circulaire près d’un ruisseau. Le maître de l’habitation nous reçut poliment, mais ne put nous offrir l’hospitalité, car la maladie régnait dans sa famille. Luimême, en dépit de ses formes athlétiques, paraissait en fâcheux état : il avait le teint blême, fiévreux, et une double voix qui passait brusquement d’un fausset tremblotant et sifflant à une basse sourde et rauque.
Sa maison étant un véritable hôpital encombré de malades, nous fîmes dresser notre tente dans la cour de la ferme.
Nous étions à peine campés lorsque nous vîmes paraître notre demi-Osage Beatte, monté sur un bon cheval, et en conduisant un autre en lesse, chargé de différentes provisions pour l’expédition. Beatte était évidemment un vieux soldat expérimenté, accoutumé et s’entendant à merveille à prendre soin de lui-même. Il se regardait comme attaché au gouvernement, étant employé par le commissaire, et il avait requis des rations de farine et de lard, et les avait mises à l’abri des injures du temps. Outre son cheval de voyage, il en avait un autre pour la chasse : celui-ci était, comme son maître, de sang mêlé, de la race domestique et de la race sauvage des prairies, un noble coursier plein de feu, de courage et d’une admirable sûreté. Beatte avait fait ferrer ses chevaux très solidement à l’agence ; bref il était préparé de tout point et pour la guerre et pour la chasse ; le fusil sur l’épaule, la poire à poudre et la giberne au côté, le couteau de chasse suspendu à sa ceinture, et des rouleaux de cordes accrochés à l’arçon de sa selle, que l'on nous dit être des lariats ou cordes à nœuds pour attraper les chevaux sauvages.
Ainsi équipé et muni, le chasseur des prairies comme le croiseur sur l’Océan est parfaitement indépendant du reste du monde, et capable de pourvoir seul à sa sûreté et à ses besoins. Il peut, s’il le juge à propos, se séparer de tous ses compagnons, et suivre sa propre fantaisie : il me sembla que Beatte sentait cette indépendance et se croyait en conséquence très supérieur à nous tous, surtout lorsque nous fûmes lancés dans les déserts. Il avait un air moitié fier moitié farouche et une singulière taciturnité. Son premier soin était toujours de décharger et de débrider ses chevaux, puis de les mettre en sûreté pour la nuit. Toute sa conduite formait un contraste parfait avec le petit créole français, babillard, hâbleur, se mêlant de tout. Ce dernier paraissait jaloux du nouveau-venu ; il nous disait à l’oreille que les métis étaient des gens capricieux, sur lesquels on ne pouvait pas compter ; que Beatte était visiblement préparé à se passer de notre assistance, et nous abandonnerait au premier mécontentement ; car il était comme chez lui dans les prairies.
CHAPITRE V.
Scènes de frontières. — Le Lycurgue des confins. — Loi de Lynch, — Danger de trouver un cheval. — Le jeune Osage.