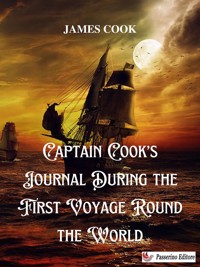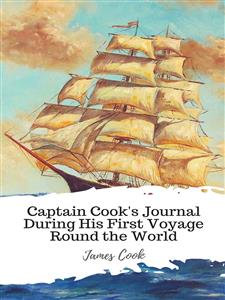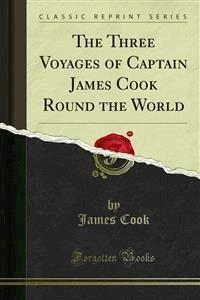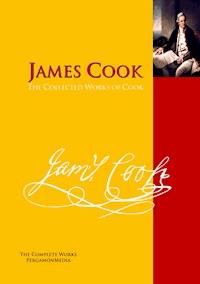Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Récit d'une expédition maritime
Partis à la recherche de la
Terra Australis Incognita, James Cook et Tobias Furneaux à la tête des vaisseaux
Resolution et
Adventure dépassent le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773. À la latitude de 71° 10’ sud, les glaces les obligent à rebrousser chemin.
Après avoir perdu la
Resolution, James Cook fait relâche à Tahiti pour un réapprovisionnement avant de repartir vers le Grand Sud. Mais le continent mythique n’est toujours pas en vue. Alors, il remonte plus au nord et explore Les Tonga, l’île de Pâques, l’île Norfolk, découvre la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
En décembre 1774, il franchit le cap Horn en passant par la Terre de Feu et est de retour le 29 juillet 1775. Il retrouve Tobias Furneaux déjà rentré en Grande-Bretagne après avoir perdu une partie de son équipage lors d’une rencontre avec des Maoris.
Le témoignage captivant du célèbre explorateur anglais à la recherche de l'Océanie !
EXTRAIT
Ces petits malheurs manquèrent d’être suivis d’un grand. Un volontaire logé à l’avant du vaisseau s’éveilla tout à coup une nuit, et entendit l’eau courant dans son poste, et qui brisait sur ses meubles. Après avoir sauté hors de son lit, il se trouva dans l’eau jusqu’à mi-jambe. Il en avertit l’offcier de quart et dans un moment tout l’équipage fut levé : on employa les pompes ; on se servit même des pompes à chapelet. Enfn un des matelots découvrit heureusement que l’eau n’entrait que par une écoutille dans le magasin du maître d’équipage ; elle avait été enfoncée par la force des vagues : on la répara sur le champ et nous sortîmes de danger. Nous fûmes chassés fort loin à l’est de notre route projetée, et je n’eus plus l’espoir de gagner le cap de la Circoncision. Nous perdîmes une grande partie des animaux d’approvisionnement que nous avions embarqués au Cap ; ce passage brusque d’un temps doux et chaud à un climat extrêmement froid et extrêmement humide affecta tout le monde sans distinction. Le thermomètre était tombé à quatre degrés centigrades, tandis qu’au Cap il se tenait communément à vingt degrés et plus. J’ajoutai quelque chose à la ration ordinaire en boissons fortes ; je faisais donner aux matelots un petit coup quand je le croyais nécessaire et j’avais invité le capitaine Furneaux à suivre cet exemple. Vint une nuit claire et sereine, la seule de cette espèce depuis notre départ du Cap, et le lendemain le soleil levant nous donna de fatteuses espérances qui s’évanouirent bientôt, car le ciel fut de nouveau couvert d’une brume épaisse accompagnée de pluie.
À PROPOS DE L'AUTEUR
James Cook (1728 - 1779) est un explorateur navigateur anglais qui a parcouru l’océan Pacifique : de l’Antarctique au détroit de Béring, des côtes de l’Amérique au Japon. On lui doit, entre autres, la découverte de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Cook, Sandwich (Hawaï)...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLAAEFrance
James COOK
Voyage en Océanie de 1772 à 1775
CLAAE
2013
© CLAAE 2013
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanc tionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
CLAAEFrance
ean ebook : 9782379110436
James Cook (1728-1779) est un explorateur navigateur anglais qui a parcouru l’océan Pacifque : de l’Antarctique au détroit de Béring, des côtes de l’Amérique au Japon. On lui doit, entre autres, la découverte de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Cook.
PREMIÈRE PARTIE
—
D’Angleterre au cap de Bonne-Espérance et à Taïti.
Deuxième voyage de 1772 à 1775
Chapitre 1 —Traversée d’Angleterre au cap de Bonne-Espérance.
Je fs voile de Deptford le 9 avril 1772, mais je ne dépassai pas Woolwich, où je fus retenu par les vents d’est jusqu’au 22. Le vaisseau descendit alors à Longreach, où l’Aventure, commandée par le capitaine Furneaux, me joignit le lendemain.
Le 10 mai, nous quittâmes Longreach avec ordre de toucher à Plymouth, mais on reconnut que mon navire la Resolution portait mal la voile et je fus obligé de relâcher à Sheerness pour remédier à cet inconvénient et changer quelque chose dans les œuvres mortes.
Le 22 juin, le vaisseau fut prêt à remettre en mer : je fs voile alors de Sheerness et, le 3 juillet, je rejoignis l’Aventure dans le canal de Plymouth.
Je reçus à Plymouth mes instructions datées du 25 juin : on m’enjoignait de prendre le commandement de la Résolution, de me rendre avec promptitude à l’île de Madère, d’y embarquer du vin et d’aller de là au cap de Bonne-Espérance, où je devais rafraîchir les équipages et me fournir des provisions et d’autres choses dont j’aurais besoin ; de m’avancer au sud et de tâcher de retrouver le cap de la Circoncision, qu’on dit avoir été découvert par M. Bouvet dans le cinquante-quatrième parallèle sud et à environ onze degrés vingt minutes de longitude est du méridien de Greenwich ; si je rencontrais ce cap, de m’assurer s’il fait partie du continent (dispute qui a si fort occupé les géographes et les premiers navigateurs), ou si c’est une île ; dans le premier cas, de ne rien négliger pour en parcourir la plus grande étendue possible, d’y faire les remarques et observations de toute espèce qui seraient de quelque utilité à la navigation et au commerce et qui tendraient au progrès des sciences naturelles.
On me recommandait aussi d’observer le génie, le tempérament, le caractère et le nombre des habitants s’il y en avait, et d’employer tous les moyens honnêtes afn de nouer avec eux des liens d’amitié.
Je devais leur offrir des choses auxquelles ils attacheraient du prix, les inviter au commerce et leur montrer dans toutes les circonstances de la civilité et des égards.
Mes instructions portaient ensuite de tenter des découvertes à l’est ou à l’ouest, suivant la situation où je me trouverais, de m’approcher du pôle austral le plus qu’il me serait possible et aussi longtemps que l’état des vaisseaux, la santé des équipages et les provisions le permettraient ; d’avoir soin de toujours réserver assez de provisions pour atteindre quelque port connu, où j’en chargerais de nouvelles pour la suite de mon voyage, puis de me rendre enfn au cap de Bonne-Espérance et de là revenir en Angleterre.
Quand la saison de l’année rendait périlleux mon séjour dans les latitudes élevées, on me permettait de me retirer au nord, à quelque endroit connu, pour rafraîchir les équipages et radouber les vaisseaux ; je devais retourner de nouveau au sud, dès que le temps serait favorable. Dans toutes les circonstances imprévues, on me laissait le maître de tenir la route que je voudrais, et, en cas que la Résolution périsse, ou fût mise hors de service, je devais continuer le voyage sur l’Aventure.
Le 29 octobre, après avoir relâché à Madère et au Cap-Vert, nous découvrîmes le cap de Bonne-Espérance. La Montagne de la Table, au-dessus de la ville du Cap, était à douze ou quatorze lieues. Le ciel était alors obscurci par le brouillard ; car autrement elle est si haute, qu’on aurait pu la découvrir à une distance beaucoup plus grande.
Nous forçâmes de voiles, dans l’espoir de gagner la baie avant la nuit ; mais, voyant que cela était impossible, nous passâmes la nuit à louvoyer. Entre huit et neuf heures toute la mer devint subitement éclairée, ou comme disent les matelots, toute en feu. Ce phénomène est assez commun, mais on n’en connaît pas aussi généralement la cause. M. Banks et le docteur Solander m’avaient persuadé qu’il était produit par des insectes de mer ; M. Poster ne paraissait pas adopter la même opinion. Je fs donc tirer quelques seaux d’eau aux côtés du bâtiment, et nous y trouvâmes une quantité innombrable d’animalcules en forme de globe, à peu près de la grosseur d’une tête d’épingle ordinaire, et absolument transparents.
L’aspect de l’océan était à la fois grandiose et le plus singulier qu’on puisse imaginer ; jusqu’à l’horizon, la mer paraissait être en fammes ; le sommet de chaque vague était phosphorescent et une ligne lumineuse marquait fortement les fancs du vaisseau. De grands corps lumineux se remuaient dans l’eau à côté de nous, tantôt lentement, d’autres fois plus vite ; en de certains moments nous remarquions clairement qu’ils avaient la forme de poissons ; et lorsque ces gros poissons lumineux approchaient de plus petits, ceux-ci se retiraient en hâte.
Après que l’eau tirée de la mer s’était un peu reposée, le nombre des bluettes semblait diminuer ; mais quand on l’agitait de nouveau elle devenait lumineuse comme auparavant. À mesure qu’elle se calmait, on voyait les bluettes se mouvoir dans les directions contraires aux ondulations de l’eau ; l’agitation était plus violente, elle paraissait au contraire, les entraîner dans son propre mouvement.
En remuant l’eau avec ma main, une des étincelles lumineuses s’attacha à mon doigt : nous l’examinâmes avec le grossissement ordinaire du microscope, et nous trouvâmes qu’elle était globulaire, transparente comme une substance gélatineuse et un peu brunâtre. Avec un plus fort grossissement, nous découvrîmes l’orifce d’un petit tube qui entrait dans le corps de cet atome, et dont quatre ou cinq sacs intestinaux remplissaient l’intérieur. Le jour naissant nous ft voir un beau ciel ; et de concert avec l’Aventure, nous mouillâmes dans la baie de la Table, à un mille de distance du fort.
Chapitre 2 —Départ du cap de Bonne-Espérance. – Recherche du continent austral.
Après avoir terminé nos affaires au Cap et pris congé du gouverneur et de quelques-uns des principaux offciers, qui me donnèrent, de la manière la plus obligeante, tous les secours possibles, nous rentrâmes à bord le 22 novembre 1772 ; nous levâmes l’ancre et mîmes à la voile.
Dès que nous fûmes en pleine mer, je disposai ma route de manière à reconnaître le cap de la Circoncision. Le 24, nous étions par trente-cinq degrés vingt-cinq minutes de latitude sud et vingt-neuf minutes à l’ouest du Cap. Nous avions autour de nous une grande quantité d’albatros : nous en prîmes plusieurs à la ligne en amorçant l’hameçon d’un morceau de peau de mouton. Plusieurs personnes de l’équipage les trouvèrent très bons, quoiqu’on servît encore du mouton frais. Jugeant que nous arriverions bientôt dans un climat froid, je fs donner des braies à ceux qui en avaient besoin, et en outre la jaquette et les chausses de drap qu’avaient accordées l’amirauté.
Comme nous entrions dans une mer qu’aucun navigateur n’avait encore parcourue et qu’on ignorait où nous pourrions nous rafraîchir, je donnai les ordres les plus positifs de ne pas perdre mal à propos l’eau douce. On plaça une sentinelle à côté de la futaille du gaillard d’arrière. On ne lava plus le linge qu’avec de l’eau salée. On employait sans relâche la machine à distiller perfectionnée de M. Irving. Au bout de deux jours, nous essuyâmes une tempête qui dura jusqu’au 6 décembre. La mer, prodigieusement grosse, se brisait avec violence sur le bâtiment. Nous n’avions eu aucune tempête pendant la traversée d’Angleterre au Cap et ceux de nous qui n’étaient pas fort accoutumés à la mer ne savaient comment se comporter dans une pareille position. Le roulis du bâtiment faisait de grands ravages parmi tous les objets fragiles et tout ce qui était mobile. Des circonstances plaisantes suivaient quelquefois la confusion générale et nous supportions tous nos accidents avec beaucoup de tranquillité. Les ponts et les planchers de chaque chambre étaient continuellement humides et le hurlement de la tempête et le rugissement des vagues, ajoutés à l’agitation violente du vaisseau, qui nous interdisait presque toute espèce de travail, formaient pour nous des scènes nouvelles et imposantes, mais en même temps fort désagréables.
Ces petits malheurs manquèrent d’être suivis d’un grand. Un volontaire logé à l’avant du vaisseau s’éveilla tout à coup une nuit, et entendit l’eau courant dans son poste, et qui brisait sur ses meubles. Après avoir sauté hors de son lit, il se trouva dans l’eau jusqu’à mi-jambe. Il en avertit l’offcier de quart et dans un moment tout l’équipage fut levé : on employa les pompes ; on se servit même des pompes à chapelet. Enfn un des matelots découvrit heureusement que l’eau n’entrait que par une écoutille dans le magasin du maître d’équipage ; elle avait été enfoncée par la force des vagues : on la répara sur le champ et nous sortîmes de danger. Nous fûmes chassés fort loin à l’est de notre route projetée, et je n’eus plus l’espoir de gagner le cap de la Circoncision. Nous perdîmes une grande partie des animaux d’approvisionnement que nous avions embarqués au Cap ; ce passage brusque d’un temps doux et chaud à un climat extrêmement froid et extrêmement humide affecta tout le monde sans distinction. Le thermomètre était tombé à quatre degrés centigrades, tandis qu’au Cap il se tenait communément à vingt degrés et plus. J’ajoutai quelque chose à la ration ordinaire en boissons fortes ; je faisais donner aux matelots un petit coup quand je le croyais nécessaire et j’avais invité le capitaine Furneaux à suivre cet exemple. Vint une nuit claire et sereine, la seule de cette espèce depuis notre départ du Cap, et le lendemain le soleil levant nous donna de fatteuses espérances qui s’évanouirent bientôt, car le ciel fut de nouveau couvert d’une brume épaisse accompagnée de pluie.
Un grand nombre d’oiseaux du genre des pétrels et des hirondelles nous avait accompagnés depuis le Cap, et la grosse mer et les vents semblaient en avoir emmené encore davantage. Nous voyions surtout le pétrel du Cap, ou pintade de mer, et le pétrel bleu, ainsi nommé parce qu’il est d’une couleur gris bleu. Son aile est coupée en travers par une bande de plumes noirâtres. Nous aperçûmes le 7, des pingouins pour la première fois, et quelques touffes de goémon, de l’espèce appelée le bambou de mer.
Le matin du 10 décembre, nous découvrîmes une île de glace du côté ouest et à environ deux lieues au-dessus du vent, une autre masse qui ressemblait à une pointe de terre neigeuse. L’après-midi, nous passâmes près d’une troisième qui avait deux mille pieds de long, quatre cents de large et au moins deux cents pieds d’élévation. En supposant que le morceau que nous vîmes fût d’une forme absolument régulière, sa profondeur au-dessous de l’eau devait être de dix-huit cents pieds, sa hauteur entière de deux mille pieds, et, d’après les dimensions qu’on vient d’énoncer, toute la masse devait contenir seize cents millions de pieds cubes de glace.
Nous étions alors au milieu de décembre, ce qui au point de vue de la saison répond à notre mois de juin, et par cinquante et un degrés cinq minutes de latitude sud ; cependant, nous avions déjà passé plusieurs icebergs et le thermomètre se tenait à deux degrés. Nous reconnûmes à midi que nous étions à deux degrés de longitude est du cap de Bonne-Espérance. Bientôt, le ciel se couvrit de brume et les brouillards, accompagnés de pluie et de neige fondue, s’accrurent tellement, que nous ne vîmes une île de glace sur laquelle nous gouvernions directement, que lorsque nous en fûmes à un mille. Le 12, nous découvrîmes plusieurs îles pareilles qui nous contraignirent à employer dans notre marche de grandes précautions. Nous en dépassâmes six le matin. Quelques-unes avaient près de deux milles de circuit et soixante pieds de hauteur ; et cependant telles étaient la force et l’élévation des vagues, que la mer en brisant couvrait d’eau leur sommet. Ce spectacle fut pour quelques moments agréable à nos yeux, mais notre esprit se remplit d’épouvante et d’horreur en pensant aux dangers qui nous menaçaient ; car un bâtiment qui dériverait, poussé par le vent, sur une de ces îles, lorsque les coups de mer sont si hauts, serait mis en pièces dans un instant.
La pluie et la neige fondue glaçaient en tombant sur nos voiles et nos agrès, d’où pendaient de tous côtés des glaçons. Le 11 à midi, nous étions par cinquante-quatre degrés de latitude sud sur le parallèle du cap de la Circoncision, découvert par M. Bouvet en 1739, mais à dix degrés de longitude à l’est, c’est-à-dire à près de cent dix-huit lieues, suivant la mesure des degrés à cette hauteur. Depuis midi, vingt icebergs de différentes étendues pour la hauteur et la circonférence s’offrirent à notre vue : l’un était couvert de taches noires, que quelques personnes de l’équipage prenaient pour des veaux marins et d’autres pour des oiseaux aquatiques ; cependant, nous ne les vîmes pas changer de place. Tout le monde s’attendait à voir terre : toutes les particularités relatives à cet objet attiraient notre attention. On examinait avec curiosité les brouillards de l’avant : chacun désirait annoncer le premier la côte. La forme trompeuse de ces brouillards et celles des îles de glace à moitié cachées dans la neige qui tombait, nous avaient déjà trompés plusieurs fois : l’Aventure nous avait aussi signalé qu’elle voyait terre. La découverte de M. Bouvet ayant échauffé l’imagination d’un des lieutenants, il monta plusieurs fois au haut des mâts et il avertit le capitaine qu’il voyait distinctement terre. Cette nouvelle amena tout le monde sur le pont : nous aperçûmes devant nous une immense plaine de glace brisée aux bords en plusieurs petites pièces ; un grand nombre d’îles de toutes les formes et de toutes les grandeurs se montraient par-derrière aussi loin que pouvait s’étendre notre vue : quelques-unes des plus éloignées, élevées considérablement par les vapeurs brumeuses qui couvraient l’horizon, ressemblaient en effet à des montagnes. Plusieurs offciers persistèrent à croire qu’ils avaient vu terre de ce côté, mais environ deux ans et deux mois après (en février 1775), dans ma route du cap Horn vers le cap de Bonne-Espérance, je naviguai précisément sur le même endroit sans y trouver ni terre ni glace.
M. Foster et M. Valles, l’astronome, avaient monté le canot afn de répéter des expériences sur la température de la mer à une certaine profondeur. La brume s’accrut tellement qu’ils perdirent de vue les deux vaisseaux. Leur situation sur une mer immense, loin de toute espèce de côtes, environnés de glaces et absolument privés de provisions était effrayante et terrible. Ils voguèrent quelque temps, faisant de vains efforts pour être entendus, mais tout était silence autour d’eux, et ils ne voyaient pas même la longueur entière de leur bateau. Ils étaient d’autant plus malheureux qu’ils n’avaient que deux rames et point de mâts ni de voiles. Dans cette situation épouvantable, ils résolurent de se maintenir sur place, espérant qu’ainsi ils apercevraient de nouveau les vaisseaux parce que le temps était calme. Enfn, dans le lointain, le son d’une cloche frappa leurs oreilles : ils ramèrent à l’instant de ce côté et l’Ave nture répondit à leurs cris continuels et les prit à bord, bien joyeux d’avoir échappé au danger de périr lentement de froid et de faim.
Nous avancions à travers les glaces brisées, tantôt dans une fausse baie d’où il fallait rétrograder, tantôt devant une plaine immense de glace fxe. Nous apercevions des baleines, des veaux marins, des pingouins et des oiseaux blancs. On voyait d’ailleurs, de toutes parts, une quantité innombrable de hauts icebergs, bien qu’une ligne de deux cent cinquante brasses ne donna point de fond.
Quelque périlleux qu’il soit de naviguer parmi de véritables rochers fottants, si je puis employer cette expression, durant une brume épaisse, cela vaut encore mieux que d’être enfermé, dans les mêmes circonstances, dans un champ de glace. Le grand danger dans ce dernier cas est de s’échouer, situation qui serait alarmante au-delà de tout ce qu’on peut dire.
Chapitre 3 —Séparation de l’Aventure.– Arrivée en Nouvelle-Zélande.
Le temps sombre et brumeux continuait. Étant arrivé par quarante-neuf degrés treize minutes de latitude sud, sans que rien annonçât le voisinage d’une terre, je revirai et portai de nouveau à l’est, et bientôt après je parlai au capitaine Furneaux. Il me dit qu’il croyait la terre à notre nord-ouest parce qu’il avait observé que la mer était tranquille quand le vent souffait dans ce rumb. Quoique cette remarque ne fût pas conforme à celles que nous avions faites à bord de la Résolution, il est cependant probable qu’il existe une terre dans cette direction, mais sans doute ce n’est qu’une petite île et non pas, comme on l’a supposé, le cap nord d’un continent austral.
Je perdis l’espérance de découvrir une terre à l’est ; et, comme le vent avait passé au nord, je me décidai à la chercher da n s l ‘ouest .
Le 8, nous eûmes une brume épaisse. Je fs plusieurs signaux à l’Aventure, qui ne put y répondre : ce qui me donna de vives inquiétudes. J’avais trop de raisons de nous croire séparés, quoique nous eussions peine à dire comment cela était arrivé. En cas de séparation, j’avais ordonné au capitaine Furneaux de croiser trois jours dans les parages où il m’aurait vu la dernière fois. Je continuai donc à faire de courtes bordées et à tirer des coups de canon toutes les demi-heures jusqu’à l’après-midi du 9. Le ciel s’étant alors éclairci, notre horizon s’étendit de toutes parts à plusieurs lieues sans que nous puissions apercevoir l’Aventure. Nous étions à deux ou trois lieues à l’est de l’endroit d’où nous la vîmes la dernière fois, et nous portions à l’ouest avec un vent très fort du nord-nord-ouest, accompagné d’une mer grosse qui venait du même rumb ; ce qui, joint à une augmentation de vent, m’obligea de mettre en panne jusqu’à huit heures du lendemain matin. Durant cet intervalle, nous ne découvrîmes point l’Aventure, quoique le temps fût assez clair, malgré que nous eussions tiré des coups de canon et allumé des feux toute la nuit. N’ayant plus d’espérance de la revoir, je fs voile et je gouvernai sud-est avec un vent très frais, accompagné d’une mer très grosse. Tout l’équipage fut affigé de cette séparation : nous ne jetions jamais les yeux sur l’Océan sans témoigner quelque chagrin de voir notre vaisseau seul au milieu de cette mer inconnue et lointaine ; la vue d’un second bâtiment avait jusqu’alors adouci nos peines et nous avait inspiré quelque gaîté.
Tandis que je louvoyais dans ces parages, des pingouins et des plongeurs frappèrent souvent nos yeux, ce qui nous ft conjecturer que la terre n’était pas loin ; mais il nous était impossible de présumer dans quelle direction. À mesure que nous avancions au sud, nous perdîmes de vue les pingouins et la plupart des plongeurs et nous rencontrâmes, comme à l’ordinaire, une grande quantité d’albatros, de pétrels bleus, de coupeurs d’eau et autres oiseaux.
Le 17 février, par un temps assez bon, un ciel clair et serein et entre minuit et trois heures du matin, nous aperçûmes dans les cieux, des clartés semblables à celles qu’on voit dans l’hémisphère septentrional, et qu’on appelle aurore boréale : je n’avais pas encore ouï parler de l’aurore australe. L’offcier de quart observa qu’elle se brisait quelquefois en rayons de forme spirale ou circulaire et qu’ensuite la lueur était très forte, et le spectacle très beau. Il ne put y remarquer de direction particulière, car l’aurore australe paraissait en différents temps et en différentes parties du ciel et elle répandait sa lumière sur toute l’atmosphère.
Dans la nuit du 20, l’aurore australe parut très brillante et très lumineuse. On la vit d’abord à l’est, un peu au-dessus de l’horizon et bientôt après elle se répandit sur tout le frmament. Cette aurore australe différait des aurores boréales en ce qu’elle était toujours d’une couleur bleuâtre, au lieu que vers le pôle Nord elles prennent différentes teintes et, surtout, une couleur de feu et de pourpre. Quelques fois, elle cachait les étoiles, d’autres fois on voyait celles-ci à travers ses rayons.
Le 21 au matin, ayant un peu de vent et une mer tranquille, deux circonstances favorables pour faire provision de glace douce, je gouvernai sur la plus grande des îles qui étaient devant nous et nous l’atteignîmes à midi, temps où nous étions par cinquante-neuf degrés de latitude sud et quatre-vingt-douze degrés trente minutes de longitude est. Nous avions vu trois ou quatre pingouins deux heures auparavant. Comme je trouvai une grande quantité de glaces fottantes, je fs mettre en mer deux chaloupes. Tandis qu’elles en prenaient à bord quelques morceaux, l’île, qui n’avait pas moins d’un demi-mille de circonférence et trois ou quatre cents pieds d’élévation au-dessus de la surface de la mer, se renversa presque entièrement : la base occupa la place du sommet et le sommet celle de la base. Nous ne remarquâmes pas que ce renversement en eût accru ou diminué la hauteur.
Le 23, je revirai et tirai de petites bordées pendant la nuit qui était extrêmement orageuse, épaisse et brumeuse, avec de la pluie mêlée de neige. Environnés de périls de toutes parts, nous soupirions après la pointe du jour. Enfn, l’aurore vint encore augmenter nos alarmes en offrant à notre vue des montagnes de glace escarpées ; nous avions passé la nuit sans les apercevoir.
Tant de circonstances défavorables, jointes aux nuits sombres de cette saison avancée, m’empêchèrent d’exécuter la résolution que j’avais prise de passer encore une fois le cercle antarctique. En conséquence, le 24 février, à quatre heures du matin, je portai au nord avec un vent très fort, accompagné de neige et par une mer très forte, qui mit en pièces beaucoup d’icebergs. Ce morcellement ne nous fut pas avantageux : nous eûmes au contraire un bien plus grand nombre de petits bancs à éviter. Les gros morceaux qui se détachent de ces îles, ne se voyant pendant la nuit que lorsqu’ils sont près du vaisseau, sont bien plus dangereux que les îles elles-mêmes qu’on aperçoit communément d’un peu loin à cause de leur très haute élévation au-dessus de la surface de l’eau, à moins que le temps ne soit brumeux et sombre. Ces dangers, cependant, nous étaient devenus si familiers, qu’ils ne nous causaient pas de longues inquiétudes ; d’ailleurs, ils étaient compensés par l’eau douce que ces îles de glace nous fournissaient très à propos et sans laquelle nous aurions éprouvé de grands besoins. Leur aspect est aussi très pittoresque. Nous en avons vu qui avaient un creux au milieu, ressemblant à une caverne percée de part en part et qui admettaient le jour de l’autre côté. Plusieurs ressemblaient à un clocher ou étaient conformées en spirales. L’imagination comparait volontiers les autres à des objets connus. Je portai toujours à l’est, inclinant vers le sud avec un vent frais du sud-ouest. Étant alors, le 15 février, par cinquante-neuf degrés sept minutes de latitude sud et cent quarante-six degrés cinquante-trois minutes de longitude est, je mis le matin le cap au nord-est et à midi au nord, ayant résolu de quitter les hautes latitudes méridionales, et de marcher vers la Nouvelle-Zélande pour y chercher des nouvelles de l’Aventure et y rafraîchir mon équipage. Je désirais d’ailleurs reconnaître la côte orientale de la terre de Van Diemen afn de m’assurer si elle est jointe à la Nouvelle-Galles méridionale.
La nuit du 17, le vent sauta au nord-ouest et souffa par rafales, accompagnées d’une brume très épaisse et de pluie. Ce temps dura toute la journée du 18, mais le soir, le ciel s’éclair-cit. La nuit, les aurores australes furent très brillantes. Le lendemain au matin, nous vîmes un veau marin et vers midi quelques pingouins et une grande quantité de passe-pierres. Nous n’eûmes alors connaissance d’aucune terre et il n’est pas possible qu’il y en eût une plus proche que la Nouvelle-Zélande ou la terre de Van Diemen dont nous étions éloignés de cent soixante lieues.
Comme le vent, qui souffait toujours entre le nord et l’ouest, ne me permettait pas de toucher à la terre de Van Diemen, je fs route sur la Nouvelle-Zélande et, ne craignant aucun danger, je fs de la voile la nuit ainsi que le jour par un vent très fort, qui fut suivi d’une brume pluvieuse, et d’une grosse houle. Nous continuâmes à trouver de temps à autre, quelques veaux marins, des poules du Port-Egmont et des algues marines.
Le 25, la terre de la Nouvelle-Zélande fut aperçue du haut des mâts et, à midi, on la voyait de dessus le pont, éloignée d’environ dix lieues. Comme je voulais mouiller à la baie Dusky ou à tout autre port que je pourrais trouver dans la partie méridionale de Tavaï Poemammou, je gouvernai sur la terre à toutes voiles, proftant d’un vent frais de l’ouest et d’un temps assez clair, qui ne fut pas cependant de longue durée, car à quatre heures et demie, la côte qui n’était pas à plus de quatre milles se trouva, en quelque manière, masquée par une brume épaisse : nous étions alors devant l’entrée d’une baie que je prenais pour la baie Dusky, trompé par quelques îles qui gisent à son embouchure.
Craignant de courir, pendant la brume, sur une plage que nous ne connaissions pas et voyant à l’avant des brisants et des terres rompues, je revirai par vingt-cinq brasses d’eau et je cinglai au large avec un vent du nord-ouest. Cette baie gît sur le côté méridional du cap ouest : on peut la reconnaître à un rocher blanc qui est sur une des îles à son entrée. Je portai au sud jusqu’à onze heures du soir que je revirai pour gouverner au nord, ayant une mer très grosse et très irrégulière. Le lendemain, à cinq heures du matin, le vent diminua, j’arrivai près de terre et nous entrâmes dans la baie Dusky.
Ainsi se termina notre première campagne à la recherche des terres australes. Depuis notre départ du cap de Bonne-Espérance jusqu’à notre arrivée à la Nouvelle-Zélande, nous essuyâmes toutes sortes de maux : les voiles et les agrès avaient été mis en pièces, le tangage et le roulis du vaisseau très violents, et ses œuvres mortes rompues par la véhémence des secousses.
Contraints de combattre sans cesse l’âpreté d’un élément rigoureux, nous avions été exposés à la pluie, à la grêle et à la neige ; nos agrès étaient toujours couverts d’une glace qui coupait les mains de ceux qui étaient obligés de les toucher. Il nous fallut faire de l’eau avec de la glace, dont les particules salines engourdissaient et scarifaient tour à tour les membres des matelots ; nous courions le danger perpétuel de nous briser contre ces masses énormes de glace qui remplissent la mer australe : l’apparition fréquente et subite de ces périls tenait continuellement l’équipage en haleine pour manœuvrer le vaisseau avec promptitude et avec précision. Le long intervalle que nous passâmes au milieu des fots et le manque de provisions fraîches ne furent pas moins pénibles : les hameçons et les lignes qu’on avait distribués aux équipages avaient jusqu’alors été inutiles, car dans ces latitudes élevées, on ne trouve que des baleines ; et il n’y a que sous la zone torride que l’on puisse pêcher lorsque la profondeur de la mer est grande. Le soleil se montrait très rarement et l’obscurité du ciel et des brumes impénétrables, qui duraient quelquefois plusieurs semaines, inspiraient la tristesse et éteignaient la gaîté des matelots les plus joyeux.
Chapitre 4 —La baie de Dusky. – Entrevue avec les naturels de ce pays.
Le temps était délicieux et l’air très doux. Poussés par un léger souffe de vent, nous avions passé devant un grand nombre d’îles couvertes de bois et des arbres toujours verts offraient un contraste agréable avec la teinte jaune que l’automne répand sur les campagnes. Des troupes d’oiseaux de mer animaient les côtes et tout le pays retentissait d’une musique formée par les oiseaux des forêts. Après avoir souhaité avec tant d’empressement de voir la terre, nos yeux ne pouvaient se rassasier de la contempler et le visage de tout le monde annonçait la joie et la satisfaction.
De superbes points de vue dans le style de Salvator Rosa, des forêts millénaires, de nombreuses cascades, qui se précipitaient de toutes parts avec un doux murmure, contribuaient de toutes parts à notre bonheur, et les navigateurs, à la suite d’une longue campagne, sont si prévenus en faveur du pays le plus sauvage que ce canton de la Nouvelle-Zélande nous semblait le plus beau qu’ait produit la nature. Les voyageurs, après une grande détresse, ont tous des idées semblables, et c’est avec leur imagination qu’ils ont vu les rochers escarpés de Juan Fernandez et les forêts impénétrables de Tinian.
Comme notre mouillage n’était pas trop commode, j’envoyai le lieutenant Pickersgill au côté sud-est de la baie pour en découvrir un meilleur, et j’allai moi-même faire des recherches de l’autre côté, où je trouvai un havre extrêmement resserré. M. Pickersgill dit à son retour qu’il en avait rencontré un très convenable à tous égards. Celui-ci me parut préférable au mien et je résolus d’y aller dans la matinée. Le bateau de pêche était revenu avec assez de poissons pour le souper de tout l’équipage et, pendant quelques heures de la matinée, on en prit une assez grande quantité pour le dîner. J’eus dès lors espérance d’être abondamment pourvu de ce rafraîchissement. Les côtes et les bois semblaient remplis de gibier et nous comptions tous goûter des jouissances que, dans notre situation, on pouvait appeler le luxe de la vie. Ces avantages me déterminèrent à passer quelque temps dans cette baie afn de l’examiner en entier, d’autant plus que personne n’avait jamais débarqué sur aucune des parties méridionales de la Nouvelle-Zélande.
Le 27 mars, j’appareillai avec une brise légère et, manœuvrant sur le havre de Pickersgill, j’y entrai par un canal qui avait à peine deux fois la largeur d’u vaisseau et nous amarrâmes dans une petite crique, à l’avant et à l’arrière, si près de la côte que le sommet d’un grand arbre, que la nature avait, en quelque sorte, préparé pour nous, touchait à notre plat-bord. On trouva ici tant de bois à brûler et tant de bois de mâture, que nos vergues étaient enlacées dans les branches d’arbres et, à environ cent verges de la pompe, il y avait un beau courant d’eau douce. Dans cette position, on commença à préparer au milieu des bois les emplacements nécessaires pour un observatoire astronomique, pour la forge et les tentes des voiliers, des charpentiers et des tonneliers ; car nos ferrures, nos voiles et nos futailles avaient besoin de réparations. Nous étions obligés aussi de débarquer les tonneaux, de faire de l’eau et de couper du bois à brûler. On se mit en outre à brasser de la bière avec les branches ou feuilles d’un arbre qui ressemble beaucoup à la sapinette noire d’Amérique. La connaissance que j’avais de cet arbre et sa ressemblance avec la sapinette me frent juger qu’en y mêlant du jus de moût de bière et de mélasse, on en composerait une bière très saine qui suppléerait aux végétaux qui manquent en cet endroit et l’événement prouva que je ne me trompais pas.
Le petit nombre de chèvres et de moutons qui nous restaient à bord ne devaient pas, suivant toute apparence, être aussi bien nourris que nous, car l’herbe y est peu abondante, grossière et âpre. Quelque mauvaise qu’elle fût, je croyais qu’ils la dévoreraient avec avidité, mais nous fûmes très surpris de voir qu’ils ne voulaient pas en goûter, et qu’ils n’aimaient pas mieux des plantes plus tendres. En les examinant, on reconnut que leurs dents étaient relâchées et que plusieurs avaient tous les symptômes d’un scorbut invétéré. Des quatre brebis et des béliers pris au Cap dans le dessein de les laisser à la Nouvelle-Zélande, je n’avais pu conserver qu’un mâle et une femelle et, même, ils étaient tellement malades malgré tous nos soins que nous craignions qu’ils n’en mourussent.