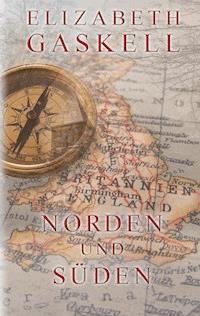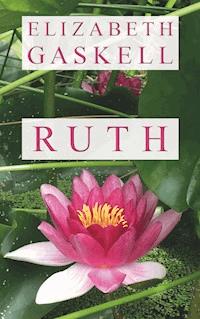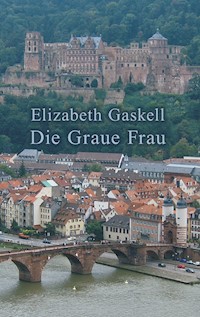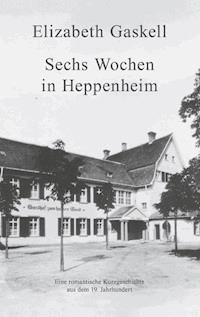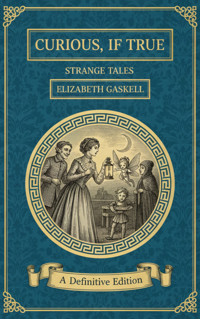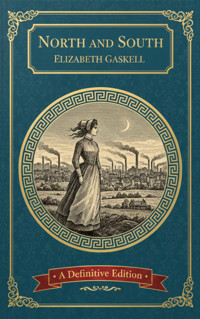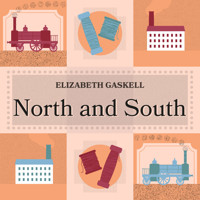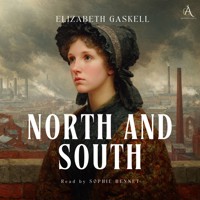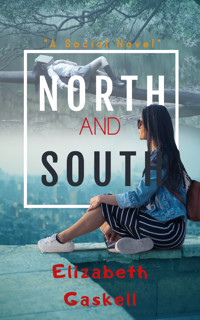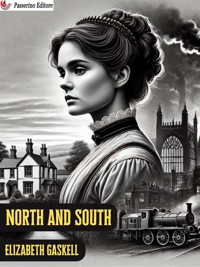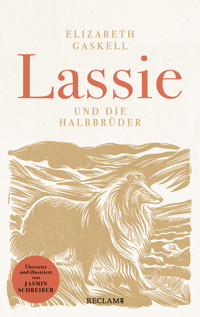Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Autour du sofa" est une collection captivante de récits courts écrits par Elizabeth Gaskell, une auteure britannique renommée du XIXe siècle. Dans cet ouvrage, Gaskell invite ses lecteurs à se rassembler autour du "sofa", symbole du confort domestique victorien, pour écouter des histoires variées, chacune offrant un aperçu des complexités de la vie humaine. Les récits qui composent "Autour du sofa" explorent une gamme diversifiée de thèmes, allant des mystères et des drames sociaux aux histoires empreintes de surnaturel. Gaskell, avec son style caractéristique, tisse des portraits riches et nuancés de ses personnages, qu'ils soient membres de la haute société ou issus des classes laborieuses. Chaque histoire est imprégnée de sa profonde empathie pour les luttes humaines, ainsi que de son habileté à capturer les détails de la vie quotidienne dans l'Angleterre victorienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
AUTOUR DU SOFA.
LADY LUDLOW
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
CHAPITRE XIII.
CHAPITRE XIV.
UNE RACE MAUDITE
LA DESTINÉE DES GRIFFITH.
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
LES DEUX FRÈRES.
AUTOUR DU SOFA.
Mes parents m’avaient envoyée à Édimbourg afin d’y recevoir les soins d’un certain M. Dawson qui avait la réputation de guérir le genre de maladie dont j’étais alors atteinte. Accompagnée de miss Duncan, mon institutrice, je devais profiter des excellents maîtres que renferme l’ancienne capitale de l’Écosse, et suivre leurs préceptes en même temps que les prescriptions du docteur. Il me fut bien douloureux de quitter ma famille, d’abandonner la vie joyeuse que mes sœurs et mes frères menaient à la campagne, et de remplacer notre grande maison, pleine de lumière et de soleil, par le petit appartement sombre et enfumé où je me trouvai seule avec ma gouvernante, qui était silencieuse et grave par nature. Il me fut bien pénible d’échanger nos courses à travers les prés et les bois, nos jeux bruyants dans le jardin, pour des promenades dans la ville, où il fallait se tenir droite, avoir son châle mis d’une façon régulière, et son chapeau soigneusement attaché.
Les soirées surtout me paraissaient horriblement tristes ; nous étions en automne, et chaque jour elles s’allongeaient davantage ; elles étaient pourtant déjà bien assez longues quand nous prîmes possession de notre vilain petit logement, tapissé de papiers gris et bruns. Ma famille n’était pas riche, nous étions beaucoup d’enfants ; les soins de M. Dawson, le traitement qu’il me faisait suivre devaient être fort coûteux, et il fallait apporter la plus stricte économie dans nos dépenses quotidiennes.
Mon père, trop véritable gentleman pour en éprouver une fausse honte, avait fait part de cette nécessité à M. Dawson, et celui-ci nous avait indiqué une maison de Cromerstreet, où finalement nous nous étions établies. Cette maison appartenait à un ancien professeur, qui préparait autrefois les jeunes gens pour l’université. Il n’avait plus de pensionnaires à l’époque où nous l’avons connu, et j’imagine que le prix de notre loyer formait, avec un petit nombre de leçons accidentelles, son principal moyen d’existence.
Notre propriétaire avait une fille qui lui servait de femme de charge, et un fils qui suivait probablement la carrière paternelle, bien que jamais on n’entendît parler de ses élèves. Une honnête petite Écossaise, trapue, carrée, aussi propre que laide, travaillant ferme et dur, et qui pouvait avoir de dix-huit à quarante ans, complétait le personnel de la maison.
Lorsque aujourd’hui, regardant en arrière, je me rappelle cette famille, je ne puis m’empêcher d’admirer la façon calme et digne dont elle supportait les rigueurs d’une pauvreté décente. Mais à l’époque où nous habitions les chambres garnies du vieux professeur, je critiquais avec amertume l’absence de goût qui avait présidé à notre ameublement. J’ignorais qu’à la ville une corbeille de fleurs est un luxe réservé au petit nombre, que l’entretien des rideaux de mousseline, des tentures de perse à fond blanc, occasionnent des frais de blanchissage que l’on économise par l’emploi de ces étoffes de laine couleur de poussière qui révoltaient mes yeux. Pas un sou n’avait été dépensé pour donner au salon quelque peu d’élégance ; et les meubles, strictement indispensables, dont on l’avait garni, étaient loin d’offrir les avantages qu’au premier abord ils faisaient espérer. Le sofa, recouvert d’une étoffe de crin, noire, dure et glissante, n’était nullement un lieu de repos : le vieux piano servait de buffet, la grille de la cheminée, réduite à sa dernière expression par un appendice intérieur, permettait à peine d’y entretenir un feu de veuve. Mais la nudité de ces pièces, froides et mal closes, n’était pas le seul inconvénient que je reprochais à notre logis. On nous avait pourvues d’un passe-partout qui nous donnait le moyen d’ouvrir la porte extérieure et de monter l’escalier sans déranger personne, de manière qu’on rentrait sans recevoir le moindre accueil, sans entendre une voix humaine dans cette maison, qui paraissait abandonnée. M. Mackensie, notre propriétaire, ne manquait pas de faire valoir, comme un précieux avantage, le silence qui régnait dans sa demeure, avantage qui pour moi la faisait ressembler à une tombe. Un autre inconvénient, qui semblerait contredire mes paroles, était le danger que nous courions sans cesse de voir apparaître le vieux professeur à la porte de sa chambre, au moment où nous passions. Le fin matois nous faisait alors, d’un air timide et rusé, quelques offres polies qui n’étaient qu’un prétexte pour nous soutirer de l’argent, et dont le refus devenait presque impossible. C’étaient quelques volumes qu’il me priait de choisir dans sa bibliothèque, en ayant soin d’ajouter, au moment où je cédais à ses instances, que le prix de la location d’ouvrages aussi précieux ne pouvait être évalué d’après le tarif des cabinets de lecture. Une autre fois il m’abordait, les mains pleines de cartes manuscrites, en me priant de les distribuer parmi mes connaissances, cartes qui n’étaient autre chose que le programme de mes études avec la promesse de me faire faire les progrès les plus rapides ; mais j’aurais cent fois mieux aimé être la plus ignorante des femmes que d’avoir ce vieux renard pour maître. Il en résulta qu’ayant fini par décliner toutes ses propositions, nous eûmes à subir les conséquences de sa mauvaise humeur : telles que de rester à la porte sans pouvoir nous faire ouvrir, lorsque par aventure nous avions oublié notre clef, tandis que le vilain homme prenait l’air à sa fenêtre, où il paraissait plongé dans une méditation philosophique, dont notre appel ne parvenait pas à le distraire.
Les femmes de la maison étaient meilleures, bien que la pauvreté, en pesant sur elles, eût vicié leur nature. Miss Mackensie retranchait à nos repas tout ce qu’elle pouvait décemment nous rogner. Si par hasard, ayant moins d’appétit que la veille, nous laissions quelque chose au fond du plat, elle s’en autorisait pour nous mettre à la portion congrue jusqu’à ce que ma gouvernante lui en eût fait des reproches.
L’Écossaise courte et grosse, qui faisait tout dans la maison et qu’on appelait Phénix, était d’une probité scrupuleuse, mais elle avait toujours l’air mécontent, malgré notre générosité. Je suis sûre que les Mackensie ne lui donnaient pas un sou de gages et qu’elle n’avait pour tout payement que les pièces des locataires. Mistress Dawson, qui le supposait avec nous, prétendait que la pauvre fille était heureuse de nous avoir, car elle affirmait que nous donnions, pour le service, autant que dans les maisons les mieux meublées.
Cette chère mistress Dawson ! toutes les fois que son nom traverse mon esprit, il me semble qu’un rayon de soleil vient éclairer le salon obscur du professeur, ou que le parfum des violettes s’élève d’un sentier que je parcours avec tristesse.
C’était la sœur et non la femme de mon médecin ; une pauvre infirme qui, selon son expression, avait reçu bien jeune son brevet de vieille fille.
Quinze jours après notre arrivée chez les Mackensie, M. Dawson avait dit à miss Duncan :
« Ma sœur m’a chargé de vous dire que tous les lundis soir quelques personnes viennent causer autour du sofa où elle est étendue ; les uns nous quittent pour aller dans le monde, les autres restent un peu plus longtemps ; si vous croyez que cela puisse vous offrir la moindre distraction, ainsi qu’à miss Great, nous serons heureux de vous recevoir. On arrive entre sept et huit, et je vous préviens qu’on se retire à neuf heures. Je ne suis pas bien sûr que cela vaille la peine de se déranger ; toutefois, Marguerite m’ayant prié de vous avertir, j’ai dû faire sa commission. »
Le docteur avait dit ces paroles d’une voix mal assurée ; il attachait sur nous un regard attentif, et s’il avait découvert le moindre signe qui témoignât de notre répugnance à répondre à l’engagement qu’il nous faisait, je ne doute pas qu’il n’eût aussitôt retiré sa demande, tant il était chatouilleux à l’égard de tout ce qui concernait sa sœur.
Mais c’eût été pour aller chez le dentiste, que j’aurais accueilli une invitation avec plaisir, tellement j’étais fatiguée de notre existence monotone. Quant à ma gouvernante, c’était à son sujet une marque d’estime trop flatteuse pour qu’elle ne s’empressât pas d’accepter. Le regard perçant du docteur ne découvrit donc, sur notre visage, que l’expression d’une joie sincère, et l’excellent homme reprit la parole avec plus d’assurance :
« Vous trouverez cela fort ennuyeux, dit-il ; excepté quelques anciens amis, de vieux barbons de mon espèce, et une ou deux jeunes femmes d’une bonté parfaite, je ne sais pas qui pourrait venir à nos lundis. Marguerite a la vue trop faible pour supporter la lumière, et le salon est fort peu éclairé ; vous voyez que cela n’a rien d’attrayant. Ne me remerciez pas avant d’en avoir fait l’épreuve ; si vous êtes satisfaites, la meilleure façon de nous exprimer votre gratitude, sera de revenir tous les lundis, de sept à neuf heures. Adieu, miss, adieu, ou plutôt à revoir. »
Je n’avais encore assisté qu’à des réunions d’enfants, et jamais bal de la cour ne parut être un plus grand honneur, et ne promit plus de plaisir à une jeune fille de Londres, que je n’en rêvais à propos de cette soirée du lundi.
Vêtue classiquement d’une robe de mousseline blanche, toute neuve et fortement empesée, que notre vieille bonne m’avait faite en prévision d’une pareille circonstance, et qui me paraissait, ainsi qu’à mes sœurs, le nec plus ultra de la parure, je me rendis avec miss Duncan chez M. Dawson, à l’heure que celui-ci nous avait indiquée.
Nous traversâmes une antichambre assez vaste (la maison était ancienne et ne manquait pas d’une certaine splendeur), et de cette antichambre on nous introduisit dans un grand salon carré, au milieu duquel le sofa de mistress Dawson avait été placé. Derrière la pauvre infirme, un candélabre à sept ou huit branches était posé sur une table ; c’était le seul éclairage de cette énorme pièce, dont les proportions m’étonnèrent, surtout en les comparant à celles des chambres rétrécies que nous occupions chez le professeur. Mistress Dawson devait avoir la soixantaine ; sa figure était fine et transparente, ses cheveux gris auraient paru tout à fait blancs, si ce n’avait été son bonnet d’une blancheur de neige, et le ruban de satin qui en formait les nœuds. Elle était enveloppée d’une espèce de robe de chambre en cachemire français, d’un gris perle. Les meubles du salon, rose foncé, avec une monture blanc et or, se détachaient sur une tenture de papier de l’Inde, couverte dans sa partie inférieure de feuillages et d’oiseaux des tropiques, dont la profusion diminuait graduellement, et qui n’offrait plus, vers la corniche, qu’un réseau de brindilles légères, parsemé d’insectes d’une délicatesse infinie. Les encoignures étaient ornées de grands vases de porcelaine de Chine, remplis de feuilles odorantes, de fleurs séchées et d’aromates. C’est au milieu de tout cela qu’était placée la chaise longue où mistress Dawson passait tous ses jours depuis bien des années.
La femme de chambre apporta du thé et des macarons qui nous furent offerts, et une petite tasse de lait coupé d’eau, que mistress Dawson prit avec un biscuit. Nous étions arrivées de bonne heure et nous nous trouvions seules avec la maîtresse de la maison ; toutefois quelques instants après des hommes de lettres, des femmes élégantes, des célébrités dans tous les genres furent annoncées tour à tour. Chacun allait, en partant, dans une réunion plus brillante ; mais ils venaient d’abord visiter miss Dawson, lui dire leurs bons mots et lui confier leurs projets. Savants et jeunes filles la considéraient également comme une amie qui en savait plus sur leur compte, et s’intéressait plus à eux que toute autre personne au monde.
Cette réception, où l’esprit et la grâce prêtaient leur éclat à l’amitié la plus franche, avait quelque chose d’éblouissant et vous laissait un souvenir à la fois plein d’enseignement et de charme.
Tous les lundis nous allions nous asseoir auprès de mistress Marguerite et nous prêtions une oreille attentive à ce que l’on disait autour de nous. L’hiver s’écoula sans apporter d’amélioration sensible à mon état de souffrance, malgré l’espoir que me donnait toujours le docteur de guérir complètement. L’été arriva ; mistress Dawson m’était devenue bien chère, quoique je n’eusse pas échangé avec elle plus de paroles qu’avec miss Mackensie ; mais les moindres mots qui sortaient de sa bouche étaient de véritables perles.
C’était la saison où l’on quitte Édimbourg ; la plupart des connaissances du docteur étaient parties pour la campagne ; je ne suis pas bien sûre que nos lundis n’en fussent pas plus agréables. Parmi les fidèles, se trouvaient M. Preston, gentilhomme du Westmoreland, qui préférait à son titre d’écuyer celui d’homme politique, et M. Spérano, exilé de Venise, banni même de France, où il avait longtemps résidé, et qui donnait maintenant des leçons de langue italienne dans la vieille capitale de l’Écosse.
Un lundi soir, j’avais poussé un petit tabouret à côté du sofa, je m’étais assise auprès de miss Marguerite, et, lui prenant la main, je lui demandai, je ne sais par quelle fantaisie, combien il y avait de temps qu’elle habitait Édimbourg. « Vous ne parlez pas écossais, ajoutai-je, et M. votre frère m’a dit que vous n’étiez pas de ce pays-ci.
— Non, répondit-elle en souriant, je suis née à Liverpool ; est-ce que vous ne le voyez pas à ma prononciation ?
— J’entends bien qu’elle diffère un peu de celle des autres ; mais elle me plaît, comme toutes les choses qui viennent de vous ; est-ce qu’on parle ainsi dans le Lancashire ?
— Hélas ! oui. Cette bonne lady Ludlow s’est pourtant donné bien de la peine, quand j’étais jeune, pour corriger mon accent ; mais il m’a été impossible de saisir celui qu’elle voulait me faire prendre.
— Voilà plusieurs fois, repris-je, que vous nous parlez de cette bonne lady Ludlow ; qui est-elle donc ? vous paraissez beaucoup l’aimer.
— Il y a bien des années qu’elle est morte, chère enfant. »
Je regrettais d’avoir évoqué ce triste souvenir, qui avait assombri la figure de mistress Dawson ; mais elle s’en aperçut et me dit avec bonté :
« J’aime à penser à elle, et je m’entretiens avec plaisir du temps où je l’ai connue ; elle a été ma bienfaitrice, mon amie ; j’ai passé auprès d’elle plusieurs années, dont je me souviens avec bonheur ; questionnez-moi donc à son égard, si cela vous intéresse, et ne craignez pas de m’attrister.
— Dites-nous alors tout ce que vous savez d’elle ? lui demandai-je, encouragée par la réponse qui m’était faite.
— Ce serait bien long, répliqua miss Marguerite. Il n’est pas probable que le signor Spérano, M. Preston et miss Duncan voulussent écouter une vieille histoire qui, après tout, n’en serait pas une, car mon récit n’aurait ni queue ni tête, et ne serait qu’un amas de souvenirs plus ou moins bien réunis.
— Quant à moi, madame, dit le signor Spérano, je puis vous assurer qu’il me sera toujours fort agréable d’écouter ce que vous voudrez bien nous dire. »
Miss Duncan balbutia quelque phrase dans le même genre. M. Preston appuya la demande que nous faisions tous ; et miss Marguerite consentit à nous parler de lady Ludlow, à condition toutefois que chacun de nous ferait ensuite un récit quelconque. La chose fut acceptée avec empressement, et nous nous rapprochâmes du sofa pour mieux entendre ce qu’allait nous dire miss Dawson.
LADY LUDLOW
CHAPITRE I.
Je suis maintenant une vieille femme, nous dit Marguerite, et les choses sont bien changées depuis ma jeunesse. Ceux qui voyageaient alors n’avaient à leur service que des diligences contenant une douzaine de personnes, et qui mettaient deux jours pour parcourir l’espace que l’on franchit actuellement en deux heures. On n’avait la poste que deux fois par semaine, et, dans certaines villes que j’ai habitées jadis, le courrier n’arrivait qu’une fois par mois. Il est vrai qu’à cette époque c’étaient de véritables lettres qu’il nous apportait ; des lettres précieuses qu’on relisait avec soin, qu’on étudiait comme un livre, et qu’on gardait toujours. À présent qu’on a le facteur matin et soir, vous n’avez plus qu’un petit nombre de lignes griffonnées à la hâte, et n’ayant aucun sens ; des billets qui la plupart du temps ne renferment qu’une ou deux phrases tellement brèves, que les gens bien élevés n’oseraient pas vous les dire. C’est un progrès, dites-vous, et je veux bien vous en croire ; toujours est-il que vous ne trouveriez pas aujourd’hui une seule lady Ludlow. Je vais essayer de vous parler d’elle ; mais ainsi que je vous le disais tout à l’heure, ce n’est pas une histoire suivie que je vais vous raconter.
Je suis la fille d’un pauvre ecclésiastique dont les enfants étaient nombreux. Ma mère était de noble origine ; quand elle voulait maintenir son rang et faire preuve de noblesse parmi les gens avec qui elle était forcée de vivre (de riches manufacturiers démocrates, partisans de la révolution française), elle mettait une paire de manchettes, garnies d’un vieux point d’Angleterre excessivement usé, mais dont tout l’or du monde n’aurait pu acheter le pareil, car le secret de sa fabrication était perdu depuis longtemps. Ces manchettes prouvaient, comme le disait ma mère, que ses ancêtres avaient eu de la naissance, tandis que les grandspères de ces riches négociants qui la regardaient avec mépris, n’avaient jamais été nés, si toutefois ces vilains avaient eu des grands-pères.
Je ne sais pas si, en dehors de notre famille, quelqu’un a jamais fait attention à ces fameuses manchettes ; tout ce que je peux dire, c’est qu’on nous avait élevés dans un sentiment de vénération pour elles, qu’on nous avait appris à ressentir une juste fierté quand elles ornaient les bras de ma mère, et qu’alors nous relevions la tête comme il convenait aux descendants de la noble dame qui la première avait possédé cette illustre dentelle. Mon père nous disait bien que l’orgueil était un grand péché ; il nous enseignait généralement à pratiquer l’humilité chrétienne, et la seule chose dont il nous fût permis de nous enorgueillir était ces vénérables manchettes ; ma mère se trouvait d’ailleurs si heureuse quand elle avait l’occasion de les porter, souvent hélas ! avec une robe de velours dont on voyait la corde, que même aujourd’hui, après la triste expérience que m’ont laissée les années, je les considère toujours comme un bienfait pour la famille. Vous pensez que je m’égare et que nous voilà bien loin du sujet de mon histoire ; pas du tout : Ursule Hanbury, l’honorable dame à qui les manchettes avaient appartenu d’abord, était à la fois la trisaïeule de ma mère et celle de lady Ludlow. C’est pourquoi lorsque mon père vint à mourir, laissant neuf orphelins sans fortune, lady Ludlow adressa, en réponse au cri de désespoir de la veuve, l’offre de venir à son secours pour élever sa famille. Je vois encore la lettre de milady : une grande feuille de papier jaune, épais et raboteux, avec une marge bien alignée, une belle écriture ronde qui, en dépit de sa grosseur, faisait tenir plus de mots dans le même carré de papier que les pattes de mouches imperceptibles des jeunes filles de nos jours. Le cachet portait un écusson en losange, car milady était veuve ; ma mère nous en fit remarquer la devise : « Foy et Loy, » et nous montra les armes d’Hanbury, dont celles des Ludlow étaient écartelées. J’imagine qu’elle redoutait le contenu de cette lettre et qu’elle se donnait un prétexte pour en retarder la lecture. Dans sa sollicitude pour nous, elle avait écrit à une foule de personnes afin de réclamer leur protection ; et la froideur, la dureté des réponses qu’elle avait reçues lui avaient fait verser bien des larmes.
Je ne crois pas qu’elle eût jamais vu lady Ludlow ; quant à moi, tout ce que je savais de milady, c’est qu’elle appartenait à la haute aristocratie, et que son arrièregrand’mère avait été la sœur consanguine de notre trisaïeule du côté maternel. Je regardai par-dessus l’épaule de ma mère, et je vis que la lettre débutait par ces mots : « Bien chère cousine. » Il me sembla qu’oh pouvait espérer, du moment qu’elle employait ces paroles ; la suite de la lettre prouva que j’avais raison.
« Bien chère cousine, disait donc lady Ludlow, j’ai appris avec beaucoup de chagrin la perte que vous avez faite par la mort d’un aussi bon mari, d’un ecclésiastique aussi parfait que l’a toujours été mon cousin Richard Dawson. »
« Tiens, dit ma mère en mettant le doigt sur ce passage, lis tout haut ces quelques lignes, afin que les enfants apprennent combien la réputation de leur père était grande, pour qu’une personne qui ne l’a jamais vu puisse en parler en ces termes. Cousin Richard ! comme Sa Seigneurie écrit bien ! Continue, Marguerite. »
Elle s’essuya les yeux et mit un doigt sur ses lèvres pour imposer silence à ma petite sœur Cécile, qui, ne pouvant pas comprendre l’importance de la lettre, commençait à jaser.
« Vous restez avec neuf enfants, écrivait milady ; j’en aurais également neuf si tous les miens vivaient encore ; mais je n’ai plus que mon Rudolph, qui est à présent lord Ludlow. Il est presque toujours à Londres, ou en voyage, et il est assez rare que je jouisse de sa présence ; mais j’ai pris avec moi au château d’Hanbury, que j’habite, six jeunes personnes bien nées que je considère comme mes filles, excepté que je ne leur permets pas un certain luxe de table et de toilette qui conviendrait à une position de fortune supérieure à celle de leurs familles. Ces jeunes personnes, qui sont toutes de condition, malgré leur peu de fortune, ne me quittent presque jamais, et je fais tous mes efforts pour remplir à leur égard les devoirs d’une femme chrétienne. L’une de ces jeunes filles est morte au mois d’avril, pendant une visite qu’elle faisait à ses parents ; voudriez-vous m’accorder la faveur de permettre à votre fille aînée de la remplacer auprès de moi. Je me charge de l’entretien de mes jeunes compagnes et leur donne tous les mois une petite somme comme argent de poche. Elles ont peu l’occasion de s’établir, Hanbury se trouvant fort loin d’une ville quelconque. Notre ecclésiastique est vieux et sourd, et mon régisseur est marié ; quant aux fermiers des environs, ils ne sont pas faits pour attirer les regards des jeunes filles placées sous mon patronage. S’il arrive néanmoins que l’une d’elles trouve un parti qui lui convienne, et que je sois satisfaite de sa conduite, je me charge du repas de noces et du trousseau, que je lui donne au grand complet. Celles qui resteront avec moi jusqu’à ma mort seront assurées par mon testament d’une pension qui leur permettra de vivre d’une manière convenable. Je me réserve de payer les voyages qu’elles peuvent avoir à faire, ne voulant pas qu’elles en entreprennent d’inutiles, et désirant, d’un autre côté, ne pas affaiblir les liens de famille par une trop longue absence de la maison paternelle. Si mes propositions vous conviennent, je ne parle pas de votre fille, je la suppose trop bien élevée pour avoir une volonté différente de la vôtre, faites-le-moi connaître, chère cousine Marguerite, et je m’arrangerai pour faire prendre la jeune personne à Cavistok, où la diligence la déposera. »
Ma mère laissa tomber la lettre et finit par dire au bout de quelques instants :
« Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi, Marguerite ! »
Jusqu’ici, la pensée de changer de place, d’embrasser un nouveau genre de vie, m’avait paru fort agréable ; mais quand je vis le regard douloureux de ma pauvre mère et que j’entendis pleurer les enfants, je renonçai bien vite à l’existence qui m’était proposée.
« Non, reprit ma mère en secouant la tête, il vaut mieux que tu t’en ailles. Lady Ludlow est toute-puissante ; elle pourra placer tes frères, et nous ne devons pas la désobliger en refusant tout d’abord ce qu’elle veut bien nous offrir. »
Après y avoir mûrement réfléchi, cette décision fut confirmée ; nous acceptâmes les offres qui nous étaient faites, et c’est ainsi que je fis connaissance avec lady Ludlow.
Je me rappelle mon arrivée au château d’Hanbury comme si elle était d’hier. La malle-poste m’avait déposée dans la ville où je devais m’arrêter :
« N’êtes-vous pas miss Dawson et n’allez-vous pas à Hanbury-Court ? Un vieux domestique vous attend, » me dit l’aubergiste, qui me toisa des pieds à la tête. Je compris alors ce qu’il y avait de pénible à se trouver tout à coup au milieu d’étrangers, et il me fallut tout mon courage pour ne pas défaillir lorsque je perdis de vue la personne à qui j’avais été confiée par ma mère. Je fus enfin perchée dans une espèce de cabriolet qu’on appelait alors une chaise, et nous traversâmes, mon compagnon et moi, le pays le plus champêtre que vous ayez jamais vu.
Arrivés au bas d’une montée assez longue, mon conducteur mit pied à terre et marcha près de son cheval ; j’aurais voulu en faire autant, mais je n’osais pas demander à ce brave homme de m’aider à descendre, et je restai dans la voiture. En haut de la côte se trouvait une grande plaine balayée par le vent, et qu’on nommait la chasse. Le vieux groom s’arrêta, reprit haleine, caressa son cheval en lui frappant sur le cou, et vint se remettre à côté de moi. »
« Sommes-nous bientôt arrivés, lui demandai-je.
— Ah bien ! oui, miss : nous avons encore une dizaine de milles à faire. »
Une fois la conversation entamée, elle ne s’arrêta plus. J’imagine que le pauvre homme avait été comme moi, et n’avait pas osé rompre le silence ; mais il domina sa timidité plus aisément que je ne triomphai de la mienne, et c’est lui qui se chargea d’alimenter l’entretien. J’eus alors des récits interminables dont il m’était impossible de comprendre l’intérêt ; par exemple, celui d’une chasse que lui avait donnée un certain chien courant dont il avait été poursuivi, il y avait de cela trente et quelques années, chasse qu’il me racontait en me signalant tous les couverts, tous les détours de l’endroit où elle avait eu lieu, comme si la topographie m’en avait été connue ; et je m’étonnais de cette épithète de courant qu’il donnait au chien en question, ne voyant pas que la faculté de courir fût, chez une bête de cette espèce, un caractère distinctif dont il fallût tenir compte.
La route devint de plus en plus mauvaise au sortir de la plaine. Il n’est personne aujourd’hui qui, n’ayant pas vu les chemins qu’on avait il y a cinquante ans, puisse s’en faire une idée. C’est tout au plus si notre bête parvenait à nous sortir des ornières profondes où notre gig était logé, suivant l’expression du vieux Randal, et je ne voyais plus rien autour de moi, tant j’étais préoccupée de me retenir à la banquette pour ne pas être lancée au dehors par les cahots épouvantables qu’il nous fallait subir. J’aurais bien fait la route à pied ; mais j’aurais eu de la boue jusqu’à mi-jambe, et il était impossible de se présenter dans un pareil état devant Sa Seigneurie, que j’aurais scandalisée. Nous finîmes enfin par aborder au milieu d’un pâturage où, ayant la perspective de marcher à pied sec, je priai Randal de m’aider à sortir de voiture, ce qu’il fit avec joie par pitié pour sa bête, dont la robe était fumante.
Le pâturage descendait graduellement jusqu’à un basfond qui se déployait entre deux rangées d’ormes séculaires, indiquant sans doute qu’une avenue avait existé jadis à l’endroit où ils s’élevaient ; ce n’était plus aujourd’hui qu’une gorge remplie d’herbe où nous entrâmes au coucher du soleil. Tout à coup je me trouvai en face d’une certaine quantité de marches qui m’arrêtèrent et me firent tourner les yeux vers mon guide.
« Si vous voulez bien descendre l’escalier, me dit Randal, je vais faire le tour et je vous reprendrai en bas ; madame serait mécontente si vous n’arriviez pas en voiture.
— Est-ce que nous sommes près du château ? m’écriai-je toute suffoquée en y pensant.
— Ne le voyez-vous pas là-bas ? » me répondit mon compagnon en désignant avec son fouet un groupe de cheminées armoriées qui détachaient leur silhouette brune sur le fond rouge du ciel, et qui se trouvaient de l’autre côté d’une grande pelouse carrée, située au bas de la pente rapide que j’avais à descendre.
Randal s’éloigna, je le retrouvai au bas de l’escalier, où je remontai dans le gig ; nous prîmes un chemin détourné qui nous conduisit à la grille et nous entrâmes dans la cour d’honneur.
Le château d’Hanbury est un vaste édifice, bâti en brique et en pierre dans le style de Hampton-Court. Les pignons élevés, les portails en plein cintre et les meneaux en pierre de taille que l’on remarque derrière le corps de logis principal, indiquaient, suivant lady Ludlow, que c’était autrefois un prieuré. On voit encore le parloir du prieur, que nous appelions tout bonnement la chambre de mistress Medlicott ; de plus une énorme grange où l’on mettait la dîme et qui est aussi haute qu’une église ; enfin une série de viviers où les moines trouvaient du poisson pour le carême et pour tous les jours maigres. Mais je ne vis pas cela tout d’abord ; à peine si, en arrivant, j’aperçus l’admirable bignonia qui, disait-on, avait été planté par l’un des ancêtres de lady Ludlow, et qui couvrait la façade ; j’éprouvais à quitter Randal autant de chagrin que j’en avais eu à me séparer de mon chaperon de la diligence ; c’était un ami de trois heures, le seul que j’eusse dans la maison. Il fallait néanmoins s’y résigner, entrer dans le château, passer devant le majestueux valet de chambre qui, debout, auprès de la porte, la tenait ouverte à deux battants, franchir la grande salle à droite du vestibule, suivre le vieux gentleman, qui prit à gauche, traversa plusieurs salons donnant sur un magnifique jardin rempli de fleurs, et monta quatre marches en sortant d’une antichambre qui suivait le dernier salon ; enfin mon guide écarta une lourde portière de soie et je me trouvai tout à coup en face de Sa Seigneurie.
Lady Ludlow était de fort petite taille, mais elle n’en perdait pas une ligne ; elle portait un bonnet de dentelle, d’une dimension démesurée, qui lui couvrait la tête sans descendre le long des joues ; ceux qui attachent sous le menton ne furent à la mode que plus tard ; nous les appelions des populaires, et milady, qui les méprisait souverainement, prétendait qu’on ne devait les mettre que pour aller se coucher. Une fontange de satin blanc fixait la coiffure de lady Ludlow, dont la toilette se composait d’un beau fichu de mousseline de l’Inde croisé sur la poitrine, d’un tablier pareil au fichu, d’une robe de soie noire avec des manches plates et courtes, à manchettes de dentelles ; la jupe, très-ample et à queue, était relevée dans l’ouverture de la poche de manière à faciliter la marche, et laissait voir un jupon quadrillé en satin lilas. Sa Seigneurie avait les cheveux blancs comme la neige, et presque entièrement cachés par son bonnet ; malgré son âge elle avait la peau fine et blanche, de grands yeux d’un bleu foncé qui devaient avoir été superbes, et ce qu’elle avait eu de mieux dans la figure, car le nez et la bouche n’avaient rien de particulier. Une canne à pomme d’or était à côté de son fauteuil ; mais c’était moins pour en faire usage que comme insigne honorifique ; elle ne s’en servait jamais que dans les grandes occasions, et parcourait le château et les jardins, toutes les fois qu’elle était seule, d’un pas aussi léger, d’une allure aussi vive qu’une jeune fille de quinze ans.
Milady était debout lorsque je fus introduite auprès d’elle ; je fis en entrant la révérence que ma mère m’avait apprise comme faisant partie d’une bonne éducation, et je m’approchai de Sa Seigneurie ; au lieu de me tendre la main, elle se leva sur la pointe de ses petits pieds, et m’embrassa sur les deux joues.
« Vous avez froid, dit-elle ; mais un peu de thé vous réchauffera ; nous allons en prendre ensemble. »
Elle agita une petite sonnette qui se trouvait sur la table ; une femme de chambre arriva, prit les ordres de sa maîtresse, et reparut quelques instants après avec deux petites tasses de porcelaine de Saxe remplies de thé, qui sans doute nous attendait, et quelques tartines de beurre d’une délicatesse désespérante ; j’en aurais mangé la totalité sans me rassasier le moins du monde, tant ce voyage au fond des ornières avait aiguisé mon appétit. La femme de chambre s’empara de mon manteau ; j’allai m’asseoir, tout effrayée du silence de cette femme, qui allait et venait sans qu’on entendît ses pas ; et, déconcertée par la voix douce, la parole nette et facile de milady, je laissai tomber ma petite cuiller dans ma soucoupe ; il en résulta un son aigu, tellement inconvenant, que j’en devins rouge jusqu’aux oreilles ; Sa Seigneurie leva les yeux, nos regards se rencontrèrent, elle comprit mon embarras.
« Vous avez les doigts glacés, dit-elle d’un air affable ; ôtez vos gants, chère petite (de bons gros gants, en peau de daim, que je n’avais pas osé défaire sans y être invitée). Les soirées sont très-froides, ajouta Sa Seigneurie, mais je vais vous réchauffer. » Elle prit mes grandes mains rouges dans les siennes, qui étaient mignonnes, blanches et douces, et couvertes de bagues éblouissantes ; puis, me regardant d’un air pensif : « Pauvre enfant ! reprit lady Ludlow, neuf orphelins dont vous êtes l’aînée ! J’aurais une fille qui serait précisément de votre âge ; il m’est impossible de me la figurer dans la même position. » Elle resta silencieuse pendant quelques minutes ; puis elle appela mistress Adam, celle de ses femmes qui était spécialement attachée à son service, et la pria de me conduire dans ma chambre.
Je crus entrer dans une cellule tant cette pièce était petite ; les murailles en étaient passées à la chaux ; un lit drapé de basin, deux chaises et deux tapis rouges en composaient l'ameublement. L’armoire et le lavabo se trouvaient à côté, dans un cabinet minuscule. Il y avait sur la muraille, en face du lit, quelques versets de l'Écriture sainte ; au-dessous pendait une gravure, assez commune alors, représentant le roi George et la reine Charlotte avec leurs nombreux enfants, y compris la petite princesse Amélie dans son chariot. D’un côté de cette gravure était le portrait de Louis XVI, faisant pendant à celui de Marie-Antoinette. Une petite boîte et un livre de prières garnissaient la cheminée ; je ne me rappelle pas qu’il y eût autre chose dans ma cellule.
Personne ne songeait à cette époque aux bureaux, aux guéridons, aux chiffonnières, aux écritoires, aux fauteuils indispensables de nos jours ; et l’on n’allait dans sa chambre que pour y faire sa toilette, y prier et dormir. On m’appela pour souper ; je descendis avec la jeune fille qui était venue m’avertir, et qui me conduisit dans la grande salle que j’avais traversée en arrivant ; j’y trouvai mes autres compagnes debout et silencieuses, et qui, lorsque j’ouvris la porte, me firent la révérence. Leur costume, qui me parut être une espèce d’uniforme, se composait d’un bonnet à rubans bleus, d’un fichu croisé en mousseline unie, d’un tablier de linon et d’une robe de laine couleur tabac d’Espagne. Je vis sur la table deux poulets froids, une salade, et une tarte aux fruits que l’on nous destinait. Le fond de la pièce était occupé par un dais surmontant une estrade où l’on arrivait par quelques marches, et où l’on voyait sur un guéridon, un pot au lait en argent, une tasse et un petit pain ; près du guéridon était un fauteuil en bois sculpté dont le dossier blasonné portait une couronne de comte.
Je pensais en moi-même que ces demoiselles auraient bien pu m’adresser la parole ; mais chacune était fort timide, et je ne l’étais pas moins. D’ailleurs, je venais à peine d’arriver par la petite porte, que Sa Seigneurie entra par une autre, qui était à côté de l’estrade ; nous lui fîmes une profonde révérence ; elle resta debout et me présenta à mes compagnes en leur recommandant de me faire un bon accueil ; je fus dès lors traitée avec la politesse obligeante que l’on doit à une étrangère, toutefois sans qu’on me parlât d’autre chose que de ce qui avait rapport au souper. Lorsque nous eûmes fini de manger la tarte et qu’on eut dit les grâces, des domestiques vinrent enlever ce qu’il y avait sur la table et apportèrent un grand pupitre, qu’ils posèrent à côté du fauteuil de milady.
Toutes les personnes de la maison se rassemblèrent autour de l’estrade ; Sa Seigneurie appela l’une de mes compagnes, qui s’approcha du pupitre, où une Bible avait été placée, et la jeune fille lut les psaumes indiqués par le rituel. Je me souviens de m’être dit en moi-même combien j’aurais tremblé s’il m’avait fallu être à sa place. Il n’y eut pas la moindre prière ; c’était aux yeux de lady Ludlow une hérésie coupable que de prier en dehors de l’office ; elle aurait mieux aimé faire elle-même un sermon à l’église paroissiale que de permettre à un laïque de débiter des prières dans une maison ; je ne suis pas bien sûre qu’elle l’eût toléré de la part d’un ecclésiastique en dehors du lieu saint.
Lady Ludlow avait été jadis fille d’honneur de la reine Charlotte. Elle était le dernier rejeton de cette vieille souche des Hanbury, si florissante du temps des Plantagenets, l’héritière de ce qui restait aujourd’hui du patrimoine de cette famille, dont les domaines s’étendaient autrefois dans quatre comtés différents, et c’était de son propre chef qu’elle possédait Hanbury-Court. Après son mariage elle avait habité, tour à tour, les différents manoirs de lord Ludlow ; elle y avait perdu tous ses enfants, à l’exception d’un seul, et ces tristes souvenirs devaient lui faire désirer d’autant plus de rentrer dans le château de ses ancêtres. J’imagine que les années de sa jeunesse avaient été l’époque la plus heureuse de sa vie, car la plupart de ses opinions, au moment où je l’ai connue, étaient celles qui prévalaient cinquante ans auparavant. Ainsi, lorsque j’arrivai chez elle, on commençait à se préoccuper de l’éducation du peuple ; M. Raikes avait établi ses écoles du dimanche, et certains ecclésiastiques demandaient qu’on y apprît non-seulement à lire, mais encore l’écriture et le calcul. Lady Ludlow n’acceptait rien de tout cela ; elle ne voulait pas même en entendre parler : c’était du nivellement, cela frisait la révolution. Une jeune personne devait-elle entrer à son service, milady la faisait venir dans sa chambre, examinait sa figure, ses habits, et l’interrogeait sur ses parents ; elle attachait à ce dernier point une importance capitale : une jeune fille, disait-elle, qui reste indifférente lorsqu’on lui témoigne de l’intérêt ou de la curiosité à l’égard de sa mère ou des marmots de la famille, ne fera jamais un bon serviteur. Puis elle regardait la manière dont la pauvre créature était chaussée, lui faisait réciter le credo, l’oraison dominicale et lui demandait enfin si elle savait écrire. La réponse était-elle affirmative, qu’en dépit de la satisfaction qu’elle avait exprimée jusqu’alors, la figure de lady Ludlow s’allongeait tout à coup ; c’était pour Sa Seigneurie un grand désappointement, une vive contrariété ; mais elle s’était fait une règle invariable de ne jamais prendre un domestique sachant écrire. Deux fois cependant, malgré cette faute irrémissible, je lui ai vu poursuivre l’examen et soumettre la postulante à une épreuve extraordinaire en lui faisant répéter les dix commandements de Dieu. Malheureusement une de ces pauvres filles, dont la mine éveillée était déjà un grand tort, après avoir répondu de la manière la plus satisfaisante, perdit tout à coup ses avantages en disant avec assurance, après avoir terminé son dixième commandement :
« S’il plaisait à milady, je pourrais lui faire une addition, je connais bien mes quatre règles.
— Une addition, malheureuse ! sortez d’ici bien vite, lui fut-il répondu ; vous pouvez entrer dans le commerce, mais vous ne sauriez me convenir en qualité de domestique. »
La jeune fille, qui plus tard épousa un riche drapier de Shrewsbury, s’en alla toute confuse. À peine avait-elle fermé la porte que je fus priée d’aller la rejoindre et de lui faire servir à goûter. Quelques instants après, milady fit revenir la pauvre créature ; mais c’était uniquement pour lui donner une Bible et pour l’avertir de se mettre en garde contre les principes révolutionnaires qui avaient conduit les Français à couper la tête du roi et celle de la reine de France.
« Je vous assure, milady, balbutia la jeune fille, que je ne ferais pas de mal à une mouche, encore bien moins au roi, et que je ne peux souffrir ni les Français ni les grenouilles. »
Mais milady fut inexorable, et prit une servante qui savait à peine compter ses dix doigts, afin de protester contre les progrès que l’arithmétique faisait chaque jour parmi les masses. Quand, un peu plus tard, le recteur de la paroisse, étant mort, fut remplacé par un jeune ecclésiastique imbu des idées nouvelles, le développement de l’éducation populaire fut l’un des points sur lesquels Sa Seigneurie et le jeune ministre ne purent jamais s’entendre.
À l’époque où vivait M. Montford, ce bon vieux sourd qui dirigeait la paroisse lorsque j’arrivai au château, milady ne manquait jamais, quand elle n’était pas d’humeur à écouter le sermon, de s’avancer jusqu’à la porte de son énorme banc, et de dire au prêtre, à l’instant où celui-ci allait monter en chaire : « Ne vous donnez pas la peine de prêcher, M. Montford, je vous en dispense pour aujourd’hui ; » et tout le monde s’agenouillait pour entonner l’antienne avec la plus vive satisfaction, y compris M. Montford, qui savait à quoi s’en tenir, malgré sa surdité ; car il ne manquait jamais, à cet endroit de l’office, de tourner les yeux du côté de Sa Seigneurie, dont il épiait les moindres gestes.
Mais M. Gray, le nouvel ecclésiastique, était d’une pâte bien différente. Plein de zèle dans l’exercice de ses fonctions, il fut d’abord au mieux avec Lady Ludlow, qui, très-charitable envers les pauvres, ne tarissait pas en éloges sur les vertus du jeune prêtre : son arrivée était pour la paroisse une véritable aubaine, et il pouvait faire demander au château, sans crainte de jamais être refusé, tout ce qui lui était nécessaire pour ses malades : bouillon, bon vin, confitures ou sagou. Malheureusement il avait, comme tant d’autres, enfourché ce fatal dada de l’éducation du peuple, et je vis milady s’attrister un dimanche, où elle avait pressenti, je ne sais à quel propos, qu’il y aurait dans le sermon quelque chose de relatif à l’établissement d’une école. Elle se leva, comme autrefois, ce qu’elle n’avait pas fait depuis deux ans que M. Montfort n’était plus, et dit au jeune ecclésiastique : « Ne vous donnez pas la peine de prêcher, M. Gray, je vous en dispense pour aujourd’hui. » Mais sa voix était mal assurée, et nous nous agenouillâmes pour les prières du prône avec plus de curiosité que de satisfaction réelle. Effectivement, en dépit de la dispense seigneuriale, M. Gray fit un sermon des plus pathétiques sur la nécessité d’établir une école dans le village. Milady ferma les yeux, fit semblant de dormir et parut ne rien entendre de la prédication, dont je pensai néanmoins qu’elle ne perdait pas un mot. Le samedi suivant j’en acquis la certitude ; elle m’avait emmenée faire une promenade en voiture avec une de mes compagnes, et nous étions allées voir une pauvre femme qui était malade depuis six mois et qui demeurait au bout de la paroisse. Comme nous sortions du cottage, nous aperçûmes M. Gray qui se dirigeait en toute hâte vers l’endroit que nous quittions. Milady lui fit signe d’approcher. « Vous avez l’air d’avoir très-chaud, lui dit-elle, je vais vous attendre et vous reconduire chez vous ; je suis à vrai dire fort étonnée de vous voir à pareil jour aussi loin du presbytère. » M. Gray releva la tête et parut ne pas comprendre. « N’êtes-vous pas juif ? » lui demanda milady, comme pour expliquer ses paroles. Le fait est que dans ce malencontreux sermon, il avait, en parlant de son école du dimanche, employé le mot sabbat pour désigner le jour du Seigneur ; ce qui était aux yeux de milady une preuve de judaïsme. « Le sabbat est le sabbat, poursuivitelle, c’est-à-dire le samedi, le jour du repos chez les juifs ; quant à moi qui suis chrétienne, je ne connais que le dimanche. »
M. Gray sourit et s’inclina : « Personne, dit-il, ne sait mieux que Sa Seigneurie quels sont les devoirs qui permettent d’enfreindre la loi en ce qui concerne le sabbat. Je vais donc sans scrupule visiter la mère Brown ; pardonnez-moi, milady, je serais désolé de vous retenir plus longtemps.
— Pas du tout, monsieur Gray, je vous ramène au presbytère. Allez voir votre malade : je vais, pendant ce temps-là, faire le tour par Oak-field, et je vous reprends dans une heure. »
Elle ne voulait pas le troubler dans sa bonne œuvre, en lui laissant penser qu’il la faisait attendre.
« Un excellent jeune homme, très-chères, nous dit-elle quelques instants après ; toutefois, soyez-en sûres, je n’en ferai pas moins vitrer mon banc. »
Nous ne savions pas ce qu’elle voulait dire ; mais nous l’apprîmes au bout de huit jours. Les rideaux qui entouraient le banc seigneurial avaient été remplacés par un vitrage, ayant environ deux mètres de hauteur ; on entrait par une portière dont les carreaux se manœuvraient comme les glaces d’une voiture. Les vitres étaient baissées pendant l’office, comme autrefois les rideaux étaient ouverts ; mais si par hasard M. Gray proférait le mot sabbat, ou parlait de son école du dimanche, milady quittait son fauteuil et relevait la glace avec un bruit significatif.
Laissez-moi vous dire à ce sujet quelques mots sur notre jeune ecclésiastique. La présentation au bénéfice d’Hanbury appartenait à deux personnes, qui exerçaient leurs droits tour à tour. C’était lord Ludlow qui avait fait nommer M. Montford, dont les connaissances profondes en équitation avaient mérité son suffrage. À vrai dire, l’habile écuyer ne fut pas un mauvais prêtre, surtout pour son époque. Il s’enivrait rarement, bien qu’il aimât la table autant que personne au monde, et ne manquait jamais d’envoyer à ceux des pauvres qui étaient malades les meilleurs plats de son dîner, au risque de les faire mourir d’indigestion. Rempli de bonté pour tous les hommes, il ne se montrait sévère qu’à l’égard des dissidents, surtout des méthodistes, contre lesquels il ressentait une haine particulière ; et il se liguait avec milady pour les expulser de la paroisse. On prétend que John Wesley avait critiqué son amour pour la chasse, et que telle était l’origine de son animosité, si peu en rapport avec son indulgence habituelle. Du reste, il y avait longtemps que la chose avait eu lieu, car, à l’époque où je l’ai connu, il était d’un embonpoint qui ne lui permettait plus de monter à cheval ; d’ailleurs, l’évêque du diocèse avait défendu la chasse à tous les membres de son clergé. Pour ma part, je ne crois pas que la morale eût souffert quand le pauvre M. Montford eût couru les bois de temps à autre avec meute et piqueur. Il mangeait tant, et prenait si peu d’exercice, que nous entendions souvent parler des colères effroyables où il se mettait contre ses domestiques, le sacristain et son clerc. Il est vrai que ceuxci n’y faisaient guère attention ; l’excellent homme revenait bientôt à lui-même, et faisait toujours aux victimes de son emportement, un cadeau proportionné à la violence de sa colère. « Que M. le curé nous envoie à tous les diables, c’est un shilling qu’il nous donne, racontait le sacristain, qui ne manquait pas de finesse, tandis que le diable ! tout court, est une impatience de vicaire, un misérable mot qui ne vaut pas plus de douze sous. » Il y avait beaucoup de bon dans ce pauvre M. Montford. Il ne pouvait supporter ni la souffrance, ni la misère des autres, et faisait tout son possible pour les soulager dès qu’il en avait connaissance ; mais il avait grand peur de troubler sa quiétude ; et, comme la vue des malheureux lui était fort pénible, il savait mauvais gré à ceux qui lui en parlaient.
« Que voulez-vous que j’y fasse ? » disait-il un jour à milady au sujet d’un pauvre homme qui s’était cassé la jambe. « Je ne peux pas lui raccommoder le tibia, c’est l’affaire du docteur ; quant à le soigner, sa femme s’en acquittera mieux que moi. Je ne pourrais que lui porter le secours de ma parole, et j’y perdrais mon éloquence ; ce serait de l’hébreu pour lui, sans compter le dérangement que lui occasionnerait ma visite : il se ferait asseoir dans une posture incommode, changerait de linge et d’habits et n’oserait pas se donner le soulagement de gronder sa femme, de crier et de jurer pendant tout le temps que je serais là. Est-ce que Votre Seigneurie n’entend pas le soupir de satisfaction que pousserait le malheureux une fois que j’aurais tourné le dos ? Où serait alors le bénéfice de mes discours ? D’autant plus que, suivant lui, j’aurais dû réserver cette exhortation pour son voisin, attendu qu’elle ne pouvait convenir qu’à un pécheur endurci. Je juge des autres par moi-même ; si j’étais malade, il me serait fort désagréable de recevoir lord Ludlow. Sans aucun doute, ce serait un grand honneur ; mais il faudrait changer de bonnet de nuit, simuler la patience, et prendre garde de fatiguer Sa Seigneurie de mes plaintes. Je lui aurais bien plus de gratitude si, au lieu de venir me voir, il pensait à m’envoyer un morceau de venaison, afin de m’aider à recouvrer la dose de santé qui est nécessaire pour jouir convenablement de la visite d’un gentilhomme. J’enverrai donc à John Butler un bon dîner jusqu’à ce qu’il soit guéri, et j’épargnerai à ce pauvre diable ma présence et mes conseils. »
Milady ne savait trop que penser des doctrines de M. Montford ; mais c’était son mari qui avait fait choix du révérend, et il était impossible de mettre en doute la sagesse du noble défunt. Elle savait d’ailleurs que John Butler recevait exactement les bons repas dont il avait été question, et qu’une ou deux guinées accompagnaient souvent le potage et le rosbif qu’on lui envoyait du presbytère. Puis M. Montford était pur jusqu’à la moelle des os ; il avait horreur des dissidents et des Français, et n’aurait pas pris une tasse de thé sans porter un toast à l’Église et au roi et sans maudire le Rump[1]. En outre, il avait eu l’honneur de prêcher devant la famille royale à Weymouth, le roi avait daigné applaudir son sermon d’un très-bien ! articulé deux fois, ce qui était la consécration d’un mérite dont, après cela, il n’était plus permis de douter,
Enfin, pendant tout l’hiver, M. Moniford venait passer au château les longues soirées des dimanches ; il nous faisait une instruction et jouait ensuite au piquet avec Sa Seigneurie. Lady Ludlow ne manquait jamais en pareille circonstance de le prier de souper avec elle ; mais comme son repas du soir se composait invariablement d’une tasse de lait et d’un peu de pain, M. Montford aimait beaucoup mieux partager notre volaille, déclarant que milady n’était qu’une hérétique, une pécheresse abominable qui faisait maigre le dimanche, jour fêté par l’Église. Nous écoutions cette plaisanterie pour la vingtième fois, en souriant comme la première ; nous avions même fini par en sourire d’avance, car elle était toujours précédée d’une petite toux nerveuse occasionnée par la crainte que cet excès d’audace ne déplût à milady ; et jamais cette dernière, non plus que le recteur, ne parut être frappée de la répétition de ce bon mot.
Un jour M. Montford mourut subitement, et nous laissa de vifs regrets. L’excellent homme léguait une certaine rente aux pauvres de la paroisse, afin qu’ils eussent à Noël un rosbif et un plumpudding, dont il donnait la recette dans le codicille de son testament.
Il priait en outre ses exécuteurs testamentaires de veiller à ce qu’on ne déposât pas son cercueil dans le caveau réservé aux recteurs de la paroisse, avant que le susdit caveau n’eût été bien aéré, car il avait toujours détesté les lieux humides. On pensait même que la chaleur excessive qu’il entretenait dans ses appartements, afin de les assainir, avait accéléré sa mort.
C’est après cet événement que la cure de notre paroisse avait été offerte à M. Gray, membre du collège de Lincoln. Il était naturel que tous ceux qui, de près ou de loin, appartenaient à la famille Hanbury, désapprouvassent le choix qui avait été fait par l’autre possesseur du bénéfice. Néanmoins, lorsque de mauvaises langues firent courir le bruit que M. Gray était un méthodiste, Sa Seigneurie déclara qu’elle ne pouvait admettre une accusation aussi grave sans avoir été d’abord convaincue par les preuves les plus incontestables.
CHAPITRE II.
Avant de nous occuper de M. Gray, je crois utile de vous dire comment nous passions notre temps au château d’Hanbury. Nous étions cinq jeunes personnes dans la maison, à l’époque de l’arrivée du nouvel ecclésiastique ; toutes les cinq de bonne famille et comptant dans l’aristocratie tout au moins un allié. Dès que nous n’étions pas avec lady Ludlow, nous nous trouvions sous la surveillance de mistress Medlicott, petite femme bien élevée, qui était depuis fort longtemps avec Sa Seigneurie, dont on la croyait un peu parente. Elle avait passé toute sa jeunesse en Allemagne, je pense même qu’elle y était née, ce qui expliquait à la fois son accent germanique et l’habileté qu’elle possédait dans tous les genres d’ouvrages à l’aiguille, ouvrages que l’on ne connaît plus aujourd’hui même de nom. Elle raccommodait les bas, la dentelle, le linge de table, la mousseline des Indes, avec une telle perfection qu’il était impossible de découvrir l’endroit où elle avait fait sa reprise. En un mot, bien qu’elle fût bonne protestante, et ne manquât jamais d’aller à l’église le cinq novembre [2], elle était aussi adroite qu’une religieuse papiste. Nous travaillions avec elle une grande partie de la journée, soit dans le laboratoire, soit dans l’atelier de couture qui donnait dans la grande salle. Lady Ludlow méprisait tous les ouvrages de fantaisie ; elle les considérait comme étant bons tout au plus à distraire les enfants ; quant aux femmes, elles devaient restreindre leurs plaisirs à un ouvrage de couture délicat et soigné. Les grandes tapisseries qui décoraient la salle étaient bien l’œuvre de ses aïeules ; mais celles-ci vivaient avant la réforme et ignoraient, par conséquent, cette pureté de goût et de principes qui doit régner dans les moindres actes de la vie, aussi bien que dans les croyances religieuses. Sa Seigneurie n’approuvait pas davantage la mode qui existait alors, parmi les femmes du monde, de fabriquer des souliers ; c’était, disait-elle, la conséquence de la révolution française qui avait bouleversé toute la hiérarchie sociale, et qui permettait qu’on vît des jeunes filles de bonne maison manier une alène, et se servir de poix, comme si leur père avait été cordonnier.
Il arrivait souvent que nous étions demandées l’une ou l’autre pour aller faire à Sa Seigneurie la lecture de quelque livre instructif ; c’était, en général, le Spectateur d’Addison ; toutefois je me rappelle un certain ouvrage traduit de l’allemand, que mistress Medlicott avait recommandé à milady : les Réflexions de M. Sturm, qui nous disait à quoi il fallait penser chaque jour, et cela depuis le premier janvier jusqu’au trente et un décembre. Rien n’était plus ennuyeux ; mais la reine Charlotte avait beaucoup aimé ce livre, et le souvenir de cette royale approbation combattait chez milady l’influence de cette lecture soporifique. Les Lettres de mistress Chapone et les Conseils du docteur Grégoire aux jeunes filles étaient, avec les ouvrages précédents, les seuls livres qu’on trouvât dans notre bibliothèque ; je ne parle pas de la Bible que nous lisions tous les dimanches. Quant à moi, j’étais enchantée de quitter l’aiguille, et même de renoncer à ma lecture, pour aller dans le laboratoire préparer les conserves et les médicaments. Il n’y avait pas de médecin à quatre milles à la ronde, et, sous la direction de mistress Medlicott, nous inspirant des formules du docteur Buchan, nous expédiions chaque jour maintes et maintes potions qui, j’ose le dire, n’étaient pas moins bonnes que celles du pharmacien. Je ne crois pas en conscience qu’elles aient jamais fait de mal ; leur saveur était généralement très douce, et quand, par hasard, nous leur trouvions un peu plus de goût qu’à l’ordinaire, mistress Medlicott nous y faisait ajouter de la cochenille et une quantité d’eau suffisante pour n’avoir rien à craindre. Mais si nos fioles ne contenaient, en réalité, aucun élément actif, nous leur mettions une étiquette dont les paroles mystérieuses aidaient considérablement à leur efficacité. Que de petites bouteilles d’eau colorée en rouge, ne contenant d’autre matière médicale, que deux ou trois grains de sel, mais bien et dûment étiquetées, sont sorties de notre laboratoire à la grande reconnaissance des malades, qui leur devaient une guérison rapide ! Que de pilules de mie de pain, fabriquées dans l’origine avec l’intention pure et simple de nous exercer à manipuler, et dont les résultats n’ont pas été moins merveilleux ! Il est vrai qu’avant de donner la boîte où elles étaient contenues, mistress Medlicott avait soin d’expliquer l’effet qu’elles devaient produire sur le malade, effet qui ne manquait jamais d’arriver. Je me rappelle un vieillard qui n’aurait pas dormi s’il n’avait pris tous des soirs quatre ou cinq de nos pilules, et qui souffrait tellement lorsqu’il n’en avait plus, qu’il se croyait à sa dernière heure ; Je suppose que la médecine que nous faisions alors au moyen de cette pharmacopée, à la fois simple et puissante, était ce qu’on appelle maintenant de l’homœopathie.