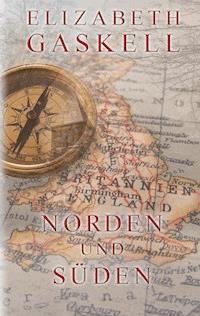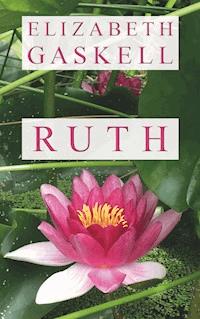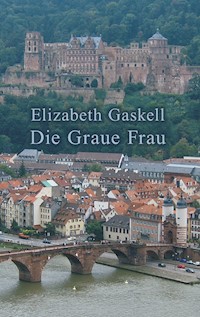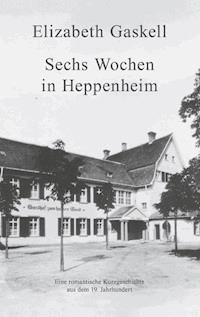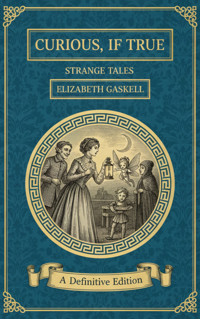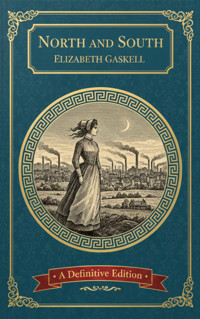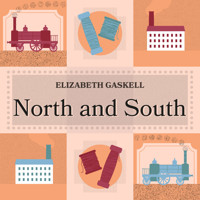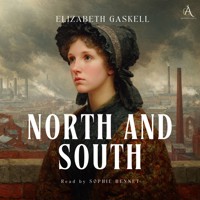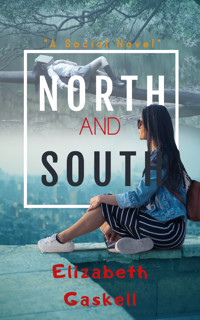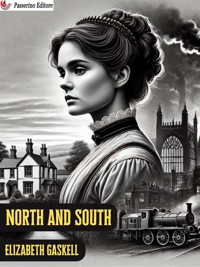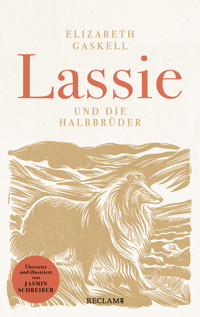Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Les Amoureux de Sylvia" est un roman captivant d'Elizabeth Gaskell, qui plonge le lecteur dans une histoire d'amour complexe et émouvante. Situé dans le nord de l'Angleterre au XIXe siècle, le récit suit Sylvia Robson, une jeune femme belle et déterminée, tiraillée entre deux prétendants. Charley Kinraid, un séduisant harponneur, fait battre son coeur avec passion, tandis que son cousin Philip Hepburn, plus réservé, nourrit pour elle un amour sincère et profond. À travers ce triangle amoureux, Gaskell explore les thèmes de la loyauté, du sacrifice et des choix déchirants qui façonnent le destin de ses personnages. Le roman est riche en descriptions évocatrices du paysage rural anglais et des coutumes locales, offrant une immersion totale dans l'époque victorienne. La tension dramatique s'intensifie à mesure que Sylvia doit faire face à des dilemmes moraux et à des événements tragiques qui bouleversent sa vie. Gaskell dépeint avec finesse les complexités des relations humaines, tout en critiquant subtilement les normes sociales de son temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE.
PREMIÈRE PARTIE.
I.
Monkshaven
II.
Les revenants du Groënland
III.
L’achat d’un manteau
IV.
Philip Hepburn
V.
Histoires de presse
VI.
Les funérailles du matelot
VII.
Tête-à-tête. — Le Testament
VIII.
Attraction et répulsion
IX.
Le Specksioneer
X.
Une éducation
XI.
Les visions de l’avenir
XII.
La fête du Nouvel an
XIII.
Perplexités
XIV.
Affaires de commerce
DEUXIÈME PARTIE.
I.
Une question difficile
II.
La promesse
III.
Avertissements inutiles
II.
Un reflux sur le fleuve Amour
V.
Une mission importante
VI.
Aimé, perdu
VII.
Un refus
VIII.
L’ombre épaissit
IX.
Représailles
X.
Joie éphémère
XI.
Les mauvais jours
XII.
Une triste veillée
XIII.
Jours ténébreux
XIV.
L’épreuve
XV.
La Robe de noces
TROISIÈME PARTIE.
I.
Jours heureux
II.
Mauvais présages
III.
Un sauvetage
IV.
Une apparition
V.
Un aventureux soldat
VI.
Ce qu’on ne dit pas
VII.
Nouvelles mystérieuses
VIII.
Isolement
IX.
Comment on se retrouve
X.
Confidence
XI.
Un message inattendu
XII.
Le Bedesman du Saint-Sépulcre
XIII.
Une fable démentie
XIV.
L’Inconnu
XV.
Premières paroles
XVI.
Sauvée, perdu
PREMIÈRE PARTIE.
I
MONKSHAVEN.
Monkshaven, — qu’il vous faudrait chercher sur la côte nord-est d’Angleterre, au bord de la Dee, justement à l’endroit où cette rivière tombe dans l’Océan germanique, — compte aujourd’hui quinze mille habitants, mais n’en avait pas la moitié à la fin du dernier siècle, époque où se passèrent les événements que nous allons raconter.
Tout autour, dans un rayon de plusieurs milles, s’étendent ces grands espaces plats et humides qu’on appelle moorlands, interrompus çà et là par quelques hauteurs couvertes de rouges bruyères. Du haut de ces cimes qui dominent la mer, s’écoulent des torrents qui, — se creusant avec le temps un chemin plus ou moins large, — ont peu à peu formé des espèces de vallons plus ou moins étroits, au fond desquels s’abrite une végétation riche et puissante. On y trouve de beaux gazons élastiques où paissent en trop grand nombre certains petits moutons à tête noire, mal venus des bouchers à cause de leur maigreur, et dont la laine courte et rude ne jouit pas auprès des tisserands d’une haute considération. Dans ces districts ruraux, éparpillés en plein marécage, la population est de nos jours trèsclairsemée. Elle l’était bien plus encore il y a quatre-vingts ans, c’est-à-dire avant que l’agriculture, devenue science, eût trouvé les moyens de lutter contre les difficultés naturelles que lui offrait le sol tourbeux de ces plaines humides, et avant que les chemins de fer, facilitant les communications, n’y amenassent chaque année les sportsmen attirés par la quantité de gibier qui peuple ces solitudes.
Monkshaven est une ville de pêcheurs. Son aristocratie, qui n’a rien de commun avec celle du comté, s’est formée parmi les aventureux négociants et les marins plus aventureux encore qui s’engagent dans les vastes opérations dont les mers du Groënland sont le théâtre. On s’en aperçoit de reste à ces vastes appentis qui s’étendent sur les bords de la Dee et d’où sort une odeur d’huile, un parfum de marée que semblent goûter les naturels de l’endroit. Presque tous ont été, sont, ou seront marins : leur destinée individuelle, l’avenir de leurs familles dépendent du succès de leurs expéditions lointaines. Tout ceci contribue à donner à la ville, au pays même, je ne sais quelle tournure amphibie. À vingt milles de la côte, les rebuts de la pêche, les plantes marines, les ordures des melting-houses (ces hangars dont nous parlions et qui servent à la fonte du « gras de baleine »), constituent la plus grande masse des engrais du district. De grandes mâchoires de cachalot, à l’aspect sinistre, surmontent, dénudées et blanchies, les portes de plus d’un enclos. Dans une famille d’agriculteurs, s’il y a plusieurs enfants, on peut être sûr que l’un d’eux est à la mer et que, tout en cultivant son modeste jardin, sa mère, les jours d’orage, tournera plus d’une fois du côté de l’Océan des regards inquiets. Les jours de loisir se passent tous à la côte. On voit que le cœur du pays est là, et que ses grands intérêts s’y débattent.
À l’époque dont je parle, le voisinage de la mer était pour tout le pays qui environne Monkshaven un motif de crainte et d’irritation. Voici quelles causes spéciales avaient amené ce résultat étrange.
Depuis la fin de la guerre d’Amérique, aucune nécessité pressante n’était venue aggraver pour l’Angleterre les conditions habituelles de la levée maritime. D’année en année, les fonds alloués pour cet objet diminuaient constamment. Ils atteignirent leur minimum en 1792. En 1793, au contraire, la Révolution française mit l’Europe en feu, et le gouvernement anglais n’épargna rien pour fomenter dans la population des Trois-Royaumes les passions anti-gallicanes soulevées par les excès du régime de la Terreur. Quand il fallut en venir aux mains on avait des vaisseaux, mais où étaient les équipages ?
Pour cette disette d’hommes, l’Amirauté possédait un remède souverain, consacré par de nombreux précédents et sanctionnés par la loi coutumière sinon par la loi écrite. Des « ordres de presse » furent émis qui invitaient les autorités civiles de tout le pays à seconder les officiers chargés de l’enrôlement maritime dans l’accomplissement de leur mission. La côte fut partagée en districts, chacun sous le contrôle d’un capitaine de vaisseau qui lui-même déléguait des lieutenants pour chaque sous-district, et, grâce au blocus ainsi organisé, tous les navires frétés pour le retour étaient attendus et guettés au passage, tous les ports strictement surveillés, et en vingt-quatre heures, s’il le fallait, on se trouvait à même d’ajouter un personnel nombreux aux forces de la marine royale. Mais à mesure que les demandes de l’Amirauté devenaient plus urgentes, ses agents devinrent moins scrupuleux. On en vint à penser qu’il était facile de transformer en bons matelots des paysans robustes. Les lois sur la presse exigeaient bien certaines formalités et certaines constatations ; mais une, fois que la capture était faite, comment un pauvre laboureur aurait-il pu justifier de sa profession habituelle, personne ne voulant écouter les témoignages qu’il aurait fournis, personne après les avoir écoutés n’y voulant croire, et personne enfin, après les avoir écoutés et les avoir crus, ne se souciant de contribuer à la délivrance du captif ? Bien des hommes furent ainsi secrètement enlevés et littéralement disparurent, sans que jamais on ait entendu parler d’eux. Les rues d’une grande ville n’étaient pas plus à l’abri que les campagnes les moins peuplées, de ces rapts exécutés à force ouverte et en plein soleil. Lord Thurlow, l’attorney-general, enlevé lui-même pendant qu’il faisait une promenade aux environs de Londres, aurait pu porter un éclatant témoignage contre les procédés tout particuliers que se permettait l’Amirauté, soit pour se procurer des marins, soit pour écarter les réclamations incommodes auxquelles ses procédés sommaires avaient donné lieu. L’isolement relatif des villageois de l’intérieur ne les mettait point à l’abri de semblables entreprises. Maint et maint paysan, parti pour la foire où il allait s’engager à l’année, ne revint jamais dire chez lui quelle place il avait trouvée ; maint fils de fermier, jeune et robuste, cessa de s’asseoir au foyer de son père et fut à jamais perdu pour son amoureuse. — Tels furent les exploits de la presse des matelots pendant les premières années de la guerre avec la France, surtout après chacune des victoires navales qui marquèrent cette lutte acharnée.
Les agents de l’Amirauté se tenaient à l’affût de tout 1 bâtiment marchand ; beaucoup de ces navires revenant après une longue absence — et revenant avec une riche cargaison — se virent abordés à douze heures de terre et dépeupler si bien par cette presse impitoyable, que leurs équipages désormais insuffisants, désormais incapables de les ramener au port, étaient réduits à les laisser dériver en pleine mer, où parfois ils se perdaient à jamais. Quant aux hommes ainsi pressés, c’est-à-dire enlevés, il leur arrivait souvent de voir disparaître en un jour le fruit rudement gagné de bien des années de travail, et leurs épargnes rester aux mains des propriétaires du navire où ils avaient servi, exposées à toutes les chances de l’improbité, à tous les hasards de vie ou de mort.
Aujourd’hui cette tyrannie nous paraît surprenante. Nous ne comprenons guère qu’aucun enthousiasme guerrier, aucune panique d’invasion, aucune soumission loyale aux pouvoirs établis, aient pu si longtemps maintenir un pareil joug. La press-gang telle qu’on la voyait alors, — appuyée de patrouilles et de sentinelles qui barraient les rues et bloquaient les maisons à fouiller, — produit sur nous l’effet d’un mythe hideux, et c’est avec une surprise voisine de l’incrédulité que nous entendons parler de ces églises cernées pendant le service divin pour que les agents de l’Amirauté pussent, tout à leur aise, arrêter et saisir au passage les hommes dont elle voulait faire sa proie. Par différents motifs sur lesquels il est inutile d’insister, les habitants du Sud acceptaient avec plus de soumission que ceux du Nord cet état de choses si abusif ; sur la côte du Yorkshire, plus particulièrement, la presse rencontrait des résistances furieuses, spécialement parmi ces matelots qui, grâce à l’élévation exceptionnelle de leurs salaires, pouvaient espérer d’arriver comme tant d’autres au rang de commerçant et d’armateur. Les hobereaux du pays lui étaient beaucoup moins hostiles. Ceux qui entouraient Monkshavën, jalousant l’opulence toujours croissante de ses habitants, voyaient avec assez d’indulgence les entraves apportées à ce commerce auquel leur dignité nobiliaire les empêchait de prendre part ; ils croyaient d’ailleurs remplir un devoir sacré en appuyant les ordres de l’Amirauté, chaque fois qu’ils en étaient requis, de tout le pouvoir civil à eux conféré, — pourvu cependant qu’ils pussent le faire sans se mêler plus que de raison à des conflits qui, après tout, ne les intéressaient guère.
Bien reçus chez ces gentillâtres, et principalement chez ceux qui avaient plusieurs filles à pourvoir, les officiers de marine employés à l’odieuse mission que nous venons de définir n’étaient pas précisément impopulaires à Monkshaven même, si ce n’est dans les moments de crise où l’exercice de leur métier les mettait en collision directe avec la population. Le souvenir de leurs exploits, leur réputation de franchise, leur gaieté bruyante et cordiale les protégeait contre la haine populaire dont leurs subordonnés conservèrent le monopole. Ceux-ci, regardés comme des espions, des « voleurs d’hommes, » de la « vermine » — ainsi les appelait-on, — voyaient fort mal accueillir leurs moindres provocations, et les gens du peuple passaient rarement devant le cabaret de bas étage qu’un pavillon bleu signalait comme le rendez-vous de la press-gang, sans cracher vers la porte en témoignage d’exécration. Mais, après tout, cela importait peu. Si dignes qu’ils fussent des surnoms qu’on leur donnait, ces hommes étaient braves et entreprenants. La loi étant pour eux, leur tâche était légitime. Ils servaient leur foi et leur pays. Toutes leurs facultés étaient en jeu, ce qui est toujours agréable. Dans leur vie aventureuse, il y avait ample matière à combinaisons adroites, à succès chaudement disputés ; elle demandait du sang-froid, du courage, et satisfaisait à cet instinct « chasseur » qui fait pour ainsi dire partie de tout homme complètement doué.
Au moment où débute ce récit, la presse n’avait pas encore fait grands ravages à Monkshaven. Seulement, à quatorze ou quinze milles en mer, l’Aurora, bon vaisseau de guerre, était à l’ancre, et eecevait les cargaisons humaines de différentes chaloupes de chasse stationnées le long de la côte, aux endroits où le « gibier » semblait vouloir donner. L’une d’elles, la Lively-Lady, était visible des hauteurs qui dominent Monkshaven et se tenait à portée de la ville, bien que dissimulée par une espèce de cap à l’examen habituel des bourgeois. Quant au cabaret dont nous avons déjà parlé, — la Randyvow-House[1], comme l’appelait le public, — il étalait naïvement son pavillon bleu autour duquel flânait volontiers l’équipage de la Lively-Lady, toujours prêt à faire boire les passants inavertis.
Ces préparatifs, si menaçants qu’ils pussent paraître, n’avaient pas encore soulevé au delà d’une certaine mesure l’esprit de méfiance et de révolte si naturel aux populations du Yorkshire.
1. ↑ Du mot français : rendez-vous.
II
LES REVENANTS DU GROENLAND.
Dans les premiers jours du mois d’octobre 1796, deux filles de fermier étaient en route pour Monkshaven, où elles venaient vendre du beurre et des œufs. À peu près du même âge, elles n’étaient pas placées dans les mêmes conditions d’existence. Molly Corney faisait partie d’une famille nombreuse, et en conséquence n’avait pas été trop gâtée ; Sylvia Robson, au contraire, était fille unique, et on la traitait chez elle avec beaucoup plus de considération que sa compagne. Toutes deux, une fois la vente terminée, avaient mission de faire quelques emplettes, mais avec cette différence que Molly devait approvisionner le ménage paternel de toute sorte d’objets utiles sans doute, mais fort peu intéressants, tandis que Sylvia était autorisée à choisir l’étoffe de son premier manteau. Le prendrait-elle gris, ou bien écarlate ? tel était le grave sujet du débat qui s’agitait entre les deux jeunes filles, tandis qu’elles dévalaient alertes et joyeuses, laissant sur le chemin l’empreinte de leurs pieds nus. Ce n’est pas qu’elles n’eussent leurs souliers et leurs bas, mais elles les portaient à la main pendant la plus grande partie de la route, suivant les traditions économiques de cette époque primitive. Arrivées près de Monkshaven, au lieu d’entrer tout droit dans la ville, elles prirent un petit sentier qui conduisait au bord de la Dee. Il y avait là de grosses pierres éparses sur la rive, et autour desquelles l’eau venait former par endroits des flaques assez profondes. Molly s’assit tout simplement sur l’herbe du bord pour laver ses |pieds ; mais Sylvia, qu’égayait peut-être la vision de son manteau futur, posa son panier sur un monticule sablonneux et sauta d’un bond léger sur un quartier de roche qui se dressait presque au milieu du courant. Une fois là, livrant ses petits pieds roses à la rapide fraîcheur de l’onde, elle se mit, par manière d’espièglerie, à éclabousser sa compagne ; mais sur la première remontrance de celle-ci, elle cessa immédiatement, et de la meilleure grâce du monde, ce jeu malvenu. Immobile, étendue sur son divan de pierre comme une sultane sur les coussins du harem, elle se serait volontiers oubliée dans cette attitude nonchalante. Molly, toutefois, d’humeur plus régulière, lui rappela bientôt que l’heure du marché allait expirer, et nos petites fermières se hâtèrent d’achever leur toilette urbaine. Leurs bas bleus bien tirés avaient été tricotés par elles-mêmes, et de brillantes boucles d’acier décoraient leurs souliers de cuir noir à hauts talons montants, bien ajustés sur le cou-de-pied. À partir de ce moment, elles marchèrent moins vite ; mais leur allure conserva cependant l’élasticité de la jeunesse, — car ni l’une ni l’autre n’avait encore vingt ans, et Sylvia n’en comptait guère que dix-sept, tout au plus. Avec leurs chapeaux de feutre noir dénoués et rejetés sur leurs épaules, leurs cheveux bouclés qu’elles venaient de remettre sommairement en bon ordre, leurs jupons courts dont elles avaient secoué la poussière, leurs petits châles (ou leurs grands mouchoirs, comme vous voudrez) épinglés sous le menton et fixés à la taille par le cordon de leurs souliers, — le panier sur le bras, le nez en l’air, les yeux baissés, — nos deux petites fermières étaient charmantes quand elles firent leur entrée dans la ville de Monkshaven.
Le havre étroit formé par l’embouchure de la rivière était encombré de petits navires de toute espèce dont les mâts, vus de loin, formaient une sorte de forêt inextricable. Au delà brillait la mer, véritable plaque de saphir sur laquelle on apercevait au loin les voiles blanches de maint et maint bateau de pêche, — immobile en apparence, et dont on ne pouvait apprécier la marche qu’au moyen de quelque point de repère choisi sur la côte ; près de la barre formée par la Dee, un bâtiment plus considérable était à l’ancre. Sylvia, récemment arrivée dans le pays, ne lui accorda aucune attention particulière ; mais Molly reconnut aussitôt un baleinier revenu des mers du Groënland… C’était le premier de la saison ! Grand événement pour Monkshaven et grand événement pour Molly, qui, entraînant sa compagne étonnée, descendit d’un pas précipité vers la place du Marché. Mais bien que ce fût une des foires les plus fréquentées de l’année, une de celles où les ménagères venaient s’approvisionner pour la saison d’hiver, la place était vide, et les trépieds que les marchands louaient à un penny l’heure, abandonnés çà et là, renversés pour la plupart, attestaient la prompte dispersion de la foule qui tout à l’heure encore encombrait cet endroit. Déposant à la hâte leurs paniers dans une boutique dont l’obligeant propriétaire venait de répondre à leurs questions empressées sur l’arrivée du baleinier, Molly et Sylvia se hâtèrent de courir au port, et, cinq minutes après, on aurait pu les voir côte à côte au milieu de la foule attentive. Mais tous les regards étaient dirigés vers le navire, qui venait justement de jeter l’ancre en dehors de la barre, à un quart de mille environ de l’endroit où elles se trouvaient. Les matelots de la douane, qui avaient conduit à bord l’officier chargé d’examiner la cargaison, revenaient en ce moment au rivage, rapportant quelques menus lambeaux de nouvelles que les assistants se disputaient à l’envi. Sylvia, étreignant la main de sa compagne plus âgée et plus expérimentée qu’elle, écoutait, bouche béante, les réponses que celle-ci arrachait à un vieux marin passablement revêche et qui se faisait tirer l’oreille pour lui répondre. Elle apprit ainsi que le bâtiment en vue s’appelait la Résolution et que sa traversée n’avait pas été fort heureuse. Le manifeste présenté à la douane ne déclarait que huit baleines ; en revanche, on disait merveille d’un autre bâtiment, la Good-Fortune, arrêté à la pointe Saint-Abb, et qui ramenait pour sa part environ quinze baleines…
« C’est le navire de mon cousin, dit Molly à Sylvia ; il est specksioneer à bord de la Good-Fortune. »
Sylvia eût peut-être demandé l’explication de ce mot à elle inconnu, mais Molly, sa curiosité une fois satisfaite, se prit à songer aux œufs et au beurre qu’elle avait à vendre, et, bien qu’un peu à regret (car elle ne songeait plus guère à son manteau), Sylvia dut suivre le long des quais sa compagne mieux avisée.
Parmi la foule qu’elles quittaient ainsi, bien des cœurs battaient à l’approche des nouvelles attendues. On se le figurera aisément, si on songe que, pendant six longs mois d’été, ces marins dont on saluait le retour n’avaient pas donné une seule fois de leurs nouvelles. Or, les navires baleiniers partaient pour le Groënland peuplés d’hommes robustes et remplis d’espérances ; mais les équipages baleiniers ne revenaient jamais comme ils étaient partis. Quels étaient ceux dont les os blanchissaient maintenant sur les terribles îlots de glace flottante ? Quels étaient ceux que l’abîme garderait jusqu’au jour où la mer rendra tous les cadavres engloutis ? Quels étaient ceux qui jamais, jamais plus, ne reverraient Monkshaven ? Telles étaient les pensées qui peu à peu donnaient une physionomie solennelle à la foule, de plus en plus silencieuse.
Cependant, à quelques pas de là, cinq ou six jeunes filles, perchées au sommet d’un monceau de charpentes marines, se balançaient en se tenant par la main et chantaient un refrain joyeux.
« Pourquoi vous en allez-vous sitôt ? crièrent-elles du haut de leur observatoire à Sylvia et à sa compagne ; dans dix minutes ils seront ici ! »
Puis, sans attendre la réponse qui ne leur serait jamais arrivée, elles reprirent leur chant insensé. La ville était complètement déserte et la place du Marché complètement vide quand nos deux fermières y revinrent.
« Vous n’avez donc pas d’amoureux là-bas, que vous rentrez sitôt en ville ? » dit à Sylvia l’homme qui lui rendait son panier.
La belle enfant ne répondit que par une moue dédaigneuse à cette plaisanterie qu’elle jugeait peu convenable. Molly, qui en prit sa part, ne s’en formalisa pas autrement. Elle se complaisait à l’idée (d’ailleurs sans aucune espèce de fondement) qu’elle pourrait avoir un sweet-heart, et s’étonnait quelque peu que cette idée restât aussi longtemps dans le domaine des chimères. Ah ! si elle pouvait, comme Sylvia, se donner un beau manteau neuf, on verrait peut-être les choses changer d’aspect… En attendant, le mieux était de sourire et de rougir, comme si les allusions à ce sujet délicat ne la prenaient pas au dépourvu. Elle alla plus loin, et répliqua de manière à faire supposer qu’elle avait effectivement, parmi les marins en voie de retour, un soupirant fort désireux de lui plaire.
Ceci ne fut pas perdu pour Sylvia qui, dès qu’elles se retrouvèrent en tête-à-tête, voulut absolument savoir le nom du soupirant de Molly. Une pareille insistance devait nécessairement embarrasser la jeune présomptueuse. Il ne lui convenait guère d’avouer qu’elle n’avait en réalité voulu désigner personne, et que son sweet-heart n’existait encore qu’à l’état d’hypothèse. Aussi commença-t-elle à se remémorer tous ceux qui, depuis qu’elle était au monde, avaient pu lui faire entendre quelques propos flatteurs. Malheureusement la liste n’en était pas longue, attendu que son père n’avait pas grand’dot à lui donner et que son minois n’était pas des plus séduisants ; mais elle se rappela tout à coup son cousin le specksioneer, qui, avant de partir pour le dernier voyage en mer, lui avait donné deux beaux coquillages, et pris en échange un gros baiser sur ses lèvres à moitié rebelles. Aussi se prit-elle à sourire, et d’un air significatif :
« On ne sait pas, on ne sait pas, dit-elle ensuite. Il ne faut point parler de ces choses-là quand on n’est pas décidée… Mais si Charlie Kinraid ne se conduit pas trop mal, peut-être sera-t-il écouté.
— Charlie Kinraid ?… qui voulez-vous dire ?
— Ce specksioneer dont je vous parlais ; … un cousin que j’ai.
— Et vous croyez qu’il s’occupe de vous ? » demanda Sylvia d’un ton bas et fervent, comme s’il s’agissait de quelque mystère sacré.
Mais Molly répondit simplement :
« Laissez-moi un peu tranquille. »
Et Sylvia ne put savoir au juste si elle coupait court à la conversation parce que sa question l’avait blessée, ou parce qu’elles arrivaient devant le magasin qui allait selon toute probabilité s’accommoder de leur beurre et de leurs œufs.
« Maintenant, Sylvia, dit Molly, laissez-moi votre panier !… Je ferai votre marché pour le moins aussi bien que vous… Courez chez Foster y choisir, avant qu’il ne fasse nuit, l’étoffe de ce fameux manteau… J’irai vous y rejoindre dans cinq minutes… Il faut nous presser un peu, voilà le soleil qui se couche ! »
Sylvia pencha la tête et s’achemina toute seule, d’un air assez triste, vers le magasin des Foster, situé sur la place du Marché.
III
L’ACHAT D’UN MANTEAU.
Les Foster tenaient à Monkshaven « le magasin » par excellence. C’étaient deux frères, de la secte des quakers, et qui touchaient aux limites de la vieillesse. Leur père avant eux, et le père de leur père avant ce dernier, s’étaient successivement enrichis dans cette boutique sombre que les anciens se souvenaient d’avoir vue plus étroite et plus sombre encore. Mercerie, épicerie, draperie, confinées dans trois compartiments différents, y étaient vendues tour à tour. Les pratiques habituelles recevaient des deux frères une cordiale poignée de main accompagnée de questions affectueuses sur l’état de leur santé ou de leurs affaires. Le jour de Noël, le magasin restait ouvert comme une protestation solennelle contre les superstitions de « la vieille Babylone, » et les deux frères, qui n’entendaient pas violenter la conscience de leurs subalternes, demeuraient ce jour-là derrière le comptoir pour répondre à tout venant. Seulement, personne ne venait. Le jour de l’an, par compensation, ils tenaient prêts, dans le salon derrière la boutique, un immense gâteau et plusieurs bouteilles de vin pour faire boire et manger tout acheteur qui se présentait chez eux. Ajoutons, comme trait de caractère, que ces gens si scrupuleux ne se faisaient aucune conscience de frauder les droits. On arrivait à l’arrière-cour des Foster par une petite allée déserte qui descendait vers la rivière, et là, sous un porche bien abrité, une manière de frapper toute particulière appelait immédiatement John ou Jeremy, — à défaut d’eux, leur principal commis de magasin, le jeune Philip Hepburn. On entendait pousser les verrous, on voyait derrière le carreau de la boutique se tirer des rideaux verts, et il était facile de conjecturer qu’il s’accomplissait là quelque transaction mystérieuse. À Monkshaven, du reste, tout le monde était plus ou moins contrebandier, et tout le monde achetait de la contrebande, grâce à la connivence légèrement déguisée des agents de la douane, très-peu rigoureux pour leurs bons voisins.
La tradition voulait que John et Jeremy Foster fussent assez riches pour acheter toute la nouvelle ville s’ils le voulaient bien, et cette réputation leur donnait un crédit immense. Le commerce de détail n’était plus pour eux qu’un insignifiant accessoire, une habitude prise et qu’ils maintenaient, achetant la meilleure marchandise possible pour la revendre avec un léger bénéfice, mais toujours au comptant. Leur grande affaire était une espèce de banque primitive, une caisse de dépôts où venait apporter ses fonds quiconque les voulait mettre à l’abri du vol. Personne ne réclamait d’intérêts pour l’argent ainsi placé ; les Foster d’ailleurs n’en eussent accordé aucun. Mais, par contre, si quelques-uns de leurs clients, dont le caractère leur inspirait confiance, se trouvaient en situation de leur demander un prêt, ils l’accordaient volontiers après renseignements, parfois aussi après garanties données, et sans demander un penny d’intérêts ou prime quelconque.
Quand on cherchait le motif qui les déterminait à continuer le commerce de détail, les uns disaient que c’était pour se « distraire ; » d’autres parlaient, en revanche, d’un, plan de mariage qu’ils avaient dans la tête ; — un mariage qui unirait William Coulson, neveu de la défunte femme de Jeremy, à miss Hester Rose dont la mère était une espèce de parente éloignée, et qui était employée dans le magasin en même temps que William Coulson et Philip Hepburn. Cette version soulevait bien des doutes : — Coulson, disait-on, n’était pas du même sang que les Foster, et si ces derniers avaient pour Hester Rose des intentions si bienveillantes, ils n’auraient pas souffert qu’elle et sa mère vécussent de privations, réduites pour mettre leur modique revenu au niveau de leurs dépenses, à prendre chez elles, comme locataires, Coulson et Hepburn, les deux commis déjà nommés. — Ces incrédules ajoutaient que John et Jeremy laisseraient bien certainement toute leur fortune à quelque hôpital ou à quelque institution de charité.
On leur répondait (car il y a réponse à tout, dans le domaine des suppositions) que les vieux gentlemen roulaient probablement quelque dessein profond dans leurs têtes prévoyantes, le jour où ils avaient permis à leur cousine de prendre chez elle Coulson et Hepburn, — l’un qui pouvait passer pour leur neveu, — l’autre qui, tout jeune encore, était évidemment à la tête de leur commerce. Que l’un ou l’autre vînt à s’amouracher d’Hester, et la combinaison secrètement rêvée par les deux quakers se réaliserait conformément à leurs vues.
Pendant que nous entrons dans tous ces indispensables détails, Hester attend patiemment le bon plaisir de Sylvia, qui reste là plantée devant elle, un peu intimidée, un peu étourdie par la vue de tant de belles choses.
Hester était une grande jeune femme sans aucun embonpoint, mais taillée dans d’assez amples proportions, et que la gravité de son aspect semblait vieillir quelque peu. Ses épais cheveux bruns, divisés en bandeaux sur son large front, étaient retenus en bon ordre par son bonnet de mousseline ; le galbe de son visage était légèrement anguleux et son teint manquait de fraîcheur, mais sa peau était d’une finesse remarquable. L’honnête et affectueuse expression de ses yeux gris les rendait charmants ; et quand ses lèvres, d’ordinaire un peu serrées, comme celles des gens qui ne disent pas toujours ce qu’ils pensent, — venaient à dessiner quelque rare sourire, lorsqu’on entrevoyait derrière elles deux rangées de dents éblouissantes et parfaitement égales, lorsque ses yeux si doux se levaient en même temps sur celui à qui elle parlait, sa physionomie devenait tout à coup très-engageante. La couleur sobre et la coupe modeste de ses vêtements n’avaient rien qui ne fût d’accord avec les idées religieuses des Foster ; mais Hester elle-même n’appartenait pas à la secte des Amis.
La direction des regards de Sylvia lui avait fait présumer, à défaut d’explications plus complètes, qu’elle désirait savoir le prix d’un beau ruban de soie rouge placé fort en évidence et qui semblait la tenir en extase. Avertie de son erreur, Hester remit en place le ruban et alla chercher l’étoffe particulière que la jeune fille lui désignait. À peine avait-elle disparu, que Sylvia s’entendit interpeller par la personne qu’elle désirait le moins rencontrer dans le magasin, et dont l’absence, au moment où elle y entrait, lui avait arraché un secret mouvement de joie ; — c’était son cousin, Philip Hepburn.
Ce jeune homme, de haute taille, mais légèrement voûté par suite de ses occupations habituelles, avait une physionomie trop sérieuse pour son âge. Son épaisse chevelure, indocile au peigne et rebelle à tous les efforts qu’il faisait pour la ramener sur son front, produisait un effet singulier mais nullement désagréable ; sa figure un peu trop longue, son nez légèrement aquilin, ses yeux noirs n’auraient pas été trop mal sans la chute disgracieuse de sa lèvre supérieure qui donnait à l’ensemble de son visage un aspect peu flatteur.
« Eh ! bonjour, Sylvia, lui dit-il… Que venez-vous chercher par ici ?… Comment va-t-on chez vous ?… Permettez que je vous aide ! »
Sylvia pinça légèrement ses lèvres rouges, et lui répondit, sans le regarder :
« Je vais très-bien, ma mère aussi ; mon père a eu quelques atteintes de rhumatisme, et… voici quelqu’un qui m’apporte ce que je demande. »
À ces mots, elle se détourna quelque peu de lui, comme n’ayant rien de plus à lui dire. Mais il n’entendait pas laisser tomber ainsi la conversation, et sautant par-dessus le comptoir avec cette agilité spéciale qu’aiment à déployer les commis :
« Je vous aiderai à bien choisir, » continua-t-il plus officieux que jamais. »
Sylvia, pourtant, sans avoir l’air de prendre garde à lui, faisait semblant de compter une monnaie quelconque.
« Voyons, que désirez-vous, Sylvie ? lui demanda-t-il à la fin, contrarié de ce long silence.
— Je désire, mon nom étant Sylvia, qu’on ne m’appelle pas Sylvie, et, puisque vous voulez absolument le savoir, je suis venue chercher de la tiretaine pour un manteau. »
Hester rentrait à l’instant même avec un apprenti qui l’aidait à traîner quelques pesants rouleaux de drap écarlate et gris.
« Pas celui-là, dit Philip, écartant du pied la tiretaine rouge et s’adressant au petit garçon… N’est-ce pas, Sylvie, c’est le gris que vous voulez ?… »
Il donnait ainsi à sa cousine, oubliant ce qu’elle venait de lui dire, le nom qui convenait à leur intimité familière. C’était à coup sûr sans malice, mais elle n’en fut pas moins très-piquée.
« C’est l’étoffe rouge que je veux, miss… Dites, s’il vous plaît, qu’on ne l’emporte pas ! »
Hester les regardait tour à tour au visage, se demandant avec quelque surprise ce qu’ils pouvaient être l’un à l’autre. Cette fillette dont elle venait d’admirer le joli visage, seraitce donc la « belle petite cousine », dont Philip avait souvent parlé à sa mère comme d’une enfant gâtée, ignorante au delà du possible, une adorable niaise, et ainsi de suite ? D’après ces propos, Hester s’était imaginée Sylvia Robson fort différente de ce qu’elle la voyait aujourd’hui : plus jeune d’abord, mais aussi bien moins intelligente, bien moins attrayante, — nonobstant la bouderie passagère qui altérait en ce moment l’expression naturellement gracieuse de son aimable physionomie. Sylvia, cependant, avait repoussé l’étoffe grise, et s’absorbait dans la contemplation de la tiretaine écarlate.
Philip Hepburn n’avait pas vu sans quelque mécontentement l’effet produit par ses charitables conseils ; il n’en revint pas moins à la charge.
« Voici, disait-il, un article excellent, qui ne crève pas les yeux comme l’autre, et qui s’assortit à n’importe quelle couleur… Vous n’irez pas prendre cette étoffe, sur laquelle la moindre goutte d’eau ferait tache.
— Je ne croyais pas qu’on vendît ici des tissus si mauvais teint, » répondit Sylvia profitant des avantages qu’on lui laissait, et se relâchant, — le moins possible il est vrai, — de sa gravité d’emprunt.
Hester vint à la rescousse.
« Ce qu’on veut dire, reprit-elle, c’est que ce drap ne conservera pas son premier lustre s’il vient à être mouillé ; mais ce n’en est pas moins un article solide et susceptible de faire bon usage. M. Foster, sans cela, ne le recevrait pas dans ses magasins… Maintenant, reprit Hester, l’étoffe grise est un peu plus serrée et durerait, je crois, plus longtemps.
— Peu m’importe, répliqua Sylvia repoussant avec obstination ce gris sans éclat… Celle-ci me plaît davantage ; veuillez en faire couper huit aunes…
— Il en faut neuf, tout au moins, pour un manteau, reprit Philip avec décision.
— Ma mère a dit huit, » objecta Sÿlvia, bien décidée à contrarier Philip autant qu’elle le pourrait.
Mais à ce moment des cris d’enfants, des bruits de pas se firent entendre dans la rue, du côté de la rivière. Oubliant aussitôt sa mante et sa querelle, Sylvia courut à la porte du magasin ; Philip l’y suivit immédiatement. Hester, qui venait d’accomplir sa tâche en mesurant l’étoffe, les contemplait avec une sorte d’intérêt passif. Une de ces jeunes filles que Sylvia et Molly avaient trouvées sur leur chemin au sortir de la foule, remontait la rue à grands pas. Elle était pâle d’émotion, ses vêtements en désordre flottaient au vent, et ses gestes abandonnés, ses allures libres, la désignaient comme appartenant à la classe la plus infime de notre population côtière. Sans qu’elle en eût conscience ses joues ruisselaient de larmes, et dès qu’elle reconnut la physionomie sympathique de Sylvia, elle s’arrêta, toute hors d’haleine, pour lui serrer énergiquement la main.
« Les voilà ! les voilà ! criait-elle ; je cours le dire à maman…
— Sylvia, demanda Philip d’un ton sévère, comment connaissez-vous cette fille ?… Ce n’est pas une personne à qui vous deviez donner la main.
— Que pouvais-je donc faire ? dit Sylvia, que l’accent de Philip plus encore que ses paroles disposait à éclater en sanglots. Quand je vois les gens si joyeux, je ne saurais m’empêcher de partager leur bonheur : ma main est allée vers elle comme la sienne venait vers moi… Pensez donc que le vaisseau arrive enfin ! Si vous aviez vu tous ces regards jetés du côté de la mer, toute cette inquiétude, toute cette attente, vous auriez vous aussi serré la main de cette jeune fille, et sans qu’il y eût un grand dommage, à mon avis… Il n’y a pas demi-heure que, du côté de la jetée, je l’ai vue pour la première fois, et peut-être ne la rencontrerai-je de ma vie. »
Hester, sans quitter le comptoir, s’était cependant rapprochée d’eux ; elle entendait ce dialogue, et le moment lui sembla venu d’y placer son mot.
« Cette enfant, dit-elle, ne saurait être tout à fait mauvaise, puisque sa première pensée était d’aller avertir sa mère. »
Sylvia jeta du côté d’Hester un vif regard de reconnaissance, qui passa malheureusement inaperçu, la jeune marchande s’étant mise à regarder par la fenêtre.
Molly Corney, arrivant presque aussitôt, entra comme une tempête dans le magasin.
« Écoutez, écoutez !… disait-elle. Entendez-vous ces cris, du côté du quai ? La press-gang est tombée sur eux comme l’Ange exterminateur… Écoutez, écoutez plutôt ! »
Personne ne parlait plus, personne ne respirait plus, et on eût dit que tous les cœurs suspendaient leur battement pour mieux entendre. — La voix populaire s’élevait en effet, poussant des cris de rage et de désespoir, parmi lesquels la distance n’empêchait pas de distinguer çà et là quelques malédictions inarticulées. Le tumulte, le piétinement irrégulier, les clameurs se rapprochaient peu à peu.
« On les mène à la Randyvow-house, reprit Molly ; et je voudrais que le roi George fût là, pour lui dire ma façon de penser ! »
Elle grinçait des dents et serrait les poings en parlant ainsi.
« Voilà qui est terrible ! dit Hester ; leurs mères, leurs femmes les attendaient comme des étoiles tombées du ciel.
— Ne pouvons-nous rien pour eux ? s’écria Sylvia. Jetons-nous dans la foule et portons-leur assistance ! Il m’est impossible de voir tout cela et de rester les bras croisés. »
Pleurant à moitié, déjà elle se précipitait vers la porte ; mais Philip la retint d’une main ferme.
« Non, Sylvia, vous n’irez pas ! Point d’étourderies, sil vous plaît. C’est la loi qui s’exécute, et personne n’y peut rien ; à plus forte raison les femmes et les petites filles, »
Cependant les premiers groupes commençaient à passer sous les fenêtres du magasin. Foster. Ils se composaient principalement de gamins du port, êtres pour ainsi dire amphibies, qui, forcés de reculer devant l’élan de la foule, n’en cherchaient pas moins toutes les occasions de jeter une insulte, un blasphème à la face des agents de la presse. Ceux-ci, armés jusqu’aux dents, pâles, de colère, se distinguaient sans peine des cinq ou six matelots à faces bronzées qu’ils venaient d’enlever à l’équipage du baleinier. La razzia eût peut-être été plus complète, mais, depuis la fin de la guerre d’Amérique, c’était le premier ordre de l’Amirauté que la population de Monkshaven eût vu ramener à exécution. Un de ces hommes adressait à ses concitoyens, d’une voix poussée à ses notes les plus aiguës, je ne sais quelle exhortation que bien peu de personnes entendaient, car elle était pour ainsi dire noyée dans les violentes imprécations, les apostrophes irritées des femmes qui se pressaient comme le Chœur antique autour du groupe fatal. Sur leurs visages convulsés et livides on pouvait lire les émotions les plus contradictoires : un mélange bizarre de tendresse et de fureur, l’ardent désir de serrer sur leurs poitrines ces chers êtres qu’une autorité cruelle leur enlevait, la soif non moins ardente d’une prompte délivrance et d’une vengeance complète.
Quelques hommes, çà et là, silencieux et sombres, n’eussent pas mieux demandé que de satisfaire à ce dernier vœu ; mais ils n’étaient pas en très-grand nombre, et l’immense majorité de ceux qu’une révolte aurait trouvés prêts était précisément à bord des baleiniers encore absents.
Au moment où la multitude orageuse se massait sur la place du Marché, au moment où, dans ses rangs serrés, la press-gang se frayait de force un chemin vers l’odieux Rendez-vous, une femme accourut et la rejoi
Habitant au delà des faubourgs, elle n’avait appris que fort tard le retour du baleinier, et, à son arrivée sur le quai, une vingtaine de voix sympathiques s’étaient hâtées de lui annoncer que son mari venait d’être enlevé pour le service du gouvernement.
À l’issue du Marché que la press-gang venait de franchir, issue qui se trouvait encombrée par la foule, cette femme fut contrainte de s’arrêter ; un cri déchirant, — le premier qu’elle eût encore poussé, — sortit alors de sa poitrine.
« Jamie ! Jamie !… Vont-lis donc vous enlever à moi ?… »
Sylvia n’en entendit pas davantage et, avec un éclat de pleurs qu’elle ne put contenir, tomba sans connaissance dans les bras d’Hester et de Molly ; elles se hâtèrent de l’emporter dans l’arrière-magasin qui était en même temps le salon de Jeremy Foster ; — John, le frère aîné, habitait une maison à lui, sise à l’autre bord de la rivière.
Quand Sylvia revint à elle, ce fut pour se retrouver, la tête nue, les cheveux complétement trempés, sur le large sofa du vieux quaker. Elle se redressa et regarda les deux femmes empressées autour d’elle, sans pouvoir d’abord comprendre ce qu’elle voyait.
« Où suis-je ? disait-elle écartant les cheveux humides qui masquaient ses yeux… Ah ! je sais, je sais maintenant ! Merci, merci ! C’est une grande sottise à moi ; mais que voulez-vous ? Tout cela m’a paru si triste… »
Et le souvenir de cette scène poignante l’aurait peut-être replongée dans un nouvel évanouissement, sans la charitable intervention d’Hester :
« Oui, ma pauvre enfant, bien triste, comme vous dites ; mais il n’y faut plus songer, puisque nous n’y pouvons rien et que cette pensée vous fait du mal… Vous êtes, je crois, la cousine de Philip Hepburn, et votre famille habite la ferme de Haytersbank ?
— Précisément,… c’est Sylvia Robson, » répondit Molly sans s’apercevoir qu’Hester voulait tout simplement faire diversion et détourner l’attention de Sylvia du sujet qui l’avait si péniblement émue. Puis elle allait commencer, avec les gémissements obligés, le récit de leur excursion à Monkshaven, lorsqu’une porte s’ouvrant derrière elle vint l’arrêter fort à propos. C’était Philip qui, par un geste muet, demandait à Hester s’il lui était permis d’entrer au salon.
Sylvia, détournant son visage du jour qui l’éclairait, se hâta de fermer les yeux. Son fidèle cousin approcha d’elle sur la pointe des pieds, et jeta un regard inquiet sur ceux de ses traits qu’elle n’avait pu lui dérober entièrement ; puis passant la main sur ses cheveux, si légèrement qu’à peine pouvait-il croire les avoir touchés :
« Pauvre petite ! murmurait-il ; combien je regrette qu’elle soit venue aujourd’hui ! Une si longue course, et par cette chaleur ! »
Mais Sylvia, déjà sur son séant, le repoussait presque. Grâce à l’excitation passagère de ses sens, elle venait d’entendre, avant qu’aucun des assistants s’y fût arrêté, le bruit d’un pas qui traversait la cour. Effectivement, au bout d’une minute, une porte vitrée s’ouvrit, et M. Jeremy parut, manifestant quelque surprise à l’aspect du groupe qu’il trouvait réuni dans son salon, ordinairement vide.
Philip se hâta de lui donner les explications nécessaires, et son patron, traversant la pièce sur la pointe du pied, — comme s’il craignait d’être importun, même chez lui, — fit signe au jeune homme de l’accompagner dans le magasin. Déjà au courant du tumulte survenu dans la ville, il venait enjoindre à son principal commis de veiller à ce que les apprentis, rigoureusement retenus à leur ouvrage, n’allassent pas se mêler à l’émeute. Voyant Philip hésiter :
« Explique-toi, mon garçon, ne garde rien sur le cœur : la mission que je te donne te contrarie-t-elle ?
— J’avais pensé à ramener chez elles ma cousine et cette autre jeune personne, car la ville est un peu en l’air et il commence à faire sombre.
— Soit, dit le bon vieillard ; je me chargerai d’arrêter Nicholas et Henri si par hasard ils voulaient s’abandonner aux instincts du vieil Adam, et puisque William Coulson n’est pas encore revenu d’York, je rangerai moi-même le magasin, je reconduirai moi-même Hester chez elle. »
Nicholas et Henri avaient déjà levé le pied, cela va sans dire, et, le magasin une fois rangé, Jeremy n’eut plus qu’à pratiquer, avec toutes les recherches de sa courtoisie surannée, les rites hospitaliers du temps. Tirant une clef de sa poche, il ouvrit un placard, creusé tout exprès assez haut et où se trouvait sa petite provision de gâteaux, de vins et de liqueurs, pour la mettre tout entière à la disposition des deux jeunes filles.
Sylvia refusa ce qu’on lui offrait. Molly, plus docile aux usages, accepta du vin et des gâteaux, ayant bien soin d’en laisser la moitié, selon les exigences de l’étiquette villageoise, et aussi parce que sa compagne la pressait obstinément de partir. Sylvia se flattait peut-être d’échapper à l’escorte de son cousin ; mais ce petit plan fut déjoué par le retour de Philip, qui rentra dans le salon, une joie grave peinte dans ses yeux, et portant sous son bras cette tiretaine rouge qui avait failli le brouiller avec Sylvia. Celle-ci boudait encore un peu, mécontente d’avoir été inutilement impolie. Cependant, et par manière d’expiation, elle mit dans ses adieux une certaine douceur qui la réconcilia complètement avec son hôte. Hester, en revanche, ne paraissait pas disposée à goûter les éloges enthousiastes que son patron accordait à cette charmante jeune fille. Ses refus malséants, son ingratitude envers Philip, révoltaient le sens droit et l’équité naturelle de la demoiselle de magasin. Peut-être aussi se trouvait-elle blessée dans un autre sentiment qu’elle ne s’avouait pas à elle-même. Toujours est-il qu’elle s’étonnait et pour ainsi dire s’alarmait quelque peu.
IV
PHILIP HEPBURN.
La ferme récemment prise à bail par le père de Sylvia était située sur une de ces hauteurs rocailleuses qui bordent immédiatement certaines portions des rivages anglais. Les établissements agricoles placés ainsi étaient, il y a soixante et dix ans, — et furent longtemps encore, — des exploitations mixtes, où la contrebande entrait pour sa bonne part. Elle fumait avec un zèle admirable des terres obstinément stériles, et sous l’abri mystérieux des rochers, maint et maint objet prohibé demeurait en entrepôt, jusqu’à ce que le fermier envoyât des gens de confiance chercher pour lui, dans de grands paniers d’osier, une provision de sables et de varechs plus ou moins authentiques, qui étaient censés devoir servir à l’engrais de ses champs. Tour à tour matelot, contrebandier, marchand de chevaux, fermier enfin, Robson était un de ces changeants aventuriers qui aident rarement à faire prospérer une famille, un de ces hommes qui sont à la fois aimés et censurés de tous leurs voisins. Il avait épousé tard, et sans beaucoup de prudence, une tante de Philip Hepburn par qui ce jeune homme avait été élevé jusqu’au moment où, se mariant ainsi, elle avait cessé de remplacer la défunte femme de son frère. C’était même Philip qui les avait déterminés, elle et son mari, à louer la ferme de Haytershank, sise dans un de ces creux dont nous avons parlé plus haut, et mieux abritée qu’on n’aurait pu le croire tout d’abord contre les vents continuellement déchaînés qui, battant ses murailles basses, fauchaient à une certaine hauteur les arbres qu’on tâchait de faire pousser autour d’elle. Mistress Robson, — Bell Robson, comme on l’appelait plus familièrement, — née native du Cumberland, était une ménagère plus laborieuse et plus recherchée que la généralité des femmes de fermier sur cette côte Nord-Est : aussi n’approuvait-elle guère leurs façons d’agir, le témoignant du reste par sa physionomie plutôt que par ses paroles, car elle ne bavardait pas volontiers. Il va sans dire que cette supériorité, à laquelle l’intérieur de son ménage devait un aspect particulièrement confortable, ne l’avait pas rendue très-populaire parmi ses voisines.
Ce soir-là, le fermier et la fermière étaient déconcertés par l’absence prolongée de leur fille. Le premier ne faisait qu’entrer et sortir de la maison, toujours plus désappointé, toujours plus impatient ; sa femme, calme et taciturne comme à l’ordinaire, ne manifestait son anxiété que par des réponses plus courtes que d’habitude et en tricotant avec un surcroît de zèle.
« Bientôt sept heures, disait le mari. J’ai grande envie d’aller jusqu’à Monkshaven chercher moi-même cette enfant.
— Non, Daniel, répondait sa femme ; tu souffrais des jambes la semaine passée, et pareille course n’est pas ton fait… Si tu veux, j’éveillerai Kester pour envoyer à ta place.
— Pas du tout, Kester n’ira pas… Il a une espèce de faible pour notre fillette, et je voudrais lui faire comprendre qu’elle n’est pas pour lui.
— Je ne pense pas qu’il se soit jamais avisé de songer à elle… Il l’aime comme une enfant qu’on a élevée dès le berceau… Du reste je puis bien, si tu veux prendre garde au lait, mettre mon capuchon et aller au-devant d’elle jusqu’au bout de la prairie. »
Mais, avant que mistress Robson eût déposé son tricot, on entendit dans l’éloignement un bruit de voix qui se rapprochait de plus en plus, et Daniel monta derechef à son poste d’observation.
« Voilà qui va bien, dit-il au retour… Nul besoin de te déranger. Et je gagerais que j’ai reconnu la voix de Philip Hepburn… Je te disais bien, tantôt, qu’il nous la ramènerait. »
La prédiction dont le fermier se targuait, c’était sa femme qui l’avait faite, et il l’avait déclarée hautement improbable. Mais elle ne voulut pas le relever pour si peu, et d’ailleurs ils étaient tout au plaisir de revoir leur petite Sylvia.
Elle revenait, les joues animées par la marée et aussi par le vent d’octobre qui vers le soir commençait à se faire vif ; sur son front un léger nuage, qui ne résista pas aux regards affectueux de ses chers parents. Philip, marchant derrière elle, avait aussi l’air fort animé, mais sa physionomie n’exprimait aucune satisfaction. Il reçut de son oncle un accueil cordial et tandis que, laissant le lait aux femmes, ils dégustaient ensemble un verre de grog, leur entretien roula sur les nouvelles que Philip rapportait de Monkshaven, l’arrivée des baleiniers, les exploits de la press-gang et le reste. Robson ne prenait pas les choses aussi froidement que Philip, et pendant qu’il exhalait maint et maint propos révolutionnaire, son poing robuste, qui retombait à chaque instant sur la table de bois blanc, y faisait vibrer les verres et les faïences. Quant à ses raisonnements politiques, ils pouvaient se résumer ainsi : Le gouvernement n’avait recours à la presse que pour combattre les Français sur mer avec des équipages égaux en nombre à ceux de l’ennemi. Par là même il témoignait une méfiance injuste à la valeur nationale, et il ne faisait pas, loyalement, la part de l’ennemi. Étant admis qu’un matelot anglais en vaut quatre du continent, n’y avait-il pas une injustice évidente à vouloir combattre ceux-ci sur un pied d’égalité numérique ?… « Autant vaudrait, pour un homme robuste, s’attaquer à une femme comme Sylvie ou au petit Billy Crofton qui n’a pas encore de culottes… Fumez-vous, Philip ? »
Philip ne fumait pas, mais il argumentait volontiers, et défendit de son mieux le gouvernement : — Avant de faire des avantages aux Français, il fallait être sûr de les battre ; et puisqu’on avait besoin d’hommes pour compléter les équipages, il fallait se les procurer de manière ou d’autre. Les bourgeois payaient leurs taxes, les soldats de milice payaient de leur personne ; les matelots ne payant pas de taxes et ne voulant pas payer de leur personne, il fallait bien les y contraindre. En somme, et malgré la press-gang, on devait se féliciter, de vivre sous le roi George et sous le régime de la Constitution britannique… Sur quoi Daniel retira sa pipe de sa bouche, et protesta qu’il n’avait articulé la moindre parole ni contre le roi George, ni contre la Constitution. Et le débat allait s’échauffant, grâce à la trèsimpolitique obstination de Philip, tandis que Sylvia et sa mère, légèrement ennuyées, reprenaient le cours de leurs occupations domestiques, après une conversation à voix basse, dont le manteau neuf avait fait les frais.
Une femme qui joue de la harpe, — c’est du moins l’avis général, — croit rehausser par cet exercice les avantages d’une taille gracieuse ; mais, sous ce rapport, le rouet à filer vaut la harpe, et je ne l’ai vu remarquer nulle part. Sylvia, ce soir-là, aurait fourni aux plus incrédules la preuve de ce que j’avance. Le ruban bleu qu’elle avait jugé à propos de nouer autour de ses cheveux ayant de mettre son chapeau pour aller au marché, laissait maintenant, relâché peu à peu, errer au hasard leurs boucles touffues. Son petit pied, posé sur la planche du rouet, était encore enfermé, — non sans quelque regret, — dans un beau soulier bouclé ; car ni elle ni Molly n’avaient voulu revenir pieds nus en compagnie de Philip. Son bras rond, légèrement hâlé, sa main effilée et un peu rouge, suivant exactement la mesure du tour de roue, attiraient le chanvre avec un mouvement agile et preste. De tout ceci, Philip ne perdait pas un détail ; mais les traits de la jeune fille lui étaient dissimulés en partie, car elle détournait à moitié la tête pour se soustraire, avec une déplaisance craintive, aux regards avides dont elle savait que son cousin l’enveloppait volontiers. Mais elle avait beau se détourner ; le craquement de la chaise où il était assis, — et qu’il faisait cheminer à grand’peine sur les dalles du foyer, n’osant guère se lever pour changer de place, — avertissait la jeune fille de la petite manœuvre à laquelle il se livrait pour la regarder autant que possible, sans tourner absolument le dos au père ni à la mère de sa bien-aimée. Contenant son impatience, elle attendait, silencieuse, l’occasion de le contredire ou de le désobliger en quelque chose ; et cette occasion se présenta naturellement lorsque son père lui demanda des nouvelles de l’emplette qu’elle avait dû faire.
« Je voulais, dit Philip, que Sylvia prît l’étoffe grise.
— J’ai pris la rouge, qui est beaucoup plus gaie et qui se fait voir de beaucoup plus loin… N’est-ce pas, père, vous aimez à me voir du bout de la prairie ?… »
Ici la mère intervint. Il ne lui convenait pas qu’on cajolât trop ouvertement son mari ; mais celui-ci avait déjà le cœur gagné.
« Laissez, disait-il, laissez cette bonne fillette faire à sa guise… À moins que Philip que voici, — le grand champion des lois et de la presse des matelots, — ne trouve quelque ordonnance qui nous défende de complaire à notre unique enfant… Car nous n’en avons pas d’autre, bonne mère, et tu n’y penses pas assez. »
Bell y pensait souvent, plus souvent peut-être que son mari, car elle se rappelait chaque jour — et chaque jour plusieurs fois, — ce petit être qui était né, qui était mort pendant une des longues absences de son père. Mais répondre n’était pas dans ses habitudes.
Sylvia lisait dans le cœur de sa mère plus facilement que l’honnête Daniel ; aussi s’empressa-t-elle de rompre la conversation :
« Philip ? reprit la folle enfant, il n’a fait que nous prêcher la loi tout le long de la route… Je ne disais rien, quant à moi, et j’ai laissé Molly se défendre comme elle pouvait ; si j’avais voulu, cependant, j’aurais eu de bons contes à faire, sur les soies et les dentelles de France dont certaines gens ont un assortiment si complet. »
Le visage de Philip s’empourpra. Non, certes, à cause de cette allusion à la contrebande dont il était un des agents les plus actifs ; mais il était piqué de voir sa petite cousine découvrir si vite combien ses pratiques étaient peu d’accord avec ses maximes ; et plus piqué encore de constater le plaisir qu’elle prenait à mettre en lumière cette flagrante inconséquence. Il s’inquiétait aussi quelque peu du parti que son oncle allait pouvoir tirer contre lui, dans leur discussion, de cette illégalité habituelle, si peu d’accord avec l’ensemble de ses idées conservatrices. Mais Daniel avait bu trop de grog pour raisonner si juste, et sa langue allait s’épaississant toujours de manière à inquiéter sa femme et sa fille, non sur les propos étranges qu’il commençait à tenir, mais sur les fâcheuses conséquences que pourrait avoir un excès de boisson dans l’état maladif où il se trouvait depuis quelque temps. La jeune fille mit simplement son rouet de côté, pour indiquer que l’heure du sommeil était venue ; sa mère, — usant d’un droit depuis longtemps conquis, — enleva le verre et le flacon d’eau-de-vie dont on abusait, selon elle. Une protestation énergique fut la conséquence de ce coup d’état ; mais Philip avait déjà pris son chapeau pour se retirer, et les imprécations du vieux fermier, à moitié furibondes, à moitié plaisantes, n’arrêtèrent pas un moment son départ. Ainsi abandonné par son unique allié, le vieux Robson dut se soumettre. Quant à Philip, il ne songeait guère, en s’éloignant, qu’à se rendre un compte exact de la poignée de main que Sylvia lui avait octroyée en signe d’adieux.
V
HISTOIRES DE PRESSE.
Le lendemain et les jours suivants, le temps s’était mis à la pluie ; les rhumatismes du vieux Robson s’en trouvaient fort aggravés, et le digne fermier, retenu dans sa demeure, s’y ennuyait à cœur joie. Sa femme, réduite comme Mme de Maintenon, — et sans autant de ressources que celle-ci, — à divertir de son mieux un homme qui n’était plus amusable, recourut dans sa détresse aux conseils de Sylvia : « Si du moins, lui disait-elle, Philip Hepburn pouvait revenir… » Mais Sylvia repoussait comme absurde l’idée que Philip pût servir de passe-temps à quelqu’un. Et quand, là-dessus, elle vit sa mère toute prête à se fâcher : « J’ai un autre remède, lui dit-elle, et bien plus certain… » Après quoi, jetant sur sa tête son tablier bleu, elle courut vers la grange où Kester, le garçon de ferme, examinait les toisons qu’on allait préparer pour la filature. L’apparition du joli minois de Sylvia que ce capuchon improvisé semblait embellir encore, fit épanouir un large sourire sur l’épais visage du fidèle serviteur, — épris peut-être de sa jeune maîtresse, — mais si secrètement que lui-même ne s’en doutait pas.
Elle avait, disait-elle, un message à lui confier ; message qui demandait beaucoup de ménagements et de diplomatie. Il ne s’agissait de rien moins que de déterminer maître Bullfinch, le tailleur, à venir, sans faire semblant de rien, s’enquérir des réparations qu’exigeaient les vêtements du fermier. On s’arrangerait pour qu’il trouvât bonne quantité d’ouvrage ; cet ouvrage le retiendrait à la ferme ; et Robson aurait ainsi, pour toute la durée du mauvais temps, un interlocuteur assuré, dont le bavardage n’était pas sujet à s’épuiser facilement. Kester entra joyeusement dans le complot, enthousiasmé de quelques incitations caressantes qui, dans la bouche de Sylvia, équivalaient aux ordres les plus péremptoires. Mais, comme la diplomatie n’était guère son fait, il la remplaça par un beau shilling dont il fit généreusement le sacrifice muet, et qui eut sur Bullfinch une influence au moins égale à celle des insinuations les mieux ménagées.
Dès le lendemain, comme par hasard, le tailleur apparaissait au seuil de la ferme de Haytersbank, et comme par hasard aussi, Bell et Sylvia découvraient une foule d’accrocs à fermer, de boutons à remettre, qui nécessitaient son installation régulière dans leur petit établissement. Une fois l’ouvrage en bon ordre, les fers au feu et la fille de la maison appelée à lui prêter aide et secours, le tailleur entra de plain-pied dans ses commérages habituels. L’émeute de Monkshaven en fit d’abord tous les frais, mais elle avait été suivie d’un incident assez grave que les gens de la ferme ignoraient encore, et que le lecteur apprendra dans les mêmes termes où il leur fut conté :
« Oui, disait le tailleur, il a fait des siennes, le Vaisseau du roi[2]… Et qui s’en serait douté ?… Il était depuis longtemps si tranquille, le lieutenant soldait si bien tous ses achats… Mais vous avez su, n’est-il pas vrai, comment il est allé prendre, à bord de la Résolution, les quatre plus beaux marins à qui j’aie jamais taillé une paire de culottes ?… Cela se passait jeudi dernier, et tout Monkshaven était en l’air… Vous auriez dit un nid de guêpes volant de çà et là et bourdonnant à qui mieux mieux, sans compter que beaucoup avaient leur aiguillon tout prêt et ne demandaient qu’à se venger… Il fallait entendre les femmes pleurer et sangloter dans les rues… Il fallait voir, pendant toute la journée du vendredi, celles qui restaient sous la pluie tout le long des quais, s’écarquillant les yeux à regarder du côté de la pointe Saint-Abb !… C’était là qu’on avait signalé, le jeudi, l’arrivée de la Good-Fortune… On l’attendit en vain toute la journée… La marée de l’après-midi passa, et de ce malheureux bâtiment on n’avait pas vu la moindre ficelle… Se tenait-il hors de vue, crainte du tender ? … Avait-il décidément pris le large ?… C’était ce que demandaient les pauvres femmes en rentrant chez elles mouillées jusqu’aux os, sans regarder personne, sans parler à personne, et tâchant de se donner courage pour la nuit d’angoisses qu’elles allaient passer. Le samedi matin, — vous vous rappelez l’orage qu’il faisait, cette pluie, ce vent terrible, — on se remit au guet dès l’aurore, et cette fois la Good-Fortune franchit la barre… Mais on avait déjà de ses nouvelles par la chaloupe de la douane. La croisière avait été bonne ; nos gens rapportaient quantité d’huile et de gras. Malgré cela ils avaient à mi-mât leur pavillon trempé de pluie, en signe de chagrin et de détresse… C’est qu’il y avait à bord un homme tué, un homme qui le matin même s’était levé frais et dispos. Il y en avait un autre, dont la vie ne tenait plus qu’à un fil ; et enfin l’équipage en avait vu partir sept, qui auraient dû se trouver là, mais que la pressgang