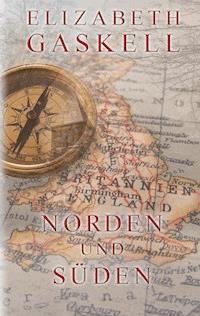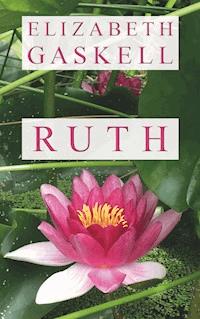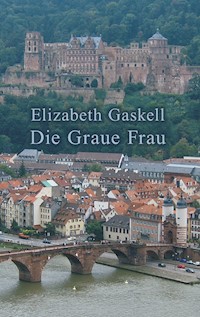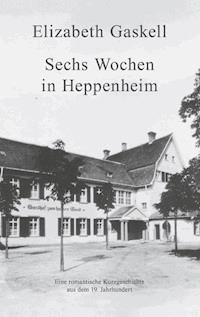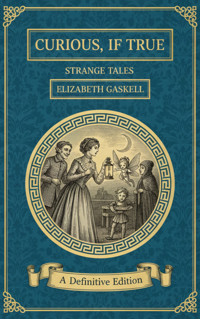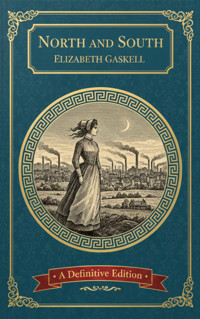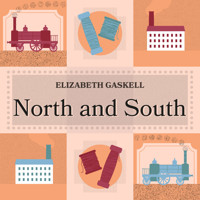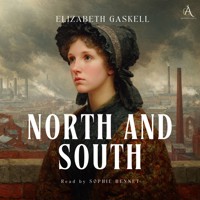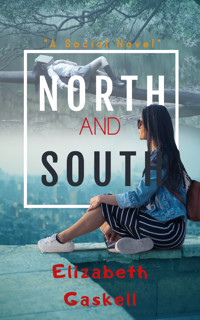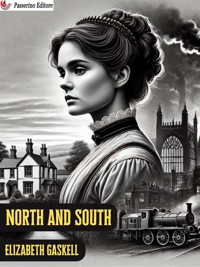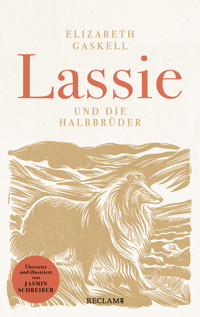Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« L'Oeuvre d'une nuit de mai » d'Elizabeth Gaskell est une nouvelle envoûtante qui transporte le lecteur dans l'Angleterre victorienne. L'histoire se déroule dans un petit village paisible, où la monotonie est soudainement brisée par l'arrivée d'un jeune artiste talentueux mais tourmenté, nommé Philip. Une nuit de mai, alors que Philip erre dans les rues désertes, il fait la rencontre fortuite d'une mystérieuse jeune femme, Eleanor. Cette dernière, d'une beauté éthérée et d'une grâce captivante, devient instantanément la muse tant recherchée par l'artiste. Inspiré par sa présence, Philip entreprend de peindre son chef-d'oeuvre, travaillant avec une frénésie créatrice jusqu'à l'aube. Au fil de la nuit, une connexion profonde se tisse entre les deux personnages. Eleanor partage avec Philip des fragments de son passé énigmatique, tandis que l'artiste lui confie ses aspirations et ses doutes. Leur échange, empreint de poésie et de mélancolie, révèle les complexités de l'âme humaine et la fragilité des rêves. Cependant, à l'approche du jour, Eleanor disparaît aussi mystérieusement qu'elle est apparue, laissant Philip avec une toile inachevée et le coeur empli de questions. L'artiste se retrouve alors confronté à un dilemme : achever l'oeuvre de mémoire ou accepter l'éphémère beauté de cette rencontre nocturne. Gaskell tisse habilement une intrigue où réalité et rêve s'entremêlent, questionnant la nature de l'inspiration artistique et le pouvoir transformateur d'une seule nuit. La nouvelle explore avec finesse les thèmes de la créativité, de la solitude de l'artiste et de la quête de sens dans un monde en constante évolution. « L'Oeuvre d'une nuit de mai » est un bijou littéraire qui captive par sa prose élégante et son atmosphère onirique. Gaskell parvient à créer un microcosme riche en émotions et en réflexions, offrant une méditation profonde sur l'art, l'amour et la fugacité du temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
L’OEUVRE D’UNE NUIT DE MAI
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
L’OEUVRE D’UNE NUIT DE MAI
I
Dans certaine ville de certain comté vivait, il y a quelque quarante ans, un jurisconsulte nommé Wilkins. Il y exerçait cette profession spéciale qui est désignée sous le nom de conveyancing attorney. C’est un peu l’avoué, un peu le notaire, un peu l’avocat consultant, bref, un légiste à tout faire qui cumule les bénéfices de plusieurs spécialités ailleurs distinctes. Le comté n’était point fort étendu, la ville ne comptait guère plus de quatre mille habitants, mais comme la clientèle de M. Wilkins se recrutait, dans un rayon de vingt milles, chez presque toutes les familles nobles, son cabinet, fondé par son grand-père, amélioré par son père, lui donnait d’assez amples produits, et le plaçait sur un très-bon pied de confiance amicale vis-à-vis des principaux personnages du pays. Sans être positivement des leurs, il était trop avant dans les secrets de leur existence pour n’être pas accueilli chez eux, admis à leur table, — sans sa femme, cela va de soi, — et même invité à leurs chasses quand un hasard plus ou moins prémédité l’amenait, à cheval, sur le chemin de leurs meutes. N’allez pas supposer qu’il jouât le rôle de parasite ou de flatteur. Il avait son franc-parler et donnait hardiment les conseils les moins agréables, soit qu’il s’agît de conclure un mariage « disproportionné, » soit de revendiquer les droits d’un tenancier traité avec une injuste rigueur.
M. Wilkins eut un fils dont la naissance le combla de joie. Sans être personnellement ambitieux, il lui en eût coûté de voir passer en des mains étrangères un cabinet dont il savait mieux que personne apprécier les riches produits. Cette considération fit pencher la balance où il pesait les futures destinées de son fils Edward, et, après lui avoir donné une éducation tout aristocratique, il l’arrêta court, au sortir d’Éton, alors que le jeune homme s’attendait à suivre, sur les bancs de Cambridge ou d’Oxford, les nobles camarades avec lesquels jusqu’alors il avait marché de pair.
Toutes sortes de compensations lui furent offertes, quand, après avoir fait à Londres ses études légales, il fut rentré, non sans quelques regrets, dans l’étude paternelle. Il eut de beaux chevaux, et absolument carte blanche pour la satisfaction de ses instincts littéraires Edward était, par nature, étranger aux vices qui dégradent ; ses penchants étaient ceux de l’homme du monde et le mettaient plutôt audessus qu’au niveau des plus orgueilleux clients de son père, pour lequel d’ailleurs il professait une respectueuse affection. Quant à sa mère, il l’avait perdue depuis longtemps.
Lorsqu’il fit ses débuts aux « assemblées » de Hamley, ces réunions, tant bien que mal imitées de celles que le grand monde patronnait à Londres, n’étaient pas tout à fait aussi exclusives que dans le principe. Et cependant, bien qu’il eût assisté, dans le cours de ses voyages sur le continent, à des bals autrement splendides que ceux de la vieille salle d’auberge où les magnats du comté se réunissaient pour danser à frais communs, il ne put se défendre d’une émotion dont il se moquait lui-même quand il dut affronter l’entrée de ce sanctuaire, à la porte duquel une foule d’absurdes préjugés faisaient bonne garde. Comment y serait reçu le fils de l’attorney Wilkins ? Quelle figure y ferait-il en présence du lord-lieutenant et d’une belle duchesse que, disait-on, ce représentant de la royauté devait y conduire ? On les attendit longtemps, on désespérait de les voir paraître, quand le frou-frou d’une robe de damas annonça l’arrivée de l’imposante dame et de sa nombreuse escorte. L’orchestre aussitôt s’arrêta, les danses furent suspendues ; un quadrille s’organisa sur nouveaux frais, où le respect dû à la duchesse ne permettait d’admettre que les gens de son entourage. Mais il se trouva que pour cette contredanse française (mode alors nouvelle) les figurants du sexe laid n’étaient pas en nombre suffisant. Il fallut convoquer l’arrière-ban, et le jeune Wilkins, qui dansait à merveille, fut requis l'un des premiers. La duchesse, remarquant sa bonne grâce, n’hésita pas à le désigner pour partner de la charmante lady Sophie, sa fille aînée, sans songer à s’informer de son origine plus ou moins plébéienne. À partir de ce moment, Edward se vit en grande faveur parmi les ladies de Hamley. Les mamans aussi le voyaient d’un bon œil, mais certains hobereaux n’en continuaient pas moins à se formaliser de ce qu’un intrus pareil était admis dans des réunions de gens comme il faut, et leurs fils, qu’Edward avait plus ou moins distancés à Éton, tant par le chiffre de ses dépenses que par celui de ses succès classiques, ne manquaient aucune occasion de le traiter, comme on dit, « par-dessus l’épaule », en lui faisant comprendre qu’ils le regardaient, par rapport à eux, comme un parvenu fourvoyé parmi ses supérieurs.
Tout ceci ne constituait pas une position agréable, et présageait en outre d’assez grandes difficultés pour le mariage auquel aspirerait tôt ou tard le fils de l’attorney. Il ne pouvait guère se dissimuler que la plus avenante de ses danseuses habituelles se regarderait en quelque sorte comme offensée s’il la conviait à venir régner dans son élégante maison ; — meublée, disons-le, avec plus de goût qu’aucun des châteaux voisins. Il le savait d’autant mieux qu’il avait déjà eu à supporter, à dévorer en silence, maint et maint déboire dont il ne pouvait guère tirer de représailles, si ce n’est en affichant un certain luxe par lequel il écrasait ses concurrents mieux doués que lui sous le rapport de la naissance. Qu’un cheval de prix fût mis en vente, il le leur enlevait sans pitié. Pas un d’eux n’avait un chenil mieux garni que le sien, et s’ils lui enviaient moins sa collection de tableaux, encore leur inspira-t-elle, connaisseurs insuffisants, ce respect que l’ignorance ne refuse guère aux objets qu’elle ne peut évaluer.
Ce fut dans ces circonstances qu’Edward s’éprit de miss Lamotte, et qu’il obtint sa main. Elle était sans fortune, mais personne ne pouvait lui contester une origine patricienne, le baronetage mentionnant Lettice, fille cadette de sir Mark Holster, née en 1772, mariée en 1799 à C. Lamotte, et décédée en 1810. Lettice Holster avait laissé deux jeunes enfants, garçon et fille, placés, à sa mort, sous la protection de leur oncle maternel, sir Frank Holster, attendu que leur père, dont jamais on ne prononçait le nom, avait disparu, mort ou vivant encore, du monde auquel appartenait sa femme. Sir Frank lui-même, — et personne ne le savait mieux que les Wilkins, — se trouvait dans une situation pécuniaire assez embarrassée. Il ne se montra pourtant pas fort enthousiasmé de l’union qui s’offrait pour sa nièce, et fit acheter son consentement par plus d’une impertinence, comme s’il n’eût pas dû s’estimer fort heureux d’établir d’une manière aussi convenable la fille d’un homme tel qu’était son beau-frère, — d’un misérable banni qui n’aurait pu reparaître dans sa patrie sans s’exposer à des poursuites immédiates, et probablement à une condamnation infamante.
Edward ressentit vivement ces insolents procédés, mais il en fut dédommagé par l’affection de sa femme qui se montra toujours fière de lui appartenir. S’il l’eût écoutée, il se serait séparé d’un monde où les préjugés lui étaient hostiles, pour se confiner dans les douceurs de la vie domestique, auprès de l’inaccessible foyer que tout bon Anglais sait transformer en château fort. Mais c’était peutêtre demander beaucoup à un jeune homme d’humeur sociable, qui, malgré les dédains dont il était parfois la victime, se sentait capable de briller dans une sphère moins étroite. Edward voulut continuer à voir et à recevoir du monde. Recevoir, en ce temps-la, c’était donner à dîner. Le vin jouait un grand rôle dans ces réunions hospitalières. Edward, qui n’avait aucun goût spécial pour cette liqueur, n’en voulait pas moins la déguster en fin gourmet. Soit à la table des autres, soit à la sienne, il tenait à se montrer connaisseur. Il en eut bientôt la réputation, et sa femme, — s’étonnant toujours qu’il se trouvât à l’aise dans un monde dont la tolérance prenait volontiers le caractère d’une familiarité quelque peu dédaigneuse, — le vit, malgré tous les conseils qu’elle lui put donner à ce sujet, rechercher de plus en plus les stimulants sociaux dont il avait pris la périlleuse habitude. Il aimait à se rencontrer, chez les nobles du pays, avec les notabilités intellectuelles qui, de temps à autre, venaient s’asseoir à leur table : il aimait ces entretiens brillants où, lorsque un vin généreux avait enhardi sa verve, il déployait à leurs yeux les connaissances exceptionnelles dont il était fier. Il jouissait de l’étonnement dont ses éminents interlocuteurs étaient saisis en trouvant un vrai dilettante, presque un artiste, dans « ce bon Wilkins, l’attorney, » qui leur avait été présenté sans façons. Tout ceci l’entraînait à des dépenses qui dépassaient de plus en plus ses moyens, et que son père eût sagement prohibées ; mais l’honnête Wilkins était mort plein de jours, laissant ses affaires dans un état florissant, entouré du respect universel, et sans avoir pu pressentir le moindre nuage dans l’avenir prospère qui semblait promis à son fils et à sa bru.
Celle-ci s’alarmait déjà du train de vie que son mari lui imposait. Il la voulait parée aussi richement que les plus élégantes femmes du pays, et, prenant ce prétexte que les bijoux étaient interdits à des personnes de leur rang, la couvrait de dentelles aussi coûteuses que les diamants dont elle se privait si volontiers, et qui effectivement lui étaient inutiles, tant elle apportait dans le monde une distinction naturelle, une grâce, une dignité de bon aloi « fort extraordinaire, disaient ses rivales, chez la fille d’un aventurier français. » Pauvre Lettice ! faite pour le monde, elle le détestait de bon cœur, et le jour allait promptement venir où elle en serait pour jamais délivrée. Rien n’avait fait prévoir ce funeste dénoûment, lorsqu’un jour Edward fut brusquement rappelé de ses bureaux d’Hamley par la nouvelle que sa femme était prise d’un mal subit. Quand il arriva près d’elle, hors d’haleine et presque hors de sens, elle ne pouvait déjà plus parler. Lui-même ne trouvait pas la force d’articuler un seul mot. À genoux près d’elle, il vit, à un regard de ses beaux yeux noirs, qu’elle le reconnaissait, et qu’elle éprouvait encore pour lui, au moment suprême, cette tendre sollicitude dont avait toujours été empreint l’attachement qu’elle lui vouait. Elle mourut ainsi, sans qu’il se fût relevé. Ne sachant comment le tirer de sa torpeur immobile, ses gens lui apportèrent sa fille aînée Ellenor, qu’on avait gardée jusqu’à ce moment dans la nursery, pendant cette journée d’alarme et de désespoir. L’enfant n’avait aucune idée de la mort, et son père, qu’elle voyait immobile, agenouillé, la frappa bien moins que ce pâle visage de sa mère sur lequel, à sa vue, le sourire accoutumé ne se dessinait point. Se débarrassant, par un geste impétueux, de la personne qui l’amenait, elle courut jusqu’au lit, baisa sans aucun effroi les lèvres pâles et froides, sur la chevelure éparse et lustrée promena sa main caressante, prodigua pour la pauvre morte qui ne l’entendait plus les tendres appellations qu’elles échangeaient dans le secret de leurs longs tête-à-tête, et dans cette crise de tendresse mêlée d’effroi, manifesta un tel désordre d’esprit que son père, forcément arraché à sa douloureuse immobilité, la prit dans ses bras pour l’emporter au fond de son cabinet, où ils passèrent tous deux le reste de la journée. Personne ne répétera jamais ce qu’ils se dirent alors. Seulement la domestique chargée d’apporter le souper d’Ellenor revint annoncer, toute surprise, à ses camarades, que « monsieur faisait manger mademoiselle, comme si elle n’avait que six mois. » Ellenor avait à cette époque près de six ans.
II
Entre Ellenor et son père, cette soirée sembla créer un lien plus étroit et plus tendre. Elle partageait ses affections entre lui et une petite sœur au berceau ; mais pour lui, ce baby n’existait pour ainsi dire qu’en théorie, et tout son cœur appartenait à l’aînée de ses deux filles. Il la voulait sans cesse auprès de lui, et lorsqu’il dînait au logis, — en général assez tard — il la voulait assise à la place jadis occupée par Lettice, encore que l’enfant eût déjà pris dans la nursery son souper à heure fixe. C’était un spectacle à la fois amusant et triste que de voir siéger ainsi cette ménagère précoce, s’efforçant de garder le digne maintien, l’attitude composée d’une véritable maîtresse de maison, jusqu’au moment où sa petite tête s’affaissait, chargée de sommeil, entre deux propos bégayés avec un sérieux parfait. Les servantes du logis lui trouvaient « des airs de vieille » et avaient bâti là-dessus une sinistre prophétie qui la condamnait à mourir jeune. Prophétie menteuse comme tant d’autres. Au lieu d’Ellenor ce fut sa petite sœur vermeille, fraîche et rieuse jusque-là, qui, saisie tout à coup de convulsions nerveuses, disparut, comme sa pauvre mère, en vingt-quatre heures. Ce nouveau coup fut très-vivement ressenti par Ellenor, qui néanmoins contenait pendant le jour l’expression de sa douleur ; mais la nuit, lorsqu’elle pouvait se croire seule, elle rappelait avec un accent déchirant le baby disparu. Son père, frappé de cette douleur insolite, mit de côté toutes ses affaires pour se vouer à cette enfant, désormais son unique souci. Il eut pour elle une assiduité, des soins, des consolations toutes maternelles, et probablement lui sauva la vie. Aussi l’aima-t-elle désormais passionnément, et d’un amour si complet, si absolu, si ingénieux dans ses manifestations, qu’il ne put s’empêcher d’en tirer une espèce d’orgueil. Le matin, quand il s’éloignait, elle le suivait du regard, penchée à la fenêtre, aussi longtemps qu’il restait en vue : « Il reviendra ce soir, » se disait-elle ensuite, comme pour bannir une terreur secrète. Le soir, après avoir couché sa poupée, elle concentrait toute son attention sur les bruits de la route, et en était venue à discerner avant qui que ce fût le trot du cheval qui lui ramenait son père. — « Je n’entends rien, lui dit un soir sa nourrice, comme elle aux écoutes. — Je crois bien, répondit Ellenor, ce n’est point votre papa. »
M. Wilkins était jaloux de cette affection tout à fait hors ligne. Il voulait que sa fille lui dût tous ses plaisirs, et, par contre, écartait de ses relations avec elle tout ce qui l’eût forcé à la blâmer ou à la punir. Aussi eut-elle une gouvernante choisie par lady Holster, et acceptée sous condition qu’elle laisserait Ellenor présider au thé de chaque soir ; — et qu’elle ne chercherait pas à la rendre meilleure, attendu qu’on y perdrait son temps et sa peine. Miss Monro se trouva justement la personne la mieux adaptée à ce programme. Elle avait mené jusque-là une existence assez tourmentée, assez pénible, pour apprécier la tranquillité d’un rôle à peu près passif. Il lui paraissait fort doux de rester chez elle, le soir, à faire ses lectures ou sa correspondance, après avoir savouré sans la moindre gêne son thé solitaire, et cela lors même que M. Wilkins passait la soirée hors de chez lui, ce qui devint de plus en plus fréquent après que le temps eut effacé les premiers regrets du veuvage. En effet, de mieux en mieux venu aux meilleures tables du comté, le père d’Ellenor, reprit peu à peu ses habitudes de bon et joyeux convive, causeur brillant après boire. Il faisait de fréquents voyages à Londres, pour se tenir au courant de tout ce qui intéressait son intelligente curiosité : jamais il ne revenait de ses tournées dans la capitale sans rapporter à sa fille quelque nouveauté de toilette, quelque joujou à la mode.
Le seul personnage de sa classe avec lequel il eût conservé des rapports fréquents, le seul habitant de Hamley, qu’il traitât avec une véritable amitié, était un de ses camarades d’Université, en compagnie duquel, pendant les deux meilleures années de sa vie, il avait voyagé sur le continent. Ce digne ecclésiastique, nommé Ness, versé dans les études classiques, recevait de temps à autre dans son vicarage un ou deux jeunes gens qu’il préparait à leurs examens définitifs, et M. Wilkins ne manquait guère de les comprendre dans les invitations qu’il adressait à leur professeur. À l’époque où Ellenor venait d’atteindre sa quatorzième année, l’élève confié aux soins de M. Ness était un jeune homme du nom de Corbet, âgé de dix-huit ans, mais à qui sa maturité précoce en eût fait aisément donner vingt-cinq, tant il y avait de réflexion dans sa conduite et de sûreté dans ses jugements. Ses relations sociales, d’accord avec la volonté de ses parents, le portaient à chercher dans la profession du légiste un supplément à des revenus déjà fort honnêtes. Une plus haute ambition l’animait du reste, et sans viser au chimérique « sac de laine » qui peuple de futurs chanceliers les avenues du jeune barreau, il entrevoyait dans l’étude des lois le début d’une carrière politique, un acheminement à quelque siége parlementaire, le moyen de s’assurer plus tard une haute influence sur la destinée de ses contemporains. C’est dans ce but qu’il avait décidé son père a le placer sous la coûteuse tutelle de M. Ness, et que plus tard, insatiable de travail, il harcelait son professeur de mille et mille questions sur les thèses les plus ardues de la métaphysique légale. Ces fréquents tournois mettaient le maître et l’élève sur un certain pied d’égalité, mais ils n’en restaient pas moins très-différents l’un de l’autre : le premier demeurant un rêveur passablement indolent et dépourvu de toute ambition, tandis que le second demandait aux théories savantes, aux recherches de l’érudition, outre la satisfaction de ses appétits intellectuels, le relief et l’appui qu’elles pouvaient prêter à ses progrès dans le monde. Ellenor dînait habituellement de bonne heure, tête-à-tête avec miss Monro ; mais elle n’en présidait pas moins au repas du soir, quand M. Ness et M. Corbet venaient s’asseoir à la table de son père. Sa taille, ses traits à peine formés, la classaient encore parmi les enfants, dont elle avait aussi la simplicité ; mais elle était femme à certains égards, et par la force des affections et par l’énergie du caractère. Pendant que Ralph Corbet argumentait avec un zèle, une confiance juvénile, se rebellant contre les opinions reçues dont ses deux « anciens » volontiers se constituaient les champions, la jeune fille l’écoutait, attentive et silencieuse, se laissant parfois gagner par son enthousiasme, mais toute prête à s’irriter, si dans le feu du combat, il s’emportait à quelque attaque directe contre M. Wilkins. Pareilles provocations n’étaient jamais perdues, et M. Corbet ne les lui épargnait pas, car ces indignations enfantines, dont il avait pénétré le secret, l’amusaient au delà de tout.
Il la rencontrait presque tous les jours, à la même heure, et voici comment. Les deux amis achetaient le Times à frais communs, et M. Wilkins s’en étant réservé les prémices, Ellenor avait mission expresse de veiller à ce que le journal fût porté régulièrement au vicarage. M. Ness l’eût attendu patiemment, mais son nouveau disciple n’était pas, à beaucoup près, d’aussi bonne composition, et miss Ellenor le trouvait presque toujours dans le chemin fleuri qui menait de la porte de M. Wilkins à celle du révérend ministre. Au début, ces rencontres n’amenaient que l’échange rapide de quelques paroles banales ; mais la conversation se lia peu à peu, et il n’était pas rare que M. Corbet, raccompagnant la petite envoyée, revînt avec elle jusqu’au jardin dont elle prenait soin, pour lui donner quelques conseils d’horticulture écoutés avec une déférence toujours croissante. Ces conseils spéciaux s’étendirent par degrés à d’autres matières que le jardinage, Maître Ralph, volontiers sentencieux, y mêlait des leçons de bienséance, voire, au besoin, d’amicales gronderies que l’humilité naturelle d’Ellenor lui faisait accepter avec une sincère gratitude. Ils devinrent très-bon amis, mais sans qu’un sentiment plus tendre parût naître dans le cœur de la jeune fille. Il battait, ce cœur innocent, à l’heure du retour paternel, mais Ralph Corbet n’avait encore conquis aucun privilège de cet ordre, et sur les joues vermeilles de sa petite amie on n’aurait pu discerner une nuance de plus lorsqu’elle le voyait paraître, pas une de moins lorsqu’il s’éloignait d’elle.
Vers cette époque se manifestèrent aussi, d’abord peine aperçus, quelques symptômes avant-coureurs, qui présageaient au carnet Wilkins une décadence future. Les parties de chasse du patron n’avaient été d’abord que des distractions fortuites ; elles devinrent un passe-temps habituel. Il prit prétexte de la santé d’Ellenor pour louer, de compte à demi avec un de ses parents, une vaste lande en Écosse. L’année d’après, la chasse qu’il loua de moitié avec un étranger ne comportait aucune des commodités nécessaires à la vie en famille. Les voyages devinrent de plus en plus fréquents, et, sans parler de la dépense qu’ils occasionnaient, ils donnaient motif aux clients de « regretter que M. Wilkins fût si rarement à leur disposition. » Le bruit se répandit qu’un nouvel attorney allait venir lui faire concurrence, et qu’il serait patronné par deux ou trois familles influentes, lesquelles se plaignaient de ne pas trouver chez leur homme d’affaires attitré l’exactitude et la ponctualité auxquelles son père les avaient habituées. Sir Frank Holster, averti de ce projet, manda son neveu par alliance, et crut pouvoir lui adresser une verte semonce sur l’émulation insensée qui le poussait à mener la même vie que les grands propriétaires dont il était l’agent salarié. Edward Wilkins n’était pas sans quelques remords à ce sujet, et de tout autre eût peut-être accepté cette salutaire leçon ; mais il lui parut singulier d’avoir à la subir d’un homme presque insolvable, qui avait eu recours, mainte et mainte fois, à l’obligeance de son père et même à la sienne. Cette réflexion lui suggéra certaines vérités désobligeantes que sir Frank ne devait jamais lui pardonner, et qui le brouillèrent définitivement avec la famille de sa défunte femme. Leur querelle eut un double résultat. En premier lieu parut une annonce dans les journaux, par laquelle M. Wilkins offrait chez lui certains avantages à un premier clerc ayant fait preuve de capacité. En second lieu, M. Wilkins écrivit au collége héraldique, afin de s’informer si on ne pourrait pas établir sa parenté avec une famille du même nom, établie dans le sud du pays de Galles, les Wilkins de Wenton, qui ont repris depuis lors leur ancien titre. Ces deux demandes eurent leurs conséquences naturelles. Un praticien sur le retour de l’âge, recommandé par une des bonnes études de Londres, vint offrir sa collaboration qu’il fallut rétribuer largement, et le collège héraldique répondit qu’on ne désespérait pas d’établir l’affiliation généalogique désirée, à la condition de n’être pas arrêté, faute de fonds, dans les recherches nécessitées par une enquête si difficile. La vanité de notre attorney était en jeu, et ne recula pas devant un sacrifice relativement assez considérable. Le collége procéda donc, et rendit une décision conforme à la sollicitation du requérant, qui s’empressa d’acheter à Londres un élégant brougham sur les portières duquel s’étala, bruyamment émaillé, l’écusson des de Wenton. Généralement, il n’en coûte pas davantage, — et c’est bien assez, — pour se faire accepter, par le gros public, comme un noble de bon aloi. Mais à Hamley, où les Wilkins étaient connus de père en fils, cette petite manœuvre n’eut pas le moindre succès, et les nobles clients de l’ambitieux attorney se permirent toute sorte de gorges chaudes à propos de cette étrange velléité en matière d’armoiries.
M. Dunster, le nouveau clerc, était un individu paisible, aux dehors décents et doux, qu’on ne pouvait certes pas confondre avec un gentleman, mais qui n’avait rien de trop vulgaire. Ordinairement pensive, sa physionomie n’exprimait qu’une attention fortement concentrée sur l’objet quelconque dont il s’occupait, mais de temps à autre, au fin fond de leurs orbites, ses yeux lançaient des éclairs d’intelligence, promptement réprimés par une volonté puissante. À peine entré en fonctions, son premier soin fut de remettre dans un ordre parfait, — plus parfait même qu’au temps du vieux Wilkins, — les documents et les archives de l’étude. Son extrême ponctualité contraignit ensuite les autres clercs, sans qu’il eût à s’en expliquer formellement avec eux, à une exactitude dont ils s’étaient fort affranchis depuis quelques années. M. Wilkins luimême se sentit comme intimidé par la régularité méthodique, l’application rigide dont on lui donnait ainsi l’exemple. Jamais, vis-à-vis de lui, M. Dunster ne se permettait la moindre observation, la moindre critique, mais ses airs désespérés, ses sourcils levés, ses lèvres pincées, à propos de la plus petite infraction aux us et coutumes du métier, troublaient son patron bien mieux qu’aucune censure explicite. Aussi ce dernier le prit-il par degrés en grande estime, et en respectueuse aversion. Plus il l’approuvait, moins il le pouvait souffrir. Ce visage austère, qui le rappelait à des devoirs odieux, lui devint profondément antipathique. La voix monotone, le débit officiellement scandé de son premier substitut lui portait sur les nerfs, et l’accent provincial qu’avait conservé ce clerc modèle, affectait péniblement la délicatesse de ses fibres auditives. Certain grand surtout vert dont M. Dunster s’affublait avec une héroïque persistance, était pour son patron un sujet d’ennui, dont il étudiait avec une sorte de plaisir puéril la décadence graduelle. Que devint ce plaisir, le jour où il découvrit que son subordonné, de par une perversité heureusement fort rare, portait chaque jour, — le dimanche y compris, — des vêtements de même couleur ? Fallait-il donc que ces habits ridicules, cet accent fâcheux, ces airs effarés et sournois appartinssent à un collaborateur irréprochable, — à un vrai trésor, comme le disait Wilkins lui-même, — à un précieux agent dont il fut démontré, en moins de six mois, que l’étude ne pouvait plus se passer ? Les clients en effet, écoutés, servis comme aux plus beaux jours, chantaient eux aussi les louanges de M. Dunster. Pour eux, il n’avait aucun des inconvénients que Wilkins trouvait si insupportables, et la netteté de ses avis, l’exactitude de ses réponses, la disponibilité permanente qu’ils trouvaient en lui, les rendaient absolument indifférents à la nuance vert-bouteille de son vieux surtout. Ils s’en moquaient bien moins que des armoiries peintes sur le brougham de maître Wilkins.
De tout ceci, Ellenor ne se doutait guère. Le nouveau clerc n’était pour elle qu’un être de raison. Son père chéri primait toujours, à ses yeux, le demeurant de la race humaine. Elle n’avait conscience que de ses brillantes qualités, de sa douceur, de ses charmants propos, de ses connaissances variées, de sa générosité inépuisable. Après lui, elle aimait surtout miss Monro, et parmi les domestiques de la maison, le cocher Dixon. Dixon était un grand gaillard, robuste encore malgré les premières atteintes de l’âge, et qui s’étant trouvé jadis le compagnon de jeux de l’enfant destinée à devenir ensuite sa jeune maîtresse, n’avait jamais complètement perdu la tradition et les privilèges de cette lointaine intimité. Serviteur favori, on lui passait des libertés de langage qui n’eussent été tolérées chez aucun autre, et miss Ellenor, habituée dès l’enfance à le trouver fort discret, lui faisait par-ci par-çà telle confidence dont aurait pu être jaloux M. Corbet, qu’elle affectionnait pourtant,... mais en seconde ligne et après Dixon. Ralph se doutait fort bien de cette préférence inavouée : il lui arriva même un jour, après plusieurs insinuations inutiles, de s’en plaindre ouvertement, ce qui lui attira une vaillante sortie de la terrible enfant. Elle était indignée qu’on voulût lui prescrire de traiter Dixon autrement qu’un vieil ami, et son jeune censeur regretta d’autant plus d’avoir ainsi encouru le déplaisir d’Ellenor, qu’il partait le lendemain même pour la résidence paternelle, d’où il devait quelques semaines plus tard, se rendre Cambridge. Il eût peut-être trouvé une certaine douceur consolante à la voir, quelques heures après son départ, se dérober à miss Monro — plongée dans l’étude de la langue espagnole, — pour venir pleurer tout à l’aise sous l’ombrage du petit bosquet de vieux arbres qui terminait assez gracieusement les plates-bandes du parterre. Ce n’était du reste qu’un passager accès de vague mélancolie, un regret fugitif accordé à l’absence du seul jeune homme qui jusqu’alors eût paru s’intéresser à elle. La même soirée d’août vit poindre et s’effacer ce nuage d’un moment. Dès le lendemain, le soleil reparut, tout aussi radieux, dans un ciel tout aussi calme que par le passé.
Un mot sur ces vieux arbres. — Ils plongeaient leurs racines dans un fragment de verte pelouse, au sol meuble et presque toujours humide. Quelques-unes se dessinant en relief sur l’épaisseur du gazon, formaient des compartiments dont chacun avait sa destination spéciale, et formaient comme les dépendances de l’appartement assigné à la poupée de la jeune miss, — le salon, le boudoir, la chambre à coucher, meublés ainsi que le prescrivait l’attribution de chaque pièce. M. Corbet, toujours un peu trop grave, voyait ces enfantillages avec une sorte de pitié dédaigneuse ; mais Dixon les prenait au sérieux, lui, et prêtait son concours à ces comédies enfantines comme s’il eût eu six ans au lieu de quarante. En même temps, nous devons le dire, il ne manquait jamais une occasion d’appuyer les bons conseils de Ralph Corbet, et, lorsque Ellenor se plaignait d’être sermonnée au delà de toute patience par ce magistrat en herbe, Dixon tâchait de lui faire comprendre la véritable portée de ces exhortations mal venues. « Soyez sûre, mademoiselle, lui disait-il, qu’on ne se permettrait pas de vous prêcher de la sorte si votre mère vivait encore, ou si votre père avait le loisir de veiller sur vous plus exactement... Mais il n’a plus de loisirs, ce pauvre homme, depuis que M. Dunster lui taille chaque jour une besogne nouvelle... On dirait qu’il est ici pour faire le malheur de son patron.
— Ah ! tenez, finit par s’écrier Ellenor avec son irréfrénable impétuosité, ne me parlez plus de M. Dunster ! Il m’est positivement odieux, et je compte ne pas lui adresser la parole quand mon père l’amènera dîner chez nous.
— À cet égard, comme à tout autre, repartit le cocher toujours prudent, mademoiselle fera, sans nul doute ce que monsieur croira devoir lui prescrire. »
III
L’été suivant revit encore M. Corbet chez son révérend professeur. Avec la meilleure volonté du monde, on n’aurait pu trouver grand changement chez notre précoce jeune homme. Mais Ellenor, elle, avait subi une complète métamorphose. À une petite fille dont les beaux yeux seuls présageaient quelque avenir, succédait une jeune lady