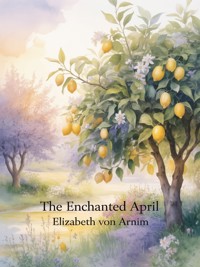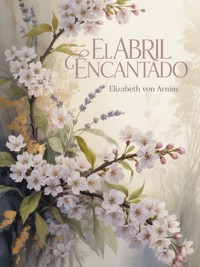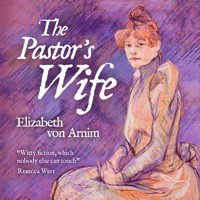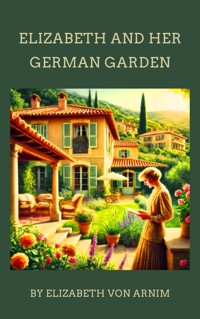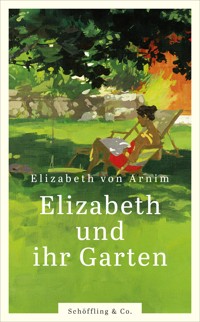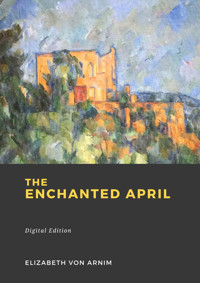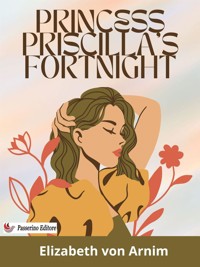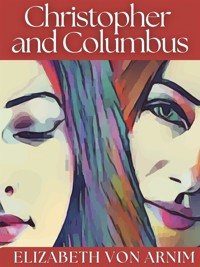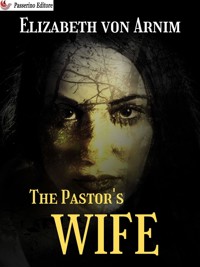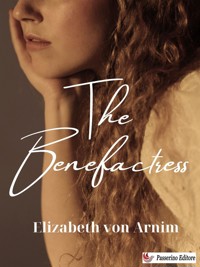9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tim Word
- Sprache: Französisch
"Avril enchanté" est un roman écrit par Elizabeth Von Armin et publié en 1922. Il raconte l'histoire de quatre Anglaises qui louent un château italien pour un mois d'avril, dans l'espoir d'échapper à leur vie morne dans l'Angleterre pluvieuse et de trouver le renouveau et l'inspiration dans la beauté de l'Italie.
L'histoire commence dans l'Angleterre de l'après-Première Guerre mondiale, où Lotty Wilkins, une femme au foyer d'une trentaine d'années, est séduite par une annonce parue dans le Times proposant la location d'un château en Italie. Elle suggère à son amie Rose Arbuthnot, une femme belle mais malheureuse d'une vingtaine d'années, de louer le château ensemble, et les deux femmes passent une annonce pour trouver deux autres compagnes afin de partager les frais. Elles sont rejointes par Lady Caroline Dester, une beauté mondaine glamour et distante, et Mrs. Fisher, une veuve riche et âgée qui s'accroche aux traditions et aux valeurs de son éducation victorienne.
Alors que les femmes s'installent dans leur nouvelle maison dans la campagne italienne idyllique, elles commencent à découvrir la magie du lieu et le pouvoir guérisseur de la nature. Lotty et Rose tombent toutes deux amoureuses de la beauté et de la simplicité de leur environnement, tandis que Lady Caroline commence à révéler son côté vulnérable. Mme Fisher, d'abord dédaigneuse de l'enthousiasme juvénile de ses compagnes, commence à s'ouvrir à de nouvelles expériences et perspectives.
Tout au long du roman, les quatre femmes explorent les jardins et les plages de leur retraite italienne, nouent de nouvelles amitiés et romances, et affrontent leurs peurs et leurs insécurités. Alors que leur séjour touche à sa fin, elles réalisent qu'elles ont été transformées par leur séjour en Italie et retournent en Angleterre avec un sens renouvelé de l'objectif et de la joie.
"Avril enchanté" est un roman charmant et édifiant qui célèbre le pouvoir de l'amitié, de la nature et de la découverte de soi. Il a été adapté plusieurs fois au théâtre, à l'écran et à la télévision et reste un classique bien-aimé de la littérature anglaise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Avril Enchanté
Par Elizabeth Von Arnim
The Enchanted April (1922). Traduction par Tim Word (2023).
All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2023 by Tim Word. All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2023, Tim Word. Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle du contenu, de la couverture ou des icônes par quelque procédé que ce soit (électronique, photocopie, bandes magnétiques ou autre) est interdite sans les autorisations de Tim Word.
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’Auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 :
Chapitre 2 :
Chapitre 3 :
Chapitre 4 :
Chapitre 5 :
Chapitre 6 :
Chapitre 7 :
Chapitre 8 :
Chapitre 9 :
Chapitre 10 :
Chapitre 11 :
Chapitre 12 :
Chapitre 13 :
Chapitre 14 :
Chapitre 15 :
Chapitre 16 :
Chapitre 17 :
Chapitre 18 :
Chapitre 19 :
Chapitre 20 :
Chapitre 21 :
Chapitre 22 :
Biographie et Analyse de l’oeuvre
Chapitre 1 :
Tout commença un après-midi de février, dans un Woman’s Club de Londres, ce fut un club malaisant et un après-midi ennuyant, lorsque Mme Wilkins qui était descendue de Hampstead pour faire ses courses et venait de finir son déjeuner, prit le Times sur la table du fumoir et lut l’annonce suivante :
Pour ceux qui apprécient les glycines et le soleil. Petit château médiéval italien sur les rives de la Méditerranée à louer meublé pour le mois d’avril. Les domestiques nécessaires seront sur place. Contacter The Times avec la référence Z 1000.
Comme dans la plupart des annonces, la personne ayant écrit celle-ci était loin d’être consciente des conséquences de son acte.
Mme Wilkins était si peu consciente que son mois d’avril pour cette année avait été réglé à ce moment-là, qu’elle laissa tomber le journal d’un geste à la fois irrité et résigné, s’approcha de la fenêtre et regarda d’un air morne la rue ruisselante.
Un château médiéval, même le plus petit de tous, ce n’était pas pour elle. Ce n’était pas pour elle, les rivages de la Méditerranée en avril, les glycines et le soleil. Ces plaisirs étaient réservés aux personnes riches. Pourtant, l’annonce avait été adressée à des personnes qui apprécient ces choses, ce qui était son cas. Malheureusement, celle-ci était pauvre. Elle ne possédait que quatre-vingt-dix livres, économisés d’année en année, soigneusement mis de côté, livre par livre, de son budget vestimentaire. Elle avait rassemblé cette somme à la suggestion de son mari, comme un bouclier et un refuge pour les mauvais jours. Son budget vestimentaire, donné par son père, était de cent livres par an, de sorte que les vêtements de Mme Wilkins, étaient ce que son époux, qui la poussait à économiser, appelait modestes et convenables, et ses connaissances, lorsqu’elles parlaient d’elle, ce qui était rare, car elle était très négligeable, disaient qu’elle s’habillait très convenablement.
M. Wilkins était avocat. Celui-ci encourageait à économiser, à l’exception de l’économie qui se trouvait dans son assiette. Il n’appelait pas cela de l’économie, mais de la mauvaise gestion. Mais celui-ci ne tarissait pas d’éloges sur l’épargne qui, telle une mite, pénétrait dans les vêtements de Mme Wilkins et les abîmait. « On ne sait jamais, disait-il, si nous sommes dans une mauvaise période, et vous serez peut-être très heureuse de découvrir que vous avez un pécule. En effet, nous le serons tous les deux. »
Elle regardait par la fenêtre du club sur Shaftesbury Avenue. C’était un club modeste, mais pratique pour Hampstead, où elle vivait, et pour Shoolbred’s, où elle faisait ses courses. Durant le mois d’avril, après être restée là quelque temps, Mme Wilkins était très morne, l’esprit tourné vers la Méditerranée, les glycines et les opportunités enviables des riches. Pendant qu’elle observait la pluie encrassée s’abattant sur les parapluies pressés et les omnibus qui éclaboussaient d’eau, elle se demanda soudainement si ce n’était pas le mauvais jour que Mellersh l’avait si souvent encouragée à préparer. Mellersh était M. Wilkins. Il l’avait si souvent encouragé à se préparer, et sortir d’un tel climat pour s’installer dans un petit château médiéval. Ce n’était pas ce que la Providence avait toujours voulu qu’elle fasse de ses économies. Une partie de ses économies, bien sûr, peut-être une toute petite partie. Le château étant médiéval, il pouvait aussi être délabré, et les délabrements n’étaient sûrement pas chers. Elle ne s’opposerait pas le moins du monde à ce qu’il y en ait quelques-unes, car on ne paye pas pour des délabrements qui sont déjà là, au contraire, en réduisant le prix à payer, ils vous payent vraiment. Mais à quoi bon de penser à tout cela ?
Elle se détourna de la fenêtre avec le même geste d’irritation et de résignation mêlées avec lequel elle avait déposé le Times, et traversa la pièce en direction de la porte avec l’intention de prendre son mackintosh et son parapluie, de se frayer un chemin dans l’un des omnibus bondés et d’aller à Shoolbred’s sur le chemin du retour. Elle voulait acheter quelques soles pour le dîner de Mellersh. Celui-ci était très difficile avec le poisson et n’aimait que les soles et le saumon, lorsqu’elle aperçut Mme Arbuthnot, une femme qu’elle connaissait de vue. Celle-ci vivait aussi à Hampstead et faisait partie du club. Elle était assise à la table au milieu de la salle où se trouvaient les journaux et les magazines, et lisait la première page du Times.
Mme Wilkins n’avait encore jamais parlé à Mme Arbuthnot, qui appartenait à l’un des différents groupes ecclésiastiques où elle catégorisa les pauvres. Tandis qu’elle et Mellersh, lorsqu’ils sortaient, allaient aux soirées des peintres impressionnistes, qui étaient nombreux à Hampstead. Mellersh avait une sœur qui avait épousé l’un d’entre eux à cause de cette alliance, Mme Wilkins était entraînée dans un cercle qui lui était tout à fait étranger, et elle avait appris à redouter les tableaux. Elle devait dire des choses à leur sujet, mais elle ne savait pas quoi dire. Elle avait l’habitude de murmurer « merveilleux » et de penser que ce n’était pas suffisant. Mais personne ne s’en souciait. Personne n’écoutait. Personne ne faisait attention à Mme Wilkins. Elle était le genre de personne que l’on ne remarque pas dans les fêtes. Ses vêtements, infestés par l’épargne, la rendaient pratiquement invisible ; son visage n’était pas attirant ; sa conversation était hésitante ; en outre, elle était très timide. Et si celle-ci ne pouvait être remarquée ni par ses vêtements, ni par son visage ni par sa conversation, Mme Wilkins, se demandait ce qu’on pourrait remarquer chez elle.
De plus, elle était toujours avec M. Wilkins, cet homme, rasé de près, à l’allure fine, donnait l’impression de se rendre à une soirée de gala, à chacune de ses sorties. M. Wilkins était très respectable. Il était connu pour être très estimé par ses associés principaux. L’entourage de sa sœur l’admirait. Il soutenait des jugements suffisamment réfléchis sur l’art et les artistes. Il était vif, il était prudent, il ne disait jamais un mot de trop, ni, au contraire, un mot de moins. Il donnait l’impression de garder des copies de tout ce qu’il disait ; et il était si manifestement fiable qu’il arrivait souvent que les personnes qui le rencontraient lors de ces soirées devinrent mécontentes de leurs propres avocats et, après une période d’agitation, se retirèrent et s’adressèrent à M.Wilkins.
Naturellement, Mme Wilkins a été rayée de la liste. « Elle », dit sa sœur, avec quelque chose de judiciaire, de digéré et de définitif dans ses manières, devrait rester à la maison. Mais Wilkins ne pouvait pas laisser sa femme à la maison. Il était avocat de famille, et tous les avocats de ce genre ont des femmes et les montrent. Avec la sienne, la semaine, il allait à des fêtes, et avec la sienne, le dimanche, il allait à l’église. Celui-ci était encore assez jeune, il avait trente-neuf ans et était ambitieux à l’égard des vieilles dames, dont il n’avait pas encore acquis un nombre suffisant dans sa pratique, il ne pouvait se permettre de manquer l’église, et c’est là que Mme Wilkins se familiarisa, bien que jamais par la parole, avec Mme Arbuthnot.
Elle la vit rassembler les enfants des pauvres sur des bancs. Elle arrivait de l’école du dimanche, exactement cinq minutes avant la chorale. Celle-ci mettait ses garçons et ses filles bien en place dans les sièges qui leur avaient été attribués, et à genoux pour leur prière préliminaire, et de nouveau sur pieds justes au moment où, au son de l’orgue, la porte de la sacristie s’ouvrait pour laisser passer le chœur et le clergé, qui se préparaient à déployer leurs hymnes et leurs litanies. Malgré son visage triste, elle était d’une efficacité à couper le souffle. Cette alliance a toujours étonné Mme Wilkins, car Mellersh lui avait dit, les jours où elle n’avait pu obtenir que de la plie, que si l’on était efficace, on ne serait pas déprimé, et que si l’on faisait bien son travail, on devenait automatiquement vif et enthousiaste.
Bien que la manière de faire de Mme Arbuthnot avec les enfants de l’école du dimanche fût plaisante, celle-ci n’avait rien d’attrayant ni de vif ; lorsque Mme Wilkins, la vit au club, celle-ci n’avait pas l’air heureuse, elle contemplait la première page du Times, tenant le journal, tout à fait immobile avec un regard impassible. Son visage, comme d’habitude, était celui d’une patiente et d’une madone déçue.
Mme Wilkins l’observa pendant une minute, essayant de trouver le courage de lui parler. Elle voulait lui demander si elle avait vu l’annonce. Elle ne savait pas pourquoi elle voulait lui demander cela. Elle avait l’air si gentille et si malheureuse. Pourquoi deux personnes malheureuses ne pourraient-elles pas se rafraîchir ensemble par une petite conversation ? Une conversation naturelle, sur ce qu’elles ressentent, ce qu’elles auraient voulu, ce qu’elles essaient encore d’espérer ? Et elle ne pouvait s’empêcher de penser que Mme Arbuthnot, elle aussi, était en train de lire cette même annonce. Ses yeux étaient fixés sur la partie même du journal. S’imaginait-elle, elle aussi, à quoi cela ressemblerait, la couleur, le parfum, la lumière, de la mer battant au pied de rochers brûlants ? Les couleurs, le parfum, la mer, le soleil… Au lieu de Shaftesbury Avenue, des omnibus mouillés, du rayon poisson de Shoolbred’s, du métro jusqu’à Hampstead, du dîner à préparer pour ce soir-là et tous les autres soirs…. Soudain, Mme Wilkins s’est retrouvée penchée sur la table. « Lisez-vous sur le château médiéval et la glycine ? » Demanda-t-elle ?
Naturellement, Mme Arbuthnot fut surprise ; mais elle ne le fut pas autant que Mme Wilkins, qui s’en voulut d’avoir posé la question.
Mme Arbuthnot ne pensait pas avoir déjà posé les yeux sur la silhouette minable, mince de la personne assise en face d’elle, avec son petit visage couvert de taches de rousseur et ses grands yeux gris qui disparaissaient presque entièrement sous un chapeau de pluie défoncé, et elle la regarda un moment sans répondre. Effectivement, elle lisait à propos du château médiéval et de la glycine, ou plutôt elle l’avait lu dix minutes plutôt, et depuis celle-ci s’était perdue dans des rêves de couleurs, de lumières, de parfum, du bruit de la mer battant au pied de rochers brûlants…
« Pourquoi me demandez-vous cela ? dit-elle d’une voix rendue un peu grave par ses interventions avec les pauvres.
Mme Wilkins rougit jusqu’aux oreilles et prit un air excessivement timide et effrayé. “Oh, seulement parce que je l’ai vu aussi, et j’ai pensé que peut-être.… J’ai pensé que d’une certaine façon…”, balbutia-t-elle.
Mme Arbuthnot, habituée à catégoriser toutes les personnes qu’elle rencontre dans des listes, se demanda alors, en regardant pensivement Mme Wilkins, sous quelle rubrique, si elle devait la classer, elle pourrait le faire au mieux.
Et je vous connais de vue, poursuivit Mme Wilkins qui, comme tous les timides, une fois lancés, s’élança, m’effrayant de plus en plus de parler seule. Tous les dimanches… je vous vois tous les dimanches à l’église…
— À l’église ? répliqua Mme Arbuthnot.
— Et cela semble une chose si merveilleuse, cette publicité sur la glycine… »
Malgré le fait que Mme Wilkins avait trente ans, celle-ci se mit soudainement à se tortiller sur sa chaise avec le mouvement d’une écolière maladroite et embarrassée.
« Cela semble si merveilleux, continua-t-elle dans une sorte d’élan, et c’est, une journée, si misérable… ».
Puis elle regarda Mme Arbuthnot avec des yeux de chien battu.
« Cette pauvre femme a besoin de conseils », pensa Mme Arbuthnot, qui consacrait sa vie à aider et à soulager.
Elle se prépara donc patiemment à les donner.
« Si vous me voyez à l’église », dit-elle avec gentillesse et attention, je suppose que vous vivez aussi à Hampstead.
— Oh oui ! », répondit Mme Wilkins.
Et elle répéta, sa tête sur son long cou mince s’abaissant un peu comme si le souvenir de Hampstead l’inclinait et répéta :
« Oh oui.
- Où cela exactement ? », demanda Mme Arbuthnot qui, lorsqu’elle avait besoin d’un conseil, commençait naturellement par rassembler les faits.
Mais Mme Wilkins, posant sa main avec douceur et caresse sur la partie du Times où se trouvait l’annonce, comme si les mots imprimés étaient précieux, répondit seulement :
« C’est peut-être pour cela que cela semble si merveilleux.
— Je pense que cette annonce, vous aurez paru merveilleuse quel que soit le lieu où vous habitez.
— Vous l’avez donc lu ?
— Oui, répondit Mme Arbuthnot, ses yeux redevenant rêveurs.
— Ne serait-ce pas merveilleux ? murmura Mme Wilkins.
— Vraiment merveilleux » répondit Mme Arbuthnot. Son visage, illuminé, redevint patient. Mais il ne sert à rien de perdre son temps à penser à de telles choses.
— Oh, mais c’est vrai, fut la réponse rapide et surprenante de Mme Wilkins. Cette vivacité ne s’accordait pas au manteau et à la jupe, le chapeau froissé, la mèche de cheveux indécise qui s’échappait… « Et puis ça ne ferait pas de mal, un tel changement par rapport à Hampstead et parfois, je crois… Je crois vraiment que si l’on veut vraiment, on finit par obtenir des choses ».
Mme Arbuthnot l’observait patiemment. Dans quelle catégorie la rangerait-elle, à supposer qu’il le faille ?
« Comment vous appelez-vous ? Si nous devons être amis, comme je l’espère, nous ferons mieux de commencer par le commencement.
— Oh oui, c’est très gentil de votre part. Je suis Mme Wilkins », dit Mme Wilkins.
— Je ne pense pas que vous me connaissez, ajouta-t-elle en rougissant, pendant que Mme Arbuthnot ne dit rien, parfois, il m’arrive à moi-même d’en douter. Mais je suis bel et bien Mme Wilkins. »
Elle n’aimait pas vraiment son nom. C’était un petit nom méchant, avec une sorte de tournure ridicule, pensait-elle, à propos de sa fin. Comme la courbe de la queue d’un carlin. Mais c’était ainsi. Il n’y avait rien à faire. Wilkins, elle l’était, et Wilkins, elle resterait ; et bien que son mari qui l’encourageait pour qu’elle se présentât en toute occasion comme « Mme Mellersh-Wilkins », elle ne le fit que lorsqu’il était là, car elle pensait que « Mellersh » aggravait « Wilkins », comme si l’on nommait Chatsworth une modeste maison de campagne.
Lorsqu’il lui suggéra d’abord d’ajouter « Mellersh », elle s’y était opposée, et après un certain temps, Mellersh était beaucoup trop prudent pour parler, sauf après une pause, au cours de laquelle il réfléchissait à ce qu’il allait dire et, très mécontent, il dit : « mais je ne suis pas une maison de campagne », et il la regarda, et espéra, peut-être pour la centième fois, ne pas avoir épousé une sotte.
Bien sûr qu’il n’était pas une villa, lui assura Mme Wilkins. Elle n’avait jamais supposé qu’il le fût. Elle avait simplement dit ce qu’elle pensait.
Plus elle s’expliquait, plus Mellersh, qui était marié depuis deux ans, pensa avoir épousé une idiote, et ils eurent une longue querelle, si l’on peut appeler cela une querelle qui se déroule avec un silence digne d’un côté et des excuses sincères de l’autre, pour savoir si Mme Wilkins avait eu l’intention de suggérer que M. Wilkins était une maison de campagne.
« Je crois que n’importe qui se disputerait pour n’importe quoi alors qu’ils n’ont pas cessé d’être ensemble un seul jour pendant deux années entières. Nous avons tous les deux besoins de vacances. », avait-elle pensé, lorsque la conversation s’était enfin terminée.
« Mon mari est avocat », continua Mme Wilkins à Mme Arbuthnot, essayant de se mettre en valeur.
Elle chercha quelque chose qu’elle pourrait dire sur Mellersh, et trouva :
« Il est très beau.
— Eh bien », répondit Mme Arbuthnot avec gentillesse, cela doit vous faire grand plaisir.
— Pourquoi ? demande Mme Wilkins.
Mme Arbuthnot, un peu décontenancée, car ses relations constantes avec les pauvres l’avaient habituée à ce que ses déclarations soient acceptées sans discussion.
— Parce que la beauté… La beauté est un don comme un autre, et que si on l’utilise correctement… »
Elle retomba dans le silence. Les grands yeux gris de Mme Wilkins étaient fixés sur elle, et soudain à Mme Arbuthnot se demanda si à force de s’adresser à un auditoire qui ne pouvait qu’être d’accord avec elle, celle-ci n’aurait pas perdu l’habitude d’écouter la personne en face d’elle.
Mais Mme Wilkins n’écoutait pas, car à l’instant même, aussi absurde que cela pût paraître, une image avait traversé son esprit, et l’on y voyait deux personnages assis ensemble sous une grande glycine qui s’étendait sur les branches d’un arbre inconnu, et c’était elle-même et Mme Arbuthnot… Et derrière eux, elle voyait sous l’éclat du soleil, les hauts murs gris du château médiéval, tout était là....
Elle regardait donc fixement Mme Arbuthnot et n’écoutait pas un mot de ce qu’elle disait. Et Mme Arbuthnot, arrêtée par l’expression du visage de Mme Wilkins, qui était emporté par l’excitation de ce qu’elle voyait, et qui était aussi lumineux et tremblant que l’eau au soleil lorsqu’elle est agitée par une rafale de vent. À ce moment-là, si elle avait été à une fête, Mme Wilkins aurait été regardée avec intérêt.
Elles se regardaient. Mme Arbuthnot avec surprise et étonnement tandis que Mme Wilkins avec euphorie. Bien sûr. C’est ainsi qu’il fallait le faire. Elle-même, toute seule, n’en avait pas les moyens, et même si elle les avait eus, elle n’aurait pas pu y aller toute seule tandis qu’avec Mme Arbuthnot cela était possible.
Elle se pencha par-dessus la table.
« Pourquoi ne pas essayer ? », murmura-t-elle.
— Essayer quoi au juste ? dit Mme Arbuthnot encore plus étonnée.
— Essayer d’y aller, dit Mme Wilkins, toujours comme si elle craignait d’être entendue. Il ne s’agit pas de s’asseoir ici et de dire, « c’est merveilleux », puis de rentrer à Hampstead sans avoir mis le doigt dans l’engrenage, de rentrer à la maison comme d’habitude et de s’occuper du dîner et du poisson, comme nous le faisons depuis des années et comme nous continuerons à le faire pendant des années et des années. »
Mme Wilkins, rougissant jusqu’à la racine des cheveux, car le son de ce qu’elle disait, de ce qu’elle l’effrayait, et pourtant elle ne put pas s’arrêter, « Nous allons passer notre vie à faire cela. Il faudrait donc faire une pause. Il faudrait donc qu’il y ait une pause. Dans l’intérêt de tout le monde. Personne ne pourrait nous en vouloir d’être un peu heureuses, parce que nous reviendrions beaucoup plus avenantes. Après un certain temps, tout le monde a besoin de vacances.
— Mais comment voulez-vous l’obtenir ? demanda Mme Arbuthnot.
— Eh bien, il suffit juste de la prendre », dit Mme Wilkins.
— La prendre ?
— La louer.
— Mais… tu veux dire toi et moi ?
— Oui ! Entre nous. En partageant, cela nous coûterait bien moins cher, et vous avez l’air si… vous avez l’air de le vouloir autant que moi… Comme si vous deviez vous reposer… Comme si vous aviez besoin de ça pour être heureux.
— Pourquoi, mais nous ne nous connaissons pas.
— Mais imaginez à quel point nous nous sentirions bien si nous partions ensemble pendant un mois ! Et j’ai mis de côté pour les mauvais jours, et je pense que vous avez fait la même chose…
— Une déséquilibrée pensa Mme Arbuthnot, mais elle se sentait étrangement émue.
— Pensez à vous éloigner de tout pendant un mois entier, pour aller dans un lieu paradisiaque…
— Elle ne devrait pas dire de telles choses, pensa Mme Arbuthnot. Le pasteur n’accepterait jamais une telle chose, malgré tout, Mme Arbuthnot se sentait étrangement remuée. En effet, il serait merveilleux de se reposer et de s’arrêter. »
Cependant, l’habitude la stabilisa à nouveau ; et après des années de relations avec les plus démunis, elle ne put seulement dire avec la légère supériorité, à la fois hautaine et bienveillante :
« Mais alors, voyez-vous, le paradis n’est pas ailleurs. Il est ici, dans nos cœurs. »
Elle devint très sérieuse, comme lorsqu’elle essaie patiemment d’aider et d’éclairer les miséreux.
« Le ciel est en nous, dit-elle de sa voix douce et grave. “C’est ce que nous dit dans notre livre. Et vous connaissez les lignes sur les points communs, n’est-ce pas ?
— Oh oui, je les connais, interrompit Mme Wilkins avec impatience.
— Les points communs du ciel et de la maison, a poursuivi Mme Arbuthnot, qui avait l’habitude de terminer ses phrases. Le paradis est dans notre maison.
— Ce n’est pas le cas”, dit Mme Wilkins, une nouvelle fois très surprise.
Mme Arbuthnot fut interloquée. Puis elle répondit doucement :
« Oh, mais c’est vrai. Il est là si nous le voulons, si nous le faisons.
— Je vous assure, bien que je le veuille, ce n’est toujours pas le cas”, déclara Mme Wilkins.
Mme Arbuthnot se tut, car elle aussi avait parfois des doutes sur le paradis. Elle s’assit et regarda Mme Wilkins d’un air inquiet, ressentant de plus en plus le besoin urgent de la catégoriser. Si elle pouvait seulement classer Mme Wilkins, la mettre en sécurité sous sa propre rubrique, elle sentait qu’elle retrouverait elle-même son équilibre intérieur, qui semblait vraiment en danger. En effet, elle n’avait pas eu de vacances depuis des années, et l’annonce, lorsqu’elle l’avait vue, l’avait fait rêver, et l’excitation de Mme Wilkins à ce sujet était contagieuse, et elle avait la sensation en écoutant ses propos impétueux et bizarres et en observant son visage illuminé, d’être tirée de son sommeil.
De toute évidence, Mme Wilkins était une déséquilibrée, et Mme Arbuthnot avait déjà rencontré des personnes dans ce cas-là. En fait, elle en rencontrait tous les jours, et ils n’avaient aucun effet sur sa propre stabilité ; alors que celle-ci la faisait se sentir très chancelante, comme si le fait de s’éloigner de ses points cardinaux que sont Dieu, son mari, son foyer, son devoir et pour une fois d’être heureuse serait à la fois bon et souhaitable. Elle n’avait pas l’impression que Mme Wilkins avait l’intention que celle-ci vienne aussi. Ce qui, bien sûr, n’était pas le cas. Elle aussi avait un pécule, placé petit à petit à la Caisse d’épargne de la Poste, mais supposer qu’elle n’oublierait jamais son devoir au point de le retirer et de le dépenser pour elle-même était assurément absurde. Elle ne pourrait pas, elle ne ferait jamais une chose pareille. Il est certain qu’elle ne pourrait jamais oublier ceux qui ont besoin d’elle, oublier la misère et la maladie. Sans doute, un voyage en Italie serait-il extraordinairement agréable, mais il y a beaucoup de choses agréables que l’on aimerait faire, mais que l’on ne peut pas faire afin de rester juste et bon.
Pour Mme Arbuthnot, les quatre grands principes de la vie étaient aussi inébranlables que les points cardinaux : Dieu, le mari, le foyer et le devoir. Elle s’était endormie sur ces faits il y a des années, après une période de grande misère, sa tête reposant sur eux comme sur un oreiller, et elle redoutait beaucoup de s’être réveillée dans un état si simple et si serein. C’est pourquoi elle chercha avec ardeur une rubrique sous laquelle placer Mme Wilkins et, de cette façon, éclairer et stabiliser son propre esprit. Assise là, la regardant avec inquiétude après sa dernière remarque, et se sentant de plus en plus déséquilibrée et infectée, elle décida pro tem, comme le pasteur le disait lors des réunions, de la placer sous la rubrique “Nerfs”. Il était tout à fait possible qu’elle entre directement dans la catégorie “Hystérie”, qui n’était souvent que l’antichambre de la “Folie”, mais Mme Arbuthnot avait appris à ne pas précipiter les gens dans leurs catégories définitives, ayant plus d’une fois découvert avec consternation qu’elle s’était trompée, et combien il avait été difficile de les en sortir à nouveau, et combien elle avait été écrasée par les remords les plus terribles.
Oui. Les “Nerfs”, c’était sûrement cette catégorie. Probablement, qu’elle n’avait pas de travail régulier pour les autres, pensa Mme Arbuthnot, pas de travail qui l’amènerait à sortir d’elle-même. De toute évidence, elle était sans gouvernail, ballottée par les rafales, par les impulsions. Les “Nerfs” étaient presque certainement sa catégorie, ou elle y serait bientôt si personne ne l’aidait. “Pauvre petite dame”, pensa Mme Arbuthnot, son propre équilibre revenant en même temps que sa compassion, et incapable, à cause de la table, de voir la longueur des jambes de Mme Wilkins. Tout ce qu’elle voyait, c’était son petit visage avide et timide, ses épaules minces, et le regard de désir enfantin dans ses yeux pour quelque chose qui, elle en était sûre, la rendrait heureuse. Non, de telles choses ne rendent pas heureux, de telles choses éphémères. Mme Arbuthnot avait beaucoup appris au cours de sa longue vie avec son mari Frédérick qu’elle l’avait épousé à vingt ans où se trouvent les seules vraies joies et non à trente-trois ans. On peut les trouver, elle le savait maintenant, seulement tous les jours, toutes les heures, en vivant pour les autres ; on ne les trouve qu’aux pieds de Dieu, n’avait-elle pas là, pris, encore et encore, ses déceptions et ses découragements, et en ressortit réconfortée ?
Frederick avait été le genre de mari dont la femme se mettait très tôt aux pieds de Dieu. De Frederick à Dieu, il n’y avait eu qu’un pas, court, mais douloureux. Elle lui paraissait courte, mais elle avait en réalité pris toute la première année de leur mariage, et chaque étape du chemin avait été une lutte, et chaque étape avait été tachée de sang. Tout cela était terminé maintenant. Elle avait depuis longtemps trouvé la paix. Et Frederick, son époux qu’elle avait passionnément aimé, son jeune mari adulé, était devenu le deuxième après Dieu sur la liste de ses devoirs et de ses indulgences. Il était là, au second rang, une chose exsangue, blanchie par ses prières. Pendant des années, Mme Arbuthnot n’a pu être heureuse qu’en oubliant le bonheur. Elle voulait rester ainsi. Elle voulait exclure tout ce qui pouvait lui rappeler les belles choses, tout ce qui pouvait la faire désirer…
« J’aimerais tellement que nous soyons amis, dit-elle sincèrement. Voulez-vous qu’on se revoie de temps en temps ? N’hésitez pas à me parler dès que vous en avez envie. »
Elle fouilla dans son sac à main, et tendit une carte.
« Tenez mon adresse. »
Mme Wilkins ignora la carte.
« C’est très drôle, dit Mme Wilkins, comme si elle ne l’avait pas entendue, mais je nous vois toutes les deux, vous et moi, en avril dans le château médiéval ».
Mme Arbuthnot retomba dans l’inquiétude.
« Vraiment ? dit-elle. Elle fit un effort pour rester sereine sous le regard de Mme Wilkins.
— Ne voyez-vous jamais les choses avant qu’elles ne se produisent ? Demanda Mme Wilkins.
— Jamais », dit Mme Arbuthnot.
Celle-ci s’efforça de sourire sans succès d’une manière tolérante avec laquelle elle avait l’habitude d’écouter la vision nécessairement incohérente et incomplète des personnes en difficulté.
« Bien sûr, dit-elle à voix basse, presque comme si elle craignait que le pasteur et la Caisse d’épargne ne l’écoutent, ce serait vraiment extraordinaire.
— Même si c’était une erreur », s’exclama Mme Wilkins, « ce ne serait que pour un mois. ».
Mme Arbuthnot commença par dire que ce point de vue était répréhensible, mais Mme Wilkins l’arrêta avant qu’elle ne puisse terminer.
« Quoi qu’il en soit, répliqua Mme Wilkins en l’interrompant, je suis sûre qu’il ne faut pas continuer à être bon trop au point de devenir malheureuse. Et je vois bien que vous avez été bonne pendant des années et des années, parce que vous avez l’air si malheureuse. »
Mme Arbuthnot ouvrit la bouche pour protester, mais Mme Wilkins ne lui laissa pas le temps.
« Depuis toute petite, je n’ai fait que la chambrière. Femme à tout faire… malgré cela, pensez-vous qu’on m’aime ? Même un petit peu ? J’aimerais tellement partir et tout laisser tomber même pour un court instant… et faire quelque chose de différent. »
Allait-elle se mettre à pleurer ? Mme Arbuthnot se sentit très mal à l’aise et compatissante. Elle espérait qu’elle n’allait pas pleurer. Pas là. Pas dans cette pièce hostile, devant tous ces inconnus…
Mais Mme Wilkins, après avoir tiré avec agitation sur un mouchoir qui ne voulait pas sortir de sa poche, réussit enfin à se moucher en apparence, puis clignant rapidement des yeux une ou deux fois, elle regarda Mme Arbuthnot d’un air tremblant d’excuse, à la fois humble et effrayée, puis elle sourit.
« Je vous assure que je n’ai jamais parlé ainsi à personne dans ma vie, murmura-t-elle en essayant de retenir sa bouche, manifestement très honteuse d’elle-même ? Je ne sais tout simplement pas ce qui m’est arrivé.
— C’est sûrement à cause de cette annonce, dit Mme Arbuthnot en hochant gravement la tête.
— Sûrement, répondit Mme Wilkins en se tamponnant furtivement les yeux, elle se moucha un peu à nouveau et de notre malheureux destin ».
Chapitre 2 :
Bien sûr, Mme Arbuthnot n’était pas malheureuse, comment pourrait-elle l’être, se demandait-elle, puisque Dieu prenait soin d’elle ? Elle laissa passer cela pour le moment sans rien dire, parce qu’elle était convaincue qu’il y avait là, un autre congénère qui avait un besoin urgent de son aide ; et pas seulement des bottes fourrées, de chaudes couvertures et d’une soupe, mais d’une aide beaucoup plus recherchée : celle des mots qu’elle aurait besoin d’entendre.
Les mots justes, découvrit-elle, après avoir essayé plusieurs mots sur la vie pour les autres, la prière et la paix que l’on trouve en se remettant sans réserve entre les mains de Dieu. Mme Wilkins répondait avec d’autres mots, incohérents auxquels il était difficile d’y trouver une réponse. Mme Arbuthnot pensa que la seule solution pour réconforter Mme Wilkins était de répondre à l’annonce. Sans engagement de sa part, évidemment. Seulement à titre indicatif.
C’était très troublant. Elle qui passait ses journées à aider et à conseiller, sauf Frederick ; elle avait laissé Frederick depuis longtemps entre les mains de Dieu. Ce fut vraiment déconcertant pour Mme Arbuthnot, d’avoir été sous l’influence de cette simple annonce et par cette étrangère avec des propos incohérents. Elle ne comprenait pas son désir soudain de ce qui n’était, après tout, que de la complaisance, alors que pendant des années, aucun désir de ce genre n’avait pénétré dans son cœur.
« Il n’y a aucun mal à demander », dit-elle à voix basse, comme si le pasteur, la Caisse d’épargne et toutes les personnes pauvres qui attendent et dépendent d’elle l’écoutaient et la condamnaient.
« Ce n’est pas comme si cela nous engageait à quoi que ce soit », dit Mme Wilkins, avec une voix tremblante.
Elles se levèrent en même temps. Mme Arbuthnot fut surprise que Mme Wilkins soit si grande et elles allèrent s’installer à un petit bureau où Mme Arbuthnot écrivit une lettre référencée Z 1000 pour obtenir plus de détails. Le seul détail dont elles se préoccupaient vraiment était le montant du loyer. Elles pensaient toutes les deux que c’était Mme Arbuthnot qui devait écrire la lettre et s’occuper de la partie commerciale. Non seulement, elle avait l’habitude d’organiser et d’être pratique, mais elle était aussi plus âgée et certainement plus calme ; et elle-même ne doutait pas qu’elle fût plus sage. Mme Wilkins n’en doutait pas non plus ; la façon même dont Mme Arbuthnot séparait ses cheveux suggérait un grand calme qui ne pouvait provenir que de la sagesse.
Malgré sa sagesse, sa maturité et son calme, la nouvelle amie de Mme Arbuthnot semblait néanmoins avoir une influence sur celle-ci. Il y avait quelque chose d’attrayant dans les propos de Mme Wilkins. Si elle donnait l’impression d’avoir besoin d’aide, celle-ci avait une curieuse contagiosité. Elle nous entraînait dans son sillage. Et la façon dont son esprit instable sautait aux conclusions qui étaient fausses, bien sûr ; comme celui de désignait Mme Arbuthnot, d’être malheureux, avait un côté déconcertant.
Quoi qu’il en fût, Mme Arbuthnot se retrouva à partager l’excitation et le désir de Mme Wilkins, et lorsque la lettre fut déposée dans la boîte aux lettres de l’entrée et qu’il était impossible de la récupérer, les deux femmes ressentirent le même sentiment de culpabilité.
« Cela montre seulement à quel point nous avons été justes toute notre vie. Il suffit que nous cachions quelque chose à nos maris pour que nous nous sentions coupables.
— Je crains bien de ne pas pouvoir dire que j’ai été véritablement juste, protesta gentiment Mme Arbuthnot, un peu mal à l’aise devant ce nouvel exemple de conclusions hâtives et fructueuses, car elle n’avait pas dit un mot sur son sentiment de culpabilité.
— Oh, mais je suis sûr que vous l’avez été, je vous vois être juste et c’est pour cela que vous n’êtes pas heureuse.
— Elle ne devrait pas dire de telles choses », pensa Mme Arbuthnot. Je dois essayer de l’aider à ne pas dire cela.
À voix haute, elle déclara gravement : « Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur le fait que je ne suis pas heureuse. Quand on se connaîtra un peu mieux, je pense que vous comprendrez que je le suis. Et je suis sûre que vous ne direz plus que la bonté rend malheureuse.
— Oui, je le sais, dit Mme Wilkins. En fait, cela dépend de notre type de vertu. Il y a deux sortes de vertus, celle qui rend heureux et celle qui rend malheureux. Celle que nous aurons au château médiéval, par exemple, est la vertu qui rend heureux.
— En tout cas, à supposer que nous allions là-bas, rappela Mme Arbuthnot. Elle sentait que Mme Wilkins avait besoin d’être corrigée. Après tout, nous n’avons fait qu’écrire pour demander. Tout le monde peut le faire. Je pense qu’il est fort probable que nous trouverons les conditions impossibles, et même si elles ne l’étaient pas, il est probable que d’ici demain, nous ne voudrons plus y aller.
Mme Wilkins rétorqua : « Je nous vois là-bas ».
Tout cela était très frustrant. Pendant que Mme Arbuthnot pataugeait dans les rues ruisselantes pour se rendre à une réunion où elle devait prendre la parole, celle-ci fut fortement troublée. Elle espérait qu’elle s’était montrée très calme et neutre envers Mme Wilkins en dissimulant sa propre excitation. Mais elle était vraiment très émue, elle se sentait heureuse, elle se sentait coupable et effrayée, ses sentiments étaient mitigés, comme celle d’une femme infidèle. En effet, c’est à cela qu’elle ressemblait lorsqu’elle arrivait en retard sur son estrade, elle évitait le regard de son public qui attendait de l’entendre essayer de les persuader de contribuer à soulager les besoins urgents des pauvres de Hampstead, chacun étant convaincu qu’ils avaient eux-mêmes besoin d’aides. On aurait dit qu’elle cachait quelque chose de déshonorant, mais de délicieux. Il est certain que sa franchise habituelle n’était pas là, et qu’elle était remplacée par une sorte de satisfaction étouffée et effrayée, qui aurait conduit un public plus mondain à la conviction instantanée d’une relation amoureuse récente et probablement passionnée.
Beauté, beauté, beauté… les mots ne cessaient de résonner à ses oreilles alors qu’elle se tenait sur l’estrade pour parler de sujets tristes à l’assemblée peu nombreuse. Elle n’était jamais allée en Italie. Était-ce vraiment à cela que son pécule devait être consacré après tout ? Même si elle n’approuvait pas la façon dont Mme Wilkins introduisait l’idée de prédestination dans son avenir immédiat, comme si elle n’avait pas le choix, comme s’il était inutile de lutter, ou de réfléchir, toutefois cela l’influençait fortement. Les yeux de Mme Wilkins avaient été ceux d’une voyante. Certaines personnes étaient comme cela, Mme Arbuthnot le savait ; et si Mme Wilkins l’avait réellement vue au château médiéval, il semblait probable que lutter serait une perte de temps. Pourtant, était-ce raisonnable de dépenser ses économies de cette façon ? … Le but de ces économies avait été inavouable, mais elle avait au moins supposé que sa fin devait être honorable. Devait-elle le détourner de sa destination, qui seule semblait justifier qu’elle le garde, et le dépenser pour se faire plaisir ?
Mme Arbuthnot parla encore et encore, tellement exercée à ce genre de discours qu’elle aurait pu le faire également pendant son sommeil. À la fin de la réunion, elle était si préoccupée par ses rêveries secrètes, qu’elle remarqua à peine le manque d’enthousiasme de son public.
Mais le pasteur le remarqua. Celui-ci fut déçu. D’habitude, sa bonne amie et supportrice Mme Arbuthnot réussissait mieux que cela. Et ce qui était encore plus inhabituel fut qu’elle semblait ne même pas s’en préoccuper.
« Je ne peux comprends pas à quoi bon ces gens prennent la peine de venir ! déclara-t-il avec un ton irrité. Rien ne semble les émouvoir.
— Peut-être ont-ils besoin de vacances, suggéra Mme Arbuthnot ; une réponse qui fut insatisfaisante et étrange, pensa le pasteur.
— En février ? l’interpella-t-il d’un ton sarcastique.
— Oh non, pas avant avril », rétorqua Mme Arbuthnot par-dessus son épaule.
« Très étrange, pensa le vicaire. Très étrange en effet ». Il rentra chez lui et ne fut pas tout à fait chrétien avec sa femme.
Ce soir-là, dans ses prières, Mme Arbuthnot pria Dieu pour être guidée. Elle sentait qu’elle devait vraiment demander de faire louer le château médiéval par quelqu’un d’autre et que toute l’affaire soit ainsi réglée, mais son courage l’abandonnait. Et si sa prière était exaucée ? Non, elle ne pouvait pas le demander, elle ne pouvait pas risquer son séjour. Et puis au fond, Dieu savait déjà ce qu’elle voulait, si elle dépensait toutes ses économies pour aller en vacances, elle pourrait très vite faire d’autres économies. Frédéric la pressait d’argent ; et cela signifierait seulement que pendant qu’elle mettrait de côté une deuxième fois, ses contributions aux œuvres de charité de la paroisse seraient moindres. Et puis ce serait le pécule suivant dont la corruption originelle serait purifiée par l’usage qu’on en ferait finalement.