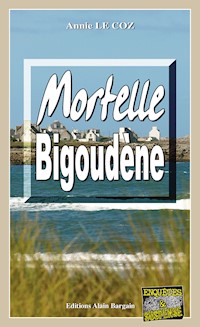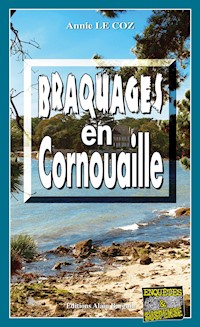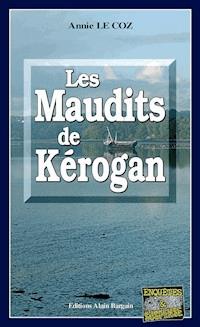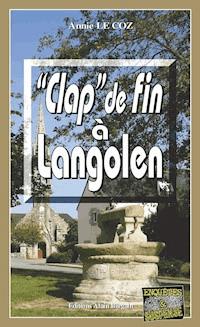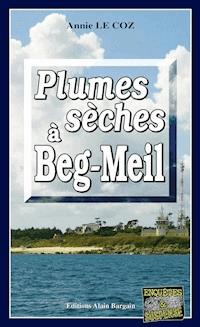Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Capitaine Paoli
- Sprache: Französisch
Un cadre idéal pour passer des vacances le long de la côte bretonne... Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour le lieutenant Paoli.
L’été, les vacances, le bord de mer… Le capitaine François Paoli et son fils Pierre en profitent pour passer quelques jours au Cap Caval. Tandis que le fils effectue un stage de voile, le père profite des bienfaits de la thalassothérapie au centre de cure “Les Cormorans”. Un peu plus tard, alors que Paoli et ses hommes enquêtent sur la disparition du directeur des Cormorans à la demande de la mère de celui-ci, ils apprennent une nouvelle disparition, celle d’une hydrothérapeute. Et pas n’importe laquelle, puisque c’était à elle qu’avait affaire Paoli pendant sa cure personnalisée. Étant la dernière personne à avoir été vue en compagnie de la jeune femme à la sortie d’un bar, les soupçons des gendarmes chargés de cette enquête se tournent tout naturellement vers lui…
Découvrez le quatrième tome des enquêtes palpitantes du capitaine Paoli, dans laquelle il se trouve être le principal suspect...
À PROPOS DE L'AUTEURE
Annie Le Coz est technicienne de laboratoire, diplômée de l'IUT en biologie médicale et auteure de la série policière
Capitaine François Paoli aux éditions Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À François.
I
Légèrement à l’écart, le “Nérée” se balançait paresseusement au gré de la houle. La matinée était bien avancée et, contrairement à ce qui s’était passé sur d’autres bateaux, personne n’était apparu sur son pont de couleur ivoire. Seuls, quelques oiseaux de mer y avaient mis les pattes, le temps d’une pause. Justement parce que rien ne bougeait à bord.
Jolie et puissante vedette dont le nom brillait au soleil, le Nérée avait une coque blanche ornée d’une bande bleu turquoise. Et sur le plat-bord arrière, une tache rouge brun.
*
Cela faisait quelques semaines qu’il avait obtenu sa promotion de capitaine de police. Mais, hormis le grade et l’augmentation de salaire qui en découlait, peu de chose avait changé dans la vie de François Paoli, n’était-ce sa voiture. En effet, depuis une dizaine de jours, il roulait au volant d’une Audi A4 neuve, plus confortable et surtout plus spacieuse que son ancien coupé 206 Peugeot. De sa dernière affaire qui s’était achevée alors que le printemps s’annonçait*, le capitaine Paoli avait gardé une certaine lassitude dont il avait du mal à se libérer. Cela se lisait dans son regard ténébreux, fréquemment absent, et son visage amaigri.
Ce matin-là, il venait de finir un interrogatoire éprouvant, quand le commissaire Vincent Duval fit irruption dans son bureau après avoir rapidement toqué à sa porte. C’est tout juste si le capitaine Paoli ne sursauta pas.
— Bonjour, Paoli.
— Bonjour, Patron.
— Tenez, c’est arrivé sur mon bureau par erreur.
Vincent tendit une lettre à François.
— Parfois, je me demande où le nouveau vaguemestre a la tête ou, plutôt, les yeux, car ce n’est pas la première fois qu’il se trompe dans sa distribution.
— Il faudra le lui demander, ironisa François dans le dos de Vincent qui ressortait.
A peine la porte était-elle fermée, qu’il ouvrit l’enveloppe : il s’agissait d’une convocation au tribunal. Il soupira, c’était le genre de chose qu’il goûtait peu. D’un geste, il envoya la feuille rejoindre un tas de papiers posé sur un coin de sa table de travail et se leva pour se dégourdir les jambes.
On toqua de nouveau à sa porte. Cette fois, il s’agissait du lieutenant Marchand.
— Salut, François !
— Salut, David !
— Tu es très occupé ?
— Très, non. Grincheux vient de me déposer ça, répondit Paoli d’un ton las.
— Une convoc’ ? Pour quand ?
— Septembre.
— Tu as le temps. Bon, on va déjeuner ?
— Déjà ?
— Eh oui, mon vieux, il est midi et quart. Alors, la dinde de la cantine ou le filet de cabillaud de L’Épée ?
Le poisson l’emporta sur la volaille.
En attendant d’être servis, ils se mirent à parler des vacances qui n’allaient pas tarder.
— Ah, j’ai hâte à la semaine prochaine pour profiter de mon bateau !
— Combien de semaines prends-tu ? demanda François.
— Deux. Je n’ai pas pu en poser plus.
Ils plongèrent le nez dans le Sancerre qu’on leur avait recommandé.
— Qu’as-tu prévu pour tes vacances ? questionna David en reposant son verre.
— J’ai réservé une semaine de thalasso à Saint-Guénolé.
— Ah, oui, c’est vrai, j’avais oublié. Et Pierre ?
— Je l’ai inscrit au club de voile voisin. J’espère que ça lui plaira.
— Ça devrait, vu qu’il aime faire le mousse sur mon bateau.
*
A peine étaient-ils de retour à l’hôtel de police quimpérois que Paoli fut informé par Marie que le commissaire Duval l’attendait.
Sachant son supérieur peu patient, il abandonna son ami et grimpa les marches deux par deux.
— Entrez ! entendit-il derrière la porte à laquelle il venait de frapper.
— Vous désiriez me voir ?
— Oui, répondit-il en lui désignant une chaise du menton.
Paoli s’assit.
— Vous avez consulté Intranet aujourd’hui ?
— Non, je n’ai pas eu le temps.
— C’est bien ce que je me disais…
— Pardon ?
— Moi, j’ai eu le temps de le faire, dit Duval en se levant pour aller à sa fenêtre.
— Et… ? fit Paoli au bout d’un moment.
— Vous êtes nommé à la PJ. A mon grand regret, car j’aurais aimé vous garder. Mais… bon… Je vous félicite, Capitaine.
Et Duval de revenir à Paoli et de lui tendre la main. Celui-ci se leva pour la serrer.
— Merci, Patron.
Si les yeux bruns du Corse s’allumèrent de la fierté d’avoir obtenu ce qu’il désirait, ceux du commissaire avaient le triste reflet de celui qui voyait partir son meilleur élément.
— Vous succédez à Barrière.
— Ici ? A Quimper ?
— Vous savez bien où se trouve le détachement de Barrière, non ? lui fit Duval avec une pointe d’irritation dans le ton.
— Heu… oui. Oui, bien sûr, répliqua Paoli.
Ayant appris qu’un poste allait se libérer à la PJ pour cause de départ en retraite, il y avait postulé sans trop y croire, tout en redoutant d’être muté sur Brest ou Rennes, ce qui aurait bouleversé sa vie et surtout celle de Pierre, son fils. Mais en entendant qu’il allait remplacer Barrière, il ne put s’empêcher de se sentir soulagé.
— Votre nomination est effective dès la semaine prochaine, déclara Duval en se rasseyant. C’est bon, vous pouvez disposer, ajouta-t-il en se replongeant dans ses papiers.
— Bien… merci.
A la cellule de police judiciaire quimpéroise, celui que le capitaine Paoli allait remplacer n’était ni plus ni moins que le chef. Il se demanda comment le reste du groupe allait prendre la nouvelle. Le seul moyen de le savoir étant de leur rendre visite, François sortit du commissariat de sécurité publique pour se rendre à quelques mètres de là au détachement PJ.
Ce fut Paul Barrière, le futur retraité, qui lui ouvrit la porte.
— Tu n’attends même pas que mon siège soit froid ? Allez, entre !
Paoli comprit immédiatement que Barrière avait, lui aussi, consulté Intranet et qu’il s’attendait à sa visite. Il le suivit dans l’escalier de bois qui ne connaissait plus depuis longtemps la caresse du chiffon ciré, mais seulement celle du balai.
— Nous avons de la visite, annonça Paul Barrière en poussant la porte. Mon successeur !
Aussitôt, une tête familière se détourna d’un écran d’ordinateur et une main se leva, tendue vers Paoli.
— Salut François !
— Salut Tanguy !
Deux autres hommes apparurent, dont un que François ne connaissait pas.
— Ça va comme tu veux, François ?
— Ça alors, Amos ! Content de revoir, Amaury.
— Et moi, donc !
— Tu es ici depuis longtemps ?
— Huit jours. Par mutation. Tu ne lis pas Intranet ?
— Pas eu le temps.
— Tu ne connais pas Marc, je crois, intervint Paul.
— Pas encore.
— Brigadier-chef Marc Renard.
— Capitaine François Paoli, se présenta-t-il en lui tendant la main.
— J’ai entendu parler de vous, répondit Renard.
— Tanguy, fais-nous donc un peu de café.
Tandis que Paul Barrière invitait François Paoli, Marc Renard et Amaury Verdier à s’asseoir, Tanguy Botrel s’éclipsa dans la petite cuisine de la PJ.
— J’ai été content de savoir que ma place te revenait, débuta Barrière. Et les autres aussi.
— Ah, oui ?
Barrière confirma ses paroles en opinant du chef.
— Tu as fait du bon boulot ces derniers mois.
— Tu me flattes, Paul.
— Ce n’est pas de la flatterie, même si ça en a l’air. Non, je voulais plutôt te féliciter, puisque je n’en ai pas eu l’occasion.
— Alors, merci pour les félicitations.
— Je suppose que Duval doit l’avoir mauvaise de perdre un homme tel que toi. Ça a dû batailler ferme en haut lieu !
— Probablement.
— Tu es sur quelque chose en ce moment ?
— Pas vraiment. Plutôt dans la paperasse. Et vous ?
Et la conversation glissa sur les diverses affaires du moment.
Au bout d’une petite heure, le capitaine Paoli se leva et s’en alla, satisfait de cette prise de contact avec ses futurs collègues.
Il réintégra son bureau, bien décidé à boucler tout ce qui pouvait l’être pour aider ceux qui allaient devenir ses anciens partenaires, les lieutenants David Marchand et Éric Durand.
*
Ce même jour, quand sa journée fut finie, il quittait l’hôtel de police en compagnie de David Marchand lorsqu’ils se trouvèrent nez à nez avec Amaury Verdier.
— Salut !
En guise de salutation, David se contenta d’une inclinaison du chef.
— Vous avez le temps de prendre un verre ? demanda Verdier.
François et David acceptèrent.
— L’Épée, ça vous va ?
L’approbation se fit de deux hochements de tête.
Chemin faisant, David apprit que François et Amaury s’étaient connus à l’école de police. Alors que François Paoli sortait dans les dix premiers de la promotion, son camarade était relégué dans la seconde moitié du classement, l’amour pour celle qui allait devenir sa femme ayant pris le pas sur ses études. Amaury tint la lourde porte du café et céda le passage à ses deux invités. Un rapide coup d’œil dans la salle, puis il les emmena vers une table.
— Que buvez-vous ? demanda-t-il en hélant le serveur.
— Whisky, répondit François.
— Moi aussi.
— Alors, ça fera trois. Trois whiskies, s’il vous plaît, dit-il au garçon qui s’était approché.
— Bien, Monsieur.
La commande passée, un silence s’installa entre les trois hommes. Comme s’ils s’étaient déjà tout dit durant le trajet depuis l’hôtel de police ? Non, plutôt, comme s’ils ne savaient pas par où commencer.
Ce fut Amaury qui se lança le premier.
— Ça fait drôle de te retrouver ici, à Quimper, François.
— Je ne m’attendais pas du tout à te voir non plus.
— Où étais-tu avant ? interrogea David.
— Versailles. C’était assez sympa, même si on ne chôme pas là-bas.
— Alors, pourquoi tu as quitté ?
— Sophie a obtenu sa mutation.
— Sa femme, précisa François pour David. Elle est prof d’anglais.
La conversation qui venait à peine de débuter fut interrompue par le retour du serveur qui déposa les verres sur la table.
*
Lorsque François Paoli ouvrit les yeux, ce matin-là, le soleil était déjà haut dans le ciel.
— Tu es réveillé ? demanda la petite voix de Pierre à la porte.
— A l’instant. Bonjour Pierre.
— Bonjour Papa, dit-il en se penchant pour embrasser son policier de père.
— Quelle heure est-il ?
— Huit heures et demie.
— Déjà ?
— Oui.
Il repoussa drap et couverture et se leva. Une fois debout, il ouvrit la fenêtre en grand et inspira profondément. Puis il se tourna vers Pierre.
— Tu as déjeuné ?
— Non, je t’attendais, mais j’ai fait ma toilette.
Une heure plus tard, douché, rasé de près, les cheveux disciplinés par un peu de gel de coiffage, François passa de la salle de bains à la chambre et s’habilla pendant que Pierre l’attendait sagement en lisant, le chien couché à ses pieds.
Puis ce fut le moment de faire les bagages. Père et fils entassèrent leur linge dans deux sacs de voyage. Les bagages terminés, François fit le tour de l’appartement pour baisser les volets et fermer les compteurs. Enfin, deux tours de clef et de verrou plus tard, ils prenaient l’ascenseur, puis embarquaient à bord de l’Audi.
La voiture prit la Transbigoudène, la route à quatre voies desservant le Cap Caval, sur laquelle le trafic était assez dense.
Au bout de la Transbigoudène, François tourna à droite en direction de Plomeur, Penmarc’h et La Torche.
La route se fit plus plate, les arbres plus rares, on approchait de la mer. Sans la voir, on la devinait à son odeur.
— On montera au phare ? interrogea Pierre en voyant la haute silhouette de l’édifice apparaître.
— Oui, à la fin de notre séjour, mais, je te préviens, c’est haut et il n’y a pas d’ascenseur !
— Ah ! Tu y es déjà monté, toi ?
— Pas encore. Les fois où je pensais le faire, il pleuvait.
Se remémorant les indications qu’on lui avait fournies, François ne tarda pas à trouver le penty qu’il avait loué pour la semaine.
La petite maison aux murs de pierre et au toit d’ardoise paraissait tapie au sol pour affronter les tempêtes, derrière un muret de pierres sèches dans lequel s’accrochaient quelques touffes de sédum et d’arméria rachitiques. Le jaune et le rose des fleurs se côtoyaient dans un désordre harmonieux.
François avait à peine éteint son moteur qu’une femme surgit, sans doute de la maison d’en face où un rideau venait de s’écarter, juste de quoi voir sans être vu. Il sortit de l’Audi.
— Bonjour !
— Mat an traoù ?
— Pardon ?
— Je disais bonjour ! Vous devez être le locataire de Louise…
— Vous voulez dire de madame Cozic ?
— Oui, c’est ça, Louise ! Moi, c’est Jeannette. Elle m’a dit de vous accueillir en attendant son retour. Elle avait son pain à prendre.
Maintenant qu’elle avait bien observé François, elle posa les yeux sur Pierre.
— Il a quel âge vot’ fils ?
— Huit ans.
— Ah !
Alors que Jeannette allait pousser un peu plus son interrogatoire, une femme apparut sur un vélo, son pain attaché en travers de son porte-bagages.
— Ah, voilà Louise ! fit Jeannette.
Madame Cozic descendit de sa monture quelque peu rouillée et l’appuya contre le muret en prenant garde de ne pas égratigner le bout de son pain.
— Bonjour ! Je vois que vous avez fait la connaissance de Jeannette. Je suis Louise Cozic, se présenta-t-elle, main tendue vers François, puis vers Pierre. C’est bon, Jeannette, tu peux nous laisser.
Jeannette tourna les talons et s’éloigna sans se presser.
— J’espère que je ne vous ai pas fait trop attendre, s’excusa Louise en fouillant ses poches.
— Non, nous venions d’arriver.
Elle sortit une clef qu’elle tourna et ouvrit la porte du penty.
— Voilà ! Entrez !
Après leur avoir fait visiter le penty, Louise Cozic remit une clef à François, récupéra son vélo et traversa la route en direction de la maison où le rideau venait à nouveau de bouger.
*
Après le déjeuner, François conduisit Pierre au club de voile où il l’avait inscrit. De jeunes apprentis navigateurs s’affairaient autour de voiliers. Un moniteur s’approcha.
— Bonjour ! Vous cherchez quelqu’un ?
— Bonjour ! Je viens me renseigner sur les heures de cours de mon fils.
— Ah ! Alors, il faudrait voir Jean-Phi, c’est le directeur. Vous voyez cette porte bleue ? C’est son bureau.
— Merci. Tu viens, Pierre ?
Une trentaine de mètres plus loin, François fit ce qu’on venait de lui dire et tous deux pénétrèrent dans un local éclairé d’une seule fenêtre, donnant sur la plage.
Un homme leva la tête de ses papiers.
— Bonjour, Monsieur. Vous êtes bien le directeur ?
— Oui, Jean-Philippe Bourg. Bonjour. Si c’est pour une inscription, tout est complet.
— Non, non. L’inscription est déjà faite. Je viens voir quand a lieu son premier cours.
— C’est à quel nom ?
— Pierre Paoli.
— Un instant.
Jean-Philippe Bourg souleva des papiers, déplaça un classeur et en attrapa un autre qu’il ouvrit. Il tourna plusieurs feuilles sur lesquelles figuraient des dates et des listes de noms.
— Paoli… disait-il à mi-voix, en suivant son listing de l’index droit. Ah, voilà ! Paoli, Pierre. Bon… Son brevet de natation est là… Vous avez apporté son certificat médical ?
— Oui, un instant…
Le temps que François fouille dans son portefeuille et le certificat changea de main.
— Bien. Cette fois-ci, on a tout. Le cours débutera demain à 10 heures.
— Parfait. Alors, à demain !
François serra la main de Jean-Philippe et entraîna Pierre dehors.
— Que dirais-tu de profiter un peu de la plage, fiston ?
— D’accord !
*
A peine arrivés à la plage, ils abandonnèrent serviettes et vêtements sur le sable à un endroit qu’ils avaient choisi depuis la dune et allèrent se baigner.
Après avoir recommandé à son fils de ne pas trop s’éloigner du bord, François fit quelques brasses vers le large avant de nager parallèlement au rivage. S’étant fixé comme but la bouée de mouillage d’un bateau, il partit d’un crawl régulier et fluide, fendant les vaguelettes.
Lorsqu’il eut atteint la bouée, il fit demi-tour et revint à son point de départ. Le corps ruisselant, il remonta le sable blanc. Pierre séchait sur sa serviette. François secoua la tête au-dessus de son fils, faisant tomber quelques gouttes d’eau fraîche sur sa peau.
— Oh, Papa !
— Quoi ?
Et il s’ébroua de nouveau avant de s’étendre sur son drap de bain.
— Je croyais qu’on devait jouer au ballon, dit Pierre.
— Tout à l’heure.
— Bon. Alors, je vais faire un tour.
— C’est ça, bonne idée, approuva François.
Tandis que Pierre s’éloignait, François se laissa bercer par le chuintement de la marée montante mourant sur le sable.
Dix minutes plus tard, il se tournait et offrait son dos à la morsure du soleil. Il ne tarda pas à s’endormir.
Ce fut la voix de Pierre qui le tira de son sommeil :
— Papa ! Papa !
— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?
— Regarde ce que j’ai trouvé.
Bras tendu, Pierre tenait une montre entre ses doigts.
— Fais voir.
— C’est une grosse ! Elle est belle, hein ?
François lui prit la montre et lui accorda un bref regard avant de demander :
— Où l’as-tu trouvée ? Sur le sable ?
— Oui, en haut de la plage, là-bas… répondit Pierre en pointant le doigt.
— Sur la dune ?
— Puisque je viens de te le dire !
— Et il n’y avait personne, pas de monsieur, à côté ?
— Ben… non ! J’ai juste vu deux filles qui jouaient avec des raquettes. Et comme ce n’est pas une montre de fille, je ne leur ai rien demandé. Et tous les monsieurs…
— On dit : les messieurs, Pierre, le corrigea François.
— Et tous les messieurs, se reprit Pierre, que j’ai vus en revenant ici, avaient une montre. J’ai bien regardé. C’est pour ça que je te la donne.
— C’est bien. En rentrant à la maison, on ira la déposer à la gendarmerie.
— Pourquoi ?
— Parce que c’est une montre de valeur, répondit François en fourrant l’objet dans le fond de son sac à dos. Tu veux toujours jouer au ballon ?
*
Après la partie de ballon, les Paoli se rhabillèrent, quittèrent la plage et rentrèrent au penty. François avait complètement oublié la montre.
— Sors Copain, je vais prendre une douche.
— D’accord ! Et après, on mange ? J’ai faim !
— Oui, oui. Allez, va !
Cinq minutes plus tard, vêtu d’un polo et d’un bermuda propres, il préparait le dîner devant le poste de télévision qui diffusait les informations régionales. Tout en coupant des tomates, François y jetait de temps à autre un coup d’œil.
Il plongeait des œufs dans une casserole, quand son attention fut captée par l’annonce d’un fait divers :
« Disparition de Pascal Loiseau, dont la photo s’affiche actuellement sur vos écrans. Sportif accompli, ce quadragénaire participait, souvent avec bonheur, à des régates. Nous le voyons, ici, recevant le prix de l’Obélix Trophy, à Bénodet. »
— Papa, on est revenus !
— Bien, dit François en coupant la télé. Va te laver les mains, on mange.
Le repas fini, la table débarrassée, François s’installa sur un bloc de granit adossé à la façade du penty et qui, vraisemblablement, devait faire office de banc.
— A quoi tu penses ? lui demanda Pierre en s’asseyant près de lui.
— A rien ! Ça doit t’étonner, hein !
— Oui, parce qu’à Quimper, tu as toujours l’air de penser à des tas de choses.
— Et comment tu sais ça, toi ?
— Ben… Tu fronces les sourcils et t’as souvent mal à la tête. Et, là, vrai de vrai, tu pensais à rien ?
— Puisque je te le dis.
— Ah, bon… Alors, tu veux bien jouer aux boules ? J’ai vu un jeu, sous l’escalier.
*
Ils sortirent de la maison et se séparèrent cinq cents mètres plus loin, devant l’entrée de l’école de voile. Quelques recommandations de prudence et d’obéissance à son fils, et François prit le chemin du centre de thalassothérapie, Les Cormorans.
François aurait pu choisir Bénodet ou Douarnenez pour effectuer sa cure. Mais après avoir téléphoné à ces deux établissements, puis aux Cormorans, il n’avait pas hésité et avait réservé une semaine de thalasso à Saint-Guénolé.
A son arrivée, il reçut la feuille de son programme. Massages, enveloppements d’algues, hydrothérapie, bains bouillonnants devaient se succéder en demi-journées : un jour le matin, un jour l’après-midi.
— Et vous pourrez également profiter du sauna ou du hammam, lui dit l’hôtesse d’accueil en lui remettant sa panoplie de parfait curiste. Veuillez me suivre, s’il vous plaît.
François emboîta le pas de l’hôtesse qui le mena jusqu’à une cabine.
— Je vais prévenir Clara. En attendant, déshabillez-vous et enfilez votre peignoir…
— Merci, Mademoiselle.
Sitôt l’hôtesse partie, François enfila son peignoir. Clara apparut cinq minutes plus tard.
— Bonjour !
— Bonjour Clara !
— Vous êtes monsieur Paoli, c’est bien ça ?
— C’est ça.
— Bien. Nous allons commencer par un bain hydro-massant. Suivez-moi.
Ils passèrent devant une série de portes portant le pictogramme d’une baignoire. Clara lui ouvrit la porte numéro 8.
— Vous avez un crochet ici pour suspendre votre peignoir, lui indiqua-t-elle. Bien, allez y, entrez dans l’eau. Ça va comme température ?
— Ça va.
— Le programme dure quinze minutes pendant lesquelles les diverses parties de votre corps seront massées de la plante des pieds aux épaules et aux cervicales.
Elle diminua l’intensité de la lumière jusqu’à atteindre la pénombre et se retira. Et François se laissa faire par les jets pulsés. Un quart d’heure plus tard, Clara reparut et modifia à nouveau l’éclairage. François cligna des yeux.
— Maintenant, je vais vous conduire dans une autre cabine pour un enveloppement d’algues.
Son peignoir enfilé, il la suivit jusqu’à la cabine 7. Celle-ci était de petite taille, sans fenêtre, mais avec deux portes en vis-à-vis. Le long d’un mur se trouvait une table qu’elle lui désigna pour s’allonger. Ce qu’il fit pendant qu’elle se saisissait d’un récipient rempli d’une mixture verte. Tandis que Clara vérifiait ce dont elle avait besoin, François la regardait faire. Elle était de taille moyenne, avait la peau mate, les cheveux châtains coupés court, des yeux bleus en amande bordés de longs cils noirs, un nez très légèrement retroussé, une jolie bouche. Son maquillage discret accentuait sa beauté naturelle.
— Je suppose que ce sont les algues ? s’enquit François en avisant le bol qu’elle tenait.
— Vous ne vous attendiez quand même pas à un tas de goémon dans lequel vous vous seriez roulé, comme ce client de Paris que j’ai eu la semaine dernière… Qu’est-ce qu’on a ri quand j’ai raconté ça aux autres ! Oh ! J’espère que vous n’êtes pas Parisien…
— Non, pas du tout.
— Allongez-vous, levez le bras gauche. Tant mieux, j’ai frôlé la gaffe. Le bras droit… Bien. A présent, la jambe gauche… et pour finir, la droite. Voilà ! Maintenant, je vous emballe dans du film plastique, pour ne pas salir la couverture… Ça va ? Et maintenant, la couverture !
— Je dois ressembler à une papillote…
— Presque ! Je reviens dans vingt minutes. A tout à l’heure !
Et comme dans la cabine précédente, Clara baissa la lumière et sortit.
Il n’y avait pas fait attention pendant le temps qu’elle étalait la purée de laminaires sur lui, mais, à présent qu’il était seul, il entendait de la musique de relaxation. Il ferma les yeux.
Il était tellement bien au chaud, détendu, l’esprit vide, qu’il fut surpris par le retour de Clara et de la lumière. Elle lui retira la couverture, puis le film plastique et lui désigna la douche.
— Je vous fais le dos, vous ferez le reste vous-même, dit-elle en réglant la température de l’eau.
— Et ensuite ?
— Vous pourrez disposer de l’espace hydro-marin, à moins que vous optiez pour un sauna ou un hammam. Vous avez aussi la possibilité de vous reposer dans la salle des arômes. Mettez-vous face au mur, je commence par les épaules.
Tout en débarrassant le dos de François de son emplâtre visqueux, elle lui demanda ce qui l’avait poussé à choisir Les Cormorans comme centre de cure.
Il répondit que, pendant ce temps-là, le temps qu’il consacrait à son bien-être, son fils suivait des cours de voile.
— Et vous-même, Clara, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
— Depuis l’ouverture de l’établissement, ça fait cinq ans. Et je m’y plais beaucoup, ajouta-t-elle.
Le rinçage du dos terminé, elle lui tendit le pommeau de douche.
— Voilà, c’est à vous ! Je vous dis donc à demain, 15 heures. Au revoir !
— Au revoir !
*
François sortit de l’établissement de cure et mit ses lunettes de soleil.
En se rendant aux Cormorans, il avait repéré un petit restaurant sympathique dans lequel il s’était réservé une table.
N’ayant personne pour converser, il patienta en regardant les clients arriver, consulter la carte, puis, après concertation, s’installer aux tables voisines.
Il y avait quelques étrangers, mais aussi des Français. Tous avaient le nez plongé dans le menu, hésitant sur les plats qui avaient l’air tous aussi appétissants les uns que les autres.
C’était cela qui avait poussé François à choisir cet endroit, tout autant que les prix, fort raisonnables pour un restaurant de bord de mer.
— Votre salade, Monsieur. Bon appétit !
— Merci.
Tout en mangeant, il se surprit à écouter la conversation d’une tablée voisine, commentant l’actualité.
— Vous avez vu les régionales d’hier soir ? On parlait de Pascal Loiseau.
— Il aurait disparu, d’après ce que j’ai entendu…
— Depuis combien de temps ?
— Une semaine, je crois. En tous cas, c’est ce qu’ils ont dit au journal.
Ils furent interrompus par une serveuse venant prendre leurs commandes. Et distraits, aussi, car leur sujet de conversation changea.
*
François retrouva Pierre en fin d’après-midi. L’enfant était enchanté par son premier cours et il s’était fait une copine, Kelly.
— On va à la plage ? demanda-t-il en déballant son goûter.
— Tu n’es pas fatigué ?
La bouche pleine, Pierre secoua la tête de gauche à droite.
— On retourne à la même plage qu’hier ?
— Si tu veux.
— Oui !
Dès qu’ils apparurent en haut de la plage, une blondinette accourut à leur rencontre. Et François comprit le « oui ! » enthousiaste de son fils.
— J’ai cru que tu n’allais pas venir…
— C’est Kelly, la présenta Pierre à son père.
— Bonjour Kelly !
— Bonjour ! fit-elle d’un ton joyeux.
Elle accompagna les Paoli jusqu’à l’emplacement choisi par François. Sitôt que Pierre fut en maillot de bain, elle le prit par la main pour l’entraîner vers la mer.
— Viens, on va se baigner !
François suivit les enfants.
— Elle est bonne ?
— Elle est claire ! s’exclama Pierre. Regarde, on voit des petits poissons !
— Je vois…
— Et, là, c’est quoi ? demanda le garçonnet, la main dans l’eau.
— Où ça ? Enlève ta main, je ne vois pas…
Comme venait de le lui demander François, Pierre sortit la main de la mer, mais en la retournant prestement de façon à envoyer de l’eau au visage de son père qui fut surpris par cette aspersion.
— Je t’ai eu ! rit Pierre en s’éloignant prudemment.
Mais en quelques pas, François était sur lui et l’éclaboussait à grands gestes. La joyeuse bataille à laquelle ils firent participer Kelly, dura quelques minutes au bout desquelles François prit la fuite vers le large.
Après une vingtaine de minutes de nage, il sortit de l’eau et remonta en regardant à droite et à gauche sans voir Pierre. La serviette jetée sur les épaules, il attrapa ses lunettes de soleil qu’il remit devant ses yeux bruns et refit un tour d’horizon d’observation. Un moment, il crut avoir repéré son fils, mais ce n’était pas lui : plus grand, un peu grassouillet.
Avisant les rochers, il songea que Pierre avait dû s’y rendre avec Kelly. Il lui fallut deux minutes pour les repérer, penchés au-dessus d’une flaque. Tranquillisé, il s’allongea et ferma les yeux. Apprécier le calme, la chaleur du soleil, le bruit des vagues… Ne penser à rien…
Il y parvint tant et si bien que Pierre dut le secouer et lui faire remarquer que la plage s’était vidée.
*
Trois jours plus tard…
François était allongé sur une table dominée par une rampe de laquelle jaillissaient plusieurs petites douches d’eau de mer chaude et se faisait masser les épaules par Clara.
— Oh, que ça fait du bien !
— Vous nagez beaucoup, n’est-ce pas ?
— Comment le savez-vous ?
— Je vous ai vu, hier.
— Vous étiez à la plage ?
— Oui. Plus exactement, je marchais sur la dune quand je vous ai vu vous mettre à l’eau. Comment l’avez-vous trouvée ?
— Elle était à bonne température. Vous ne vous êtes pas baignée ?
— Si, en revenant de ma promenade.
Elle se tut, ses mains quittant les épaules de François pour descendre le long de son dos. Il ne relança pas le dialogue, il était trop bien.
Soudain, il ne sentit plus que les jets d’eau tomber en pluie sur son corps.
— C’est fini ?
— Oui.
— Dommage !
— C’est ce que tous les curistes disent. Bien, c’est tout pour aujourd’hui, annonça-t-elle en coupant l’eau. A demain matin, monsieur Paoli !
— Et pourquoi pas à ce soir ? demanda François en enfilant son peignoir.
— Ce soir ?
— Vous n’êtes pas libre, peut-être…
— Oh, si… si ! Mais… c’est que je… je ne m’y attendais pas, dit-elle en finissant de nettoyer la cabine.
Elle allait ouvrir la porte, mais il l’en empêcha. Elle leva ses yeux bleus vers le regard brun qui la dominait.
— Cela me ferait plaisir que vous acceptiez de prendre un verre avec moi. Je vous donne le temps de mon rhabillage pour réfléchir. D’accord ?
— D’accord.
Il s’en alla au vestiaire où il prit son temps. Quand il en ressortit, Clara parlait avec une autre employée des Cormorans. Et l’échange semblait assez vif.
Il sortit, déçu que la jeune femme ne lui ait pas accordé un regard lorsqu’il passa devant elle pour sortir. Il prit la direction du penty.
Il allait pousser la porte quand son portable sonna.
— Allô ?
— Monsieur Paoli ?
— Oui…
— C’est Clara… Pour votre proposition…
— Elle tient toujours…
— Ah !
Il traduisit l’interjection comme celle d’un soulagement.
— Dans ce cas, je serai à 21 heures au Scottish Pub, ajouta-t-elle aussitôt. C’est sur la route de Kérity.
— Entendu. A tout à l’heure !
A peine eut-il coupé la communication que Pierre rentra de l’école de voile.
— J’ai fini le parcours le premier ! annonça-t-il victorieusement à son père. Il y en a qui se sont trompés dans l’ordre de passage des bouées, pourtant c’était facile à se rappeler.
— Personne n’est tombé à l’eau, aujourd’hui ?
— Non, non. Tu viens, Copain ?
Et il ressortit avec le labrador tandis que François préparait le dîner.
— Pierre, à table ! l’appela-t-il, vingt minutes plus tard.
— J’arrive !
Alors qu’ils finissaient leur repas, François demanda :
— Tu n’auras pas peur, si je te laisse un peu seul ce soir ?
— Où tu vas ?
— Dans un bar, prendre un verre.
— Ben…
— Je ne rentrerai pas tard, promis. Et puis, si la présence du chien peut te rassurer, je t’autorise à faire dormir Copain dans ta chambre.
— Vers quelle heure tu reviendras ?
— Je ne sais pas, répondit François en servant une semoule au caramel à son fils.
Il regarda l’enfant manger son dessert en attendant que son café chauffe. D’habitude, Pierre engloutissait son laitage, ce n’était pas le cas ce soir.
— Ce n’est pas bon ?
— Si, si… mais je n’ai plus très faim.
— Eh bien, mange encore trois cuillerées et donne le reste au chien.
Deux cuillerées plus tard, le labrador passait une langue gourmande dans la barquette d’aluminium. François ne dit rien, ayant deviné la contrariété qui avait coupé l’appétit à Pierre.
Ils regardèrent un peu de télévision, puis l’heure vint d’aller au lit.
— Allez, dors bien.
— Non, laisse la lumière.
— A Quimper, tu dors sans, objecta François.
— S’il te plaît… l’implora Pierre.
Mais François plongea la chambre dans le noir et ferma la porte. Il était arrivé au bout du couloir et allait descendre quand il entendit appeler :
— Papa !
— Si c’est pour la lumière, j’ai dit non !
— Papa !
— Quoi ?
— J’ai envie de faire pipi !
Il revint sur ses pas, rouvrit la porte, ralluma.
— Dépêche-toi d’y aller.
Pierre sortit du lit, fila au WC et se recoucha. Cette fois, son père tira la porte, laissant un rai de lumière du couloir filtrer, et s’en fut se préparer. Il troqua son bermuda pour un pantalon de toile beige, léger, et une chemise noire dont il laissa le col ouvert et dont il remonta les manches.
Dix minutes plus tard, alors qu’il prenait sa clef de voiture, Pierre apparut.
— J’ai soif !
— Tout à l’heure, c’était une envie de pisser, maintenant tu as soif… Tu le fais exprès ou quoi ?
— Mais… c’est vrai… j’ai soif… pleurnicha Pierre. Et j’ai chaud…
— Bon, viens boire.
L’enfant approcha, prit le verre d’eau que son père lui tendait et le but avidement.
— Merci.
— Et maintenant, tu remontes te coucher. Allez !
Pierre repartit vers l’escalier en traînant les pieds.
François jeta un coup d’œil à sa montre, il ne lui restait plus que quinze minutes avant de retrouver Clara. Mais s’il prenait la voiture, il disposait encore d’un peu de temps.
Lorsqu’il jugea que Pierre était recouché, il remonta l’escalier à pas de loup. La porte de la chambre était entrouverte, mais la lumière éteinte.
Il redescendit aussi silencieusement qu’il était monté et, cette fois, sortit.
*
Il restait trois emplacements sur le parking du Scottish Pub. Il se gara entre une moto et un camping-car, et traversa le parking en lisant les immatriculations des autres véhicules : pour la plupart des 29, mais également un 66, un 31, deux 75 et un 59.
François franchit la porte. Il y avait déjà pas mal de monde à l’intérieur du Scottish Pub où l’on se serait cru de l’autre côté de la Manche. Il ne manquait même pas la fameuse cloche que l’on fait tinter pour annoncer le dernier service avant la fermeture…
Il balaya la clientèle des yeux : Clara n’était pas encore arrivée. Il s’installa au bar, toutes les tables étant occupées, et commanda un Lagavulin. Il en apprécia la couleur ambrée, le parfum tourbé, et en prit une gorgée qu’il garda en bouche. Ce rituel de dégustation effectué, il eut un hochement de tête approbateur.
Cela faisait vingt minutes que François était en tête-à-tête avec son verre et l’avait presque fini quand il entendit :
— Nageur et amateur de whisky, à ce que je vois ?
En reconnaissant la voix de Clara, il se tourna vers elle.
— Je commençais à penser que vous ne viendriez pas.
— Désolée, j’ai eu un contretemps.
— Il n’y avait plus de table libre quand je suis arrivé. Cela ne vous dérange pas d’être au bar ?
— Pas du tout, répondit-elle en se hissant sur le tabouret qu’il occupait un instant plus tôt. Que buvez-vous ?
— C’est un Lagavulin.
— Mary, la même chose pour moi, s’il te plaît.
— Un autre, s’il vous plaît.
François attendit que Mary se soit éloignée d’eux pour prendre la parole :
— Merci d’avoir accepté mon rendez-vous…
— Puisque j’ai accepté votre invitation, monsieur Paoli…
— Mon prénom est François.
— Classique, mais j’aime bien. Donc, puisque je suis là, j’aimerais savoir en compagnie de qui je bois un verre.
— Vous le savez déjà, Clara. Un de vos curistes.
— Oui, bien sûr… Ma question était stupide ou trop directe…
— Je ne dirais pas stupide.
Malgré l’éclairage un peu faible, il nota un rosissement des joues de la jeune femme qui cacha sa gêne en trempant les lèvres dans son verre.
— Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, Clara ?
— Parce que je l’aime bien. Il ne vous plaît pas ?
— Oh, si, si ! C’est le cadre idéal pour la dégustation d’un single malt.
— Et j’aime bien la musique celtique. Tenez, ça, c’est une valse écossaise. C’est joli, non ?
Au tour de François de répondre d’un hochement de tête en déglutissant.
— Vous avez appelé la serveuse Mary et pas Marie…
— Oui, elle est écossaise. Ça fait trois ans qu’elle et son mari ont ouvert ce pub.
— Il est écossais, lui aussi ?
— Non. C’est un Breton pure souche, un gars d’ici. Ce qui ne doit pas être votre cas…
— Je ne peux pas vous le cacher. Je suis corse.
— Corse… Ah ! Je suppose que c’est votre métier qui vous a conduit ici, en Bretagne…
— Vous supposez bien.
Nouvelle pause occupée à la dégustation du single malt et à l’observation de la clientèle. Quelques mots ou commentaires de Clara à propos d’untel ou d’un autre, hochements de tête de François, sourires. Soudain, bousculée par un buveur de bière voisin qui racontait une histoire avec force gestes, Clara fut déséquilibrée et projetée vers François qui la reçut quasiment dans les bras.
Échange de regards après ce contact inattendu, suspension du temps, oubli de l’espace. Si l’instant fut bref, il n’en fut pas moins intense.
— Oh, pardon ! s’excusa le buveur de bière. Je vous ai fait mal ?
— Non, non, ça va, répondit Clara en se hissant de nouveau sur son siège. Oh, zut ! Mon verre s’est renversé.
— Je vous en offre un autre. Mary ! Sers-leur à boire sur mon compte.
Ayant jugé qu’il avait réparé sa faute, le buveur de bière oublia l’incident et reprit sa conversation.
— Je ne sais plus de quoi nous parlions, dit Clara après avoir remercié Mary.
— Et si vous me parliez un peu de vous… suggéra François.
— De moi ? Oh, vous savez, il n’y a pas grand-chose à dire. Je vois tellement de monde dans la journée que, le soir, j’aime bien le calme.
— Pourtant vous êtes ici, ce soir…
— Oui, c’est vrai, admit-elle en détournant les yeux vers la salle. Mais, ce soir, c’est différent.
— Ah, oui ? Pourquoi ?
— Depuis quelques jours, l’ambiance est un peu lourde, voire tendue, aux Cormorans.
— J’imagine que ça arrive dans n’importe quelle entreprise…
— Sans doute, oui, répliqua-t-elle d’un air songeur. Et puis…
— Et puis ?
— Non… rien.
Et là, les yeux de Clara se reposèrent sur François. Et parlèrent si bien pour elle que le Corse lui prit son verre, le posa sur le bar et l’entraîna par la main à l’extérieur du pub.
La nuit était claire. Ils firent quelques pas. A peine eurent-ils contourné la façade que François attira Clara à lui. Doucement, presque hésitant, il lui enveloppa la joue gauche, lui leva le menton et approcha ses lèvres des siennes. Ce fut d’abord un contact léger, un effleurement. Puis, François passa à quelque chose de plus sérieux. Et tandis que sa bouche goûtait celle de la jeune femme, le velouté de ses lèvres, la douceur de sa langue, que Clara glissait une main dans l’échancrure de sa chemise tout en répondant à son baiser, il se sentit parcouru par une onde de chaleur.
Sans que leurs bouches se désunissent, il la fit reculer vers le mur de pignon du pub contre lequel elle se trouva adossée en douceur. Mais, alors qu’il pressait son corps contre le sien, une image surgit du fin fond de sa mémoire. Celle d’une femme qu’il avait aimée passionnément et qu’il avait perdue tragiquement : Hélène.
Il se détacha de Clara.
— François…
— Pardon… je…
Et il s’enfuit à grands pas vers sa voiture dans laquelle il s’engouffra et quitta les lieux.
Arrivé à la pointe de La Torche, il sortit de l’Audi, fit quelques pas, tomba à genoux face à l’océan. Il ne s’en aperçut pas, mais il y avait un témoin à son désespoir.
Alors qu’il s’apprêtait à entrer dans sa maisonnette, un septuagénaire avait entendu arriver l’Audi. Bien qu’il fût habitué à la venue de noctambules en galante compagnie, il n’avait pu s’empêcher de regarder en direction de la berline allemande. Et, comme la nuit était claire, l’homme n’avait eu aucun mal à observer son conducteur.
Une demi-heure plus tard, François Paoli entrait dans un bar et commandait un double whisky.
*
Pierre poussa la porte de la chambre de son père et le vit affalé en travers du lit, tout habillé.
— Papa ?
Pas de réponse, pas même un grognement. Vaguement inquiet, Pierre s’avança dans la pièce.
— Papa, je vais à la voile. Papa, t’as entendu ? Je pars.
— Hon…
Que voulait dire ce « hon » ? Que François avait entendu ?
— Papa, t’as compris ? Je vais à la voile. Papa ?
N’obtenant toujours rien, Pierre s’approcha du lit et se pencha vers son père. C’est alors qu’il perçut l’haleine de François.
— Tu es saoul… se désola l’enfant en reculant du lit.
Il sortit de la pièce et descendit au salon. Là, il écrivit quelques mots sur un bout de papier et quitta le penty.
Plus d’une heure s’était écoulée depuis le départ de Pierre quand François émergea enfin. Il s’assit sur le bord du lit, la bouche pâteuse et la désagréable impression de voir le décor tanguer autour de lui, le tout couronné par un terrible mal de tête.
Il essaya de lire l’heure, mais ne put le faire, incapable de discerner les chiffres et les aiguilles de sa montre. Il se frotta le visage et les yeux, réussit à se lever et, d’un pas chancelant, se dirigea vers la salle de bains.
Il tourna le robinet d’eau froide du lavabo et s’aspergea la figure à plusieurs reprises avant de relever la tête et d’oser affronter son reflet dans le miroir, les mains en appui de chaque côté de la vasque. Le moins qu’on pût dire, c’était que son état n’était pas brillant. Il baissa la tête, trop honteux pour continuer à se regarder en face.
Il se déshabilla, entra dans la cabine de douche où il laissa l’eau ruisseler sur lui, le temps nécessaire à se sentir mieux. Sans passer par la case rasage, il enfila un polo et son bermuda et descendit.
L’ayant entendu, Copain arriva en fouettant l’air de sa queue.
— Oui, oui… lui dit François en se dirigeant vers la table sur laquelle était posé le mot de Pierre.
Il prit la feuille et la lut :
« J’ai essayé de te réveiller, mais je n’ai pas pu. Je vais à la voile. Je rentrerai vers cinq heures. Pierre. »
Près du billet de son fils, un petit carton lui rappelant son rendez-vous aux Cormorans. L’heure était largement dépassée. Néanmoins, François décida de s’y rendre, ne fût-ce que pour s’excuser auprès de Clara. Il attrapa son maillot de bain et sa clef de voiture. Arrivé à la thalassothérapie, il se dirigea vers l’accueil où il s’excusa pour son retard.
— Vous avez de la chance, monsieur Paoli. Une de nos clientes vient de nous téléphoner pour annuler ses soins du jour. C’est Mathieu qui devait s’occuper d’elle. Je l’appelle.
— Merci.
Mathieu arriva dans la minute et emmena François pour son enveloppement d’algues, puis au massage sous affusion. Bien sûr, ses gestes n’avaient rien à voir avec ceux de Clara, mais François ne fit pas de remarque.
Ce n’est qu’à la fin du massage qu’il fit allusion à la jeune femme.
— Clara n’est pas venue aujourd’hui et on n’a pas eu de ses nouvelles.
Dix minutes plus tard, François sortit des Cormorans et se rendit à la première terrasse qu’il trouva. Par chance, il restait une table à l’ombre d’un parasol. Il s’installa et commanda un café serré.
Tandis qu’il le buvait, il se mit à penser. A Clara. A lui et à son comportement au souvenir d’Hélène.
Il fallait qu’il voie Clara, qu’il lui parle et s’excuse. Lui dire qu’elle l’attirait comme aucune autre femme ne l’avait fait depuis la mort d’Hélène.
Le café où il se trouvait n’était éloigné que de cent mètres des Cormorans. Quelqu’un du personnel devait probablement connaître Clara. Dans un bourg comme celui-ci, beaucoup de gens se connaissaient. Il héla la jeune fille qui l’avait servi :
— Mademoiselle !
— Oui ?
Il la laissa s’approcher de sa table.
— Vous êtes d’ici ?
— Oui, pourquoi ?
— Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez une jeune femme s’appelant Clara qui travaille aux Cormorans ? Cheveux châtains, courts, yeux bleus, de taille moyenne.
— A la thalasso ? Oui, je vois de qui vous parlez. Clara Morvan. Elle s’arrête de temps en temps ici pour boire un thé.
— Savez-vous où elle habite ?
— A Saint-Guénolé, mais je ne sais pas où exactement.
— Il faut que je le sache, c’est important.
— Attendez. Je vais voir si quelqu’un du bar le sait.
La serveuse disparut, revint quelques minutes plus tard.
— J’ai votre renseignement.
François sortit un bout de papier de son portefeuille et y nota l’adresse de Clara ainsi que quelques indications pour y parvenir. Puis il paya son café et s’en alla.