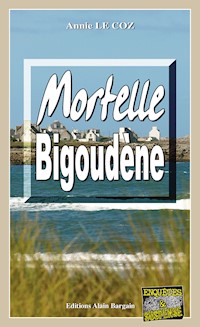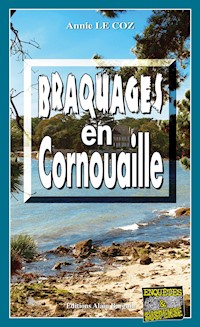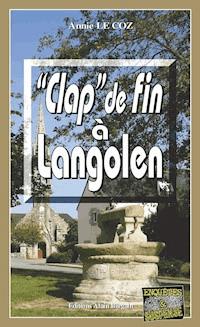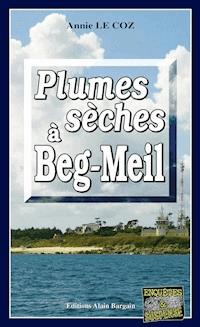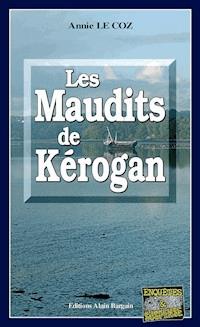
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Capitaine Paoli
- Sprache: Französisch
Un meurtre sordide et la découverte d'un jeune garçon perdu lancent le lieutenant Paoli dans une nouvelle enquête en pays Breton.
Un matin d’automne, le corps d’un homme, abattu d’une balle dans le dos, est découvert dans les bois de Plomelin. L’enquête, confiée au lieutenant Paoli, s’avère d’autant plus difficile que le malheureux a été édenté et énucléé. Huit jours plus tard, dans le même secteur , un livreurde journaux trouve un garçonnet blotti au pied d’un calvaire, sur la route des Châteaux. Il le conduit à l’hôpital où l’on constate qu’il a été abusé sexuellement. Qui est-il ? Pourquoi ne s’inquiète-t-on pas de son sort? Ayant su gagner la confiance du garçonnet, Paoli ne tarde pas à rapprocher les deux affaires. Mais quel lien les unit? Le lieutenant va devoir plonger dans les abysses de l’abjection humaine…
Plongez sans plus attendre dans le premier tome des enquêtes du lieutenant Paoli, suivez-le sur les traces de deux affaires qui semblent étroitement liées...
À PROPOS DE L'AUTEURE
Annie Le Coz est technicienne de laboratoire, diplômée de l'IUT en biologie médicale et auteure de la série policière
Capitaine François Paoli aux éditions Bargain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
David Marchand fit le plein de sa Golf au centre commercial de Kerdrézec. Tandis qu’il attendait son tour à la caisse, il se demandait comment soutenir son collègue et ami, François Paoli, dans l’épreuve qui le frappait.
Comme d’habitude, la circulation était dense en ce vendredi après-midi et il dut faire preuve d’attention pour se rendre chez celui-ci. Il repéra immédiatement sa 206 et ne put s’empêcher d’éprouver un relatif soulagement. Il se gara. Arrivé à l’étage, il tendit l’oreille, le silence régnait de l’autre côté de la porte. Il sonna et attendit. Au bout d’un laps de temps, elle s’ouvrit. François se tenait dans l’encadrement, il n’avait l’air nullement surpris par l’arrivée de son visiteur.
— Tu étais à la cuisine ? demanda-t-il pour rompre le silence.
Il se tourna vers lui et l’observa. Le regard brun du Corse était éteint, son attitude était celle d’un homme vidé de toute énergie, bras ballants au bout d’épaules voûtées.
— Je prendrais bien un café, tu nous en fais ? suggéra David.
Cela faisait une heure qu’ils étaient assis dans la cuisine. Peu de paroles étaient sorties de la bouche de François, mais David avait noté que son attitude avait changé. Même si sa voix n’avait pas encore retrouvé son ton habituel, il se tenait plus droit.
— Tu ne trouves pas qu’il fait sombre ?
David se leva et alluma. Puis il ouvrit successivement le frigo et le congélateur.
— Génial ! J’ai trouvé une pizza, ça te branche ?
— Va pour la pizza.
David la sortit de son emballage et l’enfourna. Quelques instants plus tard, une odeur appétissante se diffusait dans la pièce.
Après avoir achevé leur repas, ils sortirent sur le balcon. Un fin crachin que le vent d’ouest leur envoyait à la figure s’était mis à tomber.
— Ça sent l’automne, dit David. Les arbres ont déjà perdu pas mal de feuilles, les jours raccourcissent et voici que la pluie se met de la partie.
— Oui.
— Je vais devoir mettre mon bateau en cale sèche, il a besoin d’un coup de peinture.
— Quand penses-tu le faire ?
— Je n’y ai pas encore réfléchi, mais ça ne saurait tarder.
François tourna les talons et rentra au salon. Il se laissa tomber dans son fauteuil préféré et se pencha en avant, coudes sur les genoux, tête dans les mains. David referma la porte-fenêtre doucement, prit place sur le canapé et attrapa une vieille revue. Il se mit à la feuilleter, tout en levant, de temps en temps, un regard discret vers son ami.
Soudain il perçut un reniflement… Il mit ça sur le compte d’un coup de froid. Mais, bientôt, il vit François s’essuyer les yeux, puis se lever et ouvrir son bar.
— Ce n’est pas une bonne idée, commenta-t-il d’un ton neutre en lui prenant verre et bouteille des mains.
Il rangea les choses à leur place et referma le bar. L’espace d’un instant, il crut que François allait se fâcher, mais il se contenta de lui tourner le dos et quitta la pièce. Au grincement de la porte, David devina qu’il était parti dans sa chambre. Il laissa un moment passer, puis s’y rendit. Comme la porte était restée ouverte, il y vit une sorte d’invitation. Alors, il la franchit et s’assit sur le bord du lit.
— Ne m’en veux pas, dit-il en posant une main qu’il voulait réconfortante sur son épaule. Je n’ai pas envie de changer d’équipier, tu sais. Je sais ce que tu traverses, mais tu dois tenir le coup.
— Je ne m’imaginais pas à quel point ça pouvait faire mal !
Le jour se leva sur Quimper. Dans la nuit, le vent s’était renforcé et avait chassé les nuages vers l’intérieur du pays. Une odeur de café chatouilla les narines de François. Il repoussa le duvet qui le couvrait et s’étira, puis passa à la cuisine où David l’attendait.
— Salut, bien dormi ?
— On va dire oui, répondit-il en se versant un bol de café.
— On dirait qu’il va faire beau, tu as vu le ciel ? On pourrait faire une partie de pêche si ça te dit, puisque mon bateau est toujours à l’eau.
— Hum…
— A moins que tu proposes autre chose…
Le téléphone portable de David sonna dans la poche de sa veste. Il s’excusa et alla répondre.
— Oui ? Ah, bonjour Commissaire. Oui… non… Non, rien de spécial. Attendez un instant.
Il plaqua son portable contre sa poitrine et s’adressa à François :
— La partie de pêche me semble bien compromise, Grincheux nous rappelle pour le travail.
— Quel genre ?
— On a trouvé un corps dans les bois longeant l’Odet. Il veut qu’on aille sur place, à Plomelin.
II
François coupa le moteur et les deux hommes sortirent de voiture. Vincent Duval vint à leur rencontre.
— Venez, c’est par ici, dit-il en les conduisant au lieu de découverte du cadavre. D’après les premières constatations du légiste, le crime aurait eu lieu cette nuit, mais il est encore trop tôt pour en déterminer l’heure.
Ils franchirent le ruban de plastique délimitant le périmètre d’investigations et s’approchèrent du corps. Le spectacle était affreux. L’homme avait été énucléé et sa bouche était en sang. François quitta précipitamment le petit groupe et alla vomir contre un arbre. Quant à David, il était devenu tout pâle et faisait de gros efforts pour ne pas imiter son ami.
— On lui a arraché les dents, expliqua Duval.
— Quelle horreur ! fit-il d’une voix blanche.
— Plusieurs d’entre nous ont eu la même réaction que Paoli, moi y compris.
— Comment a-t-il été tué ?
— Une balle dans le dos. Les hommes recherchent la douille.
— J’en ai fini avec lui… déclara le photographe en replaçant le cache sur son objectif.
— Bien, merci.
François revint et s’agenouilla près du corps que le médecin légiste retournait. Une grande tache rouge maculait les vêtements du mort.
— La balle est allée droit au cœur, dit le légiste, il est mort sur le coup. Beau tir de précision.
— Vous voulez dire que le coup a été tiré à distance ? interrogea Duval.
— Il y a de fortes chances, Commissaire. L’analyse de ses vêtements nous en dira plus sur ce point.
— Bon, je vais dire aux hommes de chercher la douille en dehors du périmètre.
Il s’éloigna donner ses ordres, tandis que les lieutenants Paoli et Marchand examinaient le corps.
— Il ne va pas être facile à identifier, fit David.
— Oui, le meurtrier s’est donné beaucoup de mal. OK, toubib, tu peux lui emballer les mains, ajouta François.
— D’accord.
Il sortit des sacs plastique de petite taille de sa sacoche et en enveloppa les mains du mort, les attachant soigneusement. Puis il en sortit un plus grand et en fit de même avec la tête. Enfin, il fit signe à deux hommes de venir enlever le corps.
Les techniciens avaient quitté la scène du crime. Ne restaient sur place que Duval, Paoli et Marchand. A la limite des arbres situés dans l’axe de la position du corps, quelques hommes munis de détecteurs de métaux et de bâtons fouillaient le sol.
— Ils ne trouveront rien. Si le meurtrier a pris la précaution de mutiler sa victime, nul doute qu’il aura pris celle de ramasser sa douille, émit François.
— Je suppose que vous avez raison, Paoli. Mais, on ne sait jamais.
— Qui a trouvé le corps ? demanda David.
— La femme qui est dans la voiture, là-bas. Elle faisait son jogging avec son chien.
— Pouvons-nous lui parler ?
— J’en doute, elle est très choquée. Quand Police Secours a reçu son message, le standardiste a eu beaucoup de mal à comprendre ce qu’elle disait.
— Ouais, pas étonnant.
Ils arrivèrent à la voiture dont on refermait les portières.
— Où l’emmenez-vous ?
— Chez elle. Elle a besoin de se reposer.
— Oui, bien sûr.
— Tenez, je vous ai noté son nom et son adresse.
— Merci.
La voiture démarra, emportant la femme qui serrait son chien contre elle.
— Bien, Messieurs, je ne vois pas l’intérêt de nous attarder plus longtemps ici. Il ne nous reste plus qu’à attendre les résultats de l’autopsie.
*
Dans l’après-midi, les lieutenants Paoli et Marchand rendirent visite au médecin légiste. Dès qu’il fut averti de leur présence, Séverin Leclerc sortit de sa salle d’autopsie.
— Je ne vous attendais pas de si tôt, je n’ai eu le temps de faire que l’examen externe.
— Pas grave, Sev, ça peut déjà nous donner une idée. Alors, que peux-tu nous dire ?
— Pour l’instant, vous vous en doutez, c’est un peu mince. Il s’agit d’un homme dont je situerais l’âge entre cinquante et cinquante-cinq ans. Taille : 1,80 mètre. Poids : 84 kg. Il chausse du 43 ou, plutôt, il chaussait… Il avait des chaussures de ville aux pieds, pas neuves, mais bien entretenues. J’ai oublié leur marque, mais je vous donnerai ça plus tard.
— D’accord. Les cheveux, teints ou pas ?
— Non, couleur naturelle, poivre et sel.
— Rien d’extraordinaire si on se fie à la tranche d’âge que tu viens de nous donner.
— En effet. Je peux également vous dire que ce n’est pas un manuel, ses mains sont soignées. Pas d’alliance au doigt, pas de montre au poignet. Et pour finir, quand Georges m’a aidé à le dénuder et qu’il a fait l’inventaire des fringues de votre type, il m’a fait remarquer qu’il était habillé avec des vêtements de marque.
— Ça ne signifie pas grand-chose… fit remarquer Paoli. Beaucoup de gens en portent.
— Tu as la liste des fringues ?
— Un moment…
Séverin farfouilla dans les divers papiers étalés sur son bureau pour s’apercevoir que la feuille était devant lui.
Son petit manège avait fait sourire François.
— Tu ne changeras jamais, Sev !
— On ne se refait pas, mon vieux. Tenez, la voici. Bien, si vous n’y voyez rien à redire, je vais retourner à côté et essayer de le faire parler. Ça va pas être de la tarte, vu qu’il lui manque toutes ses dents.
— Toutes ?
— Comme je vous le dis ! A tout hasard, j’ai relevé ses empreintes digitales.
— S’il n’a pas de casier, on ne sera pas plus avancé.
— J’y pense, dit François, pourquoi l’a-t-on trouvé énucléé, à ton avis ?
— On peut donner plusieurs réponses à ta question. Une de celles qui peuvent venir à l’esprit serait la signature d’un tueur en série, s’il y avait eu des précédents, mais votre mort est le premier exemple de ce genre sur notre secteur.
— Quoi d’autre ?
— On peut aussi envisager la disparition de ses globes oculaires dans l’estomac d’un animal quelconque.
— C’est dégoûtant !
— Bon, les mecs, si vous voulez mon rapport, va falloir que je m’y remette. Enfin, si vous voulez que je vous dise, tout ça a été fait pour qu’on ne l’identifie pas.
— Oui, ben, ça, figure-toi qu’on y avait déjà songé ! Allez, ciao, Séverin, à plus !
Les deux inspecteurs étaient assis dans la voiture de François et détaillaient la liste des vêtements du mort.
— Tu te rends compte, dit David, on n’a que des fringues pour démarrer notre enquête…
— Oui, mais des fringues de marque. Ce sera plus facile que s’il avait porté des vêtements de grande surface.
— Donc, si je comprends bien, on va devoir faire toutes les boutiques de la ville ?
— Tu vois un autre moyen ? Allez, en route !
François éteignit le moteur et les deux hommes sortirent de voiture.
— Par où commençons-nous ? interrogea David.
— Il y a une boutique à cent mètres, par là, répondit François en désignant la direction du menton.
Ils se rendirent à “Classique Masculin” et regardèrent la vitrine avant de pousser la porte. Dès qu’ils furent dans la boutique, ils furent enveloppés par une atmosphère feutrée et discrètement parfumée à la fougère.
— T’as vu les prix ? Faut vraiment payer ça pour être bien habillé ?
— Bonjour Messieurs. Puis-je vous aider ?
— Nous l’espérons.
François et David exhibèrent leur carte professionnelle.
— La police ?
— Oui. Nous voudrions savoir si vous êtes dépositaire de la marque Lanvin.
— Dans quel genre d’article ?
David baissa les yeux vers la liste et répondit :
— Les chemises.
— Ah ! Les chemises… oui… c’est par ici, dit-il en les entraînant vers le mur de gauche. Nous n’avons pas encore tout rentré, mais…
— Nous recherchons une chemise Lanvin, bleu nuit, à fines rayures blanches, coupa David.
Le vendeur leva les yeux vers les casiers réservés à la marque et secoua la tête.
— Désolé, nous n’avons pas cela.
— Et les pantalons Ralph Lauren ?
— Le patron vient d’avoir la licence. On doit en avoir quelques-uns… sur ce portant, là… Quelle couleur ?
— Beige.
— Nous n’avons pas de beige, voyez vous-mêmes.
— Bien. Et dans les vestes, que faites-vous comme marques ?
— Nous faisons essentiellement les costumes, deux ou trois pièces. Les seules vestes que nous vendons à part sont des Ted Lapidus.
— Non, ce n’est pas ça.
— Eh bien, merci de votre aide, Monsieur. Au revoir.
Après “Classique Masculin”, ils poussèrent la porte de “Collections” où les vendeurs s’affairaient autour de deux clients. François et David en profitèrent pour regarder autour d’eux.
— Voilà, je suis à vous, dit l’un des vendeurs après avoir raccompagné son client.
— Avez-vous des pantalons Ralph Lauren beiges ?
— Ah, nous y voici ! Ralph Lauren. Pantalons beiges… nous y sommes. Nous avons vendu trois 46, deux à des clients fidèles, le troisième à un nouveau client qui a bien voulu que nous l’inscrivions dans notre fichier.
— Dans quelle tranche d’âge se situent ces messieurs ?
— Je ne peux pas vous répondre, nous ne demandons pas ce genre de renseignement à nos clients.
— Donnez-nous leurs noms, s’il vous plaît, par écrit. Le vendeur s’exécuta et tendit la feuille à David qui demanda :
— Faites-vous les marques Lanvin et Cardin ?
— Non, nous n’aurions pas la clientèle, mais je sais que “L’Homme Chic” les fait.
— Eh bien, ce sera tout, Monsieur, merci.
La porte de “Collections” se referma derrière eux et, après un dernier coup d’œil à la vitrine, les deux inspecteurs traversèrent la place de la cathédrale et descendirent la rue Kéréon, très animée en ce samedi après-midi.
— C’est pas mal, on a déjà trois noms, dit David.
— Ne te réjouis pas trop vite. Rien ne nous dit que notre homme fait partie de ceux-là. Et si on se prenait un verre avant d’aller à “L’Homme Chic” ? J’ai une de ces soifs !
Ils bifurquèrent sur la gauche, rue de la Halle, et se rendirent au bar qui faisait l’angle.
La vitrine de “L’Homme Chic” était arrangée avec goût. Les mannequins, vêtus des marques proposées par la boutique, étaient mis en scène dans un décor automnal qu’ils apprécièrent avant de franchir le seuil. David aperçut un vendeur et fondit sur lui avant qu’il ne soit accaparé par l’un des clients potentiels. Les présentations effectuées, il s’avéra que l’homme en question était le propriétaire du magasin, et il entraîna les deux inspecteurs dans son bureau.
— Voilà, Monsieur, nous aimerions savoir si vous avez vendu un ou plusieurs de ces vêtements ces derniers mois et, si oui, à qui.
David énuméra la liste des vêtements. L’homme hocha la tête à chaque pièce vestimentaire citée, se tapota le menton avec l’index droit, puis répondit :
— Il va falloir que je fouille dans mes registres. Je ne peux pas vous répondre, comme ça, de but en blanc.
— Faites donc, nous sommes là pour ça…
— C’est-à-dire que c’est samedi et que j’ai pas mal de monde dans la boutique. Si vous pouviez revenir un autre jour, ça m’arrangerait…
— Vos clients peuvent bien patienter un peu en fouinant…
— Oui… bien sûr… Alors, vous m’avez dit ?
En sortant de “L’Homme Chic”, la liste des acheteurs s’était allongée.
— Et voilà, de trois, on est passé à dix ! Si on continue à faire les boutiques de Quimper, on aura bientôt de quoi remplir un annuaire. Et rien ne nous dit que le mort a acheté toutes ses fringues ici, il a très bien pu les acheter ailleurs.
— Et où serait-il allé ?
— Concarneau… Pont-L’Abbé… Paris ! Je ne sais pas, moi.
— Tss, tss, fais confiance à mon flair.
— Ouais, ben, il est pas toujours infaillible, ton flair !
— Non, je sais, mais il faut bien que nous concentrions nos recherches sur quelque chose. Si nous commençons à nous disperser…
— OK, OK, on suit ton flair.
Les lieutenants Paoli et Marchand se laissèrent tomber sur une des banquettes du Café de L’Épée.
— Tous ces magasins, un samedi après-midi… je suis mort ! fit David.
Il leva la main droite pour appeler un serveur. Celui-ci arriva, donna un vague coup de torchon humide sur le bois verni de la table et demanda :
— Qu’est-ce que je vous sers ?
— Un demi, répondit David.
— Whisky, dit François sans lever le nez de ses notes.
Il sortit un stylo de sa poche intérieure, pointa la mine ici et là, et, finalement, encercla un nom.
— Tu disais que tu étais mort ? Eh bien, tu ne vas pas tarder à ressusciter, mon vieux. Regarde… un certain Gilbert Leduc est le seul homme à avoir acheté les trois pièces qui correspondent parfaitement à notre liste.
— Tu déconnes !
— Tu crois vraiment que j’ai envie de déconner un samedi soir à 19 heures ?
— Soit. Donc, on a donc identifié notre cadavre.
— Identifié, identifié… c’est vite dit. J’affirme seulement que ce monsieur Leduc a acheté ces vêtements.
François avala une longue gorgée de whisky puis il sortit son portable et appela le commissariat… La communication fut brève.
— Personne n’a déclaré de disparition. Pas plus d’un Leduc que d’un Ducon.
— Rien de surprenant, ça ne fait même pas vingt-quatre heures qu’il est froid, lui fit remarquer David. Et, à supposer qu’il ne soit pas de la région, ça risque même de tarder, sauf s’il avait une femme.
— Séverin nous a dit qu’il ne portait aucun bijou, ni alliance, ni montre. Un mec qui portait des fringues pareilles devait certainement porter une montre.
— Et tu nous aurais fait faire le tour des bijoutiers aussi ?
— A ton avis ?
Ils avaient dîné dans un des restaurants chinois de la gare et quittèrent le Shanghai en même temps qu’un groupe d’étudiants.
— On va boire un coup ?
— Je crois que ça suffit, François.
— Allez, juste une bière, quoi !
— Non, ni une bière, ni autre chose. On rentre.
— Je n’ai presque rien bu, affirma-t-il.
— Non, un rêve ! Allez, sois raisonnable et donne-moi ta clef de voiture, je vais conduire.
— Je suis capable de le faire.
— Certainement, mais encore plus de te payer le premier poteau venu. Ta clef !
Et sans attendre la réponse négative à laquelle il s’attendait, il l’arracha de la main de François.
*
David poussa la porte de l’appartement et conduisit François à sa chambre. Celui-ci chut sur son lit, bras en croix en prononçant un prénom :
— Hélène…
— Dors, répondit David en refermant la porte.
Il sortit un moment sur le balcon et son regard se perdit dans la nuit. Il se remémora le jour tragique où Hélène avait reçu une balle pendant le tir nourri effectué par les braqueurs de la banque. Elle s’était écroulée aux pieds du lieutenant Paoli. Sans un cri, sans un mot, juste un soupir et un dernier regard, déjà au bord du vide, pour l’homme qu’elle aimait et qui l’aimait. Immédiatement, François était tombé à genoux près d’elle, l’avait serrée contre lui, avait caressé son visage et ses cheveux, puis, il s’était élancé vers la banque, au mépris du danger, en hurlant. Le commissaire Duval avait alors donné l’ordre de tirer à volonté et la police avait fini par maîtriser la situation. Les cinq braqueurs avaient été abattus, et on comptait trois blessés dans la banque. Du côté de la police, hormis la perte d’Hélène Fournier, un blessé à la jambe et un homme fou de douleur : François Paoli.
Les secours avaient administré les premiers soins sur place avant d’évacuer les blessés. Mais, quand le moment fut venu d’emporter le corps d’Hélène, on eut toutes les peines du monde à en détacher François. Plusieurs hommes s’y employèrent avant qu’un médecin ne lui fasse une injection de calmant.
— Trois mois déjà… se dit David. Mais seulement trois mois…
III
Le lieutenant Marchand se leva du canapé de son ami avec quelques courbatures dans le dos et un bras ankylosé.
Il fit quelques étirements, puis alla pousser la porte de la chambre.
— François, il est dix heures et demie, dit-il après un coup d’œil à sa montre.
— David ? Qu’est-ce que tu fais là ? interrogea ce dernier, la tête sous l’oreiller.
— Tu ne te souviens plus ?
— De quoi ?
David lui fit une grimace qu’il accompagna d’un mouvement sinueux de la main.
— J’étais bourré ?
— Et pas que de bonnes intentions ! répliqua David en hochant lentement la tête. Puis il effectua un quart de tour et attrapa la cafetière pleine. Le liquide noir et fumant emplit les deux bols d’où son arôme s’éleva.
— Il serait temps que tu réagisses autrement qu’en t’enivrant, François. Figure-toi que je n’ai pas envie de te ramener tous les soirs dans ton lit pour que tu puisses décuiter, tu piges ?
— Je ne t’ai pas demandé de le faire, si ?
— Non.
Un silence tomba entre eux, rompu par le seul bruit de leurs déglutitions.
— Tu te sens capable de faire quelques longueurs de piscine ? interrogea David après avoir vidé son bol.
— Personne ne t’a entraîné pendant mon absence ? David sourit, c’était la réaction qu’il espérait.
*
Ils plongèrent d’un même élan dans le grand bassin et enchaînèrent les longueurs d’un crawl régulier. Malgré son état de la veille, François s’en tira bien et ne rendit qu’une longueur à David.
Ils sortirent de l’eau, passèrent aux douches, puis se rhabillèrent. Ils se retrouvèrent à la porte de la piscine. Il était déjà deux heures de l’après-midi.
— On se fait un Mac Do ? C’est pas top diététique, mais ça fait un bail que je n’ai pas mangé de hamburger.
— D’accord, allons-y !
Après le hamburger du Mac Do, ils hésitèrent entre une séance de ciné et une balade. Ce fut la balade qui l’emporta au pile ou face.
— Où veux-tu aller ? questionna David en quittant le parking.
— Dans les bois.
— Où ça ?
— Là où on a trouvé le mort.
— Tu sais qu’on est censé être en repos aujourd’hui ?
— Oui, pourquoi ?
— Alors, que veux-tu aller faire dans les bois, et, plus exactement à cet endroit-là ?
— Je veux visiter. Ce n’est pas interdit, si ?
— Visiter ? fit David surpris par la réponse.
— Je veux me rendre compte de certaines choses sur place.
— Et ça ne peut pas attendre demain ?
— Je peux y aller tout seul, si tu préfères.
— Non, je t’accompagne. Je me demande pourquoi c’est toujours le côté pile de la pièce qui gagne. Tu es sûr qu’il y avait un côté face ?
— C’est toi qui as sorti la pièce de ta poche.
*
Marchand stationna sa Golf sur le bas-côté de la petite route qui longeait le bois.
— Tu n’aurais pas une carte, par hasard ?
— J’ai bien une Michelin, mais pas d’IGN, répondit David après avoir fouillé sa boîte à gants.
— Dommage. Nous allons être obligés d’arpenter le secteur dans tous les sens et de faire un plan des lieux, avec les chemins et les habitations.
— Toi, tu as une idée derrière la tête… je me trompe ?
— Non, tu ne te trompes pas.
— Et, puis-je savoir laquelle ?
François commença à s’éloigner en regardant autour de lui.
Après avoir plié la carte de façon à obtenir le carré susceptible de les intéresser, David dut prendre le pas de gymnastique pour le rattraper.
— Voilà. Nous sommes ici.
— Approximativement… car ta carte n’est qu’au 1/200 000e.
— Oui, dut reconnaître David.
Ils avancèrent vers le ruban de plastique qui délimitait le périmètre où le corps avait été découvert. Un policier en tenue gardait la place. Quand il vit François soulever le ruban pour passer en dessous, il s’y opposa :
— C’est interdit, Monsieur.
— Lieutenant Paoli, se présenta-t-il en sortant sa carte.
Le garde scruta la carte, puis son propriétaire.
— Excusez-moi, Lieutenant. Je suis arrivé depuis une semaine, et…
— C’est bon, coupa François en franchissant la limite. Dites, depuis quand êtes-vous ici ?
— Ce matin, huit heures.
— Et à part nous, vous n’avez vu personne ?
— Juste un homme qui faisait du VTT, mais il est passé là-bas.
— Vous êtes seul ? intervint David.
— Non. Mon collègue est parti là-bas pour se soulager. D’ailleurs, le voici qui revient.
— Un problème, Martial ? Oh, pardon ! fit-il en reconnaissant ses supérieurs et en les saluant.
— Il n’y a pas de mal. Et vous, hormis le vététiste, vous avez vu quelqu’un passer ici ?
— Non, Lieutenant.
— Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu par ici, mais, si j’ai bonne mémoire, il y a bien une allée cavalière par-là, non ?
— Oui, dans cette direction, Lieutenant. Et, dans celle-ci, un sentier de randonnée rattrape la rivière après un bon kilomètre de marche et quelques mètres de dénivelé.
— Et par là, qu’y a-t-il ? interrogea François en tendant le bras dans une troisième direction.
— C’est le Manoir de Kérogan.
— Habité ?
— Il me semble, oui, répondit le plus âgé des policiers.
— En tout cas, intervint Martial, il l’est actuellement. Je suis passé devant, il y a deux jours, et il y avait des voitures dehors et de la lumière à l’intérieur.
— A quelle distance sommes-nous du manoir ?
— Je dirais un kilomètre environ. A travers bois. Parce que si vous prenez les chemins, ça vous rallonge le trajet.
— D’accord. Et par là ?
— C’est une ferme.
— Exploitée ?
— Oui, j’ai vu un troupeau de vaches dans un champ au-delà du bois.
Le lieutenant Paoli avait noté toutes les réponses des deux policiers en faisant un croquis sommaire.
— Bon, fit-il en ramassant son carnet à spirale et son stylo. Puisque vous semblez connaître le coin, savez-vous si la maison d’une certaine Catherine Jaunet se situe dans les parages ?
— Catherine Jaunet, vous dites ? Ce nom ne me dit rien, Lieutenant.
— Moi non plus, ça ne me dit rien. Cependant, j’ai remarqué une longère rénovée près de la route qui mène au manoir.
— L’adresse qu’elle a donnée est : Croisement du Chêne, précisa David.
— Alors, oui, c’est bien ça, mais le chêne n’existe plus depuis l’ouragan de 1987.
— Bien, merci Messieurs.
Les deux policiers saluèrent David et François. Ils prirent place à bord de la Golf.
— Et maintenant ?
— Allons donc rendre visite à cette femme qui a découvert le mort.
— Enfin, François, c’est dimanche !
— Et alors ?
— Tu pourrais respecter le repos dominical des gens, à défaut de respecter le nôtre.
— Va au Croisement du Chêne et ne discute pas !
— Bon, bon, on y va… fit David en levant yeux et épaules.
Il fit faire demi-tour à la voiture. Celle-ci mordit la berme dans un envol de feuilles mortes. La route séparait le bois, à sa droite, des pâturages, à sa gauche. Quelques habitations d’un hameau nouvellement construit pointaient leurs toits d’ardoises au fond des champs.
— Encore une banlieue-dortoir de Quimper, commenta David. Je n’aimerais pas habiter là !
— Personne ne te le demande.
— C’est ici, le Croisement du Chêne. Et voici la longère rénovée.
Il s’arrêta sur le bord de la route. Tous deux examinèrent la façade réhabilitée du bâtiment. De la fumée s’élevait d’une cheminée et une lampe était allumée derrière l’une des fenêtres. A peine, eurent-ils mis le pied hors de la voiture, qu’un berger allemand vint aboyer au portillon du jardin.
— Pas très engageant.
— Sûrement bon gardien, répliqua François en pressant le bouton de sonnette.
Ils durent attendre cinq minutes avant qu’un homme ouvre la porte et leur demande du perron :
— Oui, que voulez-vous ?
— Bonjour ! Nous aimerions parler à madame Catherine Jaunet, c’est bien ici qu’elle habite ?
— Oui.
— Est-elle là, s’il vous plaît ?
— C’est de la part de qui ? demanda l’homme en approchant.
Pendant le dialogue, le chien avait cessé ses aboiements pour les remplacer par un grondement sourd et continu.
— Couché, Scorpio ! commanda l’homme.
Il observa les cartes que lui présentaient les lieutenants Paoli et Marchand.
— Ah, la police ! Un dimanche ! Va à la niche, ordonna-t-il au chien, puis il ouvrit le portillon. Je vais voir si Catherine peut vous recevoir.
— Merci monsieur Jaunet.
— Joli, Claude Joli, rectifia-t-il sèchement. Catherine et moi vivons sous le même toit, mais…
— Qu’est-ce que c’est ? demanda une voix féminine à l’étage.
— De la visite pour toi.
— Je viens.
En attendant l’arrivée de Catherine Jaunet, les deux inspecteurs regardèrent autour d’eux. Visiblement, les travaux d’aménagement n’étaient pas finis car les occupants de la longère vivaient entre échafaudages et pots de peinture. Il restait aussi quelques cartons. De l’un d’eux émergeaient des trophées et des coupes.
— Je vous en prie, leur dit Claude Joli en leur désignant une banquette. Voulez-vous un café ?
Paoli et Marchand acquiescèrent, et Joli partit à l’autre bout de la pièce. Des talons de mules claquèrent sur les marches de l’escalier et une jeune femme d’une trentaine d’années fit son apparition.
Enveloppée dans un peignoir, le teint pâle, à peine coiffée, elle s’avança vers les visiteurs qui s’étaient levés pour la saluer.
— Asseyez-vous, Messieurs. Je crois vous reconnaître, vous êtes de la police, n’est-ce pas ?
— C’est exact, répondit David.
Elle s’installa dans un fauteuil et croisa la jambe gauche par-dessus la droite. Le pan de son peignoir glissa et dévoila une partie de sa cuisse nue.
— Vous êtes venus m’interroger ? demanda-t-elle en se penchant vers la table du salon pour attraper un paquet de cigarettes.
Cette fois, le peignoir bâilla et offrit une vue plongeante sur sa gorge.
— Notre visite n’est pas officielle, mais nous aimerions bien bavarder un peu avec vous, si vous le permettez, dit David en lui proposant du feu.
— Merci, fit-elle en soufflant sa fumée vers le plafond.
Claude Joli revint avec cafetière, tasses et sucrier.
— Tu aurais pu t’habiller, fit-il remarquer à sa compagne en posant le tout sur la table basse. Tu es à peine décente…
— Là, ça te va ? demanda-t-elle en arrangeant un peu son peignoir.
Il haussa les épaules, puis fit le service.
— Bien, de quoi voulez-vous discuter ?
— Depuis combien de temps vivez-vous ici ?
— Ça va faire six mois. Nous avons acheté cette longère, il y a un an, elle était en mauvais état. Et, comme vous pouvez le constater, les travaux ne sont pas encore finis. Pour l’extérieur, nous avons fait appel à deux artisans maçons.
— Et l’intérieur, c’est vous qui le faites ?
— Oui, les week-ends et jours de repos, si nous sommes décidés.
— Quelle profession exercez-vous, Madame ?
— Je suis secrétaire dans un cabinet comptable.
— Très souvent assise derrière un bureau, alors. C’est pour cela que vous faites du jogging ?
— Oui, il faut bien s’entretenir un peu.
— Ce n’était pas le berger allemand qui était avec vous, hier matin… N’était-ce pas un setter ?
— Si, Saxo. Il a besoin de se dépenser…
— Où est-il ? Nous ne l’avons pas vu…
— Au chenil, derrière la maison.
— Si mes connaissances en matière canine sont bonnes, le setter est un chien destiné à la chasse…
— C’est exact, Lieutenant, intervint Joli, mais quand je ne chasse pas, c’est Catherine qui lui fait faire de l’exercice en l’emmenant avec elle faire son jogging.
— Vous suivez toujours le même parcours, Madame ?
— Non, je change selon mon humeur.
— Dites-nous comment le chien a trouvé l’homme.
— Saxo m’a distancée dans le bois. Je l’ai rejoint à la clairière où il m’attendait. Quand il m’a vue, il est reparti en trottinant. Au bout de quelques mètres, je l’ai vu marquer l’arrêt, puis il a filé jusqu’à l’endroit où était le… le mort.
— Comment avez-vous su qu’il était mort ?
— Il… il avait une tache rouge sur sa veste, et… et aussi sous sa tête.
— Avez-vous touché à sa tête ?
— Oh, non ! Je n’ai touché à rien. J’ai sorti mon portable et j’ai contacté la police.
A l’évocation de sa découverte, Catherine Jaunet avait blêmi. Elle se leva et se dirigea vers un guéridon sur lequel étaient posés plusieurs bouteilles d’alcool et quelques verres. Elle se versa un cognac qu’elle but d’un trait.
— Elle est encore sous le choc, expliqua son compagnon, malgré le regard réprobateur qu’il avait eu en la voyant faire.
— C’est compréhensible. Encore une petite question.
— Oui ?
— Qu’avez-vous fait en attendant l’arrivée de la police ?
— Mais… rien… Il n’y avait plus rien à faire.
— Vous n’avez pas prévenu monsieur Joli ?
— J’étais absent. Je ne suis rentré qu’hier après-midi.
— Quelle profession exercez-vous ?
— Je suis technico-commercial.
— Bien, nous allons vous laisser. Merci pour le café. Nous nous reverrons certainement.
David se leva, imité par François qui n’avait pas ouvert la bouche une seule fois de tout l’entretien.
— Je vous raccompagne, dit Claude Joli.
*
— Tu n’as pas été très bavard, dis-moi… émit le lieutenant Marchand en rétrogradant derrière une voiturette sans permis. Je pensais que tu aurais participé un peu plus.
Son passager avait la tempe appuyée contre la vitre et le regard perdu sur le bas-côté de la route.
— Comment ?
— Je dérange tes pensées ?
— Hum…
David coula un regard vers François. Pas de doute, il avait l’esprit ailleurs.
La Golf s’arrêta devant la maison du lieutenant Marchand… Il descendit de voiture, en fit le tour et, à la manière d’un chauffeur de maître, il ouvrit la portière de François et l’invita à sortir.
— Monsieur est arrivé.
— Qu’est-ce qu’on fait devant chez toi ?
— Je n’ai pas envie de dormir une autre nuit dans ton canapé, répondit-il en tournant la clef dans la porte.
— Ah !
— Allez, entre.
David ôta sa veste et la suspendit au mur, puis alluma la lumière du salon et y poussa son ami.
— Tu as vu ? J’ai refait la déco.
— Oui…
— Assieds-toi, voyons, ne reste pas planté comme ça !
— Oui…
Mais il ne bougea pas, mains dans les poches de sa veste, regard perdu à travers l’une des baies vitrées.
— Qu’y a-t-il, François ?
— Rien…
— Ça, ça m’étonnerait ! Quand tu n’as rien, tu es de meilleure compagnie que ça.
David sortit deux bières de son frigo, les décapsula et en tendit une à François qui prit enfin place sur un bout du canapé. Lui-même s’installa dans un fauteuil club et étendit les jambes. Il avala une gorgée de bière au goulot.
— Un peu fraîche, tu ne trouves pas ?
— Si.
— Dans ce cas, que dirais-tu d’une partie de billard ? On apprécierait mieux nos bières, argua-t-il en se levant.
Il appuya sur un interrupteur. La lumière tomba d’une suspension en laiton portant deux globes verts, et éclaira la table couverte de feutrine verte.
Il prit ensuite deux queues au râtelier et revint au billard.
François n’avait pas bougé.
— Tu veux commencer ? demanda-t-il en sortant les boules. François ?
Comme il n’obtenait pas de réponse, David alla jusqu’au canapé.
— Écoute, mon vieux…
— Ça suffit ! s’écria François en se levant brusquement et en le repoussant. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ? Éric et toi, vous ne me lâchez pas les baskets ! Mais, je n’ai rien demandé à personne, moi, figure-toi ! Alors, une fois pour toutes, fiche-moi la paix !
Décontenancé par cette subite réaction, David vit François se diriger vers la porte.
— Où vas-tu ?
— Je rentre à Quimper.
— Chez toi, j’espère, monologua David.
Car François avait déjà claqué la porte derrière lui.
*
Le taxi qu’il avait appelé de son portable le déposa au pied de son immeuble. Il régla la course, traversa le hall d’un pas incertain et appuya sur le bouton de l’ascenseur. Au bout d’une minute, celui-ci arriva et la porte s’ouvrit sur sa voisine, Marine Roussel.
— Bonsoir François. Tu m’attends ? Je vais juste jeter mes journaux…
— OK.
Elle revint peu après.
— Merci. Alors, comment ça va, depuis le temps ? fit-elle en appuyant sur le bouton de leur étage commun.
— On fait… on fait aller, répondit-il dans un souffle.
— Dis plutôt que ça ne va pas…
La porte de l’ascenseur coulissa, ils étaient arrivés. Sans lui en demander la permission, Marine lui prit la main et le conduisit chez elle.
— Allez, entre un moment.
— Je… je ne veux pas te déranger.
— Ce n’est pas le cas.
— Et… et puis… je… je ne serai peut-être pas… d’une compagnie très agréable.
— Ne fais donc pas de manières ! Tu as bu un coup, c’est que tu as tes raisons. Et alors ?
Elle ouvrit la porte de son F2 et poussa François à l’intérieur. Une odeur de fromage chaud planait dans l’air.
— J’ai mis des lasagnes au four pour ma sœur Katia et moi, mais elle m’a appelée pour me dire qu’elle ne viendrait pas avant demain. Tu aimes ça, les lasagnes ? Tiens, assieds-toi !
Marine lui présenta une chaise sur laquelle il se laissa tomber, puis s’employa à mettre le couvert. Le visage posé dans sa paume gauche, il la regarda faire en silence. Depuis qu’ils se connaissaient, c’est-à-dire depuis qu’elle lui avait demandé de l’aide lors de son emménagement, un an plus tôt, ils avaient toujours entretenu des relations cordiales, jamais équivoques.
Elle sortit le plat du four et servit une part de lasagnes à François.
— Merci.
— Tu ne devineras jamais ce que j’ai fait aujourd’hui, dit-elle. Je me suis baignée !
— A la mer ?
— Évidemment !
Et, tout en mangeant, une bouteille d’eau minérale gazeuse pour boisson, elle se mit à raconter son dimanche après-midi à François. Dire qu’il était heureux à ce moment-là serait exagéré, mais Marine eut le mérite de réussir à le faire sourire.
— Un café ?
— Si tu veux.
— Tiens, sois gentil, et prends les tasses là-haut. Tu peux les apporter au salon ?
Leurs tasses furent bientôt vides.
— Tu en veux un autre ? T’inquiète pas pour ton sommeil, c’est du déca.
— Ce n’est pas pour mon sommeil que je m’en fais, mais je suis en train d’empiéter sur le tien.
— Ne t’en fais pas, je ne commence qu’à dix heures demain matin.
Il y eut un moment de silence que François rompit après avoir avalé son second café :
— Merci Marine.
— Merci pour quoi ? Pour les lasagnes et la Badoit ou le déca ? Tu plaisantes, j’espère ! rit-elle.
Mais elle vit son air grave.
— Tu n’as pas à me remercier.
— Si, pour ne pas m’avoir posé de question, ni fait de remarque ou de reproche.
— C’est donc que David en a fait… dit-elle à mi-voix en caressant les cheveux de François.
Réalisant la portée de son geste, elle était sur le point de s’excuser, quand il demanda :
— Tu veux bien que je pose la tête sur ton épaule ? Comme un grand frère…
— Un grand frère perdu, n’est-ce pas ?
Il s’inclina sur l’épaule de Marine.
— Selon toi, François, qu’est-ce qu’une petite sœur serait censée faire pour son grand frère en ce moment ? Parler ou se taire ?
— Je ne sais pas.
Marine opta pour le silence. Elle le conserva jusqu’à ce qu’elle entende un reniflement.
— Ça passera, François, il faut juste laisser le temps au temps.
Il redressa la tête, s’essuya les yeux et inspira profondément pour se reprendre.
— Je vais te laisser.
Au moment de sortir, il se tourna vers elle et se pencha pour l’embrasser sur la joue.
— Merci encore.
IV
Paoli sortit de sa 206 CC et la verrouilla. Il traversa la cour et pénétra dans le commissariat. Le personnel prenait ses fonctions, selon le rituel du lundi matin, c’est-à-dire sans hâte.
— Bonjour Marie.
— Bonjour François, répondit la réceptionniste-standardiste. Si tu veux voir la main courante, elle est sur le bureau du commissaire Duval.
— Grincheux est déjà là ?
— Depuis cinq minutes.
Il s’éloigna du bureau d’accueil et gravit les marches qui menaient à son bureau. Il avait à peine mis le pied à l’étage que la voix de son supérieur s’éleva :
— C’est vous, Paoli ?
— Oui.
— Séverin Leclerc m’a dit que vous étiez déjà passé le voir.
— Oui. J’ai pensé que, comme vous nous aviez appelés, l’affaire nous revenait. Ai-je mal compris ?
— Pas du tout, c’est effectivement Marchand et vous qui allez vous en occuper. Dès qu’il sera là, vous pourrez vous y mettre. Mais je tiens à vous dire une chose, Paoli, et je ne me répéterai pas… Quel que soit votre humeur ou votre moral, tâchez de ne pas boire sur votre temps de travail. Et quand je dis boire, je suppose que vous me comprenez…
François Paoli hocha la tête et sortit pour s’installer à son bureau. À son arrivée, David Marchand fit un arrêt devant la porte ouverte de son collègue.
— Tiens, tu es là ? Je ne t’avais pas entendu arriver, remarqua François.
— C’est sûrement à cause de mes nouvelles chaussures extra-souples. Que proposes-tu ?
— Qu’on s’occupe de Gilbert Leduc, pardi !
— D’accord, ça me va. Et par où commençons-nous ? Le téléphone intérieur sonna, privant Marchand de la réponse de Paoli qui répondit. La conversation fut de courte durée.
— C’était Séverin.
*
Les lieutenants Paoli et Marchand étaient debout près de la table d’autopsie sur laquelle reposait le corps non identifié du mort des bois. Séverin Leclerc avait couvert sa face d’un linge, le spectacle de deux orbites vides et d’un sourire édenté étant insupportable.
— Votre bonhomme a parlé, et pas qu’un peu ! jubila le jeune légiste.
— Vas-y, Sev, raconte ! Qu’est-ce que tu attends ?
— Par quoi voulez-vous que je commence ?
— Par ce que tu veux.
— Bon. Eh bien, commençons par ce qui est caché. Ses dents ont été arrachées après sa mort, proprement. Vous allez me dire qu’au moins il n’a pas souffert, je suis d’accord.
— Qu’entends-tu par travail propre ?
— Pas de lésion des joues.
— Donc, un travail de pro… un dentiste ?
— Probable. Mais celui qui a fait ça, n’a pas eu besoin de tout arracher. J’ai fait des radios des mâchoires et, d’après les clichés, il ne restait pas plus d’une quinzaine de ses dents d’origine à notre client, sans parler de ses dents de sagesse qu’il n’avait plus depuis longtemps.
— Eh bien, si on doit interroger tous les dentistes de Quimper et de la région, on n’a pas fini ! fit David.
— Et pourtant, on n’aura sans doute pas le choix, lui répliqua François. Pour les yeux, tu ne peux rien nous dire ?
— Non, impossible. Par contre, votre homme a eu des relations sexuelles avant sa mort. J’ai également examiné le contenu de son estomac, peu important. Il avait dû manger de bonne heure, et assez léger, et n’a pas bu exagérément car son alcoolémie n’était pas élevée.
— Et ses mains, Sev, est-ce qu’elles t’ont appris quelque chose ?
— Rien trouvé de spécial sous les ongles, en dehors de l’humus du bois où il a été trouvé.
— Bon, et la balle ? Tu l’as extraite ?
— Oui, c’est du 22 long rifle, tirée à distance. Rien d’extraordinaire.
— Dégâts causés ?
— Section de l’artère coronaire, mort instantanée.
— Ce qui sous-entend que le meurtrier a utilisé une lunette, émit David.
— Et une bonne ! Au fait, Séverin, à quelle heure situes-tu la mort de notre homme ?
— Deux heures du matin, à peu de chose près.
— En pleine nuit… cela nécessite une visée à infrarouge.
— Tenez, je vous ai mis la balle là-dedans, dit Séverin en donnant un petit sachet à David.
— Merci, on va la transmettre au labo.
— Vous aurez le compte rendu écrit dans la soirée, ça ira ?
— Oui. Allez, ciao, Sev, à plus !
Paoli et Marchand pointaient déjà leur nez dehors, quand la voix de Séverin Leclerc se fit entendre dans leurs dos.
— Hé, attendez !
— Quoi ?
— Les chaussures… c’est une marque italienne, Valleverde.
— Pas courant par ici, ça, fit François. Bon, merci Séverin, à plus tard.
*
Ils avaient fini de déjeuner et attendaient qu’on leur serve leurs cafés. Dehors, la pluie s’était mise à tomber et les passants se hâtaient sous leur parapluie.
— Voici vos cafés, leur annonça le serveur.
— T’aurais pu nous apporter l’addition, tant qu’à faire, Guy !
— Vous êtes à la bourre ? Je vais vous chercher ça ! Pendant quelques instants, la seule occupation de Paoli et Marchand fut de dissoudre le sucre dans leur café.
— On fait quoi, cet après-m’ ? interrogea David en déballant son carré de chocolat.
— On repart à la campagne.
— T’as vu le temps ? On va patauger dans la gadoue !
— Téléphone pour toi, François, dit Guy en déposant l’addition sur la table.
— Au bar ?
— Oui.
Il se leva, sortit de l’argent de sa poche et laissa à David le soin de régler leur repas. Le barman lui tendit le combiné et s’éloigna de quelques pas, par souci de discrétion. François appuya son index droit sur l’oreille correspondante pour occulter le brouhaha environnant.
— Allô ? Oui, c’est moi. Oui… Que dites-vous ? Ah ! Bon, on arrive. Tenez, j’ai fini, dit-il au barman qui reprit le combiné.
Il revint à la table et prit sa veste sur le dossier de sa chaise.
— Grincheux veut nous voir. Il y a du nouveau.
— Genre ?
— Genre « vous le saurez quand vous serez dans mon bureau ».
— Eh bien, allons-y !
*
François s’effaça pour laisser passer David. Duval se tenait debout près de la fenêtre et sirotait un café.
— Jetez un œil à ce qui est posé sur mon bureau, ordonna-t-il.
Les deux inspecteurs se penchèrent sur un petit sachet en plastique transparent.
— Des dents ?
— Un bridge, oui.
— Qui vous a fait cette farce ?
— Ce n’est pas une farce, Messieurs. C’est une mère de famille qui nous l’a apporté. Son fils a trouvé le bridge dans son épuisette en fouillant une flaque. C’est quand elle a lu le journal, qu’elle a pensé à nous adresser ces dents. Évidemment, étant donné le séjour dans l’eau, il n’y a plus de trace de sang.
— Où a-t-il pêché ça exactement ?
— En aval de là où a été trouvé le corps. J’ai envoyé deux hommes sur place, mais, s’il y a eu des empreintes de pas, elles ont disparu à cause des marées.
— Depuis la nuit de vendredi à samedi, ça en fait quelques-unes !
— Je viens d’appeler Séverin pour lui dire qu’on allait lui apporter le bridge afin qu’il vérifie si celui-ci appartenait au mort.
— J’y vais, dit David en empochant le sachet contenant les dents.
Duval termina son café et prit place derrière son bureau.
— Vous avez travaillé sur les vêtements du mort, je crois…
— Oui, et cela nous a donné un nom, Gilbert Leduc.
— Eh bien, vous feriez bien de vérifier l’existence de ce monsieur dans les fichiers d’identité.