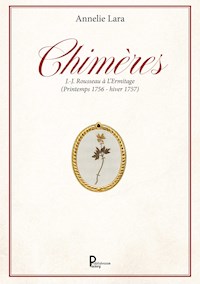
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En avril 1756, la marquise d’Épinay met à la disposition de Jean-Jacques Rousseau l’Ermitage, une maison située non loin de son château, à l’orée de la forêt de Montmorency. Il s’y installe le 9 avril 1756 avec sa compagne Thérèse Levasseur et la mère de cette dernière.
En l’espace de vingt mois, ses relations avec Mme d’Épinay se dégradent jusqu’à ce que celle-ci l’expulse de l’Ermitage le 15 décembre 1957.
Vingt mois au cours desquels le philosophe se brouille avec Mme d’Épinay, Grimm, Diderot, et tombe amoureux de Sophie d’Houdetot dont il parlera comme ayant été son unique amour.
Au cours de ces mois, Jean-Jacques Rousseau dit avoir traversé : la grande révolution de ma destinée… la catastrophe qui a partagé ma vie en deux parties si différentes.
C’est cette catastrophe, ces mois déterminants dans sa vie et sa pensée que narre l’auteure.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Annelie Lara, l’auteure, a vécu en terres africaine, européenne et asiatique. Après avoir enseigné dans une université privée à Taïwan, elle s’est installée dans le beau Languedoc, terre rebelle des Cathares et des Camisards. Jardiner, peindre, écrire, autant de voies qui la mènent à la méditation.
Dernières publications :
Olympio Highlife, éditions L’Harmattan, 2021.
L’Ombre bleue, éditions Du Mont, 2018.
Song Qingling, Une Flamme étoilée dans la Chine du XXe siècle, éditions L’Harmattan, 2017.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AnnelieLara
Chimères
J.-J. Rousseau à L’Ermitage(Printemps 1756 - hiver1757)
Ouvrages du même auteur :
Olympio Highlife, L’Harmattan,2021.
L’Ombre bleue, éditions Du Mont,2018.
Song Qingling, Une Flamme étoilée dans la Chine du XXe siècle, L’Harmattan,2017.
Les Bellezêveries, L’Harmattan,2007.
Traité des caractères, LIU Shao (IIIe siècle), traduit du chinois par A.-M LARA, Gallimard,1997.
À toi
« Je commençai de craindre que je n’eusse employé ma vie à sacrifier à des chimères. »
–J.-J. Rousseau, Les Confessions IX, II.
-1- L’Ermitage
Enfin, madame, j’ai pris mon parti, et vous vous doutez bien que vous l’emportez ; j’irai donc passer les fêtes de Pâques à l’Ermitage, et j’y resterai tant que je m’y trouverai bien et que vous voudrez m’y souffrir ; mes projets ne vont pas plus loin que cela. Voilà maintenant un déménagement et des embarras qui me font trembler.
Nous sommes en mars 1756, quarante ans après la fin de règne interminable et sclérosée de Louis XIV. La chape de plomb s’est soulevée sous la Régence. Louis XV, depuis treize ans, gouverne seul. La période des grandes mutations est en marche. À présent, Paris bruisse d’idées nouvelles. Dans les salons et les cénacles, que de débats, que de polémiques ! La vie intellectuelle et mondaine étincelle. Jean-Jacques Rousseau a quarante-quatre ans et, déjà, il est une star internationale.
Six ans auparavant, en 1750, son Discours sur les sciences et les arts l’a fait largement connaître. En octobre 1752, son opéra, Le Devin du village, un intermède en un acte, a été représenté à deux reprises au château de Fontainebleau. Louis XV, la marquise de Pompadour, toute la cour l’ont applaudi. Malgré cet éclatant succès Jean-Jacques s’est dérobé à la présentation au roi du lendemain et a refusé la pension qui aurait pu lui être accordée : Quel scan-dale ! vitupèrent les salonniers parisiens, tout consumés d’envie. Le même jour, Jean-Jacques a démissionné du poste lucratif de caissier qu’un receveur général des finances, M. de Francueil, lui avait confié. La responsabilité d’un tel poste, l’inquiétude qu’elle lui causait et sans doute la conscience de son inaptitude pour celui-ci le rendaient malade. C’en est trop pour Diderot (1713-1784). Il s’emporte contre son ami. C’est leur première querelle fondamentale. La dispute qui annonce toutes celles à venir en ce qu’elle porte sur le thème essentiel qui divise les deux philosophes : doit-on se compromettre avec le pouvoir ?
Dans la lettre de doléances qu’il adresse à son retour de Venise, en octobre 1744, à La Porte Du Theil, premier commis des affaires étrangères, Jean-Jacques écrit à propos de la carrière : J’aime mieux vivre libre et pauvre jusqu’à la fin, que de faire mon chemin dans une route aussi dangereuse. Depuis, il ne cesse de s’interroger : un écrivain se destinant à éclairer le genre humain peut-il accepter de devoir sa subsistance au prince ? Peut-il remplir son devoir d’intellectuel tout en étant salarié par le pouvoir en place ?
À ces deux questions, il répond sans la moindre équivoque en choisissant une façon de vivre austère : En renonçant à me présenter au roi, je perdais, il est vrai, la pension qui m’était offerte en quelque sorte ; mais je m’exemptais aussi du joug qu’elle m’eût imposé. Adieu la vérité, la liberté, le courage. Comment oser désormais parler d’indépendance et de désintéressement ? Il ne fallait plus que flatter ou me taire, en recevant cette pension [...]. Je crus donc en y renonçant prendre un parti très conséquent à mes principes.
À peine deux ans plus tard, en 1754, son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommesachève de le rendre célèbre dans l’Europe entière. Partout, Jean-Jacques éblouit par son style et la rigueur de sa pensée. Partout, il suscite louanges et critiques. Partout aussi il inquiète, il choque, car il s’attaque à la société, entreprend de mettre à nu les vices de son système et leurs conséquences. Ne combat-il pas la noblesse, la royauté de droit divin et les prétendues convenances sociales ? Ne s’en prend-il pas aux fondements mêmes de toutes les institutions, en rapportant tout le mal à la propriété ? N’oppose-t-il pas pour la deuxième fois, la nature à la civilisation, en avançant que la civilisation rend les hommes malheureux et coupables en les asservissant ?
Bien plus, l’auteur à succès qu’il est devenu s’acharne à rejeter les chaînes de la renommée : Le génie ne s’achète point, il ne connaît ni l’argent ni l’ordre des princes ; il ne leur appartient point de le faire naître, mais seulement de l’honorer (juillet 1756).
Pour conserver sa sacro-sainte indépendance, le mot obsessionnel de ses écrits, il se choisit un travail obscur. Désormais, annonce-t-il, il gagnera sa vie en s’adonnant à de simples transcriptions de partitions musicales : Je renonçai pour jamais à tout projet de fortune et d’avancement, déterminé à passer dans l’indépendance et la pauvreté le peu de temps qu’il me restait à vivre. [...] à briser les fers de l’opinion [...] sans m’embarrasser du jugement des hommes.
Revenu de Genève fin 1755, il réside à Paris où, trop sollicité par les curieux, il est taraudé par l’idée de fuir cette ville de bruit, de fumée et de boue, pour un lieu plus proche de la nature. Son besoin de calme, d’une retraite propice au travail et à la réflexion, l’incite à partir s’établir dans sa patrie bien-aimée, Genève. Deux choses cependant le font hésiter : sa mauvaise santé et la difficulté d’y exercer son métier de copiste. Ajoutons une troisième raison non dite : l’installation toute récente de Voltaire à Genève (1755) qui l’inquiète. Voltaire se montre ouvertement hostile à son égard. Leur contentieux date de dix ans. Une génération sépare les deux hommes. Leur contentieux date de dix ans. À l’époque, Jean-Jacques avait dû remanier, sur ordre du duc de Richelieu, La Princesse de Navarre de Voltaire mise en musique par Rameau. Voltaire avait jugé ses corrections comme autant de « balourdises ». Un soufflet qui avait grandement affecté la vanité de Jean-Jacques.
Fin 1755, c’est précisément à ce moment que Louise d’Épinay le presse d’accepter son hospitalité.
La marquise d’Épinay (1726-1783) souffre des infidélités notoires de son mari, Denis-Joseph La Live d’Épinay (1724-1782). En menant une existence de bâton de chaise, ce fermier général mange allègrement sa fortune avec des actrices de petite vertu. Après avoir obtenu la séparation de biens, la marquise est venue vivre à Paris. Elle y fréquente assidûment les salons littéraires où se réunissent les grands intellectuels du temps. Elle-même reçoit.
C’est son amant, Louis Dupin de Francueil (1715-1786), père de ses deux autres enfants et futur grand-père de George Sand, qui lui présente Jean-Jacques, alors secrétaire de Mme Dupin, sa belle-mère.
Ce diable d’auteur, pauvre comme Job, qui a, dit-on, de l’esprit et de la vanité comme quatre, vient souper de temps à autre chez la marquise, dans son hôtel parisien, et à la belle saison, dans son château de la Chevrette situé dans la vallée de Montmorency. Peu à peu, il lui sert de confident. Simple secrétaire, il s’efforce de faire le courtisan sans trop y parvenir. En 1748, il tient même un petit rôle, celui du valet Carlin dans L’Engagement téméraire, une comédie en trois actes et en vers qu’il a écrite pour distraire Louise d’Épinay du deuil de sa petite fille, et que l’on donne le jour de la fête locale dans l’orangerie, le superbe théâtre du château.
Pour inciter la coqueluche, que le Tout-Paris s’arrache, à renoncer à son projet de retourner à Genève, Louise d’Épinay lui a fait visiter une maison de son domaine, avant que Jean-Jacques ne parte pour la Suisse : Un joli potager, avec une petite loge fort délabrée, qu’on appelait L’Ermitage.
Ce lieu solitaire et très agréable m’avait frappé, quand je le vis pour la première fois, avant mon voyage à Genève. Il m’était échappé de dire dans mon transport : Ah ! Madame, quelle habitation délicieuse ! Voici un asile fait pour moi. Mme d’Épinay ne releva pas beaucoup mon discours ; mais à ce second voyage je fus tout surpris de trouver, au lieu de la vieille masure, une petite maison presque entièrement neuve, fort bien distribuée, et très logeable pour un petit ménage de trois personnes. Mme d’Épinay avait fait faire cet ouvrage en silence et à peu de frais, en détachant quelques matériaux et quelques ouvriers de ceux du château. Au second voyage, elle me dit en voyant ma surprise : Mon ours, voilà votre asile ; c’est vous qui l’avez choisi, c’est l’amitié qui vous l’offre ; j’espère qu’elle vous ôtera la cruelle idée de vous éloigner demoi.
Ses « ours », c’est ainsi que quelques hommes les plus éminents, des familiers de Louise d’Épinay, se nomment par jeu et par politesse. Ils affichent une soumission apparente à la maîtresse des lieux qui fait mine de les régenter. En fait, ces lettrés viennent d’abord chez la marquise pour se retrouver entre eux. Jean-Jacques, l’ours montagnard, y fait figure deroi.
En mars 1756, Jean-Jacques balance encore. S’il accepte l’Ermitage, il pose d’emblée ses conditions : il paiera les gages du jardinier, et surtout il jouira d’une liberté sans réserve, sans être tenu d’aller faire sa cour à la dame du château. Ne reproche-t-il pas déjà à la marquise de vouloir faire un valet d’un ami ?
Il finit toutefois par céder, presque à contrecœur, tout en n’étant pas sûr de faire le bon choix : Madame d’Épinay, qui ne voulait pas en avoir le démenti, devint si pressante, employa tant de moyens, tant de gens pour me circonvenir [...], qu’enfin elle triompha de mes résolutions. Renonçant au séjour de ma patrie, je résolus, je promis d’habiter l’Ermitage, et, en attendant que le bâtiment fût sec, elle prit le soin d’en préparer les meubles, en sorte que tout fut prêt pour y entrer le printemps suivant.
La marquise connaît l’homme. Elle s’entend bien avec lui. Leur amitié remonte à neuf ans (1747). Elle le sait susceptible, ombrageux, mais déjà si célèbre. Et elle le veut chez elle, sur ses terres. Détenir un trophée en quelque sorte à portée de mains pour s’attirer les regards parisiens. Au demeurant, elle voit parfaitement à quoi elle s’expose en lui proposant une retraite : « Il est sans les usages du monde, mais il est aisé de voir qu’il a infiniment d’esprit ». Plus tard, elle dira de lui qu’« il était complimenteur sans être poli ». Quoi qu’il en soit, la bonne volonté qu’elle met à l’héberger est tangible et bien réelle. Mais quel but poursuit cette femme d’esprit en agissant ainsi, hormis la notoriété que la présence sur ses terres d’un tel protégé lui apporterait ? Aurait-elle pour Jean-Jacques plus que de l’amitié ?
Trois choses sont certaines : elle goûte sa conversation, elle recherche son commerce tandis que son amant, Francueil, la délaisse et la déçoit. Il faut dire qu’il a fini par lui préférer la compagnie de son débauché de son mari. Quant à elle, cela fait deux ans qu’elle se console dans les bras de Melchior Grimm (1723-1807). Mais, entre Francueil avec lequel elle ne parvient pas à rompre et Grimm qu’elle n’a pas encore déclaré être son amant en titre, il y a un intervalle de quelques mois. Ne chercherait-elle pas à séduire Jean-Jacques ? Et qu’en est-il de lui ? Jusqu’où occupe-t-il cet intervalle et quel zèle y met-il ? Quelle est sa conduite envers Louise d’Épinay durant les vingt mois où il habite l’Ermitage ?
Le peintre Jean-Étienne Liotard a fait un portrait de la marquise. Elle-même se décrit sans la moindre complaisance, même si elle semble plutôt contente d’elle : « Je ne suis point jolie, je ne suis cependant pas laide. Je suis petite, maigre, très bien faite. J’ai l’air jeune, sans fraicheur, noble, doux, vif, spirituel et intéressant. Mon imagination est tranquille, mon esprit est lent, juste, réfléchi et sans suite».
Jean-Jacques se montrera dans les Confessions plutôt objectif : Elle était aimable, avait de l’esprit, des talents [...] La nature [lui] avait donné, avec un tempérament très exigeant, des qualités excellentes pour en régler ou racheter les écarts.
Tous deux partagent surtout une passion commune à la mode : l’éducation des enfants. À cette époque, on prend conscience qu’une société meilleure exige une nouvelle éducation. Les encyclopédistes s’emparent de la question. Ils se mêlent de pédagogie dans le but d’améliorer la société et le bonheur des êtres humains.
À la Chevrette ou dans l’hôtel parisien de la marquise, Jean-Jacques s’émeut de voir cette dame prendre réellement soin de ses enfants. Il faut dire qu’elle détonne parmi les mères de son milieu. À la fois présente et attentive, tout amour et dévouement pour ses deux enfants, Louise d’Épinay ose se risquer sur le terrain de l’éducation alors monopolisé par les hommes. De Jean-Jacques, elle tire la plupart de ses idées en la matière et, dès 1756, elle met par écrit les siennes en deux recueils : le premier s’adresse à la gouvernante de sa fille, l’autre a pour titre Lettres à mon fils, un premier essai de pédagogie que Jean-Jacques trouvera mauvais. La marquise va bientôt incarner le nouveau modèle maternel inconnu des dames de sa classe. Elle deviendra l’ancêtre des mères éducatrices et institutrices des siècles suivants.
Pour l’heure, impressionnée par le moralisme de Jean-Jacques, elle souhaite bénéficier de ses leçons et ne cesse de le questionner. Elle s’emploie donc à le charmer pour le retenir chezelle.
Lors de la publication de l’Émile, traité philosophique sur la nature de l’être humain et sur l’éducation de l’enfant, rédigé durant les années 1759-60, Jean-Jacques confiera à Lenieps que ce livre est le résultat d’un travail de huit ans. Dans les Confessions, il évoque vingt ans de méditation et trois ans de travail. Plusieurs dames du monde ont toujours sollicité ses avis sur la meilleure éducation à donner à leurs enfants. Après Fénelon, c’est lui l’expert en ce domaine. La marquise ne voit que son propre intérêt à l’installer à proximité de la Chevrette. Elle entend bien tirer profit de sa présence.
Quant à Jean-Jacques, aurait-il la moindre attirance pour la marquise ? Ce qu’il écrit à son propos semble clair : des détails physiques lui firent toujours oublier son sexe auprès d’elle. Il ne tente pas de la séduire : Elle était fort maigre, fort blanche, de la gorge comme sur ma main. Ce défaut seul eût suffi pour me glacer. La dame n’est donc pas son genre. Jean-Jacques préfère les femmes bien en chair. Si d’aventure elle a fait des avances au roi de ses ours, celui-ci les a repoussées sans y mettre trop de formes : Cette idée ne me vint jamais près de madame d’Épinay et ne m’y serait peut-être pas venue une seule fois en ma vie, quand je l’aurais passée entière auprès d’elle. Non que j’eusse pour sa personne aucune répugnance : au contraire, je l’aimais peut-être trop comme ami, pour pouvoir l’aimer comme amant.
Il y a aussi ces tête-à-tête pesants où il ne semble guère apprécier l’esprit de la dame adulée des cénacles parisiens : Je sentais du plaisir à la voir, à causer avec elle. Sa conversation, quoique assez agréable en cercle, était aride en particulier : la mienne, qui n’était pas plus fleurie, n’était pas pour elle d’un grand secours.
Sans s’en douter, Jean-Jacques inflige à l’orgueilleuse marquise une double blessure d’amour-propre : elle ne le retient ni par son physique ni par son esprit.
Mais remontons plus avant.
Avril 1756 : Jean-Jacques est ravi de quitter Paris pour la campagne, retrouver la nature apaisante et s’y repaître de solitude. Le début du livre IX des Confessions témoigne de sa joie : L’impatience d’habiter l’Ermitage ne me permit pas d’attendre le retour de la belle saison. Et, sitôt que mon logement fut prêt, je me hâtai de m’y rendre, aux grandes huées de la coterie holbachique…
Sous le terme d’holbachique, Jean-Jacques regroupe tous les encyclopédistes qui fréquentent rue Royale « la synagogue », c’est-à-dire le salon parisien du baron d’Holbach. Issu de la petite noblesse, ce baron au caractère difficile et volcanique accueille généreusement ses amis philosophes grâce à sa considérable fortune. Jean-Jacques évolue à l’intérieur de ce cercle jusqu’à son retrait à l’Ermitage.
Ce fut le 9 avril 1756 que je quittai la ville pour n’y plus habiter. [...]. Mme d’Épinay vint nous prendre tous trois dans son carrosse. Son fermier vint charger mon petit bagage, et je fus installé dès le même jour. Je trouvai ma petite retraite arrangée et meublée simplement, mais proprement et même avec goût. La main qui avait donné ses soins à cet ameublement le rendait à mes yeux inestimable, et je trouvais délicieux d’être l’hôte de mon amie, dans une maison de mon choix, qu’elle avait bâtie exprès pour moi. Quoiqu’il fît froid et qu’il y eût même encore de la neige, la terre commençait à végéter. On voyait des violettes et des primevères. Les bourgeons des arbres commençaient à poindre, et la nuit même de mon arrivée fut marquée par le premier chant du rossignol, qui se fit entendre presque à ma fenêtre, dans un bois qui touchait la maison.
Le voilà donc installé dans la jolie demeure que Louise d’Épinay a fait rénover tout exprès pour lui. Distante d’un peu plus d’un kilomètre de son château, elle jouxte la forêt de Montmorency : [Cette maison] est située dans la plus belle vue. Il y a cinq chambres, une cuisine, une cave, un potager d’un arpent, une source d’eau vive, et la forêt pour jardin.
À l’époque, l’Ermitage est immergé dans la nature. C’est dans ce havre de paix que Jean-Jacques demeure du 9 avril 1756 à la mi-décembre 1757 en compagnie de Thérèse Levasseur (1721-1801) et de la mère de celle-ci, Marie Levasseur. Il nomme ces deux femmes ses gouverneuses. Cela fait une bonne dizaine d’années qu’il s’est mis en ménage avec Thérèse, une jeune lingère quasi illettrée. Elle lui apporte l’affection et la présence féminine qui lui manquent. Il a pris à sa charge la mère, une octogénaire aux tendances dominatrices, et supporte nombre de neveux, nièces, sœurs de Thérèse, ainsi que son escroc de frère qui n’hésite pas à le voler. En somme, avec cette belle-famille sangsue, il fait vivre sept à huit personnes. Quant au père de Thérèse, Jean-Jacques vient de le placer, sur la demande de la mère, dans une maison de charité. Jusqu’alors, le père lui aussi était à sa charge.
Jean-Jacques ne parle de sa compagne qu’avec les plus grands égards. Peu de plaintes, que des éloges dans sa Correspondance et dans ses œuvres. Pourtant, David Hume finira par lâcher : « Elle est méchante, querelleuse, bavarde, mais elle a sur cet homme l’empire d’une nourrice sur son enfant ».
Entre 1747 et 1755, Jean-Jacques a sans doute eu cinq enfants de Thérèse. La décision de les confier aux Enfants-Trouvés lui revient, selon ses dires, ainsi qu’à Marie Levasseur. Thérèse ne s’y serait résolue qu’avec bien de la peine. Plus tard, Sophie d’Houdetot avancera le contraire. Il semble bien que la mère et la fille aient choisi la solution la plus simple pour elles. Jean-Jacques explique ces abandons successifs par son manque de moyens. Comment subvenir aux besoins de sa nombreuse belle-famille et à ceux des enfants à naître ? Il se sent incapable d’assumer une telle responsabilité, trop de bouches à nourrir. Il écrit en 1751 à Mme de Francueil : C’est l’état des riches, c’est votre état, qui vole au mien le pain de mes enfants ; vous prenez pour le déshonneur du vice ce qui n’est que celui de la pauvreté. On abandonne dans le Paris d’alors plus d’un tiers des nourrissons. Cela fait partie des mœurs du temps. Faute d’argent, Jean-Jacques fait comme tant d’autres. Son choix d’une pauvreté assumée afin de demeurer libre a pesé lourd sur sa constante précarité, sur les conditions matérielles dans lesquelles il a vécu. Plus tard, il cherchera ses enfants et n’en retrouvera aucun. Il en concevra une peine muette et infinie : plus d’une fois, depuis lors, les regrets de mon cœur m’ont appris que je m’étais trompé. Dans l’Émile, il confie : Je prédis à quiconque a des entrailles [...] qu’il versera longtemps sur sa faute des larmes amères et n’en sera jamais consolé.
En ce printemps 1756, Jean-Jacques jouit du bonheur d’être à l’Ermitage : Je me sentais fait pour la retraite et la campagne. Il m’était impossible de vivre heureux ailleurs.
Au lieu de commencer à m’arranger dans mon logement, je commençai par m’arranger pour mes promenades, et il n’y eut pas un sentier, pas un taillis, pas un bosquet, pas un réduit autour de ma demeure, que je n’eusse parcouru dès le lendemain. Plus j’examinais cette charmante retraite, plus je la sentais faite pour moi. Ce lieu solitaire plutôt que sauvage me transportait en idée au bout du monde. Il avait de ces beautés touchantes qu’on ne trouve guère auprès des villes ; et jamais, en s’y trouvant transporté tout d’un coup, on n’eût pu se croire à quatre lieues de Paris.
Les débuts se déroulent sous les meilleurs auspices : Quoique le temps me contrarie depuis mon arrivée ici, je viens de passer les trois jours les plus tranquilles et les plus doux de ma vie ; ils le seront encore plus quand les ouvriers qu’occupe mon luxe ou votre sollicitude seront partis. [...]. En attendant, je m’arrange [...]. Vous me trouverez rangé délicieusement, à la magnificence près que vous y avez mise, et qui, toutes les fois que j’entre dans ma chambre, me fait chercher respectueusement l’habitant d’un lieu si bien meublé. [...]. En me promenant ce matin [...] j’y ai mis mon ancien ami Diderot à côté de moi, et, en lui faisant remarquer les agréments de la promenade, je me suis aperçu qu’ils augmentaient pour moi-même [...]. Malgré la barbe de l’ermite et la fourrure de l’ours, trouvez bon que je vous embrasse. [...]. Les gouverneuses veulent que je vous supplie d’agréer leurs très humbles respects ; elles s’accoutument, ici presque aussi bien que moi, et beaucoup mieux que mon chat. [...].
L’été s’écoule lentement. Jean-Jacques surveille de près les faits et gestes du jardinier de la marquise : Votre jardinier a encore emporté ce matin des pêches au marché de Montmorency. On ne peut rien ajouter à l’effronterie qu’il met dans ses vols ; et bien que ma présence ici le retienne, je vois très évidemment qu’elle lui sert de raison pour porter chez vous encore moins de fruits qu’à l’ordinaire. [...].Je suis obligé de vous écrire tout ceci, car il est difficile d’avoir de conversation tranquille dans les courts intervalles que j’ai à passer près de vous.
On sent poindre une légère critique envers Louise d’Épinay. Trop de monde s’agite autour d’elle. Lorsque la marquise ne se trouve pas à Paris, elle reçoit à la belle saison dans son château. La Chevrette, dans le domaine de Deuil, est un château Louis XIII, une promenade d’un quart de lieue de l’Ermitage. Il comprend un parc à la française, des bassins, des jeux d’eau, des parterres décorés, des statues de pierre et de marbre. Un grand canal aboutit à une grotte artificielle et à une cascade. Denis La Live d’Épinay a entrepris des travaux d’embellissement. Sa femme, Louise d’Épinay, en a la libre jouissance. Mais c’est à Paris qu’elle tiendra salon à partir de 1762. À la différence des autres salons littéraires et philosophiques, le sien ne comportera ni date fixe ni thème imposé. Les rencontres à la Chevrette sont décontractées et festives : on y parle littérature, on y joue de la musique, on y fait du théâtre. La marquise accueille tout ce que Paris compte d’hommes adeptes des Lumières. Cela fait beaucoup de monde. Beaucoup trop pour l’ours de l’Ermitage.
Qui donc a ses entrées au château ?
En premier, l’amant de la châtelaine, le célèbre Melchior Grimm. Celui qui se fera appeler plus tard Baron Grimm. Voilà deux ans qu’elle s’en remet à lui pour tout, qu’il la conseille sur tous les plans. Devenu son confident, son protecteur, il est incontournable. Dès 1749, Jean-Jacques a introduit ce fils de pasteur, sans titres ni fortune, dans les meilleures maisons de Paris. C’est lui qui l’a présenté à Louise d’Épinay et à Diderot. Le parcours du Bavarois d’expression française est représentatif de celui de bien des jeunes européens contemporains cherchant à se hausser dans la société du XVIIIe au moyen de tous les stratagèmes possibles. Jean-Jacques l’a poussé dans la lumière en se jetant avec lui dans la querelle des partisans de Rameau et de la musique italienne. Dans une lettre sur la musique française écrite en 1753, Jean-Jacques s’est déclaré pour l’italienne et s’est fait au passage quelques inimitiés. Grimm, secrétaire du duc d’Orléans, est devenu célèbre du jour au lendemain en 1752 après avoir publié une brochure soutenant la musique italienne. Pour achever de se faire connaître, il rédige des chroniques de la vie intellectuelle parisienne qu’il envoie aux princes éclairés et à l’aristocratie européenne. Il se fait le champion du boniment scribouillard. Entre autres souverains étrangers, Catherine II de Russie fait partie de ses lecteurs. Dans cette gazette du Tout-Paris littéraire, culturel et mondain, Grimm sait restituer le ton railleur tellement parisien qui plaît tant aux étrangers. Il y évoque les salons littéraires tenus par les Parisiennes, les thèmes qui y sont débattus. À peu de frais, il brille et épate ses lecteurs européens. Il collabore aussi à l’Encyclopédie et au Mercure de France. Ce trentenaire est avant tout un mondain habile, un manœuvrier retors. En tout cas, un adepte du faste, de la galanterie et des femmes quoique l’homme n’ait rien d’un adonis : des yeux proéminents, une épaule un peu forte, le nez de côté. Son visage trop fardé de blanc avec le creux des joues rempli de céruse l’a fait surnommer par l’ami Gauffecourt (1691-1766), Tyran-le-Blanc. En dépit de ce physique plutôt ingrat, Tyran-le-Blanc séduit et trace son chemin dans le monde des Lumières. Son ascension éclair lui permet de substituer très vite à son habit noir râpé, à ses bas usés, l’habit brodé, les bas de soie bleue, et d’y ajouter épée, carrosse, laquais et valet-secrétaire. Grisé par son succès, il se montre insolent envers ses amis et bien trop impertinent envers Jean-Jacques.
Ce dernier, par ailleurs, s’inquiète de voir Diderot s’amouracher du Bavarois au parfum musqué. Il considère que Grimm accapare un peu trop son ami de longue date : Je ne sais si je pourrai jamais jouir réellement de cette augmentation ; si cela peut se faire un jour, ce ne sera guère que par le crédit de mon ancien ami Grimm ; peut-être pourra-t-il et voudra-t-il bien me procurer une visite de l’ami que je lui ai procuré, et partager avec moi le plaisir que j’aurai de le recevoir ?
Entré le 9 avril à l’Ermitage, Jean-Jacques espère dès le 13 la venue de son ami Diderot.
Un attachement profond lie les deux hommes. Leur amitié, fort ancienne, remonte à quatorze ans, lorsque Jean-Jacques est arrivé à Paris, en1742.
À première vue, les deux amis ont beaucoup de points communs. À un an près, ils ont le même âge. Tous deux sont fils d’artisans : l’un fils d’un horloger de Genève, l’autre d’un honnête coutelier de Langres (Grand Est). Si Diderot vient d’une famille stable, il n’en va pas de même pour Jean-Jacques, orphelin de mère. Délaissé par un père fantasque et aventureux, oublié par son oncle maternel, il n’a connu de foyer solide que par à-coups. Tous deux sont des lettrés bohèmes. Bien que le père de Diderot fût aisé, il n’a pourtant pas hésité à couper les vivres à son fils. Celui de Jean-Jacques a dilapidé sa fortune. Les deux amis supportent les mêmes débuts difficiles.
Lorsqu’en 1744 Jean-Jacques est de retour à Paris après une malheureuse expérience de premier secrétaire d’ambassade à Venise, ils deviennent inséparables. Des années, ils se voient chaque jour, ils jouent aux échecs ensemble, ils rêvent de leur avenir. Des années, ils sont ces deux jeunes inconnus qui cherchent à se faire une place dans le monde des lettres. Diderot, énergique, généreux, chaleureux, parvient à dissiper la mélancolie du second. Sa faconde subjugue Jean-Jacques. Grâce à son ami, Jean-Jacques se secoue, il reprend confiance. Diderot évoquera cet heureux temps : « L’amitié est la passion de la jeunesse ; c’était alors que j’étais lui, qu’il était moi [...]. Nous n’avions qu’une bourse ; je n’étais indigent que quand il était pauvre ». Mais ils divergent de façon radicale par leurs caractères : l’un est un extraverti quand l’autre est un introverti. En outre, le premier, Diderot, sait s’emparer de l’affectivité des autres au point d’entraîner des caractères sans affinités avec lui. C’est ce qui se passe avec Jean-Jacques.
Tous deux choisissent à la même époque le même genre de compagne, deux lingères incultes :





























