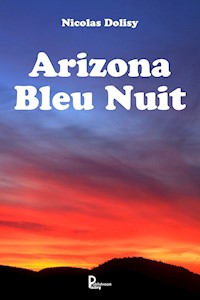Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Chris Lee et Sarah Wilson, deux enfants du Détroit des années soixante, grandissent côte à côte et sont secrètement épris l’un de l’autre. Leur couleur de peau les oppose et les événements politiques et sociétaux sont autant d’obstacles auxquels se heurte leur idylle.
La violence explose et les morts s’amoncellent. Ces derniers ne sont pas décidés à laisser les vivants tranquilles.
Lorsque Kennedy échappe à une tentative d’assassinat le 22 novembre 1963, l’histoire prend un tournant que nul n’aurait pu imaginer.
Les trajectoires de la petite histoire du quartier de Delray et de la grande Histoire américaine vont entrer en collision et faire éclater des vérités invraisemblables.
Certains passages de ce roman sont violents et peuvent heurter la sensibilité des jeunes lecteurs.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Nicolas Dolisy enseigne l’anglais au lycée depuis 2007. Il s’intéresse particulièrement aux États-Unis. Son premier roman,
Arizona Bleu Nuit, est paru en 2021.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NICOLAS DOLISY
CONSTELLATIONS AMÉRICAINES
Avant-propos
Certains personnages du roman sont des personnes ayant véritablement existé. Toutefois, au regard de la dimension uchronique du récit, on ne saurait leur imputer la responsabilité des actions, intentions, propos qui leur sont prêtés par l’auteur.
Ce n’est pas la couleur de peau qui détermine le bien ou le mal que l’on fait autour de soi, mais le degré de pureté du cœur.
Certains passages de ce roman sont violents et peuvent heurter la sensibilité des jeunes lecteurs.
« Je ne peux pas dire qui je serai demain. Chaque jour est neuf et chaque jour je renais. »
–Paul Auster
CHAPITRE 1
Le Petit monde de ChrisLeeLe Magnolia de Détroit
Comment ce magnolia peut-il pousser en plein Détroit ? Christopher Lee se le demande. À bientôt onze ans, le jeune garçon arpente les rues de son quartier de Delray, à la faveur d’une délicieuse fin d’après-midi de mai 1960. La ville est une pieuvre obèse et visqueuse qui s’est échouée sur les rives du lac Michigan. Son mucus empêche ses quartiers de se flétrir et le mollusque étend ses tentacules aussi loin que voudraient s’enfuir les autochtones. La pieuvre est exclusive. La pieuvre est sournoise. La pieuvre est laide. C’est la verrue utile de l’Amérique, le fleuron de son industrie automobile, son poumon économique depuis des décennies. Non contente de développer à l’envi la liberté sur quatre roues, elle a également gagné ses galons à la guerre en produisant massivement l’arsenal des forces alliées, contribuant ainsi à l’éradication du mal absolu incarné par les fascismes européens. La mégalopole avait pourtant, elle aussi, avalé les êtres, et en son centre elle arborait fièrement les excroissances verticales manifestant ainsi sa morgue mégalomaniaque : le Fisher Building, le Guardian Building, le Penobscot Building. Détroit avait tout pour réussir. Elle a pourtant tout gâché. Les grèves du lac Michigan étaient défigurées par les usines dont les fumées ne laissaient jamais le soleil s’établir dans la grise capitale de General Motors. Les eaux étaient polluées, l’urbanisme mal pensé. Détroit n’échappait pas à l’ultra-communautarisme qui a toujours gangréné le pays. La ségrégation raciale, appliquée avec particulièrement de zèle dans les États du Sud, a eu pour conséquence, dans les années 1920, un exode sans précédent de la population noire vers les grandes métropoles du Nord. Toutes les villes furent concernées par « la Grande Migration » : que ce soit New York et son quartier de Harlem, Philadelphie, Cincinnati, ou encore Chicago. Détroit fut également prise d’assaut. Le nord du pays, réputé pour être accueillant envers tous les groupes ethniques, a eu pourtant tôt fait de montrer son vrai visage, dès lors que les sombres réalités commencèrent à écorner les considérations idéologiques.
Comment ce magnolia peut-il pousser en plein Détroit ? Christopher Lee ne parvient pas à se départir de cette question qui le hante. La tête penchée, il contemple la beauté de ce feuillage éphémère, si fragile, qui s’entête à s’afficher ostensiblement, à la manière d’un paon, chaque saison au milieu des agglos des quartiers sud de la ville. Christopher Lee est un garçon qui passe l’essentiel de son temps seul, à s’inventer des histoires dans sa chambre, à imaginer ce qu’est le monde de l’autre côté de la morosité du Michigan. Il déambule dans son quartier en assimilant toutes les odeurs, que ce soient les rares effluves floraux ou les puanteurs émanant des égouts. Ce jeune garçon est un rêveur. Il scande dans sa tête des bouts de poèmes de Robert Frost, combattant ainsi la médiocrité visuelle du South Detroit. Les poèmes de Frost, il les a appris à l’école. Les vers qu’il connaît par cœur sont couchés dans son cahier de poésie. À la maison, il n’y a aucun livre. Son père, Ron Lee, est ouvrier chez General Motors, et sa mère, Tammy, fait quelques heures de ménage par semaine dans les bureaux de l’entreprise. On ne manque pas d’argent, mais on n’en dépense pas pour le superflu. Chez les Lee, la littérature et l’art c’est du superflu. Les sous font des petits à la banque, et c’est très bien ainsi.
Le foyer est froid, voire glacial. La mère fume toute la journée. Elle ne parle pas. Les seules fois où elle ouvre la bouche, c’est pour rejeter la fumée de ses Craven A ou pour mâcher du chewing-gum. Jamais un baiser, ni pour Christopher ni pour Ron. Le père, parlons-en justement. Bien bâti, carré, le chef de famille, plutôt expansif, la tchatche, mais pas viril dans l’expression. Et des petits coups sur l’épaule de son fils, d’un air complice, « Hein, fiston ?! ». Un fils qu’il veut façonner à son image. Il le veut gaillard et joueur de baseball. Un Américain comme il faut. Un Américain moyen. Moyen plus, moyen moins, selon les jours. Ron Lee se sent un Américain « moyen plus » les vendredis soir. Pour rien au monde il ne raterait le rendez-vous hebdomadaire du 426 Richmond Street. Il quitte alors la maison vers 19h40, sa cape blanche et son chapeau pointu sous le bras. Ce n’est que quelque temps plus tard que Chris comprendra qu’il est question de rassemblements de membres du Ku Klux Klan. Le Klan a toujours été très actif dans l’État du Michigan. Pour Ron c’est une question de fierté, d’honneur, de culture, d’identité, de race, évidemment. Le sentiment d’appartenir à un groupe et de défendre les intérêts suprêmes de la nation contre ceux qu’ils appellent les « ratons laveurs ». Depuis 1955, la situation est tangente. L’affaire Rosa Parks à Montgomery dans l’Alabama a mis sur orbite le pasteur de l’église baptiste d’Ebenezer : un certain Martin Luther King, et a rebattu les cartes dans une nation qui a inscrit la ségrégation raciale dans sa loi à la fin du dix-neuvième siècle.
Lorsque le père n’est pas là, la maison s’abrutit de silence. Les mains posées sur ses cuisses, Chris s’assied sur le rebord de la fenêtre de sa chambre en regardant dehors les gouttes de pluie traversées par la lumière du réverbère. Au rez-de-chaussée, la mère est installée à la cuisine, fumant cigarette sur cigarette, tournant les pages du Saturday Evening Post, entre deux gorgées de whisky. De temps à autre, Chris se lève, et, comme dans un musée, il parcourt des yeux les peintures de Rockwell ou de Sargent, les unes des magazines que sa mère consent à ce qu’il découpe pour les épingler aux murs de sa chambre. Derrière chaque illustration se cache une histoire que le garçon imagine et se raconte, inlassablement. Sa préférée est peut-être celle du 14 mai 1960. Le père de famille est au calme dans le salon, installé à son étude, organisant sa collection de timbres. Les cheveux gominés, le nœud papillon impeccable et un gilet couleur caca d’oie. Le calme ambiant est alors balayé par l’arrivée dévastatrice d’un de ses enfants, accompagné par une demi-douzaine de camarades remuants qui ruent dans les brancards, tapotent sur le piano à queue, se battent sur le canapé ou grattent une guitare en chantant à tue-tête. Le père a la mine déconfite, mais n’intervient pas. Il manque manifestement d’autorité. La vague submersive de Bill Haley ou Chuck Berry détrône l’Amérique à papa et les disques rayés de vieux crooners qui s’empierrent sur des gramophones hors d’usage.
Ron Lee ressemble un peu à ce père désabusé. Un manque d’autorité patenté, bien que Chris n’ait jamais eu l’idée d’en abuser. Ron Lee est un paradoxe ambulant. Sa carrure en impressionne plus d’un, mais sa voix de castra désarçonne. Il joue les gros bras avec ses copains encagoulés, mais s’effraie et panique quand un cafard traverse le sol de la cuisine, tandis que la mère demeure impassible. Les années passant, Chris tâche d’intellectualiser et d’analyser le comportement de son père dont la haine des Noirs est maladive. Le paternel entend bien faire infuser ses poncifs klaniques auprès du fiston. « C’est la plaie de notre pays. D’abord l’esclavage a été aboli et puis ils ont tout retourné, ils ont répandu le crime, la paresse, la sous-culture, le chômage. Ils ont enclenché le processus de dissolution progressive de notre race. Parce que, tu comprends, c’est bien de la survie de la race blanche dont il est question. On leur a fait une fleur en abolissant l’esclavage, et maintenant on voudrait aller plus loin : abolir la ségrégation. Mais les conséquences seront similaires à celles qui ont suivi l’abolition de l’esclavage. Seulement, il n’y aura plus de garde-fou ; toutes les barrières auront sauté. On se fera manger. Si l’esclavage avait été si mauvais, pourquoi George Washington avait-il des centaines d’esclaves ? Personne n’en parle deça… »
Christopher écoute attentivement son père, par déférence, politesse, et aussi ce besoin de décrypter sa psyché. Il a cette conviction profonde que comprendre son père c’est déchiffrer la part de ce père qui est tapie en lui. Il peine à trouver cette part, mais parfois il décèle quelques bribes qui lui paraissent sensées, et qui semblent correspondre à ce qu’il est. Cette affirmation au sujet de George Washington est d’un bon sens manifeste. Le père martèle le risque d’extinction de l’Amérique blanche avec une précision millimétrique qui rappelle une récitation sue par cœur par une écolière soucieuse de plaire à son institutrice. Le fond du propos est violent, mais la prosodie est dissonante. La voix est fébrile. La main touche à peine l’épaule du fils comme si, au fond de lui, Ron savait qu’il ne pouvait rien lui imposer, mais son for intérieur l’enjoignait de s’y essayer malgré tout. Ron incarne la pensée de l’Américain moyen WASP (blanc, anglo-saxon, protestant) de son temps. Il est l’héritier des fondateurs du Klan, né en 1865, concomitamment avec la défaite des États confédérés. « N’oublie pas, fils, que nous portons le nom de l’illustre Général Lee. Nous devons nous en montrer dignes. Je suis sûr que nous descendons de lui. Il faudrait qu’un jour on fasse des recherches, là-dessus. »
Chris opine du chef. Le père rabâche toujours les mêmes choses, mais n’agit pas. « On va déménager dans le Sud, là où sont nos racines. » Le Sud, c’est en fait Tammy qui en est originaire. Tuscaloosa, en Alabama, où elle a vu le jour en 1921. Fille unique d’un mariage de convenance, les sentiments n’étaient pas de rigueur, les épanchements d’affection encore moins. À vingt-huit ans, elle a tiré un trait définitif sur cette famille taiseuse. Elle a alors claqué la porte sans prévenir, sans état d’âme ni regret. Elle a pris une succession de bus de la compagnie Greyhound et a atterri un peu par hasard à Détroit, où elle fut immédiatement embauchée par General Motors pour des heures de ménage. C’est là qu’elle rencontra Ron alors qu’il prenait sa pause cigarette. Elle détestait ça, le tabac. Mais l’amour, ou du moins ce qu’elle identifiait comme tel, a fait naître chez elle une dépendance à la cigarette, qu’elle ne quittera plus de sa vie. Christopher est né dans l’année, au milieu des fumées de clopes. Les parents de Tammy n’ont jamais cherché à savoir ce qu’il était advenu de leur fille, pas plus que cette dernière n’a daigné prendre de leurs nouvelles.
À l’école publique McKinley, sur Oak Street, Christopher est assis près de la fenêtre et regarde les feuilles qui frissonnent dans les arbres. L’algèbre ce n’est pas son truc. Il se passionne en revanche pour l’histoire, la géographie, et la littérature. Le reste des leçons et les mots de Mademoiselle Quimby deviennent ensuite évanescents. Il rêve des grandes plaines déroulées depuis les contreforts des Montagnes Rocheuses. Il rêve des chiens de prairie et de leurs galeries, il rêve des grands espaces sauvages du Montana, de leurs ours, et des milliards d’insectes qui pollinisent la flore locale. Mademoiselle Quimby l’interrompt dans sa rêverie et le réprimande pour sa nonchalance devant la leçon d’algèbre. Elle lui confisque alors les trois images qu’il tient en main, et qui ont récompensé ses belles réussites de rédaction. La jeune institutrice aime beaucoup Christopher et c’est à contrecœur, consciente de devoir assumer sa figure d’autorité, qu’elle le punit et lui fait recopier des lignes. Christopher ne lui en veut pas et s’exécute. Confuse et chamboulée, l’institutrice n’en laisse rien paraître, mais y songera toute la soirée avec une boule qui lui serrera la gorge.
À la fin des cours, le garçon erre dans le quartier, préférant se passer d’une collation que, du reste, personne ne lui a préparée à la maison. Ses parents ne l’attendent pas, d’ailleurs. La seule règle est d’être rentré pour 18h. La brise de mai lui chatouille les joues et il finit par se planter devant l’arbre. Bon sang, Chris Lee, comment ce magnolia peut-il pousser en plein Détroit ? Le jeune garçon se gargarise de longues minutes en dévorant des yeux les fleurs rose pâle qu’il arbore. Si le paradis existe bien, des magnolias doivent y pousser, se dit-il. Une vieille dame qui nourrit des chats sur un banc voisin l’approche, et, s’amusant de la fascination du garçon pour l’arbre, lui explique que la floraison est très éphémère, et qu’elle prendra fin tout au plus dans dix jours. « Mais ne t’inquiète pas, gamin, chaque année, les fleurs reviendront. » La nature est opiniâtre, surtout quand elle est belle. L’optimisme des paroles de la vieille dame a commencé à germer chez Chris et il ne s’interdit pas de penser qu’à la manière dont il attendra la floraison de l’arbre l’année suivante, les chats attendront la vieille dame tous les jours, à la même heure, car ils savent qu’elle viendra chaque jour sans jamais faire défection. Ils ignorent pourtant encore qu’un jour elle ne viendra pas, et qu’à partir de ce jour, elle ne viendra plus jamais.
Comment ce magnolia peut-il pousser en plein Détroit ? Il posera la question à la vieille dame demain. En attendant, il se penche et ramasse une des feuilles déjà tombées. Il y en a cinquante, peut-être cent déjà au sol, mais c’est une feuille en particulier sur laquelle il a jeté son dévolu. Veloutée au toucher, sensuelle et encore odorante, il la range dans la poche de sa veste. Il la conservera jusqu’à son dernier souffle.
CHAPITRE 2
Les Arcanes du pouvoirMerci pour tout, Dwight Eisenhower
Dwight Eisenhower, que l’on surnomme affectueusement « Ike », a bien travaillé. Il a été une figure paternelle, rassurante. Petit à petit il s’est efforcé d’estomper le traumatisme de Pearl Harbor, a chassé les « sorcières » communistes, a emblématisé les années cinquante, une décennie économiquement prospère. Mais les deux mandats se terminent et Elvis est passé par là. L’Amérique veut son renouveau qu’elle sent incarné par le Sénateur John Kennedy. « Jack », comme on l’appelle, est un catholique issu d’une famille irlandaise cossue de Boston. Sa fougue et son énergie contagieuses n’ont d’égales que sa coiffure parfaite et son insolente jeunesse. Joe, le père, a placé tous ses espoirs et tout son argent dans la carrière de son poulain de fils. Comme Joe Jackson plus tard, le patriarche considère sa descendance comme une entreprise qu’il veut rentable. L’aîné doit être président, sinon rien. Lui-même se targue d’avoir obtenu le poste prestigieux d’ambassadeur des États-Unis à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d’être, moins glorieusement, rappelé par Roosevelt, qui tenait Joe Kennedy en mépris eu égard à son incompétence et son arrogance. Qu’importe. Il faut sauver les apparences. La ménagère devant son poste de télévision n’a d’yeux que pour John Kennedy. L’époux, d’abord jaloux, contrarié, et regrettant d’avoir fait l’acquisition du téléviseur, est à son tour hypnotisé par le jeune candidat. La (seule) force de Jack, c’est son pouvoir de séduction sur les femmes aussi bien que sur les hommes. Quelques formules bien pensées telles que « ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays » et la promesse de la conquête de la lune d’ici la fin de la décennie achèvent de convaincre les téléspectateurs.
Son adversaire républicain, Richard Nixon, ne manque toutefois pas de qualités. Son bilan, pourtant sous-estimé au poste de vice-président de Eisenhower, peut faire pâlir n’importe quel homme politique. Nixon est un homme de l’ombre, un besogneux qui connaît ses dossiers par cœur. Eisenhower n’éprouvait pas de sympathie particulière pour « Dick » Nixon en qui il voyait un roquet qui lui servirait de pare-feu. Eisenhower l’envoyait sur la scène internationale afin de représenter la bannière étoilée. Il en acquit une expérience extraordinaire. Que ce soit en Asie, en Afrique, ou en Amérique du Sud où il essuya jets de projectiles et crachats de manifestants hostiles à la politique étrangère des États-Unis, Nixon se montra digne de la mission qui lui avait été confiée, essuyant au passage une condescendance à peine voilée de la part du général, désagréablement surpris des succès de son second. Nixon assura même le rôle de président — sans en récolter les lauriers — quand « Ike » était trop souffrant pour l’exercer (la constitution n’avait pas encore statué sur ce cas de figure). Enfin, « Dick » Nixon accepta de rencontrer successivement Castro et Khrouchtchev, qu’Eisenhower refusait de voir. Nixon a le curriculum vitae bien rempli, mais il n’a ni la classe ni le charisme de Kennedy. Lors du dernier débat, Nixon convainc majoritairement les auditeurs de la radio par son assurance et son expertise alors que ceux qui suivent le débat télévisé voient plus qu’ils n’écoutent. Et, en l’occurrence, ils voient le costume, la posture, le sourire, la coiffure de « Jack » Kennedy.
« Jack » l’emporte le 8 novembre 1960 bien qu’il n’ait pas remporté la majorité des États. Cela s’est joué à rien. Quelques milliers de voix… Ou de dollars de Papa Joe.
Pour ce qui est de la question raciale, Kennedy s’y intéresse, mais elle n’est pas urgente. Il faut ménager la chèvre et le chou, et ne pas mécontenter davantage un électorat républicain qui souffre d’une sacrée gueule de bois au lendemain de l’élection. Et puis, pour les autres, l’adage dit que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. C’est de bonne guerre. Eisenhower avait déjà un peu défriché le terrain avec la fin de la ségrégation dans les écoles dès 1954, et surtout ce qui lui tenait particulièrement à cœur : la fin de la ségrégation dans l’armée. On avait envoyé les Noirs au front dès 1941. Ils méritaient de regagner un peu de citoyenneté au vu de leur sacrifice pour le drapeau. « Ike » en était conscient. Il était sur le terrain. Il avait libéré les camps de concentration allemands côté ouest et avait vu l’horreur de ses yeux. Il avait senti l’odeur de putréfaction des cadavres entassés. Le terrain, il connaissait. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles il avait ensuite envoyé Nixon en représentation.
Kennedy, de son côté, s’enivre des voyages à l’étranger et se délecte de constater l’enthousiasme qu’il suscite. C’est une véritable star de cinéma. L’Europe l’attend, l’acclame, le désire. Les femmes fantasment sur lui, les hommes le jalousent, mais n’en laissent rien paraître. Lors du sommet de Vienne en juin 1961, il tranche avec la figure inquiétante de Khrouchtchev. Le mur de Berlin se construit, et Kennedy ne fait rien pour empêcher cette ignominie. Pis. Avec son frère Bobby, il s’arrange avec les grands de ce monde, et comme on échange des cartes aux jeux des sept familles, autorise le mur en échange de pouvoir installer des missiles dissuasifs en Grèce… Drôle de bonhomme… Le sommet de Vienne avait pourtant eu pour objet de désamorcer les tensions, mais l’anticommunisme viscéral de la famille Kennedy transcende le bon sens et n’a cure de la parole donnée.
Jackie, la First Lady, est au mieux un faire-valoir, au pire un pantin qui doit se taire et avaler toutes les infidélités de son mari. Lors des vacances à la mer à Martha’s Vineyard, l’île prisée des Américains fortunés au large de l’État du Massachusetts, le couple invite des amis, et tous se prélassent sur de beaux bateaux hors de prix. JFK, derrière ses lunettes de soleil, arbore un sourire ravageur qui ne laisse de marbre aucune convive. Il honore les dames. Les maris savent, Jackie sait. Jack sait qu’elle sait. La vie est belle. Si ce n’étaient ces fichus maux de dos. À vingt ans il se blesse lors d’un match de football à Harvard. Plus rien ne sera pareil ensuite. Ses vaines tentatives pour intégrer l’armée américaine ont finalement été suivies d’un succès après que Papa Joe fit jouer ses relations. Jack intègre la réserve de la Navy et se bat héroïquement contre les Japonais, sauvant même un de ses frères d’armes, ce qui lui vaudra la médaille de la Navy et du Marine Corps. Il serait difficile de brosser un portrait de Kennedy en quelques lignes. Jack est avant tout un homme de défis, à l’ambition sans bornes. Il entend bien brûler la vie par les deux bouts, réussir tout ce qu’il entreprend, que ce soit sur le plan politique ou « sentimental ». Il a besoin d’adrénaline et ne veut laisser personne indifférent. Il aspire à être admiré. Prêt à user de tout pour arriver à ses fins, ce Machiavel des temps modernes n’hésitera pas à faire appel à son père et à ses relations pour obtenir des passe-droits, éhontément. La morale catholique s’en trouve passablement écornée. Mais Jack a sa propre religion, savant mélange de protestantisme — avec une farouche volonté de réussir —, d’hédonisme — avec une vie de plaisirs et de conquêtes —, et de stoïcisme — où, malgré d’atroces douleurs lombaires, il donne le change à ses interlocuteurs, aux journalistes, aux photographes et au peuple d’Amérique. Aux problèmes de dos s’étaient ajoutés des problèmes gastro-intestinaux qu’il calmait par une prise abondante et chronique de corticoïdes. Le sevrage s’accompagnait d’un grave problème lié aux glandes surrénales. À la fin des années 1940, on le croyait perdu. La morphine devient son plus fidèle allié.
Que dire du vice-président Lyndon Johnson ? C’est un être brutal, rustre, abject. Bien que viscéralement anticommuniste, on peut placer JFK sur la partie gauche du spectre de l’électorat démocrate, alors que Johnson est plutôt à droite. Johnson incarne d’ailleurs le parti démocrate à l’ancienne, un parti qui se méfie du pouvoir fédéral à la manière dont l’État du Texas se méfie de Washington DC. La bascule idéologique entre les deux partis s’opère justement au cours de cette décennie, et le parti républicain, jadis représenté par Abraham Lincoln, renoue avec une Amérique plus conservatrice, plus hostile à l’État fédéral. Ce parti ayant, de fait, un peu occulté les minorités, c’est le parti démocrate, jadis pro-ségrégation, qui se retrouve à draguer l’électorat afro-américain. Belle ironie de l’histoire.
Par leurs antagonismes, John Kennedy et Lyndon Johnson forment un duo complémentaire à la tête du pays. Johnson rote à table, défèque la porte ouverte tout en échangeant avec ses collaborateurs tandis que Jack arbore le même sourire « Colgate » en toutes circonstances. Pourtant, il n’en peut plus. En plus d’une plaque métallique dans le dos, les opérations se multiplient, des plaies ne se cicatrisent pas, il développe des infections urinaires, des staphylocoques dorés et des poussées de fièvre qui le font tomber dans des semi-comas. Les injections d’anesthésiques se multiplient. À la façon dont le bon docteur Morel soignait Hitler à grands coups de seringues, de mélanges douteux et expérimentaux, le docteur Jacobson s’évertue à rendre la vie de son patient acceptable et ses douleurs tolérables. Point d’éthique ni de déontologie. Le docteur « Feelgood » injecte. Point. On ne saurait que trop saluer la résilience de Kennedy, qui, pour satisfaire les photographes, porte ses deux enfants, Caroline et John Junior, s’amuse de voir ce dernier jouer sous la table de travail du bureau ovale. Il est plus gênant de se dire que, quelques heures plus tard, Marilyn Monroe prendra la place du bambin pour offrir à Jack quelques instants de détente. Marilyn en est une parmi des centaines. Pas étonnant que les douleurs de ce Louis XV américain, qui s’occupe davantage de sa libido que des affaires du pays, soient chroniques. Quand il décide de prendre les affaires de politique étrangère à bras le corps, c’est une catastrophe. Il y a au large de la Floride une petite île. Si l’on y prête suffisamment attention, on peut y voir des volutes de cigares qui montent jusqu’aux cieux, et qui se perdent dans l’infini. John veut assaillir Cuba, à la façon dont il se jette sur les dames. Mais Castro n’est pas du genre à se coucher pour un regard profond. JFK s’allie alors avec les opposants cubains au régime castriste, les nostalgiques de Batista, et avec l’organisation logistique de la CIA, organise un débarquement dans la baie des Cochons. L’opération est un fiasco. L’hubris de John et son anticommunisme entêté l’enferrent dans des positions absurdes et dangereuses. Khrouchtchev, l’imprévisible dirigeant soviétique, installe alors des missiles sur les côtes cubaines, des missiles dirigés vers la Floride, à quelque cent cinquante kilomètres de là.
Entre-temps, John peine à se débarrasser d’une Marilyn de plus en plus encombrante. Ivre, elle s’invite, en avril 1962, à la fête d’anniversaire du président et entonne un suave « Happy Birthday to you, Mr. President. » Jackie n’aurait pas supporté d’assister à cette humiliation. Son sens de l’anticipation lui a permis de sauver quelque peu la face en se réfugiant avec chiens et enfants dans leur maison de Virginie. La séquence fait le tour du monde et les choux gras de la presse à scandales. Marilyn tombe enceinte et décide de se faire avorter. On ne saura jamais si le bébé était de John ou de son frère Bobby. Plus discret que son aîné, Bobby n’en était pas moins un séducteur invétéré, qui, par déférence familiale ou patriotisme, restait dans l’ombre, réglait les problèmes politiques et privés de Jack. Marilyn meurt en août après être restée pendant trois jours cloîtrée dans le noir, allongée sur son lit, au milieu de carcasses de poulet, du sang de ses règles et de ses déjections. Bobby s’organise pour que la thèse du suicide par surdose médicamenteuse soit retenue.
Le second semestre 1962 est chaotique. L’escalade entre les deux blocs trouve son paroxysme à l’automne, et il s’en est fallu de peu pour que la Crise des Missiles ne débouche sur un troisième conflit mondial. Nixon n’en croit pas ses yeux. Lui qui avait tant œuvré pour la détente entre les États-Unis et l’URSS découvre, effaré, l’inconséquence des actes du locataire de la Maison-Blanche. Richard Nixon va de dépression en dépression. N’ayant pas digéré son injuste défaite à la présidentielle de 1960, il est le spectateur impuissant d’un mauvais film où l’acteur principal s’amuse à saboter les conditions qu’il avait réunies pour une paix durable entre capitalistes et communistes. Chanceux, Kennedy sort vainqueur de ce bras de fer imbécile. Khrouchtchev finit par proposer des conditions allant dans le sens d’une détente. Jack a encore gagné à la roulette russe. Nixon, le mouton noir, échoue à se faire élire au poste de gouverneur de Californie en novembre 1962. Au lendemain de sa défaite, il déclare à la presse, acquise à son adversaire : « vous n’aurez plus de Nixon pour traîner dans le coin, messieurs, car il s’agit de ma dernière conférence de presse. » Les journaux titrent « Nécrologie politique de Nixon. » Dans sa résidence californienne, loin du regard de sa femme Pat, il pose un révolver sur sa tempe. La main est tremblante et le front ruisselant. Il se ravise puis s’effondre dans son rocking-chair. Sa femme accourt et le prend dans ses bras. Le couple pleure. Dick promet qu’il ne recommencera plus. Pat jure par tous les dieux que l’Amérique est maudite. L’avenir lui donnera raison.
CHAPITRE 3
Le Petit monde de ChrisLeeMuck Fichigan
Le 21 novembre 1962, Chris fête ses 13 ans. La chaleur prodiguée par le poêle et la voix de Miss Quimby lui font aimer ces grises journées d’automne. Jusqu’au lycée, Miss Quimby s’occupe de la classe unique de l’école McKinley, où se côtoient des jeunes gens de six à quinze ans. Les écoles sont intégrées depuis 1954. Toutefois, Blancs et Noirs ne se mélangent pas. Les blancs sont assis côté fenêtre, et les noirs, très majoritaires dans la classe, côté couloir. Depuis les années 1920, des taudis se multiplient, en particulier dans les secteurs est de la ville, que les Afro-Américains ont investis. Du fond de son veston, Chris ressort de temps à autre la feuille de magnolia ramassée quelques années plus tôt dans la rue. Bien conscient que le fait qu’elle ne se soit pas flétrie est anormal, il n’en dit mot à personne et continue de l’admirer régulièrement et jalousement.
–Chris, qu’est-ce que tu fabriques ?
–Rien, Miss, pardon, répond le jeune homme en remisant sa fleur au fond de sa poche.
–Rappelle-moi la date de l’attaque de Fort Sumter, s’il te plaît.
–Oui, Miss, c’est le 12 avril1861.
–D’accord. Tu sais que dans deux ans tu vas au lycée. Il est important que tu sois bien concentré, tout le temps.
–Oui, Miss, je vous demande pardon.
Miss Quimby a la délicatesse de ne pas prendre Chris à défaut. Elle sait qu’il n’aura aucun mal à donner cette date, mais son devoir d’instructrice la contraint de rappeler au garçon les règles sur lesquelles elle ne transige pas, tel que le respect de l’adulte, le respect de l’autre, la discipline, etc.
–Jeunes gens, à partir de demain, nous accueillons trois nouveaux élèves dans la classe. Ce sont trois jeunes filles. Je compte sur vous pour leur réserver le meilleur accueil possible.
–Miss, où allez-vous les installer dans la salle ? demande Stanley.
–Elles seront côté couloir, Stanley.
Les enfants sont conditionnés à ne pas aborder la question raciale de façon frontale et polémique. Jane Quimby n’est que trop consciente des tensions qui enveniment la ville de Détroit, au même titre que le pays tout entier.
–Quel âge, Miss ?
–Reformule ta question, Stanley, s’il te plaît.
–Oui, Miss. Je vous demande pardon, Miss. Quel âge ont les trois filles, s’il vous plaît, Miss ?
–Je préfère cela, Stanley. Je te prie de faire davantage attention à tes prises de paroles intempestives. Laurie-Ann a 14 ans, Sarah, 13 ans, et Guadalupe 8 ans.
Des rires étouffés se manifestent à l’évocation du prénom de la benjamine. Miss Quimby fait claquer sa règle sur le bureau et le silence se fait. Chris Lee écarquille les yeux d’admiration pour son institutrice et rêve, en secret, de l’avoir pour mère. Une mère qui sait alterner la douceur et l’intransigeance, une mère qui parle, qui raconte de belles histoires, qui est capable de le prendre dans ses bras. Une mère qui s’emporte, qui rassure, qui embrasse. Une mère normale, en somme, pas une mère indifférente. Chris se dit que l’indifférence fait partie des pires sentiments qui soit, pour qui en est destinataire, et ainsi l’arme la plus redoutable qui soit pour qui en fait usage. En rentrant chez lui, il sort un vieux carnet à spirale de dessous son matelas, et note cette observation dedans, au milieu de mille autres idées, bouts de poèmes, compilés au fil des ans. Ce soir-là, ni repas, ni gâteau d’anniversaire. Personne ne s’en souvient. Il hésite à placer sa feuille de magnolia dans le carnet, mais finit par se raviser, et la laisse dans la poche de sa veste. Au coucher, il ferme les yeux et récite dans sa tête le poème de Robert Frost, « S’arrêter près des bois un soir de neige ». C’est pour lui le plus beau poème du monde. Il est d’ailleurs, ce soir-là, de circonstance puisque la neige s’empare des rues silencieuses de Détroit. Il sait malheureusement que le lendemain, au moment où il foulera le sol enneigé, les cendres que les fumées auront fait tomber sur le sol souilleront la blancheur virginale du manteau cotonneux. Le garçon profite des instants qui précèdent son sommeil et se recrée un monde, loin de Détroit. Il rêve des grandes plaines du Wyoming, du paysage des Montagnes Rocheuses au printemps, quand tout renaît. Il s’imagine un avenir, simple, modeste, heureux. Écrire de la poésie dans une cabane du Montana, près d’un lac. Chris déteste Détroit. Le jeudi 22 novembre, sur le chemin de l’école, il donne frénétiquement des grands coups de pied dans la neige boueuse, liquide, dégueulasse, et se promet de quitter cet enfer un jour. Les batailles de boules de neige sont interdites dans la cour de l’école. Chris n’a aucun mal à respecter les consignes quand ces dernières émanent de Mademoiselle Quimby. Figée, les bras croisés, le regard dur, elle surveille moins qu’elle ne dissuade, et dissuade moins que son esprit ne s’évade en repensant à la douce soirée de la veille, où, un verre de vin à la main, elle écoutait sur son transistor un des tubes musicaux du début des années soixante, Georgia on My Mind de Ray Charles. Vingt-six ans c’est un jeune âge, mais le célibat est déjà pesant. Elle se dit que le jour où un homme lui déclarera sa flamme de la façon dont Ray Charles crie son attachement viscéral à sa Géorgie natale, elle ne quitterait plus cet homme. Ils se prélasseraient ensemble les soirs d’été interminables sur leur lit double, avec le ciel étoilé dans leur chambre, un ciel qu’ils dévoreraient des yeux à travers leur fenêtre de toit. Cet homme devra être parfait, ouvert d’esprit, intelligent, curieux de tout, romantique, audacieux, et beau comme un arbre. Avec lui elle irait sur les routes du Tennessee, dans une décapotable. Elle retirerait la broche qui retient ses cheveux en un chignon bien convenable. Elle goûterait aux vrais trésors de l’Amérique, dévalerait des collines verdoyantes de Virginie-Occidentale, et échangerait ce baiser langoureux dont elle a toujours rêvé, prise dans le parfum aux notes ambrées que porterait son amoureux.