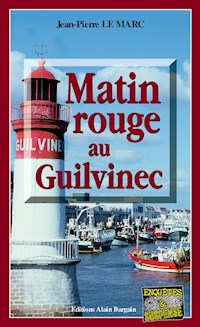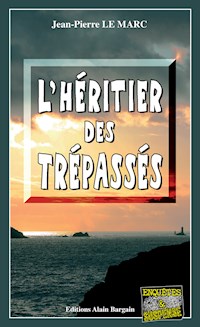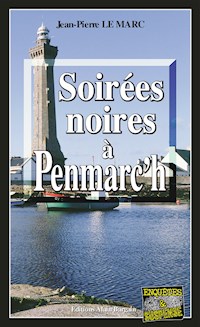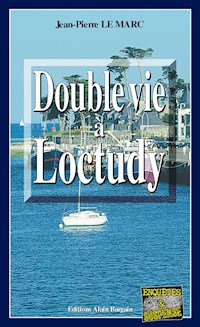
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un marin aguerri fait une mystérieuse et tragique rencontre dans une impasse...
Jean-Gabriel est un homme solide. C'est un marin aguerri. Trente-cinq ans de navigation sur toutes les mers du globe l'ont mis face aux situations les plus diverses. Une étrange silhouette, comme née de la bruine, croisée dans l'impasse familière, va pourtant jeter le trouble dans son esprit. Il va suffire de cette vaporeuse apparition pour bouleverser la quiétude de Loctudy. Notre lieutenant de police Sarah Christmas réussira-t-elle à juguler les miasmes du passé pour rendre à ce petit port sa douceur de vivre ?
Embarquez avec la lieutenant Sarah Christmas dans une troisième enquête des plus troublantes au port de Loctudy, avec ce polar breton palpitant !
EXTRAIT
Depuis une cinquantaine d’années, on évoquait régulièrement ici l’histoire de cette jeune femme, toute vêtue de blanc, que plusieurs automobilistes, dignes de foi, avaient rencontrée la nuit. Une flamme blanche, aux gestes saccadés d’un film au ralenti, agitait le bras au bord de la route. La plupart des automobilistes, inquiets ou croyant avoir rêvé, passaient leur chemin en accélérant. Les plus téméraires ou les plus inconscients s’arrêtaient. D’une voix douce, une jeune femme blonde au teint pâle demandait :
—Je suis en retard. Pouvez-vous me prendre près de vous ?
De tous ceux qui s’arrêtaient, personne n’avait su résister au regard implorant de la jeune femme. Elle montait dans la voiture et s’asseyait sans que le siège ne semble supporter son poids. La portière se fermait toute seule. Un parfum extraordinaire prenait immédiatement possession de l’atmosphère. C’était un mélange subtil de fleur, de miel, d’océan et de ciel. La jeune femme s’enveloppait dans son long vêtement blanc.
— J’ai froid, s’excusait-elle d’une voix douce et étrangement musicale.
— Voulez-vous que je mette le chauf…
Elle rejetait simplement la tête en arrière et se laissait aller…
—Non. Ça ne servirait à rien. S’il vous plaît… Je vais simplement vous dire où me conduire.
Au chauffeur, troublé sinon inquiet, elle indiquait un parcours vers un chemin oublié, menant à un ancien carrefour où l’on ne passait plus souvent.
—Je vous remercie beaucoup, disait alors la jeune femme. Vous êtes très gentil. Voyez-vous, c’est ici que je suis morte, il y a très longtemps, dans un accident de voiture. Un des premiers de l’époque.
Et, dans un grand tourbillon vaporeux, la portière s’ouvrait et la passagère disparaissait dans le néant. Légende, farce macabre ? Nul ici n’aurait eu l’outrecuidance de l’affirmer.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Breton, régionaliste convaincu,
Jean-Pierre Le Marc est né le 27 Juillet 1948 à Larvor, Loctudy (Finistère). Après une solide expérience de l'environnement économique et des relations humaines acquise au sein d'entreprises industrielles régionales, il se consacre depuis des années à une vocation ancienne et forte : le journalisme de terrain. Indépendant de nature et à de nombreux titres, il axe son activité sur des reportages essentiellement basés sur les réussites et les challenges économiques du Grand Ouest, ainsi que sur le patrimoine et la culture bretonne. Passionné d'Histoire, il est, également, depuis son enfance, marqué par la grande aventure de l'Indochine, ses errances et ses souffrances. Il est décédé en mars 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Nous remercions tout particulièrement les Éditions YCA à Quimper pour leur participation (photo de couverture) et vous recommandons leurs magnifiques cartes postales.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
En souvenir de Papa, ce marin au sourire si doux.
À notre Gis, auprès de qui nous retrouvons nos sources maritimes.
À tous mes ancêtres, ces quelques pages… et un gros bisou à travers le temps.
PROLOGUE
Le deuxième coup de masse fit littéralement exploser la porte vitrée. L’alarme aurait beau jeu de sonner dans les locaux de la société de surveillance ou chez les gendarmes. Ils avaient au moins quinze kilomètres à parcourir de nuit avant d’arriver sur place. Quinze kilomètres à une vitesse maximum de cent dix à l’heure. C’était plus de temps qu’il n’en fallait pour franchir la vitre brisée et défoncer les étagères. L’ombre cagoulée, aux mains gantées de cuir, agissait relativement vite. Son souffle était court et sonore. La masse pulvérisa les tiroirs de rangement des médicaments. Des dizaines de boîtes de calmants, de tranquillisants, se répandirent sur le sol. Les mains les enfournèrent rapidement dans le grand sac posé par terre. « Facile, trop facile. J’ai la trouille, bon sang, j’ai la trouille. » Les mots lui roulaient dans la tête comme autant de menaces. La sueur coulait sous sa cagoule. La caméra de surveillance filmait tous les mouvements. L’ombre saisit le sac et la masse et disparut du champ. Elle se hâta vers une voiture garée un peu plus loin. Le moteur ronronnait. Le sac passa dans le coffre et l’ombre s’assit sur le siège de droite.
— Ça a été ? demanda le chauffeur.
— Oui, mais dégage, dégage ! dit la voix essoufflée.
La voiture roulait déjà, mais à vitesse normale. Le chauffeur avait pris une route différente de celle par laquelle viendraient les gendarmes.
— Tut, tut… Tu t’affoles. C’est mauvais pour les nerfs et pour la santé. Vois-tu, dans ces petites pharmacies de campagne, ils ne peuvent pas deviner que, lorsqu’on vient acheter des produits à la gomme, pratiquement invendus, ça permet de repérer les lieux. Surtout si c’est moi qui fais le repérage. Enlève cette cagoule, tu as l’air d’un gangster. Remets ta veste et boucle ta ceinture. Encore un joli coup, n’est-ce pas ? Tu arrives au bout de ton contrat. Tiens, c’est pour toi. Le chauffeur lui tendit une enveloppe de papier kraft. Elle était bourrée de billets de banque. Avant huit heures du matin, la voiture serait garée place de la gare à Quimper, près de l’agence de location. Le plein d’essence serait fait. Les faux papiers qui avaient servi à la louer étaient d’une perfection totale.
— Cent cinquante kilomètres de détour. C’est l’affaire d’une heure et demie. Pas de problème pour les contrôles. Je roule tranquille.
I
Quatre heures du matin. Les rues de Loctudy sont désertes. La bruine et le crachin couvrant la région depuis quelques jours n’incitent guère, il est vrai, aux balades trop matinales. Mi-raisin, mi-tomate, le temps est, à la vérité, plutôt chagrin sur l’Armorique tout entière.
La dépression atmosphérique, enflant il y a quelques jours encore dans le Golfe de Gascogne, était grosse de liaisons célestes, aussi mystérieuses qu’insaisissables. De ses flatulences atlantiques si souvent imprévisibles, naissaient des avatars retors, pondus au gré des vents. Attendait-on le vent, chargé comme une outre de ses pitoyables ivresses ? Ne venaient pourtant que la brume et ses lents cortèges de créatures aux masques mous, ambassadrices d’on ne sait trop quelle tribu céleste. Quel dieu mythique se cachait donc derrière ces perturbations irritantes ? Bien inspiré… qui aurait pu le dire.
Et si la nature, qui, après tout, n’en faisait qu’à sa guise, laissait banalement libre cours à ses dérangements aérophagiques, expectorés à tous les vents de l’univers.
* * *
Errant des Tropiques à l’Équateur, la dernière dépression atmosphérique était d’abord remontée bruyamment vers le nord, en mer d’Irlande*, avant de venir se visser dans l’ouest de l’Atlantique. Là, sur “Ouest Grande sole”, apparemment satisfaite de ses galops océaniques, elle avait, semble-t-il, décidé de mettre bas. On attendait une portée de créatures sauvages ! Il n’y en eut pas ! Pas de tempêtes parcourues d’animaux aux naseaux frémissants, pas de ruades, pas de coups de col des chevaux d’écume. La cavale des grands espaces n’accouchait, banalement, que d’un crachin aussi tenace que désagréable.
La température d’ailleurs était douce et le baromètre prenait des vacances en toute stabilité. La mer, bien que grise et plombée, était d’huile. Fatigué d’une fusion entre métal et ciel, l’océan s’était mis à bâiller.
Ici, on savait donc ce qu’était un véritable temps de chien, et ses prémices ne se résumaient guère en banales brumisations atmosphériques. Et puis, qu’on aime ou pas le temps qu’il faisait, il était là, et personne, en ce bas monde n’avait le pouvoir de l’obliger à changer de costume de cérémonie.
Alors, en cette fin de nuit, accrochées à la bruine en meringues de lumière orange, les lueurs des réverbères pendaient en étranges cordons ombilicaux de sodium suspendus entre le jour et l’ombre.
Les pavés mouillés du trottoir de la rue de Kerlannick absorbaient les bruits des pas de l’homme qui, le col du blouson de mer relevé jusqu’au nez, pestait contre le temps. À la vérité, il détestait le crachin. Dieu savait si, pourtant, les années de mer aidant, Jean-Gabriel avait connu des conditions météorologiques autrement désagréables que ce maillage humide !
En retraite de la Marine Marchande depuis une dizaine d’années, Jean-Gabriel avait naturellement repris du service comme marin-pêcheur. Patron et unique matelot d’un petit canot de six mètres vingt équipé d’un moteur monocylindre de 9 cv, le “Kérillis” hoquetait quotidiennement son « touk-touk-touk » caractéristique. Comme tant d’autres marins, Jean-Gabriel posait ses lignes dans les parages des Glénan et de l’Île aux Moutons. Plus de trente ans de “marmar*” avaient conduit Jean-Gabriel sur toutes les mers du monde. Il connaissait mieux le port de commerce de Yokohama, au Japon, que celui du Corniguel, à Quimper-Corentin.
Jean-Gabriel était un loctudiste de toujours, héritier d’une famille d’agriculteurs goémoniers. La différence était mince alors, entre le marin et le paysan, qui, au gré des saisons ou des circonstances, se penchaient tous deux, au point de n’en faire qu’un, sur le sillon de terre ou d’écume.
À 20 ans, comme tant d’autres, Jean-Gabriel avait fait son service militaire dans la Royale, effectuant son premier tour du monde sur la Jeanne d’Arc : il avait découvert San Francisco, Hollywood, Tokyo, Saïgon… et Elvis Presley était spécialement venu à Honolulu chanter pour l’équipage de “La Jeanne”. Elvis était encore ce mythe vivant qui avait crevé l’écran dans le fameux film en noir et blanc King Creole.
Les escales de la “Jeanne d’Arc” étaient des rêves en pointillés, des photos de calendriers des Postes, des images de livres de géographie. Alors, revenu à la vie civile, Jean-Gabriel savait qu’il ne pouvait plus, comme il l’avait un temps imaginé, jeter l’ancre dans un champ de poireaux.
Appelé par la terre, il était désormais acquis aux voyages transocéaniques. Il devait partir, partir, arpenter l’océan, ne poser son sac que le temps d’une livraison d’engrais à Tanger, d’un chargement de phosphate à Tunis, ou d’un embarquement de machines-outils à New York. Des coques grinçantes de ses débuts aux navires des grandes compagnies, Jean-Gabriel avait tout connu. Il avait subi des tempêtes aux Bermudes, des temps de chien dans l’Océan Indien, des coups de tabac monstrueux sur toutes les mers du monde. Il avait vu se lever des vagues monstrueuses sur la ligne d’horizon, entendu gronder les fauves menaçants des orages tropicaux, mais jamais, au grand jamais, il n’avait pu supporter le crachin.
La retraite venue, sa soif de voyage apaisée, Jean-Gabriel avait, pour achever son histoire en toute sérénité, jeté l’ancre dans son port d’attache de la rue des Merles, dans un petit lotissement, près de la plage de Langoz.
Célibataire, bien retraité, comblé par la vie, il s’amarrait à l’existence avec la satisfaction d’un homme sans problème.
Et c’est sans angoisse particulière, que, ce matin-là, il baignait dans cette atmosphère un peu surréaliste que l’éclairage blafard des lanternes rendait plus étrange encore.
Et puis, il avait ses habitudes. Qu’il pleuve, qu’il vente, que la brume lui brouille le regard ou que le gel lui fige le bout du nez, ses premiers pas le menaient invariablement sur la digue de Langoz où, à la belle saison, dans l’ombre fuyante, il prenait un plaisir infini, presque primitif, à voir apparaître la roche et la tourelle de Men Bret alors que scintillaient encore les feux des nombreuses balises et tourelles qui ceinturaient la baie. Face à lui, par beau temps, les îlots des Glénan émergeaient de l’océan comme un formidable sous-marin de légende. C’était un spectacle à contempler aux jumelles, entre jour et nuit, quand le phare des Moutons et la tourelle de Fort Cigogne, que l’on ne pouvait qu’imaginer ruisselants d’eau, remontaient, à l’aube, de leur voyage quotidien dans les fonds marins. Les îles n’étaient pas des rejets de l’océan. Elles étaient ses enfants naturels, ceux que créaient les dieux de la mer et du ciel dans leurs unions sauvages.
* * *
Quelques cris d’oiseaux de mer étouffés par la bruine remontaient du port. Ils rappelaient immanquablement ces appels effrayants que les légendes bretonnes prêtent aux âmes de disparus égarés dans leur errance vers l’éternité. Un promeneur imaginatif ou aux nerfs un peu fragiles n’aurait d’ailleurs pas manqué de réprimer un frisson.
Mais il fallait bien plus que ce décor de film glauque pour effrayer un homme comme Jean-Gabriel. Il fallait autre chose que les cris d’une bande de mouettes pour l’impressionner. Il passa sous un lampadaire. La rue de Kerlannick baignait dans une atmosphère un peu étrange, celle d’un mélange d’ombres ouatées et de crachin tenace. Jean-Gabriel avait hâte de retrouver les lumières scintillantes du port, ces balises pour un nouveau départ. Il était pressé de prendre le large.
— On y arrive, murmura-t-il comme chaque matin, tout à la hâte de gagner son bateau.
Comme tous les marins, il était captif d’un sentiment indéfinissable face à la mer. L’océan exerce un magnétisme incomparable sur les esprits. Il faut savoir s’accorder à lui mais aussi s’en méfier en permanence. Sous la mer la plus plate se cachent les pièges les plus imprévisibles. La mer est une carnassière, dévoreuse d’hommes, de coques, de mécaniques. N’en faisant qu’à son humeur, elle réduit à néant en quelques instants, les plus grands calculs mathématiques, les meilleures équations, les plus belles épures des plus beaux navires. Une différence de quelques dizaines de millibars au baromètre, peut se traduire par la plus fabuleuse tempête ou le calme le plus plat.
Débouchant soudain de l’impasse Francis Kornbout*, une forme sembla s’animer au fond de la ruelle. Jean-Gabriel s’en étonna. Il ne croisait jamais personne à cet endroit à une heure aussi matinale, durant la petite demi-heure qui le menait au port. Jean-Gabriel s’aperçut que la forme, d’abord indistincte et qu’il avait crue immobile, venait lentement vers lui dans une crucifixion hallucinante. Il rentra le cou et, instinctivement sur la défensive, sortit les mains des poches de son blouson. La forme, enveloppée dans une tulipe de soie blanche, semblait évoluer au-dessus du sol. Alors, Jean-Gabriel vit s’approcher de lui une silhouette blanche, diffuse, fantomatique. Le crachin ne détrempait pas encore les plis d’un ample et long vêtement blanc surmonté d’un visage aux longs cheveux blonds.
Jean-Gabriel sentit se hérisser les poils de ses bras. Pour la première fois de son existence il ressentit la peur, la frayeur viscérale, incontrôlable.
— M…, la Dame Blanche !
Les bras en croix, le fantôme, revêtu de ce grand suaire avançait désormais dans un silence absolu. Jean-Gabriel n’entendait même plus les cris lointains des mouettes. La Dame Blanche, cet ectoplasme, ce fantôme de légende, cette manifestation de l’au-delà… était là, face à lui !
Depuis une cinquantaine d’années, on évoquait régulièrement ici l’histoire de cette jeune femme, toute vêtue de blanc, que plusieurs automobilistes, dignes de foi, avaient rencontrée la nuit.
Une flamme blanche, aux gestes saccadés d’un film au ralenti, agitait le bras au bord de la route. La plupart des automobilistes, inquiets ou croyant avoir rêvé, passaient leur chemin en accélérant. Les plus téméraires ou les plus inconscients s’arrêtaient. D’une voix douce, une jeune femme blonde au teint pâle demandait :
— Je suis en retard. Pouvez-vous me prendre près de vous ?
De tous ceux qui s’arrêtaient, personne n’avait su résister au regard implorant de la jeune femme. Elle montait dans la voiture et s’asseyait sans que le siège ne semble supporter son poids. La portière se fermait toute seule. Un parfum extraordinaire prenait immédiatement possession de l’atmosphère. C’était un mélange subtil de fleur, de miel, d’océan et de ciel. La jeune femme s’enveloppait dans son long vêtement blanc.
— J’ai froid, s’excusait-elle d’une voix douce et étrangement musicale.
— Voulez-vous que je mette le chauf…
Elle rejetait simplement la tête en arrière et se laissait aller…
— Non. Ça ne servirait à rien. S’il vous plaît… Je vais simplement vous dire où me conduire.
Au chauffeur, troublé sinon inquiet, elle indiquait un parcours vers un chemin oublié, menant à un ancien carrefour où l’on ne passait plus souvent.
— Je vous remercie beaucoup, disait alors la jeune femme. Vous êtes très gentil. Voyez-vous, c’est ici que je suis morte, il y a très longtemps, dans un accident de voiture. Un des premiers de l’époque.
Et, dans un grand tourbillon vaporeux, la portière s’ouvrait et la passagère disparaissait dans le néant. Légende, farce macabre ? Nul ici n’aurait eu l’outrecuidance de l’affirmer.
Tout était possible dès lors que l’on évoquait le trépas. Le char de l’Ankou, sinistre messager de la mort, avait alimenté les veillées durant des décennies. Les voix déchirées des vieux conteurs rappelaient de tout temps le défilé des âmes hurlant leur détresse des nuits durant. Les femmes, les enfants, terrifiés, s’avançaient tremblants vers la lumière des chandelles ou le feu de l’âtre. Alors, les yeux du vieux, assis au bord de l’âtre, brillaient d’un éclat étrange. Il crachait dans le feu pour conjurer le mauvais sort. Chacun se signait, alors que s’installait un silence inquiétant : l’Ankou venait frapper à la porte.
— Il arrive. L’Ankou est là ! Écoutez ! On entend grincer les roues de sa charrette.
Chacun entendait ce qu’il voulait et, à la terreur succédait l’épouvante. Dans le silence de la nuit, venus de nulle part, bruissaient des milliers de battements d’ailes.
— Ce sont ses oiseaux, disait le conteur. Il y aura un mort dans le hameau demain matin.
Les vieux marins, quant à eux, connaissaient mieux le “Bag Noz”, le terrible “bateau de nuit” de l’Ankou : le “Bag Noz”, qui ne naviguait que de nuit et par un épais brouillard, était mené par un terrible capitaine, le premier mort de l’année. L’équipage – marins à la peau parcheminée, aux yeux vides, aux visages décomposés, portant chacun un corbeau sur l’épaule – manœuvrait sous le regard de l’Ankou, armé de sa faux. La longue barque pontée glissait silencieusement dans le brouillard. Accostait-elle dans un port, que des ombres mystérieuses surgissaient du néant et, empruntant une passerelle invisible, embarquaient pour l’éternité. Un cri lugubre retentissait parfois – celui de l’Ankou, donnant un ordre de manœuvre – alors que des grincements de poulies annonçaient le départ du navire vers l’au-delà. Une odeur de charnier couvrait celle de l’air marin. Malheur à celui qui, l’âme noire d’hypocrisie et de malfaisance, croisait le chemin de l’Ankou dans les lueurs rougeâtres et la brume du soleil levant. Il devait alors s’apprêter à affronter les tourments de la nuit éternelle.
* * *
Jean-Gabriel n’avait pas eu le temps de réfléchir. La forme vaporeuse était déjà là, face à lui. Elle le frôla et ses yeux grands ouverts se tournèrent lentement vers le marin, cloué au sol par la peur et la surprise. C’était une jeune femme au visage très pâle aux très longs cheveux flottant sur les épaules. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres.
— Viens, suis-moi, dit-elle d’une voix très douce, une de ses mains, dans un mouvement lent de battement d’aile de mouette, tentant de l’attirer vers elle. Terrorisé, Jean-Gabriel recula.
La forme continua à avancer dans le brouillard et ses bras s’étendirent de nouveau de chaque côté de son corps. C’est avec la même lenteur irréelle que son visage regarda une dernière fois le marin. « Viens, viens, accompagne-moi là-bas ! », disait elle d’une voix traînante. « Là-bas, là-bas. » Elle se mit à rire, le brouillard l’enveloppa.
Une terreur panique, primale, s’empara de Jean-Gabriel. Terrifié, il courut jusqu’à la criée comme il n’aurait jamais cru pouvoir courir de sa vie. Les poumons déchirés par l’effort, il ne s’arrêta qu’une fois arrivé sur le quai étrangement désert. Il longea la Coopérative maritime, les ateliers de mécanique et les magasins de marée, regardant longuement autour de lui. Il se remit à courir sur le quai Rémy Le Lay. Deux minutes plus tard, ses pas sonnaient sur le ponton. Il franchit d’un bond le franc-bord de son navire. Ses mains fouillèrent fébrilement ses poches à la recherche de ses clés. Il les trouva enfin, et, trempé de sueur et de crachin, s’enferma à double tour dans la passerelle.
— Bon sang, ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! haleta-t-il enfin, au bord de l’asphyxie.
* * *
Quelques jours plus tard, l’attention de Jean-Gabriel – évidemment remis de ses émotions – fut attirée par un article signé G.L.M. dans le journal local. Un petit reportage évoquait l’arrivée à Loctudy, rue Francis Kornbout, d’Angélique Dumontel, une généalogiste professionnelle qui, disait l’article, possédait une belle réputation dans son milieu. « Ma famille est d’origine française. J’ai beaucoup voyagé et vécu à l’étranger avant de m’installer à Paris. J’ai voulu me spécialiser dans tout ce qui touche à l’Amérique latine. Je m’adresse essentiellement à des professionnels… », confiait-elle à la journaliste. « Les gens sont souvent surpris de découvrir des trajets inexplicables de leur famille. Savez-vous que certains noms, apparemment très bretons, sont, en réalité, originaires du Nord de la France. Le XVIIe siècle était très demandeur de verriers sur le littoral, où l’on préparait la soude, utilisée dans cette industrie. »
Lassée du bruit, du trafic mécanique, du confinement dans les enceintes de béton, Angélique avait choisi de quitter Paris pour s’installer à la pointe de la Bretagne.
« Mon père m’a parlé de Loctudy, il y a quelques années. J’ai trouvé plusieurs sites sur internet. Grâce au web d’ailleurs, je suis en contact permanent avec des généalogistes du monde entier. Je désire rester ici. Je ne peux plus vivre dans une grande cité… », expliquait-elle.
— Alors ça ! s’exclama Jean-Gabriel, c’est fantastique. Mais c’est ma Dame Blanche !
Le marin n’avait soufflé mot de son étonnante rencontre. Sa première frayeur passée, il avait rapidement retrouvé… ses esprits. Dix minutes plus tard, il prenait la mer et oubliait cette affaire. Le lendemain matin, il repassa d’ailleurs à l’heure habituelle dans la rue de Kerlannick, sans faire de rencontre. Seul, un lampadaire éclairait le fond de l’impasse Francis Kornbout, déserte. Il sourit de sa frayeur passée.
Mais, étant un brave homme, il s’était pourtant inquiété de savoir si, après sa fuite précipitée, la “Dame Blanche” n’avait pas eu d’accident.
« On l’aurait trouvée, ou quelqu’un l’aurait recherchée… », pensa-t-il.
Il tenta de se rassurer. « Elle a dû rentrer à la maison. »
Ses sentiments, pourtant, étaient partagés entre souci de discrétion et inquiétude. Se répétait-il que tout cela ne le regardait pas, une pensée l’obsédait cependant : « Elle pourrait tomber dans le port… ou se casser une jambe sur les rochers à la marée montante. Ah ! Et de quoi aurais-je l’air alors que j’étais au courant ? »
Bien que n’ayant aucune responsabilité dans l’affaire, il estimait se trouver moralement dans une situation de non-assistance à personne en danger. Cette idée le culpabilisait d’autant plus que personne n’avait évoqué une telle mésaventure dans le quartier du port.
— Ah ! Ça m’embête, râla-t-il.
Pesant longuement le pour et le contre, il prit, le soir même, une décision irrévocable : dès le lendemain matin, il irait voir cette inconnue dont il avait désormais l’adresse et lui expliquerait tout.
Ceci étant, il dîna de bon appétit d’un plat de spaghettis devant un western des années soixante, un genre dont il était friand. Les exploits de “Big Jack” et ses chevauchées fantastiques à la poursuite des desperados le passionnaient. Les héros dégainaient leur Colt six coups “peacemaker” à la vitesse de l’éclair, perçant une pièce de dix cents jetée en l’air à quinze pas. La célèbre Winchester au pontet de cuivre brillant crachait ses balles à une cadence désormais légendaire. La sueur, les cris, la poussière, les ricochets du plomb sur les roues des charrettes faisaient vibrer l’air. Des bourdons métalliques de calibre 38 faisaient éclater les portes des saloons. “Big Jack”, le plus rapide, soumettait les desperados. Un shérif au menton volontaire mettait les bandits en cellule avant de les conduire jusqu’au pénitencier. Aventurier de la prairie et des villes du Far West, “Big Jack” rechargeait calmement son arme, un prototype de Bergman 1901, avant de crier un puissant « Hiaooh ! » au conducteur de la caravane. Les fouets claquaient au-dessus des croupes des chevaux. Sous le soleil levant, la longue colonne se mettait en route, les regards braqués vers la lointaine Californie ou le Wyoming.
* Dans la Zone VII a, entre l’Irlande et l’Angleterre, un secteur météorologiquement perturbé et bien connu des marins.
* Marmar : La Marine Marchande si chère au cœur de tous les Bretons.
* 1872-1973. Botaniste et ingénieur franco-hollandais, inventeur d’un célèbre modèle de corne de brume.
II
Le lieutenant de Police Sarah Christmas, entrée dans la police après son diplôme de Droit, était une belle jeune femme aux yeux d’un vert très pur, aux cheveux châtains coupés court. Son grand-père, Abraham Christmas, maraîcher en Cornouaille anglaise, avait, par son fils, le père de Sarah, fait souche à Saint-Pol-de-Léon, en Bretagne, trente ans auparavant. Sarah était la gentillesse même. Si sa profession la mettait en présence de situations dramatiques, elle ressentait toujours la même souffrance face à la détresse humaine.
La fréquentation quotidienne de la tragédie, de la déchéance, du malheur des autres, la marquait invariablement.
Si les dérives de l’âme pouvaient prendre des voies diverses, elles se distinguaient, hélas, trop souvent, par des actes épouvantables. Encore jeune pourtant, Sarah avait, depuis quelques années, été confrontée à tout ce que l’homme, depuis sa création, inexplicablement aspiré par sa furie destructrice, invente pour nuire à son prochain.