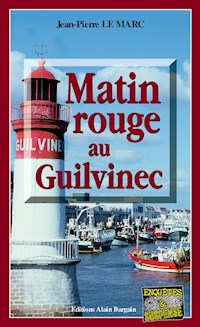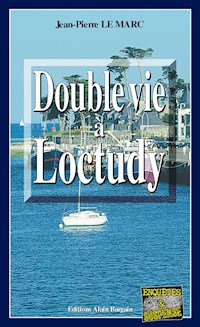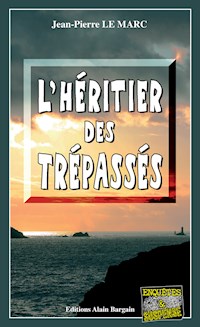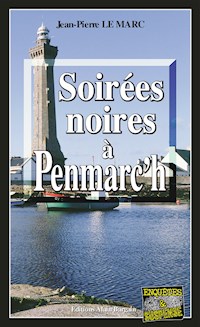
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Des faits étranges ont lieu une nuit près d'un phare dont le sommet est habité par des corbeaux...
Jeanne Toussaint trottine plus qu'elle ne marche. La nuit tombe assez vite et elle préfère être rentrée avant qu'il ne fasse noir. Et puis, elle n'aime pas ces corbeaux qui, depuis quelques temps, se sont installés au sommet du phare, comme s'ils avaient décidé que tout ce qui passait sous leurs ailes, leur appartenait. Les corbeaux, même s'ils n'étaient que de banales corneilles, avaient ici mauvaise réputation. On les affublait, mais qui sait pourquoi, de pouvoirs maléfiques. On liait leur présence à des fins tragiques, leurs cris à des appels d'âmes en détresse. Jeanne hâte le pas. Le phare lance ses premiers éclats vers le large. Les corneilles, lasses de suivre cette ombre pressée qui ne les intéresse pas, vont se poser au-dessus de la lanterne. Demain matin le lieutenant de police Sarah Christmas marchera dans ses pas...
Suivez la lieutenant de police Sarah Christmas à Penmarc’h pour le second volet de ses enquêtes trépidantes, avec ce polar breton empli de mystères et de suspense !
EXTRAIT
Le témoignage, involontaire mais déterminant d’Isidore dans la découverte de la cache, lui donnait une importance nouvelle. N’étant pas informé de la découverte des restes de Jules, il ne pouvait, bien sûr, prendre la véritable mesure du drame. Restait la mort de Jeanne dont nul n’aurait pu dire si elle avait un rapport avec ces anciennes affaires fétides…
— J’ai pensé à autre chose concernant Jeanne et Marie-Héloïse, à tout ce qui a pu se passer à l’époque, s’était peu après rappelé Isidore. Je ne sais comment vous dire mais…
— Mais ?
—Ça concerne la vie privée d’un certain nombre de personnes, s’était-il risqué. Alors, avant de vous en parler, il faut que je vous fasse voir quelque chose. Il puisa dans un meuble, deux ou trois albums aux couvertures vieillottes et une collection de cahiers d’écoliers, aux allures de pièces de musée.
— J’aurais aimé être historien local, avoua-t-il à Sarah, mais je n’en ai jamais trouvé le temps. Alors j’ai gardé tout ça…
Des dizaines de photos conservaient dans leur mémoire de sulfite de sodium, les regards, les âmes, d’hommes et de femmes, aujourd’hui transformés en poussière. Une fraction de seconde et une banale surface sensible de celluloïd suffisaient à arrêter les rouages du temps, à ranimer les visages, à raviver les rires, les tristesses, les joies, les peines. Sarah aimait se pencher sur ces traits d’inconnus, ces hommes, ces femmes, que le destin avait fait naître si longtemps avant elle et qu’elle ne rencontrerait jamais.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Belle description de cette Bretagne à Penmarc'h et de ses habitants. Un moment d'évasion ! -
Bob Darwin, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Breton, régionaliste convaincu,
Jean-Pierre Le Marc est né le 27 Juillet 1948 à Larvor, Loctudy (Finistère). Après une solide expérience de l'environnement économique et des relations humaines acquise au sein d'entreprises industrielles régionales, il se consacre depuis des années à une vocation ancienne et forte : le journalisme de terrain. Indépendant de nature et à de nombreux titres, il axe son activité sur des reportages essentiellement basés sur les réussites et les challenges économiques du Grand Ouest, ainsi que sur le patrimoine et la culture bretonne. Passionné d'Histoire, il est, également, depuis son enfance, marqué par la grande aventure de l'Indochine, ses errances et ses souffrances. Il est décédé en mars 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Nous remercions tout particulièrement les Éditions YCA à Quimper pour leur participation (photo de couverture) et vous recommandons leurs magnifiques cartes postales.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Marie-Hélène et Patrick, Pour notre amitié de granit.
I
Automne. Lundi soir.
Jeanne Toussaint frissonna. Comme souvent ici, elle redoutait les intersignes, ces sinistres annonces d’une mort prochaine, ces croyances lointaines profondément ancrées dans l’âme bretonne. Aussi loin que puisse remonter la mémoire, la tradition, l’histoire, la littérature même, évoquaient les appels du trépas. Ils pouvaient prendre des formes diverses : bruits, cris, souffles étranges, sensations indéfinissables, passages d’animaux… mais, à chaque fois, pour ceux qui y croyaient, leurs manifestations ouvraient à une âme humaine les portes de l’Éternité. Alors, Jeanne, soixante-huit ans, se signa deux fois en passant devant la croix de granite plantée sur la chapelle. Elle pensa à tous ceux qu’elle connaissait et qui, atteints de maladies plus ou moins graves, ne tarderaient pas à trépasser.
— “Ils” sont là pour ça, murmura-t-elle en accélérant le pas, elle qui, d’ordinaire, trottinait plus qu’elle ne marchait.
Car, comme chaque soir, “ils” venaient voler devant elle, la défiant de leurs regards perçants, si incisifs qu’ils semblaient capables de pénétrer le tréfonds de son âme. Des heures entières, ils pouvaient demeurer immobiles comme des statues, figés dans leurs robes noires et soyeuses, plantés en inquiétants gardiens de la vieille chapelle collée à l’ancienne tour à feu, entre le sémaphore de la Marine et le phare de Penmarc’h. Ce n’est qu’à la nuit venant, que les corbeaux faisaient une ultime inspection de leur royaume, celui qu’ils disputaient à coups d’envolées râleuses aux oiseaux de mer. Jeanne se trompait d’ailleurs quand elle imaginait qu’il s’agissait de corbeaux, ces animaux quasi-mythiques dont l’espèce avait été décimée au fil des ans. A r Vran, « corvus covax », le grand corbeau, omniprésent dans la symbolique de toutes les mythologies celtiques, ne trouvait guère plus refuge que dans les falaises littorales escarpées de Goulien, dans le Cap-Sizun, dans celles de Crozon ou de Camaret ou, encore, dans quelques sites légendaires de la Bretagne intérieure.
Les oiseaux qui l’inquiétaient tant, n’étaient donc que de simples corneilles de cheminées, irritées ou intriguées par l’arrivée régulière de cette promeneuse tardive. La corneille d’ailleurs, contrairement aux légendes qui circulent sur son compte, n’est guère qu’un gros passereau inoffensif, aisément domesticable, et qui aime – jusqu’à s’installer dans les familles – la compagnie des humains. Douée d’un talent d’imitateur hors pair, elle sait, comme nul oiseau peut-être, transformer ses résidences en véritables fosses d’orchestre.
Les corneilles du phare de Penmarc’h, qui y avaient élu domicile depuis peu, craillaient donc, apparemment agressives mais seulement curieuses, plongeant en vols tournoyants vers cette intruse solitaire qui, à pas pressés, franchissait impudemment les frontières de leur territoire. Un coup d’aile les posait sur la coupole blanche du phare, tout là-haut, à moins qu’il ne les niche, par on ne sait quel miracle d’équilibre, dans le creux moussu d’une ouverture de la tour de pierre.
Elles allaient au gré de leurs envies, solitaires ou en tribus, ces commères impénitentes que rien ne semblait pouvoir faire taire et qui étaient, il faut l’avouer, curieuses comme… des pies.
Un cerveau de corneille ne fait, d’ailleurs, guère la différence entre la mouette tridactyle ou le goéland argenté, et une passante habillée de gris. Gardiennes d’on ne sait quel royaume, elles craillaient ici comme elles auraient pu aussi bien le faire d’une gargouille de cathédrale ou d’un créneau de la tour de Nesle. Vêtues de leur robe sombre, comme les juges de l’instant ultime, elles auraient pu figurer au cœur de décors de cauchemar dans lesquels, encadrés de cierges de pierre, des autels dressés dans des étendues infinies, auraient ruisselé de lueurs surnaturelles. Noires comme les plus ténébreuses des nuits, les corneilles évoquaient immanquablement, pour Jeanne, les sinistres juges de l’Inquisition, ces terribles religieux qui, d’un geste, condamnaient ceux qu’ils carbonisaient au nom de Dieu…
Si ces images anciennes baignaient pour Jeanne dans un certain flou, elle demeurait cependant sensible aux superstitions diverses qui marquaient à jamais sa conscience.
Très tôt orpheline, elle avait été élevée par deux cousines maternelles, sa seule famille, pingres, riches, mauvaises comme des teignes. Comme elles d’ailleurs, Jeanne était mauvaise, mauvaise de cette malfaisance qui, trop souvent, trouble la quiétude, au cœur de certaines sociétés. Le caractère, les modes de vie forgent parfois la parole comme la lame empoisonnée d’une épée, cette arme redoutable dont, partout au monde, on use, hélas, trop souvent, à merci. La calomnie, ici comme ailleurs, allait toujours bon train. On surveillait le voisin, la voisine, leurs enfants, leurs cousins et surtout la bru, cette engeance qui, si elle n’était pas de la région, pouvait se révéler capable de tout. Les corneilles de la côte, dont les alliances évoluaient au fil des événements, déchiraient allégrement à grands coups de bec, ceux et celles qu’elles jalousaient. Mais on ne criait rien ni ne le déballait sur la place publique, sous peine de retour de bâton. En réalité, tout était murmuré, soufflé à demi-mot, susurré en insinuations ponctuées de grimaces expressives. Jeanne, qui lisait depuis toujours la presse locale, regrettait, d’ailleurs qu’elle ne soit plus précise. Qu’on n’y trouvât pas, par exemple, deux pages sur sa commune, des ragots, des cancans, bref tout ce qu’elle imaginait se passer chez les autres.
Dans le pays, on était “rouge” ou “blanc” et Jeanne, élevée par des cousines bigotes, n’était pas vraiment révolutionnaire ! L’industrie de la conserve pourtant, dès la fin du XIXe siècle, avait souvent mis le pays en émoi et les rapports de la gendarmerie nationale de Pont-l’Abbé, appartenant au 11e Corps d’armée, 11e Légion, font état de confrontations vigoureuses. « En ce mois de mai 1897 la région connaît une grande effervescence » dit un commentaire officiel qui n’est pas sans rappeler les événements de 1896 où cinquante soudeurs-boîtiers syndiqués des usines Amieux, Cassegrain, Rondeau et Tillot de Saint-Guénolé, ont voulu empêcher de travailler ceux qui ne l’étaient pas. « Un sieur Peigné a été arrêté sur la route de Penmarc’h à Saint-Guénolé par une bande de dix hommes… et durement frappé par l’un d’entre eux » souligne le rapport. L’usine Tirot d’ailleurs, qui avait embauché un contremaître ferblantier nantais, n’eut pas le temps d’apprécier ses services : les soudeurs-boîtiers dès son arrivée, le mirent dans une voiture, lui payant le retour à Nantes.
Un autre ferblantier, douarneniste, fut, raconte la chronique, malmené et rossé. Un troisième, venu du Guilvinec, « poursuivi par une bande sur la route de Kérity à Penmarc’h » ne dut son salut qu’à sa vitesse à la course. Alors que l’on parlait déjà de “complot”, monsieur Guiziou, maire de Penmarc’h, adressa au Préfet, sous le numéro 96, le télégramme suivant : « Situation calme – ouvriers et patrons ont dû avoir réunion hier soir pour entente – Envoyez gendarmes – Veillez. » Un séjour des forces de l’ordre à l’Hôtel de Bretagne s’éleva à 124,15 Francs, note que présenta l’hôtelier au Conseil municipal, mais celui-ci considéra que la somme ne devait pas être à sa charge… et refusa de payer.
Jeanne n’était, certes pas, l’héritière des contestataires. Confrontée comme chacun à l’inconnu, elle pensait d’ailleurs que sa comparution devant l’Éternel ne serait pas celle que l’on réserve à ces mécréants et autres athées qui, brandissant le drapeau rouge, clamaient : « Vive l’Anarchie ! »
Un peu rassurée sur le sort de son âme, ce n’était pas sans un frisson désagréable, cependant, qu’elle repensait parfois à ces horribles taolennou, les tableaux de mission de son enfance, peintures horribles de cruauté que les religieux promenaient d’église en église, promettant aux hérétiques les plus horribles supplices de l’éternité. Crachant le feu purificateur, des tribus de diables à la queue fourchue menaient d’effroyables sarabandes autour des pécheurs embrochés ou suspendus à des crochets de boucher et promis à une agonie sans fin, dans les flammes d’un immense bûcher.
Veuve depuis très longtemps, Jeanne Toussaint priait parfois pour l’âme de Jules, son mari tragiquement disparu en mer qui, lui, n’était pas croyant, ou seulement au gré des circonstances et des obligations légales. En vérité, Jules Toussaint aimait tout ce que la religion dénonçait. Le samedi et le dimanche, il jouait aux cartes, un des plus grands périls où risquait de sombrer l’âme humaine ! Les cartes, les dominos, les jeux de boules… le café – an ostilli – étaient, pour qui s’en tenait aux canons de la morale du temps, les marches de l’abîme où menait la faiblesse humaine.
Jeanne était propriétaire d’une petite épicerie-mercerie à Saint-Pierre, une maison à vitrine ancienne entre le 677 route du Phare et le magasin d’été de la Coopérative maritime.
***
Ce soir-là donc, Jeanne Toussaint, comme elle le faisait chaque jour après avoir fermé son commerce, s’engagea, au pied du phare, dans la rue des Naufragés du 23 mai 1925. Le chemin longeait la grève, débouchant entre les rues Ar Gored et Runavalen. C’était un endroit calme. De sobres et belles maisons de pierre du XIXe siècle soulignaient l’attachement de l’homme à la mer. La tempête, ici, n’était pas prétexte à évocations poétiques chantant les abysses marins, mais bien un déchaînement fantastique des éléments. Elle avait, bien des fois, décimé la population vivant au pied du phare. Poussées par on ne sait quelle formidable mécanique, les vagues roulaient sur les hauts fonds rocheux, envahissant les jardinets, balayant les poulaillers, inondant les maisons, noyant les ruelles ! Annales et chroniques relatent ces effroyables agressions de l’océan, ces raz de marée recouvrant la campagne jusqu’aux marais de la Joie et ceux de Lescors.
Jeanne jeta un regard rapide vers la mer qui découvrait très loin vers Grouiez Braz. Dans le soir venant, des blocs de rochers parallélépipédiques évoquaient les restes d’anciennes forteresses marines, comme si, autrefois, l’homme avait élevé là des murs destinés à le protéger de l’océan.
Il faisait sombre déjà, et les suites de la tempête de fin de semaine faisaient craquer le ressac et moutonner la marée basse. Il arrivait souvent qu’en début d’automne une dépression heurte de front l’anticyclone, créant de petites perturbations qui pouvaient aussi bien annoncer un bel été indien que le plus détestable des mauvais temps. La Bretagne littorale était ainsi, riche de ses différences, digne et capricieuse, câline ou surprenante, seule maîtresse de ses outrances imprévues.
Jeanne poussa encore le pas. Derrière elle, le phare, cette gigantesque bougie de pierre, lançait ses premiers feux, rappelant aux marins la présence des écueils et des brisants qui les guettaient à fleur d’écume.
Les corneilles s’étaient lassées de Jeanne. Après leurs derniers craillements moqueurs, elles s’étaient installées sur la lanterne, tout là-haut, attendant dorénavant on ne sait quel visiteur ailé importun qui viendrait les déranger à la nuit tombée.
II
Le matin suivant.
Victor Chapalain, un gaillard de belle taille, avait passé un peu plus de vingt-cinq ans dans le service de santé de la Marine nationale, y achevant sa carrière comme infirmier-major. Âgé de cinquante-cinq ans aujourd’hui, Victor était un homme d’environ un mètre soixante-dix-sept, bon vivant, bien portant, au front dégarni et au ventre rond. C’était un personnage attachant, excessif parfois, mais un homme sympathique et habile, au cœur sur la main, un “débrouillard” qui ne rechignait jamais à la peine pour aider les autres. Comme la majorité de ses amis, Victor aimait les célébrations de la vie, les soirées en chansons, les dimanches en chaussons. Après avoir fait plusieurs tours du monde sur les bâtiments de la Royale, il était venu s’installer au pied du phare de Penmarc’h.
Durant sa carrière militaire, il n’avait eu qu’une idée en tête, une idée fixe : arriver en bonne santé à la retraite et, enfin, se livrer à sa passion dévorante, l’élevage de lapins. Depuis quelques années donc, il était à la tête d’un élevage d’une centaine de bêtes qui accaparait le plus clair de son temps. Du lever du jour au coucher du soleil, il ne vivait que pour ces boules de poil aux longues oreilles dont il surveillait la santé et la croissance avec un soin attentif. Craignant, comme la peste, la « maxi », comme le disaient parfois certains, la myxomatose, cette maladie vénérienne des lapins importée d’Australie en Europe, il contrôlait, vaccinait ses bêtes avec l’attention d’un vétérinaire patenté. Il les nourrissait également avec tout le soin d’un éleveur professionnel. Les grosses carottes de sable de la Torche, comme les arsken lez, les « os de lait », ces plantes cousines du pissenlit qui, lorsqu’on les cueille, laissent couler un jus blanchâtre, faisaient le bonheur de ses pensionnaires.
Victor nourrissait également les quelques lapins qu’élevait Jeanne Toussaint. Tous deux étaient, en réalité, petits-cousins germains, par l’intermédiaire du père de Jeanne, Ferdinand, décédé en août 1922, dont le frère, Marcel, son oncle, mort durant la guerre 39-45, avait, en avril 1934, épousé Albertine, sa belle sœur déjà veuve sans enfants et nièce de Marie-Josèphe, une cousine par alliance de Victorine, sa mère, dont l’oncle avait autrefois été marié à sa marraine. Une relation familiale qui, pour être complexe, n’en était pas moins proche et solide.
Vers 8 heures 45 donc, ce matin-là, alors que depuis le milieu de la nuit, tombait un crachin familier, Victor, passant par la grève, comme il en avait l’habitude, poussa la barrière de bois du jardin de sa cousine, 7 impasse Valentin Lucachenn, du nom de l’inventeur de la célèbre lampe-tempête. Il sema au vent d’ouest quelques borborygmes et relents du bouillon de pot-au-feu que, depuis des années, avant une tartine garnie de harengs, il avalait chaque matin en guise de petit déjeuner. Ses voies nasales, obstruées par une sinusite tenace, se libérèrent brusquement en un éternuement puissant. Comme de nombreuses personnes, Victor souffrait de ce mal chronique qui le prenait dès la fin de l’été, et qui, par périodes, lui plantait un iceberg dans le crâne. Il s’en soignait d’inhalations aux odeurs âcres, une médication ramenée de l’armée, aux dates de péremption dépassées depuis belle lurette. Victor faisait bouillir ces lanières de feuillage de Guyane épaisses comme des copeaux de châtaignier qui, cuites à point, se transformaient en une vague pâte à papier aux vertus réputées anti-sinusitales. Victor ne doutait pas une seconde des effets bienfaiteurs du traitement, quand bien même le prenaient des crises aiguës d’éternuement.
« Les anciens, pensait-il, se mettaient du tabac à priser dans les narines. Je ne me souviens pas avoir vu mon grand-père ni mon arrière-grand-père enrhumés. Et pourtant, Dieu sait s’ils éternuaient ! »
Et il se demandait régulièrement si l’association des deux traitements, celui de la Royale et celui de ses ancêtres, n’atteindrait pas enfin le but recherché : lui déboucher à jamais les voies nasales. Il respira très fort mais, bien que puissantes, les senteurs marines ne parvenaient qu’atténuées à ses sens perturbés. Mais, foin de ces détails ! Il parcourut à grands pas l’allée du jardin.
Jeanne, qui ouvrait son petit magasin de la rue du Phare à 8 heures 30, quittait sa maison vers 8 heures 05, un rite depuis qu’elle tenait commerce.
Elle habitait une grande construction bigoudène, néo-traditionnelle, que ses cousines lui avaient fait bâtir juste avant ses fiançailles. C’était une maison bien trop vaste pour elle, le type de construction que certains élevaient parfois, à l’époque, dans les années cinquante à soixante, non seulement par besoin d’espace, mais aussi pour révéler leur aisance ou s’acheter femme ou mari. Le marbre ou ses imitations, les rampes ouvragées, le chêne des cuisines, la fausse cheminée, les vitraux colorés et, surtout, la pierre de taille, se voulaient, en la circonstance, les témoins de l’aisance et de l’épaisseur du compte en banque. La chronique populaire locale de ces temps-là – souvent médisante – affirmait d’ailleurs que de nouveaux riches ne reculaient devant rien, même devant la plus profonde stupidité, pour faire valoir leur fortune. Des commérages colportaient, entre autres rumeurs invérifiables mais de source sûre, que certaines femmes parvenues de la région, “pour faire bien” et garnir des bibliothèques qu’elles n’ouvraient jamais, achetaient chez les libraires de Quimper-Corentin… d’épais livres d’auteurs au mètre linéaire ! Et, ne racontait-on pas aussi, la main sur le cœur et la tête sur le billot, cette étonnante histoire : une femme du Pays Bigouden apprit qu’une voisine dont elle estimait les moyens inférieurs aux siens, s’était offert un piano à queue ! Un superbe instrument, fort cher et bien inutile d’ailleurs, au regard du peu de connaissances musicales de la mélomane d’occasion qui ne faisait guère la différence entre la clé de sol… et celle de son sous-sol ! Mais la lutte était âpre dans ce genre de course à la bêtise, et les concurrentes ne reculaient devant aucun extrême.
— Eh bien, si elle a pu faire ça, je m’en achèterai un à deux queues ! avait fièrement proclamé l’autre.
L’histoire avait, bien entendu, fait le tour de la région et personne ne savait plus vraiment quelle part de vérité on pouvait en retenir. Mais elle ressemblait à tant d’autres, celles où l’on trouvait invariablement ces caricatures imbéciles. Certaines aussi, s’affublaient parfois d’un accent étrange, copie grotesque de tonalités empruntées aux Parisiennes en vacances qu’elles pensaient devoir imiter pour se donner des airs “de la ville”. Elles butaient alors, régulièrement, sur des difficultés de prononciation. Et elles jouaient les stars, ces nouvelles précieuses ridicules dont l’on riait franchement et qui pensaient que l’argent suffisait à donner de l’esprit aux bécasses.
Jeanne, il faut le reconnaître, ne faisait pas partie de ces oies gavées de prétention et qui, comme l’affirmait avec force et depuis si longtemps le bon sens populaire, voulaient « penser plus haut qu’elles n’avaient le… cerveau ! »
N’eût été sa méchanceté native et incurable, Jeanne Toussaint était fine, intelligente, instruite, observatrice et intuitive. Remarquablement douée pour le calcul, elle aurait pu, ailleurs et en d’autres circonstances, faire une belle carrière de comptable. Personne n’aurait songé à contester ses capacités, son sens de la réflexion et des affaires. Son petit commerce n’était qu’un magasin de village sans prétention, certes, mais qui, au fil des années – en plus d’un demi-siècle – avait permis à ses cousines, puis à elle-même, d’amasser une petite fortune. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les dentellières à domicile lui avaient fourni des aunes et des aunes de “picot”, la dentelle locale… importée d’Irlande en d’autres temps, que, selon la coutume du troc en vigueur ici, elle leur avait payé en produits d’épicerie : “pochons” de café en grains, conserves, cirage, cognac Saint-Rémy et apéritif Saint-Raphaël, les indispensables composants des “deux saints”, un solide et puissant apéritif dont le mélange (consommé avec modération) n’était pas très catholique mais tuait les vers dans l’œuf, guignolet-kirsch, cassis, pâté Hénaff, maquereaux au vin blanc Raphalen, lessive Saint Marc ou encore mouchoirs de Cholet, chaussons à carreaux, pantoufles noires… un beau système d’échange que Mercure n’aurait pas renié.
Jeanne avait donc touché un bel héritage de ses cousines. Elles lui avaient non seulement construit la maison mais aussi légué le commerce, des bons du trésor de la belle Caisse d’Épargne et quelques millions de menue monnaie. Au décès de la dernière, sous les piles de draps, Jeanne avait trouvé plusieurs liasses de billets de cinq cents francs au papier encore craquant, valeurs rares mais sûres… Ses cousines l’avaient formée à leur image, ce qui était, il faut bien l’avouer, assez regrettable. Quand elle avait atteint l’âge du mariage et, malgré son physique ingrat, elles lui avaient trouvé un époux, Jules Toussaint qui disparut tragiquement quelques années plus tard, lors d’un naufrage d’hiver aux abords des îles Glénan. Jeanne ne ressentit aucun chagrin. Pleura-t-elle ce mari de convenance ? Personne ne la vit, les yeux mouillés de larmes, sous son châle de deuil ! Veuve encore jeune, sans prétention de convoler une nouvelle fois, elle s’installa dans sa nouvelle vie, comme s’il n’y en avait jamais eu d’autre !
Les prétendants ne manquèrent pourtant pas, qui auraient volontiers occulté son manque d’attrait, pour sacrifier leur fierté à leur cupidité. Car, plus redoutables qu’un philtre enchanté, les sous des cousines, à défaut de rendre amoureux, rendaient aveugles et sourds.
***
Arrivé au bout de l’allée, Victor consulta une nouvelle fois sa montre : elle indiquait bien 8 heures 45 et les persiennes de Jeanne demeuraient closes ! Dans cette impasse, nichée au milieu d’un quartier tranquille dont la plupart des maisons étaient des résidences secondaires ou des habitations de retraités, cette époque de l’année n’était guère animée. Le temps chagrin n’incitait pas aux balades matinales et chacun préférait se claquemurer dans son abri, dans l’attente de jours meilleurs. Victor fronça ses sourcils épais. Au lieu de gagner les clapiers comme d’habitude, il posa sa caisse d’arsken lez au pied des marches. La clé de la maison était restée à l’extérieur de la serrure ce qui le surprit de la part de Jeanne ! Se brossant soigneusement les pieds sur le paillasson, la main sur la poignée, il fit un pas en avant. Mais, connaissant la méticulosité de sa cousine, il se ravisa, préférant se mettre en chaussettes. Puis il poussa la poignée de la porte d’entrée. Les lumières du couloir et celles de l’escalier étaient allumées.
— Ah, ah ! C’est étrange ! fit-il, de ce ton un peu théâtral qu’il aimait à employer dans les infirmeries de la Royale et qu’il avait conservé, la retraite prise.
Sa voix, malgré sa sinusite, prenait alors des tonalités graves de ténor s’apprêtant à interpréter un air de Gounod.
— Oh là ! fit-il encore, exprimant ainsi son étonnement grandissant, puis il murmura quelques « hum, hum » dubitatifs, avant de se décider.
« Oh, oh, je n’aime pas ça ! » Il entra.
— Jeanne ? Es-tu là ? appela-t-il vainement.