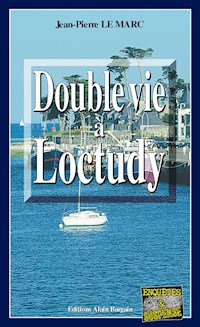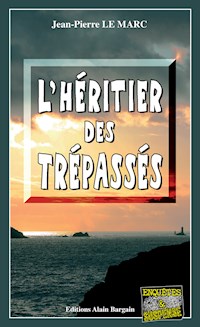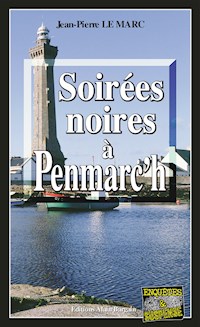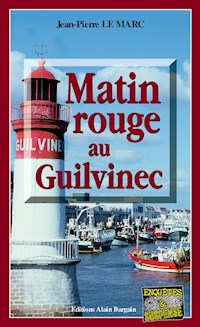
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Norbert Le Gall, un industriel en plein succès, s'attire les foudres de ses ennemis...
La réussite de l'industriel du mareyage Norbert Le Gall, un homme d'une forte personnalité, est exemplaire. Sa volonté, son goût du risque, sa poigne de fer, lui ont permis de bâtir, contre vents et marées, un véritable empire. Présent de la pointe de la Bretagne à l'embouchure de Bidassoa, Norbert Le Gall fait claquer la flamme de sa propspérité dans toute l'Europe. Mais un tel succès ne va pas sans attirer de fortes inimitiés. Au lieutenant de police Sarah Christmas revient bientôt la mission de dénouer une situation tragique et complexe, qui révèle bien des drames et des secrets.
Accompagnez la lieutenant de police Sarah Christmas dans une première enquête agitée au Guilvinec, avec ce polar breton plein de rebondissements !
EXTRAIT
Quelques semaines auparavant, un soir où sa belle soeur, déchaînée, cherchant le scandale, l’avait, une fois de plus, traité de maquereau sous la criée devant le parterre des mareyeurs et des marins réunis, il s’était éloigné, les mains dans les poches, murmurant seulement : « Pauvre conne ! ». Considérant l’échec de sa vie familiale comme une simple défaillance commerciale, Le Gall, faisait reposer sur les fragiles épaules de sa femme le poids de son stupide égocentrisme. Alors, ce jour-là, la nouvelle de la mort de son
beau-frère avait fait tomber le masque sévère, impénétrable que portait Francine : elle avait souri !
— Ça devait bien lui arriver un jour à ce salaud. J’espère qu’il a eu le temps de se voir mourir ! avait-elle
craché haineusement.
Au cours de leur entretien Sarah Christmas avait plusieurs fois dû la ramener à l’ordre, sans que d’ailleurs cela sembla avoir de résultat.
—Ce n’est pas moi qui l’ai tué, mais celui qui l’a fait mérite mon estime.
— Madame, vous allez trop loin. On a tué un homme et je vous interdis de vous comporter ainsi ! s’était insurgée Sarah, furieuse.
Haussant les épaules et, avec la plus grande désinvolture, un sourire carnassier aux lèvres, Francine avait répondu :
—Et alors ? Qu’est-ce que vous allez faire ? Me mettre en prison ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Breton, régionaliste convaincu,
Jean-Pierre Le Marc est né le 27 Juillet 1948 à Larvor, Loctudy (Finistère). Après une solide expérience de l'environnement économique et des relations humaines acquise au sein d'entreprises industrielles régionales, il se consacre depuis des années à une vocation ancienne et forte : le journalisme de terrain. Indépendant de nature et à de nombreux titres, il axe son activité sur des reportages essentiellement basés sur les réussites et les challenges économiques du Grand Ouest, ainsi que sur le patrimoine et la culture bretonne. Passionné d'Histoire, il est, également, depuis son enfance, marqué par la grande aventure de l'Indochine, ses errances et ses souffrances. Il est décédé en mars 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Nous remercions tout particulièrement les Editions YCA à Quimper pour leur participation (photo de couverture) et vous recommandons leurs magnifiques cartes postales.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
A Laure.
I
Bretagne.
Le Guilvinec, un des ports du Pays Bigouden.
Lundi matin, 8 novembre, 7 heures. Le temps est maussade en ce miz du breton, ce « mois noir » que personne n’aime. Comme chaque année à cette période de transition entre les saisons, le crachin sévit sur l’Ouest. Bousculé par l’affrontement perpétuel que se livrent l’océan et la pointe de la Bretagne, l’automne marin a endossé ses couleurs de circonstance, un mélange d’ocre plombé de teintes grises où luisent les reflets minéraux de l’ardoise, ar men glaz, « la pierre bleue » accouchée des filons de schiste des Monts d’Arrée et des écailles éclatées des Montagnes Noires. La terre, la mer, se font une scène. Des bouleversements incongrus éliminent les couleurs, gomment le bleu, transforment l’océan en un vaste chaudron où se déchirent l’automne et l’hiver. Des nuages pesants, forgés aux enclumes des dieux celtes, menacent de s’écraser sur le monde. Amoncellements de plomb qu’une étrange magie suspendrait en l’air, ils parcourent le ciel tel un troupeau de chevaux métalliques, une horde lente chassant sous ses sabots des couleurs fuyantes, lisses, pesantes, insaisissables écoulements d’un mercure chargé de granite. Le ciel est une voûte, un assemblage de blocs d’univers unis par des clés étranges, qui parfois se brisent, libérant à merci des torrents d’eau ou des cascades de soleil. L’Armorique du bord de mer s’accommode bien de ces dosages fabuleux, de ces nuances fragiles, précieuses et lourdes à la fois, qu’elle seule sait mêler, comme les peintres d’autrefois préparaient leurs enluminures, liant savamment la terre à l’eau.
Les hommes, ici, vivent dans des ports, ces rustiques îlots de terre et de pierre que l’océan admet aux frontières de son empire, des villages posés sur le rivage, des réunions de maisons, des rues et des ruelles tracées au cœur d’une vie dédiée à la mer.
Ce matin-là, sur le port du Guilvinec, Anne-Marie Le Goff, une grande femme de quarante-neuf ans, dotée d’une certaine expérience de la vie mais nourrie comme tant d’autres au lait des légendes bretonnes, frissonne un peu quand grincent sur leurs gonds si souvent exposés au sel, les montants de la petite porte de service de l’arrière de la Smob, la Société des Marées Océanes Bretonnes, fondée et dirigée par Norbert Le Gall, un long bâtiment de la zone portuaire où elle travaille depuis si longtemps.
Dès sa plus tendre enfance Anne-Marie a été impressionnée par les évocations de l’Ankou, ce messager de la mort dont parlaient les vieux à la veillée. Les voix usées des anciens chuchotaient des récits effrayants déchirés de cris d’âmes égarées hurlant leur détresse la nuit entière. Projetées comme des fantômes sur les murs de chaux de la petite maison de pierre, le pen-ty, où luisait faiblement le crucifix de buis paré de sa branche de laurier, les flammes de la cheminée accouchaient d’ombres mouvantes, de formes fugitives nées d’étonnants sortilèges. Nourrissant la terreur qui broyait l’assistance, les conteurs crachaient dans l’âtre pour conjurer le mauvais sort. Les vieilles femmes se signaient. L’ombre de l’Ankou prenait possession de l’assemblée et les lambeaux de son suaire, son odeur fétide, semblaient couvrir la terre.
Mais le charretier des âmes est aussi un terrible marin. Son Bag noz, le « bateau de nuit », naviguant par d’épais brouillards, est un lugubre navire commandé par un sinistre capitaine, le premier mort de l’année. Personne n’a jamais vu l’embarcation, mais les navigateurs d’autrefois décrivaient le bâtiment comme une longue barque pontée gréée de voiles en lambeaux. Les marins montés aux haubans seraient d’épouvantables cadavres, aux gestes lents, aux yeux vides, portant chacun un corbeau sur l’épaule. Planté derrière le capitaine, un être effroyable à la peau parcheminée sorti du tombeau pour sa mission, se tient l’Ankou, armé de sa faux, qui préside à la manœuvre. Dans un silence glacial, rompu seulement par les grincements du gouvernail, le navire s’approche lentement du quai sans jamais y accoster. Des ombres, surgissant mystérieusement du néant, empruntent une passerelle tendue dans le vide. Le pont craque quelques instants sous leurs pieds décharnés, avant qu’elles ne disparaissent à jamais dans les cales, embarquant pour l’Eternité. Alors qu’une horrible odeur de charnier couvre celle du vent marin, la brume s’épaissit encore, dévorant le décor. Quand le temps s’éclaircit, l’air demeure lourd de senteurs putrides auxquelles se mêlent des exhalaisons de feu et de soufre. Les témoignages existent de marins qui, embarquant avant la fin de la nuit, ont, sans jamais le voir, senti le passage de l’Ankou.
« Il est venu cette nuit ! », disent-ils. Alors, les croyants se signent. Rares sont ceux qui haussent les épaules. Si le temps est à la brume, personne ne dort sur le chemin qui mène aux lieux de pêche. Dans les lambeaux de l’aube imprécise, certains affirment avoir vu fuir dans l’horizon brumeux une longue barque sans nom disparaissant aux premières lueurs du soleil. Malheur à qui croise le chemin de l’Ankou !
* * *
Si le poids de ses terreurs enfantines la marque à jamais, ce matin-là, le frisson d’Anne-Marie Le Goff est bref. Il y a quelques minutes elle a quitté sa maison de Léchiagat, une belle demeure néo-bretonne en pierres de taille, bâtie face à la mer, au 17 rue Amandine de Pen-Ar-But, au bord de la corniche, non loin de la rue des Quatre-Vents et de la rue de l’Océan. Aux beaux jours, Anne-Marie – au pas aussi énergique que son caractère – vient parfois à pied au travail, mais elle n’aime guère arpenter les rues par les matins sombres et pluvieux de l’automne. Alors, comme chaque jour depuis que le beau temps a doucement tiré sa révérence, elle parcourt le chemin en voiture. Le paysage lui est si familier qu’elle n’y prête jamais attention. Elle remarque à peine les premières lumières des hôtels du port où dorment encore paisiblement les touristes de la Toussaint.
Les façades défilent – qu’elle ne regarde pas où des fenêtres s’allument déjà malgré l’heure matinale. On se lève tôt chez les marins. La croix verte de la pharmacie, visible de très loin, brille comme les étoiles de Saint-Exupéry quand, perdu dans la nuit où le plongeaient ses explorations célestes, l’aviateur se guidait sur les éclats salvateurs des astres.
Ici, l’alignement des habitations raconte une histoire, celle d’un port où chaque quartier est déjà un village en soi. Les générations de pêcheurs y ont ancré leurs attaches durant deux siècles, sacrifiant aux traditions, aux modes, ou au goût du temps, l’architecture de leur maison. Depuis quelques temps d’ailleurs, s’alliant avec la pierre taillée ou la blancheur éclatante des enduits inspirés de la chaux ancienne, plusieurs façades prenaient, avec bonheur, des couleurs d’Irlande. Nées d’un cousinage naturel entre la mer et le minéral, des tonalités lumineuses surgissaient un jour, comme autant de réponses aux peintures généralement chaudes et vives des coques des bateaux.
Le pont jeté en court arc de cercle entre le port de plaisance et l’arrière port symbolise l’histoire de la ville, celle qui unit ses chantiers navals à sa grande aventure maritime.
Un visiteur étranger aurait marqué un temps d’arrêt en découvrant au loin les formes insolites émergeant du terre-plein de carénage du slip-way.
Mais Anne-Marie, depuis bien des années, ne prête aucune attention aux silhouettes fantomatiques des navires en léthargie mécanique. Elle ignore le portique d’acier de l’énorme élévateur à bateaux, qui, sous l’éclairage au sodium des lampadaires, rappelle l’étonnant squelette d’un monstre onirique échoué sur les quais. Rien ne la surprend, rien ne l’effraie, puisque rien ne la concerne en ce monde, sinon cet endroit où elle se rend. Seul compte Norbert Le Gall, son œuvre, sa réussite.
* * *
Comme chaque matin depuis plusieurs années, François Le Flohic, l’homme de confiance de Norbert, l’ami fidèle, est là, qui l’attend. Entre Anne-Marie et François le rite est quotidien car ils sont unis par l’habitude, par l’indéfectible amitié qui les soude au même homme. Comme un vieux couple, ils se sont forgé le masque d’une identité commune, créant leurs ressemblances, liant leurs différences. Leurs journées sont coulées dans le même moule, et rien ne vient jamais déranger l’organisation artificielle de cette vie étrangement consacrée à un autre homme. Si l’un d’entre eux arrive en avance, l’autre l’attend sous le porche. Très proches l’un de l’autre, on pourrait penser qu’ils vivent ensemble, que leurs vies sont communes ou qu’ils sont, comme ces éternels fiancés qui ne se sont jamais décidés, constatant, un jour, qu’il est trop tard pour tenter de vivre à deux. Célibataires, à jamais indépendants, ils mènent séparément leur existence sans jamais se rencontrer en dehors du travail. Un seul lien les unit : leur admiration pour Norbert Le Gall. Ils ne se posent guère de questions sur la vie, limitant leurs pérégrinations philosophiques aux problèmes quotidiens. Leur existence entière ne vaut que par Norbert et par ces tonnes de murs de béton qui les surplombent. Leur raison de vivre tient derrière cette façade, derrière ce décor de ciment mal éclairé et encore silencieux, gris comme le rideau d’un immense théâtre en relâche.
La porte de derrière de la Smob peut bien grincer un peu quand Le Flohic la pousse, Anne-Marie sait que l’Ankou n’aime guère ces bâtiments trop modernes pour sa guise. Et puis François est un homme solide et fort, avec lequel elle est en parfaite sécurité. Comme chaque matin ils se sont serré la main.
— Alors Anne-Marie, ça va ?
— Bien. Encore beaucoup de travail aujourd’hui. S’il n’y avait ce temps épouvantable…
Elle a en horreur cette pluie fine d’automne, ambassadrice d’un hiver précoce et humide.
— Norbert est déjà rentré, la porte n’était pas fermée à clé ! dit François, apparemment indifférent à la météo et aux sautes d’humeur des saisons.
— Sa « poule », la coiffeuse, est peut-être partie avec un autre ! crache Anne-Marie.
Elle, ou François peut-être, a appuyé sur le bouton où niche secrètement la luciole électrique de la minuterie. Après une longue volée de marches ils ont gagné l’étage, avant de franchir la double porte de chêne du couloir rappelant, en grosses lettres de cuivre, que là se trouve la « Direction générale », le domaine privé de Norbert et d’Anne-Marie. Au fond, le bureau de Le Gall est plongé dans l’obscurité.
— Norbert ? appelle-t-elle.
La chaleur dans le couloir est anormale, comme si les radiateurs avaient fonctionné durant tout le week-end. Anne-Marie s’étonne :
— Mais François, Norbert ne devait rentrer que dans la matinée… de Huelgoat… Il n’est pas là…
Anne-Marie allume dans le bureau et constate avec terreur qu’elle se trompe…
Norbert Le Gall est bien là, affalé dans son siège aux grands accoudoirs, la tête à demi emportée. Des débris de visage, de sang, de chair constellent le siège et les murs. Seul le large dossier a empêché le mareyeur de s’écrouler. Sa minichaîne hi-fi est pulvérisée. La sonde de chauffage central fixée au-dessus de la plinthe a explosé dans son logement, expliquant les délires de la chaudière.
Anne-Marie n’a pas senti que François Le Flohic la prenait aux épaules. Son regard halluciné ne pouvait se détacher du visage détruit de Le Gall qui semblait contempler une scène où, désormais, il n’était plus qu’un étranger. Durant un très court instant, Anne-Marie Le Goff a eu la sensation grotesque que Norbert lui faisait une farce et que la tragédie qui détruisait irrémédiablement son esprit allait s’arrêter. Il fallait maintenant qu’il se lève, qu’il se mette à rire et hurle : « Je t’ai fait une blague ! ».
Ses jambes déjà ne la portaient plus, et un mot lui envahissait la bouche comme une horrible bile :
— Cervelle, cervelle…
Elle perdit connaissance. Le Flohic la posa sur la moquette, attentif à ne rien toucher. Garée derrière l’usine, sur son parking privé, la splendide Porsche noire de Norbert Le Gall s’était couverte d’un linceul poisseux. Le crachin l’emprisonnait dans sa trame humide.
* * *
Comme chacun ici, durant la semaine précédente, Anne-Marie avait fleuri les sépultures familiales et versé un flot de larmes sur son histoire, sur son passé. Dévastatrice comme un grand coup d’éponge, la vie avait, comme chez tant d’autres, balayé les existences de son père et de sa mère qui n’étaient plus que des noms gravés sur des morceaux de marbre biseautés, pages multiples d’un catalogue minéral exposé aux froidures de novembre. Dissous dans le temps, noyés dans l’espace infini qui, à la dernière seconde, sépare l’homme de son âme, ils vivaient ailleurs, dans un monde sans poids et sans mesure, là où l’esprit trouve enfin la paix. Mais Anne-Marie ne se posait pas la question de cette façon. Conditionnée depuis son enfance, elle conservait une foi naïve qui lui faisait imaginer un Dieu barbu installé au-dessus des nuages. Elle avait pieusement conservé au fond de son esprit les images d’Epinal d’un catéchisme rudimentaire, irréel, surréaliste, où le bon et le mauvais s’affrontaient à coups de fourches, de croyances et de damnations diverses. Marquée par les taolennous, les « tableaux de missions », ces images peintes longtemps prêchées dans les villages, l’Enfer était pour elle un immense chaudron volcanique ouvert sur des chaînes de souffrances. Là, pour l’Eternité, peinaient, se débattaient, accrochées à des crocs de bouchers, pendues par les pieds, brûlées sur des bûchers, les dépouilles sanglantes, démembrées, empalées, désarticulées et hurlantes des milliards de pécheurs égarés dans l’humanité en marche. Car la damnation, cette torture éternelle, guettait chacun : les joueurs de cartes, les musiciens, les femmes, les jeunes, les danseurs, les chanteurs, les hommes heureux de l’être et de ne devoir à la vie que le bonheur d’exister, les jeunes coquettes, les vieilles cocottes, les accordéonistes, les cracheurs de flammes, les saxophonistes, les propriétaires de salles de cinéma, les acteurs définitivement voués à Sodome et Gomorrhe, les buveurs de cidre, les joueurs de biniou, les joueurs de bombarde, les photographes, les maires, les peintres figuratifs… et les libres-penseurs ! Il n’existait aucune dérogation. Comme des milliers d’autres personnes, Anne-Marie Le Goff avait été marquée de cette empreinte, mais, les années aidant pourtant, l’influence religieuse desserrait son étau.
Encore mince, élégante, grande, blonde sans ostentation, Anne-Marie avait une belle allure. Une prestance qui seyait bien à sa profession de chef du personnel de la Smob et à son poste de numéro deux du groupe. Elle était, et elle le savait, le reflet de Norbert, sa main, sa voix. Sans la trouver jolie – son visage manquait de grâce – on reconnaissait toutefois qu’elle « avait un genre », un de ces styles que, dans la région, les autres femmes envient et critiquent à merci. La société matriarcale qui, depuis des générations, dirigeait le pays, avait toujours la langue leste et pourquoi pas – mauvaise. Certaines femmes faisaient ainsi parfois preuve d’une étonnante méchanceté, souvent inexplicable, qui tendait presque à un art de vivre le mal.
Alors, dans le Pays Bigouden, où la vie privée est une chose publique, les conchennous, ces commérages, ces cancans malfaisants dont la puissance destructrice croît en l’espace de quelques heures d’un seuil de maison à un autre, ces papotages malsains, malmenaient les réputations, détruisaient les certitudes, faisant courir les bruits et circuler les ragots les plus divers dans un bouillon de culture sans cesse enrichi de murmures et de chuchotements entendus. Des oreilles attentives les recueillaient, des esprits retors les distillaient, des langues acérées les colportaient, comme autant de nouvelles accrochées aux épines d’un redoutable réseau de barbelés. On faisait et on défaisait les réputations, et, en quelques jours, on accrochait au pilori de la rumeur les familles les plus honnêtes. Un mot, une phrase, une image, fournissaient aux imbéciles, aux hypocrites, en permanence à l’affût de nouvelles venimeuses à véhiculer et de vies à broyer, la matière première nourricière de leur méchanceté et de leur stupidité.
* * *
Quelques jours auparavant, Norbert étant en déplacement d’affaires, Anne-Marie était venue, comme elle le faisait régulièrement avant de monter, inspecter les bureaux de l’entrée.
— L’interrupteur général, s’il te plaît François ? avait-elle demandé à Le Flohic. Chaque soir en effet, le dernier partant coupait l’alimentation électrique du hall d’accueil et des bureaux du rez-de-chaussée.
— Il n’y a pas de petites économies ! Et avec toutes ces jeunes secrétaires qui ne pensent qu’à leurs toilettes… ronchonnait régulièrement Anne-Marie.
Posant son imperméable humide sur le comptoir de verre de l’accueil - ce qui lui permettrait une réflexion injuste et désagréable à l’encontre de l’une des femmes de ménage - Anne-Marie Le Goff avait rapidement inspecté le hall d’accueil, le standard et les bureaux, pestant contre les tiroirs fermés à clé.
— Encore ! avait-elle ragé, secouant nerveusement la porte d’une armoire métallique. J’aimerais savoir ce « qu’elle » cache là ?
« Elle », c’était Valérie Gourlaouen, la responsable des standardistes et des secrétaires, une jeune femme d’une trentaine d’années, au regard trop clair et trop franc pour lui plaire. Leurs affrontements étaient réguliers. Chaque soir, sans tenir compte des remarques d’Anne-Marie, Valérie condamnait les serrures de ses armoires. Sans qu’elle n’y soit pour rien, elle était, et cela avait une énorme importance dans la région, la filleule d’Henri Le Guen, l’expert-comptable commissaire aux comptes de l’entreprise, et s’était mariée avec le fils du propriétaire des Glacières Maritimes, un des associés de Norbert Le Gall. Jolie, aimable, bien diplômée, extrêmement compétente, intelligente, trilingue et bien payée, Valérie Gourlaouen avait, en quatre ans, imposé sa jeunesse et son dynamisme dans le service. Des rumeurs circulaient même depuis quelques mois, prétendant qu’elle pourrait faire un excellent chef du personnel. Certains affirmaient que la redoutable Anne-Marie chancellerait sur son piédestal. Ces bruits de coursive roulaient depuis que l’on évoquait des participations extérieures, notamment d’un important groupe financier privé. Il y avait six mois en effet, la filiale d’une multinationale s’était rapprochée de la Smob.
Contrairement à certains de ses confrères qui avaient su préserver précieusement, jalousement, leur identité et leur patrimoine, Norbert ne possédait pas cette qualité qui fait les grands bâtisseurs. S’il avait un grand courage et un sens inné du commerce, le mareyeur demeurait pourtant plus un opportuniste qu’un véritable entrepreneur. Il lui manquait cette âme, cette trame indéfinissable tissée au sein d’une culture d’entreprise soigneusement acquise au fil des générations et qui fait la race des créateurs. Norbert était comme un de ces fruitiers sauvages, apparu un jour sous une saute de vent, capable d’envahir un jardin, mais qui se laisserait séduire par la moindre greffe. Confronté aujourd’hui à des problèmes classiques de développement, il avait dû recapitaliser et s’associer à quelques loups de la finance désireux de donner une autre dimension à l’entreprise. Sans heurts, sans audit officiel, des consultants spécialisés avait décortiqué le fonctionnement de la Smob.
— Vous avez toutes les qualités, mais également tous les défauts, d’une entreprise trop confinée dans ses habitudes. Vous êtes un spécialiste dans votre domaine, mais aujourd’hui vous devez évoluer pour nos intérêts communs… avaient asséné les consultants à Le Gall.
Ils avaient particulièrement insisté sur l’état déplorable des relations humaines et sur le rôle néfaste d’Anne-Marie Le Goff. Ce jour-là, pour la première fois, Henri Le Guen avait confirmé.
— Tu sais, Norbert, ça ne va plus très bien avec Anne-Marie.
Les consultants avaient enfoncé le clou :
— Madame Le Goff représente un problème majeur pour nos collaborations futures !
— On travaille ensemble depuis plus de vingt ans. Vous ne voulez tout de même pas que je la mette à la porte ? s’était renfrogné Le Gall.
— Sans aller jusque là, on peut envisager une autre solution, plus… adaptée. Mais madame Gourlaouen nous semble très efficace pour la remplacer.
— Oui, elle est bien… avait-il confirmé.
— Mieux que cela, monsieur Le Gall, elle est intelligente, efficace, compétente. Madame Le Goff n’est plus à sa place. Vous devez prendre une décision rapide. Notre groupe a une politique très précise à ce sujet.
Norbert ne s’attendait pas à un jugement aussi catégorique au sujet d’Anne-Marie. Bien que lucide, il vivait encore sur un passé qu’il estimait indestructible. Quelques phrases simples pourtant, la conviction de ses interlocuteurs, avaient suffi à installer un immense doute dans son esprit.
Très sensible aux regards extérieurs, il trouvait là une confirmation à ce que lui avait dit, sans acrimonie, son amie de cœur, Sylvie Le Dantec, coiffeuse à Concarneau, qu’Anne-Marie, avec mépris, appelait « la poule de Norbert ». Divorcée et mère de Caroline, une fille de quinze ans, Sylvie Le Dantec était une femme franche et claire, que la vie n’avait pas ménagée.
Un jour où il ne le lui demandait pas, Sylvie lui avait donné son avis :
— Anne-Marie Le Goff est une personne épouvantable. Personne ne peut s’entendre avec elle. C’est une garce. Je plains ton personnel.
Pour toute réponse Norbert s’était contenté d’une de ses grimaces habituelles, et personne n’avait su dire s’il approuvait ou désapprouvait.
* * *
Alors, témoin impassible et silencieux, les mains dans les poches de son caban de marin, François Le Flohic, comme souvent, avait regardé Anne-Marie s’acharner sur les tiroirs fermés à clé. Il n’ignorait rien des explications, sinon des algarades, qu’elle avait eues avec Valérie à ce sujet.
— Il n’y a pas de secrets dans l’entreprise ma chérie, plaidait hypocritement Anne-Marie, évoquant les tiroirs sous clé.
Elle se heurtait à des réponses catégoriques :
— Il y en a ! J’ai la responsabilité de ce service, je l’assume. Si je pouvais mettre tous ces dossiers dans un coffre chaque soir, je le ferais ! répliquait la jeune femme avec fermeté.
— Oui, bien sûr ma chérie, tu as certainement raison. Je disais ça, pour t’aider.
— Merci. Je m’organise très bien toute seule.
A défaut de pouvoir lui arracher les yeux, contenant sa colère, Anne-Marie semait alors la panique dans les bureaux de l’étage, terrorisant à merci les employées qu’elle avait en grippe.
Quelques semaines auparavant, elle avait pourtant cru tenir sa revanche.
Un petit événement familial avait bouleversé la vie de Valérie Gourlaouen. Son mari, économiste et ingénieur en agroalimentaire, qui n’avait pas suivi les traces d’entrepreneur de son père, avait été victime d’un licenciement brutal à la suite du dépôt de bilan d’une grosse unité industrielle de la région. S’emparant de l’événement avec cette étonnante malignité, vorace comme une tumeur, qui la poussait au dénigrement, Anne-Marie avait immédiatement sonné de la trompe.
— Vous l’avez vu celui-là, avec tous ses diplômes, ça ne l’a pas empêché… Au chômage, vous vous rendez compte… Il a bonne mine.
Deux mois plus tard cependant, le mari de Valérie avait créé son propre cabinet d’études économiques. Une création qui avait fait rager Anne-Marie. A la jeune femme, elle avait doucereusement proposé :
— Tu sais ma chérie, peut-être qu’on peut… si tu veux qu’on t’aide…
— Non, merci. Nous n’avons besoin de rien. Tout va très bien.
Ces luttes à fleuret moucheté, dont elle sortait systématiquement vaincue, minaient et détruisaient lentement Anne-Marie.
* * *
Mais ces rancœurs, ces désespoirs immenses qu’elle ruminait depuis plusieurs mois et qu’elle portait comme une croix, Anne-Marie les oubliait chaque matin en franchissant le seuil de l’entreprise. Gavée d’illusions et malgré les doutes qui la dévoraient, elle voulait croire encore que rien n’avait changé. Et pourtant !