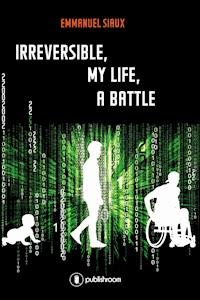Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Quarante ans d'une vie trépidante, jusqu’au jour où tout bascule.
L’accident, qui oblige Emmanuel, pilote-moto professionnel, et motard de la police nationale, à quitter le monde des valides pour rejoindre celui des handicapés.
En parallèle, avant l’accident, pendant son coma, et encore après, des signes extérieurs mystérieux viennent se mêler à sa vie.
Hasard ou synchronicité ? Ces signes étaient-ils là pour le prévenir ? L’accident était-il programmé ? Afin de ralentir sa vie, ou lui faire prendre un chemin différent ?
À travers son parcours, vous découvrirez la face cachée du quotidien d’un paraplégique, avec toutes ses souffrances, psychologiques et physiques, ainsi que les étapes de sa reconstruction, semée d’obstacles et d’embûches.
Un témoignage poignant et juste, un exemple de force morale et de volonté.
EXTRAIT
Il était trois heures du matin, c’était le 22 février 2013, le réveil sonnait. Il était l’heure de se lever et d’aller servir et représenter la République. Comme tous les quinze jours, le vendredi matin, je me transformais en oiseau de nuit. Je me rendais au commissariat central de Toulouse pour enfiler mon habit de lumière, ou plutôt ma tenue de motocycliste de la Police Nationale. Je rejoignais les effectifs de police prévus pour le contrôle d’alcoolémie, et nous partions tous ensemble vers un point bien précis pour installer le dispositif.
Ce matin-là, comme beaucoup d’autres matins, notre point de chute était aux Ponts-Jumeaux, un très bon endroit pour cueillir les délinquants de la route alcoolisés. Ma mission était simple, enfin quand je parle de ma mission, c’était plutôt la mission du motocycliste : il s’agissait de poursuivre les vilains automobilistes qui refusaient de se soumettre au contrôle, ou carrément fonçaient sur le barrage de police. C’était une mission que j’aimais particulièrement.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1973,
Emmanuel Siaux a été motard dans la Police Nationale pendant vingt ans, Champion de France des Rallyes Routiers et Team Manager de l'Equipe de France Police Moto. À l'aube de la quarantaine, un accident de la route, en service, le cloue dans un fauteuil roulant, l'obligeant à faire face à un nouveau défi : le long parcours de la reconstruction et de l'apprentissage de la vie en tant que paraplégique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emmanuel Siaux
IRRÉVERSIBLE, MA VIE, UN COMBAT
L’ACCIDENT
Il était trois heures du matin, c’était le 22 février 2013, le réveil sonnait. Il était l’heure de se lever et d’aller servir et représenter la République. Comme tous les quinze jours, le vendredi matin, je me transformais en oiseau de nuit. Je me rendais au commissariat central de Toulouse pour enfiler mon habit de lumière, ou plutôt ma tenue de motocycliste de la Police Nationale. Je rejoignais les effectifs de police prévus pour le contrôle d’alcoolémie, et nous partions tous ensemble vers un point bien précis pour installer le dispositif.
Ce matin-là, comme beaucoup d’autres matins, notre point de chute était aux Ponts-Jumeaux, un très bon endroit pour cueillir les délinquants de la route alcoolisés. Ma mission était simple, enfin quand je parle de ma mission, c’était plutôt la mission du motocycliste : il s’agissait de poursuivre les vilains automobilistes qui refusaient de se soumettre au contrôle, ou carrément fonçaient sur le barrage de police. C’était une mission que j’aimais particulièrement. Il était très rare d’ailleurs, sur une matinée, de ne pas essuyer au moins un refus d’obtempérer. C’était une sorte de jeu pour moi, qui provoquait une petite montée d’adrénaline qui me mettrait en forme pour la journée.
Il était cinq heures du matin, aucun retard sur la mise en place, et nous voilà partis pour le début des festivités. Tout était normal, la routine. Les premiers véhicules se présentèrent, et les conducteurs soufflèrent chacun à leur tour. Nous partîmes en chasse à deux reprises ce matin-là, pour deux automobilistes pressés et ne voulant pas, bien entendu, être contrôlés. Ce matin-là, nous avions gagné, et même touché le jackpot : les deux fuyards n’étaient pas seulement pressés, mais aussi alcoolisés. Nous avions réussi, avec mon collègue, à les intercepter et à les faire revenir gentiment au point de contrôle. À vrai dire, ça ne se passait pas toujours comme ça, mais ce matin-là, c’était parfait.
Nous avions, avec l’ensemble des effectifs, mis fin aux contrôles plus rapidement que prévu, car ce matin-là était spécialement « alcoolisé » et nous devions ramener nos prisonniers au commissariat, afin de traiter dans les règles de l’art les procédures délictuelles.
Ayant rencontré deux refus d’obtempérer, nous avions décidé de faire une procédure pour soulager nos collègues, car comme je le disais auparavant, les motocyclistes ont une mission principale lors des contrôles d’alcoolémie : celle de prendre en charge les véhicules en fuite. Bien entendu, si les conducteurs prennent trop de risques, nous avions pour instruction de les laisser plus ou moins filer, en annonçant leur progression et en nous contentant de relever simplement leur plaque d’immatriculation. Vous comprendrez que pour nous c’était assez frustrant de laisser partir un véhicule, mais parfois les autorités avaient raison, le jeu n’en valait pas la chandelle.
Il était neuf heures, notre procédure était terminée, nous avions pris un bon café à l’accueil du commissariat et nous étions prêts à enfourcher à nouveau nos motocyclettes pour patrouiller et aller surveiller notre « Ville Rose ». Il faisait froid mais très beau, une belle journée s’annonçait, et pourtant ce qui allait se produire allait changer ma vie.
Ma fin de service était très précise, dix heures cinquante minutes – et oui, nous sommes très précis dans l’administration ! Il était dix heures trente, l’heure de rentrer. Nous décidâmes, avec mon collègue, de regagner le quartier général pour notre fin de service. Nous étions détendus et contents d’avoir passé une matinée sans embûches. Nous nous trouvions à deux minutes du commissariat et je décidai d’emprunter la rue Salambô, une rue qui m’était familière, car je la choisissais très souvent pour rentrer au commissariat. Pour tout dire, je la connaissais par cœur, c’était une rue prioritaire, à droite comme à gauche, avec une succession de rues qui la coupaient. Les automobilistes qui circulaient sur les rues perpendiculaires devaient être très attentifs avant de couper la rue Salambô, surtout que la visibilité n’était pas toujours bonne. Je savais pertinemment que cette rue était dangereuse, et c’est pour cela que je redoublais de vigilance lorsque je l’empruntais. Je ne comprenais pas d’ailleurs pourquoi, dans cette rue, il n’y avait que des cédez-le-passage et non des stops. Pour moi qui étais un professionnel de la route, il était inconcevable de ne pas faire marquer un arrêt total et obligatoire pour passer ces intersections en toute sécurité. Je savais que, pour que les services de la mairie de Toulouse chargés de la signalisation routière et du réseau routier bougent, et commencent à se rendre compte qu’il y avait un problème, il aurait fallu quelques morts et quelques blessés graves, comme partout en France d’ailleurs.
Je connaissais pratiquement toutes les rues de Toulouse et je ne pouvais que constater, impuissant, que les infrastructures étaient largement inadaptées et devenaient de plus en plus dangereuses pour nous, et tous ces automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons, en pleine recrudescence. Pour contenter tout le monde, la mairie de Toulouse et ses services de voierie nous sortaient des choses hallucinantes tous les jours. Par exemple, dans des rues très étroites et à sens unique, ils arrivaient à créer des pistes cyclables, et tenez-vous bien, en sens inverse de la circulation, une aberration ! Ces gens-là se trouvaient sûrement dans une impasse et voulaient faire plaisir à tout le monde. Très politique bien sûr, car si vous arriviez à satisfaire autos, vélos et piétons, tout le monde serait content et beaucoup plus de monde se retrouverait aux urnes pour réélire l’excellent maire en place, qui faisait bouger sa ville, n’importe comment, mais qui la faisait bouger. Tant pis pour les transformations stupides et inadaptées, tant pis si cela rendait la ville dangereuse, tant pis pour les futurs accidents, tant pis pour les prochains blessés, tant pis pour les prochains morts. Ils comprendront peut-être un jour qu’ils ont commis des actes criminels en créant tout et n’importe quoi de façon inadaptée. Pauvre Baron Haussmann, il doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait anticipé avant tout le monde l’arrivée de tous ces véhicules, et qui avait créé de grands espaces et de grands boulevards, afin de faciliter les déplacements et afin que tout le monde puisse trouver sa place à l’avenir...
Je me souviens, quand j’avais été muté en janvier 2002 de la capitale à Toulouse, les premiers tours de roue sur ma motocyclette administrative avaient été très surprenants. Je glissais régulièrement et j’avais vite compris que dans la Ville Rose tous les marquages au sol étaient très glissants et très dangereux pour les deux-roues. Encore une absurdité dans le choix de la peinture, car il existait pourtant des peintures adhérentes, comme celle, très efficace, qui était employée dans les rues de Paris. Mais à Toulouse, on avait encore sûrement un crétin qui avait signé un marché avec une maison de peinture sans s’assurer des caractéristiques techniques, et sûrement pour un bas coût aussi, sauf que l’on ne peut pas se permettre de petites économies quand il s’agit de la sécurité des usagers de la route. Je suis persuadé que des glissades et des accidents auraient pu être évités si un choix judicieux et réfléchi avait été fait.
Ce jour-là, arrivé à hauteur de la première intersection, c’est-à-dire au croisement de la rue Salambô et de la rue Reyer, j’eus la désagréable surprise de voir surgir un automobiliste devant mes roues, qui n’avait pas respecté la signalisation routière l’informant de me laisser la priorité. Il circulait rue Reyer, une rue sur ma gauche qui coupait la rue Salambô pour se poursuivre en face, en devenant la rue des Scouts. Je le sentais vraiment motivé pour aller rejoindre les scouts et finir son acte en kamikaze, sans se préoccuper de nous. Malgré mon professionnalisme et l’habitude d’éviter les mauvais conducteurs, cette fois-ci, cela me paraissait très compliqué. Je me retrouvai donc avec un véhicule à cinq mètres devant moi, en mouvement, avec aucun évitement possible et trop peu de distance pour freiner et stopper ma motocyclette. C’était la première fois que je ressentais une telle sensation d’impuissance, avec personne pour m’aider. Je savais cette fois que j’allais avoir droit à l’accident.
La vie est parfois mystérieuse, cela faisait plus de vingt ans que je faisais de la moto, et je n’avais jamais eu d’accident. J’étais devenu motocycliste de la Police Nationale en 1996, j’avais parcouru des milliers de kilomètres en milieu urbain à Paris avant d’être muté à Toulouse, j’avais évité des dizaines d’accrochages avec des automobilistes imprudents... J’avais même représenté la Police Nationale pendant des années en tant que pilote-moto, en prenant de nombreux risques, car vous pensez bien que la moto en compétition n’est pas sans risque. C’était incroyable et pourtant, ça y était, je me retrouvais face à l’inévitable, l’accident.
Il y en a pour qui, dans cette situation, la vie aurait défilé. En aucun cas ma vie n’a défilé, j’ai pris cette situation comme les autres, je savais seulement que je ne pourrais pas m’en sortir sans dégâts. Je pris la décision, dans ce court instant, et après avoir analysé la situation, de me positionner debout sur les cale-pieds de ma motocyclette, afin de sauver ma peau et de ne pas finir encastré dans la carrosserie de la C3 blanche. J’eus le réflexe également de dévier ma trajectoire pour viser le capot du moteur, car c’était un obstacle plus bas et plus facile à franchir que l’habitacle. Malheureusement, la suite ne s’est pas passée comme je l’aurais souhaité. Avec l’impact, j’ai perdu connaissance et je n’ai donc pas pu me réceptionner lors de la chute. Les dégâts sont terribles quand vous tombez comme une marionnette, comme un poids mort.
Je me réveillais un court instant après ce choc terrible, je ne savais absolument pas où j’étais, et j’entendais mon collègue me dire « tu as eu un accident, Manu, mais les pompiers sont là, ils vont te sauver, tiens le coup ». J’entendais, à travers mon casque, des sirènes qui venaient de toutes les directions, et là je savais que je n’avais pas fait semblant, que cette fois-ci c’était l’accident à mettre dans les annales. Il faut dire que je suis quelqu’un qui fait rarement les choses à moitié. J’essayais de bouger, j’étais allongé sur le trottoir, aucune partie de mon corps ne réagissait et je me sentais partir. Tout d’un coup, plus de son, plus d’image. Étais-je mort ? Je ne le savais pas. J’allais le savoir plus tard, quinze jours après.
L’accident était-il programmé dans ma vie ? C’est la question que je me pose encore : notre vie est-elle écrite ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Je me pose toutes ces questions car des signes, avant ce drame, s’étaient manifestés. Avaient-ils un rapport, je ne sais pas, mais ce que je sais c’est qu’ils étaient là et qu’ils sont encore là.
En effet, depuis deux ans environ, j’étais perturbé par des numéros doubles, qui n’arrêtaient pas de m’accompagner au quotidien. À chaque fois que je regardais l’heure, il était par exemple « 22 h 22 » ou « 17 h 17 ». Quand je contrôlais des véhicules, ils avaient toujours des plaques comportant des chiffres doubles. Je n’en pouvais plus, si bien qu’un jour je m’arrêtais dans une rue et demandais à mon collègue s’il voyait bien la même chose que moi dans cette rue, c’est-à-dire des véhicules stationnés avec presque tous des plaques à numéros doubles. Il me confirma voir la même chose et je me dis « ouf, je ne suis pas devenu fou ». À partir de ce moment-là, il dut bien constater que ce phénomène se reproduisait à chaque fois que l’on patrouillait ensemble. C’était tout simplement hallucinant, il commençait d’ailleurs à flipper.
Et si je vous disais que l’endroit où je m’étais arrêté ce jour-là, avec une succession d’une dizaine de véhicules avec des plaques à numéros doubles, était la rue Salambô, ça vous ferait flipper ? Moi dans tous les cas, ça m’interpelle. Comme par hasard, l’accident s’est produit un 22 février. Je vais vous faire flipper une dernière fois et nous en reparlerons plus tard, mais j’ai appris par la suite que ma chambre d’hôpital en réanimation était la chambre 222, et qu’actuellement j’ai 22 vertèbres paralysées. Pour info, je suis né un 22, bizarre non ? Allez j’arrête, j’en garde pour plus tard...
LE COMA
Pendant que les médecins urgentistes se pressaient et s’acharnaient pour me maintenir en vie, je partais dans un autre monde, le coma. Quel drôle de monde, tout se mélangeait, le passé, le présent, le futur. Un monde indescriptible, même en l’écrivant je ne pourrais pas reproduire les sensations que j’ai ressenties. Vous êtes dans un monde où vous vous retrouvez en souffrance et très affaibli. Vous côtoyez à la fois les vivants et les morts, et les gens qui sont dans la longue attente de savoir dans quel camp ils vont finir, comme je l’étais. Ça doit être ce que l’on appelle l’entre-deux.
Parlons-en, de cette longue attente. Mon histoire se passait en Espagne. Pourquoi l’Espagne ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, ce que je peux vous dire c’est que dans le coma, je connaissais exactement mes blessures. Pourquoi ? Peut-être que l’on entend les médecins autour décrire les blessures. Dans mon cas, plusieurs dons d’organes m’attendaient dans une clinique espagnole, tenue par un grand ponte coréen. On devait me faire don d’un demi-corps pour remplacer mes jambes et mon bassin, et d’une cage thoracique complète afin de remplacer mes poumons malades. C’était vraiment affreux. Une maman avec sa petite fille était venue pour signer le don d’organes, qui provenaient du mari de cette dame, tué dans un accident de voiture, et elles venaient me voir pour connaître la personne à travers laquelle il allait revivre. Un moment inoubliable et douloureux pour moi. J’ai encore à ce jour dans la tête les pleurs répétés de cette petite fille, qui réclamait son père. À ce moment-là, le temps m’était compté et mon gros problème était vraiment un problème respiratoire. J’étais allongé sur un lit, à côté de deux autres lits, au sous-sol de cette clinique et un tunnel blanc se trouvait face à nous, dont émanait une forte lumière. Sur ma gauche je voyais de vieilles dames espagnoles toutes vêtues de noir et portant des chapelets, qui nous appelaient par des gestes répétitifs de la main. Elles surveillaient une sorte de dortoir rempli de morts, et insistaient pour qu’on aille vers elles. Encore un moment à oublier. À ce moment-là, je pense que ma vie ne tenait qu’à un fil. Finalement j’ai dû choisir la lumière blanche, en empruntant ce fameux tunnel, car je suis toujours là.
Oui, je n’ai pas pu enregistrer dans ma mémoire toute l’histoire de mon coma, je l’ai compris plus tard. J’ai fait deux arrêts cardiaques suite à des complications respiratoires. D’ailleurs ma plus grosse souffrance dans le coma était vraiment le manque d’oxygène. La suite de l’histoire de mon coma m’a vraiment convaincu que je n’avais pas halluciné et qu’il y avait sûrement une explication à tout ça. La clinique possédait cinq niveaux et le cinquième était prévu pour accueillir les familles en visite, avec un grand restaurant. Ce jour-là, ma famille était au complet, j’étais assis avec eux, ils discutaient tous entre eux, très heureux, et moi j’étais en pleine souffrance respiratoire. Je n’osais rien dire jusqu’au moment où ce ne fut plus possible. Il fallait absolument que l’on me ramène dans ma chambre pour que je me repose, avec un masque à oxygène. Je parlais à mon frère, qui était juste à côté de moi mais qui n’entendait rien, mon père non plus, et les autres membres de ma famille étaient dans mon dos, tout excités, mais aucun ne détectait ma détresse, à aucun moment. Je voyais mon père et mon frère se gaver de nourriture, sans prêter aucune attention à mes appels. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne me répondait. Un peu plus tard, ma grand-mère s’assit à côté de moi, et commença à son tour à manger. Je la regardais en lui disant :
Toi non plus, Mamie, tu ne veux pas m’entendre, vous préférez manger et me laisser agoniser ! Qu’est-ce que tu me racontes ? me répondait-elle. Je ne te laisserai jamais souffrir.Au fur et à mesure la journée se passa, ma famille quittait le restaurant et Marie-Hélène, ma tante, une des dernières présentes sur place, appela ma grand-mère pour la ramener chez elle. Celle-ci refusa de suivre ma tante et m’annonça que son chemin était maintenant ailleurs. Je ne comprenais rien et je sentais que j’étais sur le point de passer l’arme à gauche. Je m’étouffais de plus en plus, et tout d’un coup je me laissai porter : ma respiration s’était coupée. Je ne respirais plus. J’ai compris plus tard que je faisais à ce moment-là mon deuxième arrêt cardiaque, mais j’ai compris bien plus encore : ma grand-mère était la seule à me répondre dans le coma, pourquoi ? Elle était comme moi, sûrement, dans l’entre-deux, et comme elle me l’annonçait auparavant, elle était en train de prendre un autre chemin, celui de l’au-delà.
Avant l’accident, j’étais vraiment athée, quelqu’un qui ne croyait en rien, mais maintenant, je ne sais plus...
Après m’être réveillé du coma, je compris, quelques jours plus tard, que ma grand-mère était sur le point de nous quitter. Elle est en effet partie quelques jours après, et a été enterrée le 22 mars. Encore un chiffre double, incroyable non ? Et le jour de l’anniversaire de ma sœur. D’ailleurs, mamie Eugénie nous a quittés suite à des complications respiratoires.
Je me demande d’ailleurs si ma mamie n’aurait pas sacrifié ses poumons pour me les offrir, afin de m’aider à survivre dans l’entre-deux, car elle était tellement généreuse. Je ne le saurai jamais. J’espère seulement que non, car il y a vraiment des situations graves où il vaut mieux partir. Si on m’avait dit un jour que je serai absent pour les obsèques de ma mamie, je ne l’aurais jamais cru. Pardon Mamie, ça m’était impossible cette fois-ci, mais ce n’est que partie remise, je te retrouverai au paradis, je pense que je le mérite.
Mon coma a vraiment été une épreuve et le restera, car malheureusement les vilaines cicatrices restent la plupart du temps en mémoire.
En ce qui concerne le passé, mon coma m’a permis de me retrouver aussi quelques instants enfant, super en forme, en train de courir partout, enfin une chose positive. Mais en ce qui concerne le futur, je n’ai pas vu les numéros du loto, dommage, mais un gros problème entre le monde occidental et le monde arabe, et devinez quand ? Pendant l’année 2022. Nous verrons bien.
Attention quand même à 2020, avec ses doubles, c’est une année unique dans son genre. Elle est en harmonie avec son nombre de siècles et son nombre d’années, vingt siècles plus vingt années. Le prochain phénomène ne se produira qu’en 2121...
LE RÉVEIL
Nous étions début mars et je me trouvais aux portes du réveil, j’apercevais l’entre-deux qui filait et tout commençait à redevenir réel, enfin presque. Un bip familier me confirmait que mon cœur battait et que je vivais.
Quel réveil, j’étais tout ensuqué, branché de partout comme un astronaute en plein test, sauf que je n’étais pas à la NASA mais dans une chambre d’hôpital, en surveillance intensive. Beaucoup de monde m’entourait, en blouses blanches, et particulièrement une dame de couleur noire qui était en train de me passer du beurre de cacao sur les lèvres.
Je distinguais un visage familier, celui de ma mère, souriante de me voir rouvrir les yeux. Je reprenais peu à peu mes esprits et je comprenais maintenant que j’avais sacrément morflé. Je m’observais comme je le pouvais et je commençais à tester mon corps. J’essayais de faire bouger mes membres inférieurs, mais malgré mon insistance ils ne répondaient à aucun commandement. Je poursuivais avec mes abdominaux, même réponse. Je finis par les bras, mais un seul fonctionnait, le gauche. « Ouf », pensais-je, car j’étais gaucher. Je continuais à me tester et je pouvais observer une multitude de tuyaux branchés en direction de mon visage. J’avais subi une trachéotomie, ce qui me permit de comprendre que je ne respirais plus seul, car mes poumons avaient été touchés. Je n’étais pas du tout étonné, cela correspondait à mon histoire des jours passés dans le coma.
Je poursuivais mon inventaire et il me tardait qu’il se termine. Deux tuyaux enfoncés dans mes narines servaient à m’alimenter. Une perfusion était branchée également sur mon bras gauche et j’apercevais sur le côté un drain qui évacuait mon sang. Pour finir, une attelle me maintenait l’épaule et le bras droit, tous deux endormis. L’inventaire touchait à sa fin, avec sûrement quelques oublis, que je n’étais pas pressé de découvrir. Je luttais pour rester au maximum dans le monde réel, j’avais trop chargé psychologiquement dans l’autre. Rien à faire, c’était dû aux différents tranquillisants que l’on m’injectait à longueur de journée. Je me rendormis aussitôt. J’étais vraiment trop faible.
Les jours s’enchaînaient, et mon état était stable mais n’évoluait pas. Je prenais de plus en plus conscience qu’il allait être très difficile de récupérer. L’angoisse était omniprésente, celle de penser que je ne marcherais peut-être plus jamais, que je ne respirerais peut-être plus jamais seul mais avec l’aide d’une machine. Ma vie serait rattachée à mon cerveau, intact, et à ma main gauche. J’essayais d’éviter d’y penser mais cela m’était impossible.
Lors des rares visites qui étaient autorisées, les gens me lançaient des sourires. Je me sentais obligé de les leur rendre et de leur faire comprendre qu’une compétition avait commencé, car Manu ne baisse jamais les bras. Voilà l’image que les gens avaient de moi, un compétiteur hors norme, et je ne voulais pas les décevoir. En fait, Manu était désormais tout autre, et il ne souhaitait qu’une chose : partir, partir. J’essayais de me rattacher à quelque chose qui m’aurait donné l’envie de rester, mais même penser à ma fille, que j’aimais par-dessus tout, ne me donnait pas assez de force. C’était horrible.
Mon état commençait à nouveau, après quelques jours, à se dégrader, une escarre sacrée qui s’était développée à force d’être alité prenait de l’ampleur, je montais en température et je frôlais le 40. J’avais beaucoup de mal à respirer et les médecins ne trouvaient pas l’origine de cette poussée de fièvre. Après une semaine de souffrance, ils détectèrent une septicémie. Apparemment je n’avais pas assez morflé, il me manquait la cerise sur le gâteau. Dans ces moments-là, vous priez, non pas pour rester, mais pour partir au plus vite. Je ne savais pas que l’on pouvait autant souffrir dans la vie.
Décidément, on ne me voulait pas là-haut, pourtant j’aurais vraiment pensé que cette fois-ci c’était la bonne, mais non, peut-être la prochaine fois...
Je commençais à détester les médecins, qui s’acharnaient à me sauver. Je ne comprenais pas que l’on veuille sauver à tout prix une personne qui, de toute façon, n’allait jamais retrouver une vie normale. La vie était déjà si difficile valide...
J’avais vraiment l’impression de devenir fou, et je devenais de plus en plus nerveux. La machine respiratoire était terrible, elle ne battait pas la mesure comme les battements de mon cœur et j’avais l’impression de m’étouffer à chaque inspiration et à chaque expiration. Je sonnais régulièrement, mais rien d’anormal pour les infirmières, je ne désaturais pas. Quand arrivait la nuit, j’avais très peur de finir étouffé et je n’arrivais pas à dormir, malgré les doses de cheval de tranquillisants qu’on m’injectait.
Le plus terrible, c’est que je ne pouvais même pas m’exprimer, car la trachéotomie m’empêchait de parler. Caroline, ma compagne, m’avait apporté une ardoise de Charlotte, avec un feutre, pour communiquer. C’était pitoyable, je n’arrivais même plus à écrire correctement. J’avais l’impression que mon stylo pesait une tonne. J’étais vraiment très faible physiquement, mais malheureusement mon cerveau, ma conscience étaient intacts. Ensemble, ils comprenaient que ma vie avait changé. Ils essayaient de commander tous les deux mon corps, qui ne réagissait plus, ou alors avec une maladresse et une faiblesse jamais rencontrées. Quel choc pour eux, alors qu’ils étaient habitués à pousser ce corps dans ses limites physiques sans que jamais il ne faiblisse !
J’étais quelqu’un qui aimait beaucoup se lancer des défis physiques, avec une force mentale incroyable. J’adorais ça, j’adorais me surprendre et me dépasser. D’ailleurs, juste avant le drame, je m’étais mis à beaucoup courir, comme si j’avais pressenti que l’on allait me prendre mes jambes.
J’étais un compétiteur, d’ailleurs pour la petite histoire, j’étais depuis des années sportif de haut niveau dans la Police Nationale, et j’avais même été champion de France en rallye routier moto. C’était une discipline qui demandait de la rigueur et une certaine concentration, car nous n’avions pas droit à l’erreur, une sortie de route pouvant se finir dans un arbre ou dans un ravin. Tout au long de ma vie j’ai été un sportif, dans beaucoup de disciplines, je mettais sans cesse mon corps à contribution physiquement. J’aimais tout simplement me sentir en forme et fort, et j’adorais avoir mon indépendance. Je rendais régulièrement des services à mon entourage, tous savaient qu’ils pouvaient toujours compter sur moi, j’adorais aider mais je détestais l’inverse, je préférais me débrouiller seul et ne pas déranger.
J’étais maintenant confronté à la dure réalité : celle de devoir sûrement tout réapprendre, avec toutes mes séquelles. Moi grand sportif, j’allais peut-être devoir rester cloué dans un fauteuil roulant à vie, avec l’aide d’une auxiliaire de vie, le choc.
Je n’avais plus le choix, j’étais prisonnier de mon propre corps, il fallait que j’essaie, que j’aille voir. Au fil des jours, je commençais à retrouver un peu le moral, et je me mis à essayer de réparer mon corps, sachant pertinemment que le chemin allait être très long.
Je commençais à comprendre que le moral influait beaucoup sur la réparation du corps, alors je décidais de partir en compétition contre moi-même, en essayant, pour avancer, de puiser dans les petites ressources qui me restaient. Dans ces moments-là, quand vous êtes en pleine reconstruction, il faut savoir une chose : vous n’avez pas peur de la mort, mais de la vie. C’est beaucoup plus facile de mourir que d’exister, et je pense que la raison est là.
Les souvenirs très frais du coma me rattrapaient souvent la nuit et je me mettais alors à cogiter. Je repensais sérieusement à la rencontre avec ma grand-mère, et un flash me vint une nuit, la dixième nuit environ après ma sortie du coma. J’en déduisis que si elle était la seule à m’avoir entendu, c’est qu’elle se trouvait sûrement dans l’entre-deux et donc qu’elle n’était pas très bien. Le lendemain matin, après ma toilette, je m’empressais de demander l’ardoise à l’aide-soignante, afin d’informer ma mère que Mamie était très mal et qu’elle allait sûrement mourir. Au regard de ma mère, je compris qu’elle le savait et qu’elle se refusait à m’en parler, pour ne pas m’infliger une peine de plus. Dans ma tête c’était l’apocalypse.
Ma grand-mère était ma « Mamie », la seule et l’unique. Il y avait entre nous une complicité incroyable, elle était pour moi un modèle. C’était une très grande personne, tant par sa générosité que par son intelligence, et elle avait énormément d’humour. Elle m’avait accompagné tout au long de ma vie. Elle a beaucoup participé à mon éducation et m’aura transmis les valeurs essentielles de la vie, merci Mamie.
Je savais, et j’en étais persuadé maintenant, que l’entre-deux existait vraiment, que mamie Eugénie allait nous quitter bientôt, que ce n’était qu’une question de temps. Je venais de prendre un coup de massue, j’étais dans un état second, je venais de me rendre compte que l’une des personnes que j’aimais le plus au monde allait partir, sans que je puisse lui dire au revoir.
Mamie Eugénie, dite Manette, nous quitta en effet deux jours plus tard. Je m’y étais justement préparé, et j’avais préparé une petite playlist pour son enterrement. J’avais choisi l’Aria de Bach et l’Adagio d’Albinoni, deux de mes morceaux de musique classique préférés. Je ne comprenais pas qu’en si peu de temps je subisse autant de sentences, je devais sûrement avoir une trop belle vie et il était temps que cela cesse. C’était vrai, j’avais une vie plutôt agréable, un métier qui me plaisait, une compagne agréable – avec des relations certes tendues les derniers temps, mais comme dans tous les couples – une ravissante petite fille, Charlotte, ma princesse de 4 ans, et toute cette petite famille était réunie dans une belle maison.
À quand la prochaine punition ? Je ne le savais pas, mais il fallait que je retourne à mon travail de reconstruction avec une peine supplémentaire, la disparition de Mamie, que je ne verrai plus jamais. Je me réconfortais un peu en pensant que la dernière fois qu’elle m’avait vu dans le monde réel, j’étais entier et en forme. Je ne savais pas, en revanche, si son dernier souvenir allait être celui de l’entre-deux, lorsqu’elle me regardait en souffrance en train de suffoquer, ou celui de moi en pleine forme dans le vrai monde. Toutes ces pensées me rendaient dingue, je me demandais vraiment si je ne devenais pas fou.
Je me forçais à changer de sujet et je pensais maintenant à ma fille. Il fallait vraiment que je me batte pour elle.
Une page venait de se tourner, Mamie au ciel, et moi qui allais commencer une nouvelle vie d’invalide. Un super programme en perspective...
Le neurologue m’avait rendu visite dans la journée pour m’annoncer des choses non réjouissantes, pendant qu’on enterrait ma grand-mère à l’église Sainte-Thérèse de Tarbes. C’était le 22 mars, Caroline, ma compagne, était restée avec moi, pendant que tous mes proches étaient aux funérailles.
Le neurologue venait m’annoncer que je ne marcherais sûrement plus jamais, qu’il serait peut-être possible que je récupère un jour le bras droit et peut-être également mes poumons, mais bien sûr avec un énorme point d’interrogation. Je pus me rendre compte, par contre, dans les instants qui suivirent, que mes canaux lacrymaux fonctionnaient très bien, tellement bien que j’avais l’impression que la perfusion qui m’alimentait en eau descendait à vue d’œil. Encore aujourd’hui, je me rends compte que dans mon corps les organes fonctionnent toujours à la perfection. La nature est vraiment bien faite, elle laisse intacts les organes qui servent lorsqu’on est plongé dans la tristesse...
J’étais maintenant fixé, le ponte avait parlé, mais je refusais de le croire et j’étais déterminé à lui prouver le contraire. Il fallait absolument que je récupère mon bras et mes poumons. Je savais que pour mes jambes ça allait être très compliqué, car il m’avait opéré et avait pu s’apercevoir que ma colonne vertébrale et ma moelle épinière avaient été sérieusement touchées.
Je me retrouvais donc avec du pain sur la planche, deux défis : d’un côté un gros problème aux poumons, pour être plus précis – les termes médicaux sont tellement élégants – une « lame de pneumothorax bilatérale avec épanchement pleural bilatéral » accompagné d’une « contusion pulmonaire bilatérale à la partie antérieure du lobe supérieur » et d’un « pneumo-médiastin sans brèche trachéale », et d’un autre côté, une « lésion du plexus brachial » accompagné d’une « fracture de la clavicule » et d’une « fracture de la tête humérale », sans oublier une petite « compression de moelle », qui pourrait éventuellement correspondre à la paralysie du membre supérieur côté droit.
J’adorais les défis, mais là, il fallait en quelque sorte sortir le grand jeu et défier la science. Je refusais de baisser les bras, même si cette épreuve ne m’avait jamais été présentée dans mon autre vie, je me réconfortais en me répétant que la science était inexacte et que j’allais le leur prouver.
Je voyais le jour tomber, et je savais que Mamie avait maintenant rejoint Papi dans le tombeau familial, où les retrouvailles devaient être magiques. Caroline s’apprêtait à quitter ma chambre 222 à l’hôpital Purpan, et j’allais me retrouver seul avec la nuit pour fêter mon premier mois d’hospitalisation. C’était également l’anniversaire de ma sœur Alexandra, 41 ans, la pauvre, elle trouvera sûrement un goût amer à fêter tous ses prochains anniversaires en même temps que ceux de l’enterrement de Mamie...