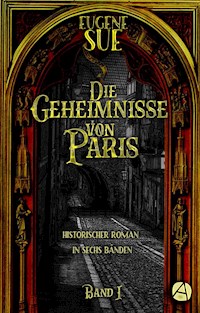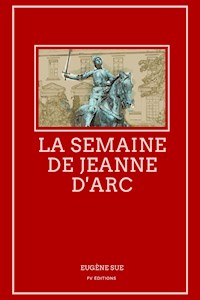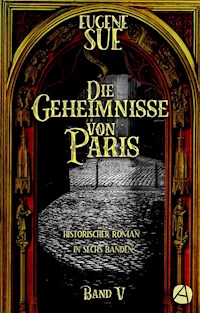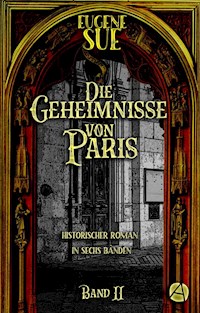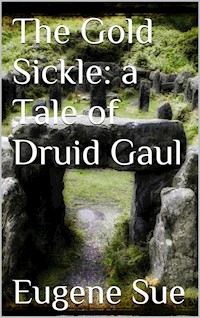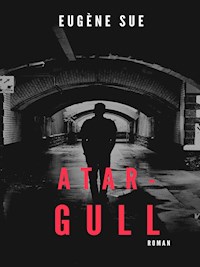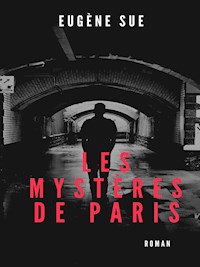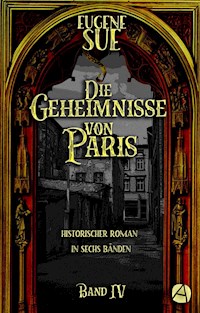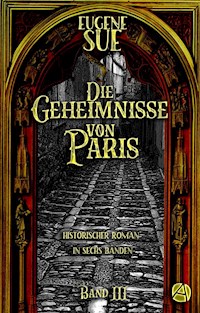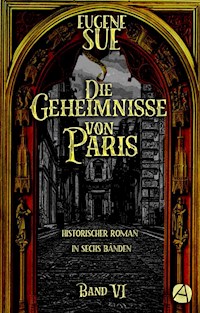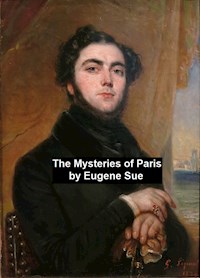Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans ce récit, Eugène Süe nous raconte l'histoire, les attitudes, les réactions de deux femmes dont le mari, pour s'être opposé, a été arrêté et envoyé au bagne lors du coup d'état de Napoléon III le 2 décembre 1851. La première, Jeanne, est la femme d'un paysan, la seconde, Louise, celle d'un bourgeois. Toutes deux ont une attitude héroïque, défendant leur mari et élevant seule leurs enfants. C'est un témoignage passionnant sur un aspect méconnu de cet événement historique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeanne et Louise - Les Familles des transportés
Jeanne et Louise - Les Familles des transportésPRÉFACEJEANNELOUISEPage de copyrightJeanne et Louise - Les Familles des transportés
Eugène Sue
À
LA MÉMOIRE
DE
CHARLES BAUDIN,
REPRÉSENTANT DU PEUPLE,
MORT
POUR LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE
ET
DE LA CONSTITUTION,
LE 3 DÉCEMBRE 1851,
SUR LA BARRICADE DE LA RUE STE-MARGUERITE
***
CE LIVRE EST DÉDIÉ
PAR
EUGÈNE SÜE
4 novembre 1852
PRÉFACE
J’ai dû écrire ce livre avec une extrême modération.
Voici pourquoi :
Le produit de cette publication est destiné à venir fraternellement en aide à un grand nombre de mes chers compatriotes, réfugiés dans les États Sardes, en Belgique ou en Suisse, et que la proscription a privés des ressources de leurs travaux habituels.
Telle est la cause de l’extrême et souvent pénible réserve que je me suis rigoureusement imposée… Mes amis, je l’espère, la comprendront : peut-être m’en sauront-ils quelque gré.
Ailleurs, je raconterai mon séjour et celui de plusieurs autres représentants du peuple au fort du Mont-Valérien, alors je pourrai parler sans contrainte.
J’ai donc le ferme espoir que les gouvernements qui accordent une généreuse et souvent sympathique hospitalité aux refugiés français, ne s’opposeront pas à ce que l’un de leurs frères, tâche, au moyen de sa plume, et selon la faible limite de ses forces, de soulager des malheurs aussi honorables que dignes d’intérêt.
À ce sujet, un mot :
L’acte du 2 décembre (je dis l’acte ! ! ! je suis, on le voit, réservé, contenu…) ; l’acte du 2 décembre a jeté sur la terre d’exil, selon l’arrêt de leurs juges (je dis leurs juges ! ! ! on ne saurait, je crois, pousser plus loin la modération) ; donc, l’acte du 2 décembre 1851 a jeté sur la terre d’exil, selon l’arrêt de leurs juges, la lie des partis, l’écume de la France, les partageux, les jacques, les pillards, les violeurs de femmes, les incendiaires, les assassins, les bandits !
Eh bien ! depuis que ces partageux, ces jacques, ces bandits sont réfugiés en Suisse, en Belgique, en Angleterre, dans les États Sardes, les gouvernements de ces nations ont-ils eu à reprocher à ces jacques, à ces partageux, à ces bandits, un crime ?… non, pas même un crime ;… mais un méfait ? non, pas même un méfait ;… un délit ?… non pas même un délit… mais la moindre inobservance de la loi du pays où ces hommes, mis au ban de l’Europe, ont trouvé un refuge hospitalier ?
NON ! car, il s’agit ici de faits prouvés, éclatants, qui sont l’une des consolations de la France ! Ses enfants proscrits ont partout fait aimer, vénérer son nom !
Les cœurs le moins prévenus s’émeuvent en voyant un grand nombre de ces proscrits fièrement résignés, demander quelles que soient leurs aptitudes, demander au travail, souvent au plus rude travail… le pain amer de l’exil[1].
Oh ! si quelqu’un de nous avait été cité devant les tribunaux étrangers, pour une action mauvaise ou honteuse, avec quelle joie cruelle, avec quel retentissement inexorable, les journaux séides du gouvernement de Son Altesse Impériale auraient appris au monde entier la honte de l’un des nôtres !… Mais, non, non, si haineux que soit l’esprit de parti, nous imposons même à nos ennemis… le respect !
Ai-je donc trop présumé de la bienveillance, j’oserais dire de l’équité des gouvernements, mieux à même que personne d’apprécier la délicatesse, la noblesse du caractère des refugiés français, en espérant que ces gouvernements ne mettront aucun obstacle par la publicité de ce livre. Son but est sacré ; puis, ni son sujet, ni sa forme ne peuvent blesser en rien la susceptibilité internationale la plus ombrageuse. Je m’explique :
L’acte (je dis toujours l’ACTE) ; l’acte du 2 décembre 1851 a brisé violemment la constitution, la LOI, c’est un fait reconnu, avoué, glorifié par les fauteurs mêmes de cet acte.
C’est un fait acquis à l’histoire par l’arrêt de la HAUTE COUR NATIONALE du 2 décembre 1851.
Or, pour la gloire impérissable de la France, des milliers d’honnêtes gens : bourgeois, paysans, artistes, prolétaires, gens de lettres, représentants du Peuple, tous fidèles à la loi et au droit, ont voulu défendre cette constitution, CONFIÉE À LA GARDE ET AU PATRIOTISME DE TOUS LES FRANÇAIS (Article 110 de la constitution de 1848).
Ces milliers de défenseurs de la LOI et du DROIT sont aujourd’hui presque tous proscrits ; d’autres sont morts sur le pavé des villes, d’autres, dans les sillons de leurs champs paternels ; d’autres, sur l’échafaud ; d’autres sont aux galères, ou transportés sous le ciel dévorant de l’Afrique et de la Guyane : ces derniers surtout sont, de tous, les plus cruellement frappés.
L’exilé en Europe peut recevoir souvent des nouvelles de sa famille, quelquefois l’appeler près de lui, au milieu de ces doux épanchements, rêver encore la France sur le sol étranger.
Mais, le transporté, séparé des objets de ses affections par l’immensité des mers, est en proie à des inquiétudes, à des angoisses horribles ; et souvent, sa complète ignorance du sort des siens, est aussi cruelle pour lui que la pire des certitudes !
Mon Dieu ! songe-t-on ce que c’est que de se dire à chaque heure du jour, ou durant les solitaires insomnies de la nuit :
– Ma femme ? ma mère ? mes enfants ? mon père ? ma sœur ? mon frère ? où sont-ils ?… que deviennent-ils ?
Et si ce transporté est l’unique soutien d’une famille tendrement aimée ?… que devient cette famille ?
Ce qu’elle devient ?… Ah !… ce qu’elle devient ? Ce livre va vous l’apprendre, lecteur ; et, à quelque opinion politique, à quelque nation que vous apparteniez, si vous êtes homme de bien, vous éprouverez une compassion douloureuse pour tant de maux immérités !… pour tant de touchantes et innocentes victimes ! pour tant de familles privées de leur unique appui ; privées de leur chef dont le crime fut d’avoir, un jour, au nom du DROIT… défendu la LOI !
L’un de nos récits : JEANNE, est l’histoire de la famille d’un paysan transporté.
L’autre récit : LOUISE, est l’histoire de la famille d’un bourgeois transporté.
Il n’y a dans ces tristes pages nulle exagération ; ce sont des faits connus de tous. Et si, en vertu des motifs déjà donnés, je n’étais fermement résolu de ne pas sortir de la modération ou plutôt du silence que je me suis momentanément imposé, je pourrais citer une multitude de faits irréfragables qui prouveraient la complète réalité des récits qu’on va lire.
Et maintenant, le plus cher de mes vœux serait comblé, si la publication de ce livre pouvait venir efficacement en aide à ceux de me compagnons d’exil, dont le malheur peut seul égaler la dignité !
EUGÈNE SÜE
[1] À Genève, M***, instituteur d’un rare mérite, a longtemps travaillé avec les maçons du pays.
JEANNE
Sylvain Poirier était journalier ; de plus, il cultivait deux quartiers de terre en locataire, situés près de sa demeure, pauvre maison isolée, non loin de la lisière des grands bois de Mareuil, qui s’étendent à quelque distance de Beaugency, au-delà de la rive gauche de la Loire, en venant d’Orléans.
Sylvain, après avoir payé la dette du sang à la France, et servi trois années en Afrique, revint au pays, et épousa une jeune fille du village de St-Laurent-des-Eaux, nommée Jeanne Masson. Il en eut successivement trois enfants ; elle était grosse du quatrième. Le père de Sylvain vivait encore ; longtemps brûleur de charbon dans la forêt, où il passait des mois entiers, été comme hiver, dans une hutte de terre ou de branchages, les infirmités accablaient sa vieillesse ; perclus de douleurs, il marchait difficilement et presque courbé en deux. Mais, le courage et le bon vouloir ne lui manquaient point ; tant qu’il le pouvait, il concourait, avec son fils et sa bru, à la culture des deux quartiers de terre qui aidaient à vivre toute la famille. Sylvain, en bon fils, avait dit à son père, lorsqu’il le vit incapable de travailler :
– Venez avec nous ; vous m’avez donné le pain de mon enfance, je vous dois le pain de votre vieillesse.
Le père Poirier, lorsque la douleur ne paralysait pas ses bras, travaillait encore à l’état de sabotier ; il tâchait d’être le moins possible à charge à son fils ; non qu’il doutât de son bon cœur, mais Sylvain avait à nourrir son père, lui, sa femme et ses trois enfants. Or, s’il gagnait, bon an, mal an, le chômage défalqué, deux cent quarante à deux cent cinquante francs, c’était beaucoup ; il lui fallait encore payer là-dessus la locature de ses deux quartiers de terre ; mais ils produisaient un peu de seigle, des pommes de terre et des légumes. Sylvain avait, en outre, une vache à moison[1], qui lui donnait son lait et l’engrais nécessaire à la fumure de sa terre.
Les deux aînés des enfants, Pierre, âgé de dix ans, Marie, âgée de treize ans, allaient ramasser du bois sec et couper de la bruyère pour le chauffage de la maison. Enfin, la famille vivait… à peu près.
Sylvain Poirier était un brave et honnête homme ; de ceci, voilà deux preuves connues de tout le pays. Un soir, à son retour des champs, ayant trouvé sur la grand-route de Romorantin une sacoche bien garnie, perdue, sans doute, par un marchand de bestiaux du Berry, il la porta au maire de St-Laurent-des-Eaux, pour que celui-ci fît tambouriner la perte de cette sacoche, et qu’elle pût être réclamée par son propriétaire. Une autre fois, le feu prit dans une ferme du côté de Lailly, Sylvain arriva un des premiers sur le lieu de l’incendie, arracha une vieille femme du milieu des flammes, et il eut les pieds si dangereusement brûlés, qu’il dut rester au lit pour plus d’un mois sans pouvoir travailler ; on le citait d’ailleurs comme un homme d’un caractère très-doux, de mœurs paisibles et rangées, sobre, intelligent et laborieux travailleur. Il n’allait point au cabaret par fierté ; n’ayant pas d’argent à dépenser pour son plaisir, il ne voulait ni boire à crédit, ni se faire régaler par personne.
Sylvain était républicain, parce que son bon sens lui prouvait qu’en France, la République était le véritable gouvernement du peuple par le peuple ; il ne disait pas, comme tant d’autres égoïstes ou pauvres aveuglés :
– Qu’est-ce que nous a donné la République ?
Sylvain savait que l’enfant au berceau a besoin de grandir, d’être paternellement protégé, instruit, développé, pour devenir un homme robuste, et Sylvain disait :
– Protégeons l’enfance de la République, elle nous donnera la paix, le repos, le pain de notre vieillesse, lorsque nous aurons vécu dans le travail et l’honnêteté… La République… c’est le plus bel héritage que nous puissions léguer à nos fils !
Il aimait encore la République, parce que c’était la loi de son pays, et que cette loi, le peuple l’avait faite par l’organe de ses représentants, librement choisis et délégués par lui ; il était donc républicain au nom du bon sens, du droit et de la loi.
Sylvain avait, comme on dit : tiré le bon lot à la loterie du mariage, en épousant Jeanne Masson ; il eût difficilement rencontré une plus active ménagère, une femme d’un meilleur cœur, d’un caractère plus égal, plus ouvert et surtout plus gai ; aussi, lorsque ses enfants pleuraient au lieu de les gronder ou de les battre, Jeanne les faisait rire, au milieu de leurs larmes, par une drôlerie ; elle faisait rire aussi son mari, et aussi le bon vieux grand-père, au risque de lui faire casser sa pipe entre ses dents, ce qui arrivait parfois : alors toute la maisonnée, petits et grands, de rire plus fort encore ! Quant à la propreté sur elle, dans le ménage et dans les hardes de son mari, de ses enfants et du vieux père, Jeanne était incomparable. Si pauvrement vêtue que fût la famille, jamais on ne la voyait en haillons ; plus soucieuse du dessous que du dessus, Jeanne s’inquiétait peu des blouses rapiécées, pourvu que tout son monde eût du linge blanc le plus souvent possible, et pour ce faire, elle ne s’épargnait point au blanchissage. Élevés par de tels parents, les enfants profitaient au mieux. Bons et laborieux comme leur père, aimants et gais comme leur mère, déjà les deux aînés, Pierre et Marie, travaillaient selon leurs forces. Dominique, le cadet, âgé de trois ans et demi, était le Benjamin de la maison, et surtout du vieux père Poirier, qui avait façonné à son petit-fils, une mignonne paire de sabots en fin bois de noyer ; car, l’ancien brûleur de charbon parvenait à peu près à chausser toute la famille, en sabotant à la veillée.
Par une froide et pluvieuse soirée d’automne, vers la fin de novembre 1851, la famille de Sylvain était réunie autour du foyer après souper. Leur demeure se composait d’une grande chambre à cheminée, où se trouvait le lit de Sylvain et de sa femme : dans une petite pièce voisine étaient le lit du grand-père et ceux des enfants ; on voyait dans la chambre principale : un buffet garni de vaisselle, une armoire à linge, quelques chaises et une table, meubles reluisant de propreté. Au-dessus du vaste manteau de la cheminée était suspendu un fusil de chasse à deux coups ; car, en sa qualité de bon tireur, on requérait souvent Sylvain pour les battues aux loups que l’on faisait durant l’hiver dans les bois de Mareuil.
Le vieux père Poirier, qui, ce soir-là, ne souffrait point de ses douleurs, sabotait assis sur un escabeau, à l’un des angles du foyer, en fumant sa pipe ; Jeanne, belle et grande brune de trente-six ans, aux yeux aussi noirs que ses dents étaient blanches, s’occupait de tailler et de coudre la layette de son quatrième enfant, qu’elle devait dans deux mois environ mettre au monde. Le petit Dominique, assis aux pieds de Jeanne, appuyait sa tête sur les genoux maternels ; Marie, la fille aînée, tricotait, et Pierre, à l’aide d’une plane et d’un couteau, façonnait de son mieux un râteau à foin ; Sylvain, à la lueur d’une petite lampe de cuivre à bec, lisait un journal à demi déchiré que lui prêtait amicalement un aubergiste de St-Laurent-des-Eaux. Ce journal était la Constitution, feuille républicaine d’Orléans, rédigée avec autant de patriotisme que de talent et de courage, par mon excellent ami M. Tavernier, aujourd’hui proscrit. Que, dans l’exil, ce souvenir de l’exilé lui soit doux !
À mesure que Sylvain poursuivait sa lecture, ses traits mâles et ouverts s’assombrissaient. Jeanne s’en aperçut la première, et dit gaîment :
– Qu’est-ce que tu as donc, Sylvain ? Tu as l’air tout triste. Tu ressembles au bedeau de la paroisse, quand il voit qu’on a vidé la corbeille de pain béni… Le père gourmand ! Attends un peu, je vais te dérider… Regarde-moi donc en face !
SYLVAIN.
Chère femme !… il paraît que ça va mal à Paris…
JEANNE, riant.
Bah… qu’est-ce que ça fait, pourvu que ça aille bien chez nous, n’est-ce pas, bon vieux père ?
LE PÈRE POIRIER, hochant la tête.
Savoir,… ma fille,… savoir…
SYLVAIN.
Vois-tu, Jeanne,… si ça va mal à Paris,… ça n’ira guère mieux ici.
JEANNE.
Qu’est-ce qu’il y a donc de nouveau ?
SYLVAIN, d’une voix grave.
On craint un coup d’état…
JEANNE, riant.
Quelle bête est-ce que c’est que ça ?
SYLVAIN.
Une méchante bête,… car elle fait couler le sang.
JEANNE, inquiète.
Qu’est-ce que tu dis là ?…
SYLVAIN.
S’il y a un coup d’état, c’est la guerre civile à Paris et en France.
JEANNE.
Ah ! mon Dieu !… mon pauvre homme !
À ce moment, on frappe à la porte de la maison de Sylvain, et presque aussitôt entre un voiturier de Lailly. Il a 25 ans environ ; il est complètement aviné, sa physionomie est presque hébétée ; l’exaltation de son bonapartisme l’a fait surnommer dans le pays Ratapoil, et le sobriquet lui en est resté.
RATAPOIL (ouvrant brusquement la porte, et riant d’un rire niais).
Bonjour les voisins ! Vive l’Empé…é…é…é… reurre !
SYLVAIN, haussant les épaules.
Te voilà,… bon sujet ?
RATAPOIL.
Oui, crénom d’un petit caporal ! me voilà… Bonsoir, père Poirier ; bonsoir, la mère Jeanne ! (Il s’assied lourdement en trébuchant).
JEANNE.
Vous voilà dans un bel état ! Quel exemple pour ces enfants (Elle se lève, prend dans ses bras le petit Dominique, qui s’est endormi sur ses genoux, et dit à Pierre et à Marie qui se font des mines pour se moquer de Ratapoil) : Venez vous coucher, mes petits.
PIERRE et MARIE, embrassant tour à tour le père Poirier, puis Sylvain.
Bonsoir, grand-père ;… bonsoir, papa ;… bonsoir Rrrrata…tapoil… (Ils se sauvent en riant dans la pièce voisine, où Jeanne les suit).
RATAPOIL.
Oui, Ratapoil !… à mille, à deux cent mille poils !… et je m’en vante.
SYLVAIN.
Il n’y a pas de quoi… Qu’est-ce que tu nous veux ?
RATAPOIL.
Je viens te faire une commission de la part de Petit-Jean.
SYLVAIN.
Quand donc l’as-tu vu, ce brave garçon ?
LE PÈRE POIRIER.
Oh ! oui,… c’est un brave et digne, notre ami Petit-Jean !
RATAPOIL.
Cré… nom ! j’étrangle ;… il n’y a pas de quoi se rafraîchir ici ! nom d’un petit chapeau !
SYLVAIN.
Si… je vas te donner de quoi te rafraîchir,… car tu me parais fièrement échauffé (Il se lève, va prendre une cruche, et verse un verre d’eau à Ratapoil).
RATAPOIL.
De l’eau ! nom d’un aigle ! de l’eau ! Voilà comme tu rafraîchis les amis !
SYLVAIN.
Il ne nous reste qu’un peu de vin, et c’est pour le père.
RATAPOIL.
De l’eau… je n’en boirais pas, quand ça serait pour boire à la santé de mon Empéreur !
LE PÈRE POIRIER.
Dieu merci,… ce règne-là est fini !
RATAPOIL.
Oh ! père Poirier, vous qui auriez l’âge d’être un vieux de la vieille,… pouvez-vous parler comme ça ?
LE PÈRE POIRIER.
Oui,… c’était beau pour les paysans, le temps de l’Empereur !… Comme tant d’autres, je les ai connus pour mon malheur, ces mauvais jours-là !… Tout le monde était pris par la conscription,… et c’est à peine s’il restait assez de bras pour cultiver la moitié des champs ; le reste demeurait en friche. Le pain valait quatre et cinq sous la livre.
RATAPOIL.
Des mauvais jours ! cré… nom,… mauvais jours ! ousqu’il y avait nos aigles ! la redingote grise ! ! la gloire ! ! la victoire ! ! cré… nom… les abeilles, le petit chapeau !… (avec un hoquet), et tout…
SYLVAIN.
C’était superbe et… très-cher pour les pauvres gens… Mais, voyons, dis-moi la commission dont t’a chargé Petit-Jean.
RATAPOIL.
Voilà… J’ai traversé, ce soir, Saint-Laurent-des-Eaux, où j’ai rencontré Petit-Jean. Il avait sa balle sur le dos, et revenait du côté de la Ferté ; il est entré au cabaret pendant que je buvais bouteille, et m’a dit : « Si tu t’en retournes à Lailly, tu passes devant la maison de Sylvain. Dis-lui qu’il ne s’en aille pas à sa journée demain matin, avant de m’avoir vu… Je serai chez lui au petit jour ».
SYLVAIN.
Bien,… je l’attendrai… Merci.
RATAPOIL.
Vois-tu,… ton farceur de Petit-Jean, c’est un rouge comme toi.
SYLVAIN.
Pas si rouge que toi ; tu vous as une trogne !
RATAPOIL.
C’est que j’ai bu à la santé de mon Empéreur, et qui a bu… boira ; à propos, dis donc, y paraît que ça chauffe !
SYLVAIN.
Quoi ?
RATAPOIL.
Enfoncée la République !
SYLVAIN.
Ah bah ! vraiment ! Et d’où sais-tu cela ?
RATAPOIL.
Je viens de porter des futailles chez M. Noireau… Tu connais M. Noireau ?… au château de la Plinière,… un vieux de la vieille,… quel grognard ! des moustaches d’un pied.
SYLVAIN.
Il était pharmacien,… mais c’est égal,… continue.
RATAPOIL.
Eh bien ! il m’a dit : Enfoncée la République ! enfoncée l’Assemblée ! Avant qu’il soit peu, le Président aura f…lanqué la pelle au… dos des 25 francs par jour, et il se fera Empéreur… Cré nom ! nos aigles !… le petit chapeau ! En…foncée la République ! Vive mon Empéreur ! !
Sylvain, redevenu soucieux, échange un regard d’intelligence avec son père, qui, haussant les épaules, semble rassurer son fils. Jeanne, après avoir couché ses enfants, rentre dans la chambre, et dit à Ratapoil :
– Faites-moi le plaisir de ne pas crier si fort, vous empêcheriez mes enfants de dormir.
RATAPOIL.
Mère Jeanne,… si je crie,… c’est le cri de l’aigle pour son Empéreur adoré !
JEANNE.
Allez donc cuver votre vin dehors ! Vous ne savez pas ce que vous dites… Ma pauvre mère m’en a assez conté de tristes et vilaines choses sur le temps de l’Empereur ! Toutes les mères le maudissaient ! et elles n’avaient que trop raison ! Il fallait racheter trois et quatre fois de la conscription le dernier enfant qui vous restait. Je ne sais combien de paysans à leur aise, ayant de bonnes terres et de bonnes vignes au soleil, ont été ainsi réduits à la besace pour avoir acheté deux ou trois remplaçants à leur dernier fils, afin de l’empêcher d’être, comme tant d’autres, de la chair à canon ; sans compter qu’il ne restait dans les villages que les borgnes, les bossus, les bancroches : comme c’était régalant pour les filles à marier ! Il y avait à la Ferté, me disait ma mère, le petit Godillot, qui faisait le coq de village, le renchéri, parce qu’il n’était bossu que par-devant ! Laissez-moi donc tranquille,… l’empire, c’était le beau temps des bossus !
SYLVAIN.
L’entendez-vous, mon père ? Il n’y a que Jeanne pour trouver cela.
RATAPOIL.
Cré nom ! si l’on peut dire ! Mais, l’Empire, mère Jeanne, c’était… (avec un hoquet) c’était…
SYLVAIN.
Voyons ! qu’est-ce que c’était ?
RATAPOIL.
Cré nom ! mais, c’était l’Empire ! quoi ! Enfin l’Empire… avec les vieux de la vieille ! nos victoires ! nos aigles ! le petit caporal et tout le tremblement… Voilà !… et vive mon Empéreur ! Nous allons l’avoir, nous l’aurons !
SYLVAIN.
Lequel ?
RATAPOIL.
L’autre ! l’ancien ! ronde ! le vieux de la vieille !
SYLVAIN.
Ah çà ! l’ancien n’est donc pas mort ?
RATAPOIL.
Pardi !
JEANNE.
Voyez-vous ça ! Il vit encore !
RATAPOIL.
Il vit très-bien, caché dans une île sauvage, où il attend que le Président ait f…lanqué la botte au… dos de la République ; alors, il reviendra avec ses aigles,… cré nom ! et son petit chapeau !
SYLVAIN, à son père.
L’entendez-vous ? Il est soûl comme une grive en automne.
LE PÈRE POIRIER, riant.
Ah çà ! mon brave Ratapoil, et ses cendres que l’on a rapportées de Sainte-Hélène à Paris ?
RATAPOIL.
Comment ! père Poirier, vous, un homme d’âge, vous donnez dans ce godant-là ? Vous donnez dans les cendres !
LE PÈRE POIRIER.
Ce n’étaient donc pas ses cendres ?
RATAPOIL.
Cré nom ! si ça ne fait pas suer… Mais non ! c’étaient des fausses cendres ! L’Empéreur a été enlevé de Sainte-Hélène par des nègres américains, de l’île déserte où il se cache, en attendant que son neveu ait fait son lit aux Tuileries pour venir y coucher (l’autre…) avec ses aigles, ses abeilles, son petit chapeau, les vieux de la vieille et tout le tremblement !
JEANNE, riant.
Toute cette ménagerie-là dans le même lit ?… Excusez du peu ! il faut qu’il soit de taille… Déraisonnez si vous voulez ; mais, ne criez pas si fort, vous allez réveiller mes enfants…
RATAPOIL, pouvant à peine se tenir sur ses jambes.
Allons, mère Jeanne, on ne crie plus, on s’en va ! Il est tard ! père Poirier ; bonsoir, Sylvain… Je ne vous dis que ça… Enfoncée la République, et vive mon Empéreur !
JEANNE, le poussant dehors.
Mais, allez-vous-en donc ! vous faites un sabbat d’enfer !
RATAPOIL, sortant et manquant de tomber.
Vive mon Empé…é…é… reurre ! Je le soutiens,… je le soutiendrai… à mort !
JEANNE.
Commencez donc par vous soutenir vous-même… (Fermant la porte à clef). Vilain raboteur ! faut-il qu’il ait bu pour dire des bêtises pareilles !
SYLVAIN, tristement.
Ah ! mon père, malgré moi, je suis inquiet !
LE PÈRE POIRIER.
Pourquoi donc ?
SYLVAIN.
Ce M. Noireau, dont parle Ratapoil, est bien informé,… il a des amis à Paris… Tenez, mon père,… il se trame quelque chose ;… le journal a raison…
LE PÈRE POIRIER.
Allons donc, mon garçon ! Ratapoil est gris, il ne sait pas ce qu’il dit…
JEANNE.
C’était une vraie comédie ; et s’il n’avait pas crié d’une voix à éveiller nos enfants, je ne l’aurais pas mis à la porte… (Contrefaisant gaîment Ratapoil) : Nom d’un petit chapeau !
Sylvain, pendant que son père et sa femme ont ainsi parlé, s’est levé en secouant la tête d’un air pensif, et est allé prendre le vieux fusil à deux coups, placé au-dessus de la cheminée ; puis, il revient, d’un air de plus en plus soucieux, tenant l’arme entre ses mains, et dit à Jeanne, non moins étonnée que le père Poirier :
– Ma bonne femme, donne-moi un chiffon et une goutte d’huile…
JEANNE.
Tu vas donc nettoyer ton fusil ?
SYLVAIN.
Oui.
JEANNE.
Pour quoi faire ?
SYLVAIN.
J’en aurai peut-être besoin bientôt…
JEANNE.
De ton fusil ?
SYLVAIN, les larmes aux yeux.
Oui, ma pauvre femme… Quoi que mon père en dise, j’en suis sûr, il se complote quelque chose ; et, en tout cas,… il faut se tenir prêt…
JEANNE, comprenant la pensée de son mari, pousse un cri d’effroi, et se jette à son cou en pleurant.
Sylvain !… mon bon Sylvain !… tu veux aller te battre, s’il y a du bruit à Paris… Père… père !… vous l’entendez…
LE PÈRE POIRIER, cachant sa figure entre ses mains.