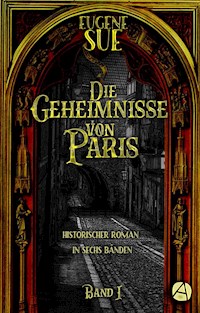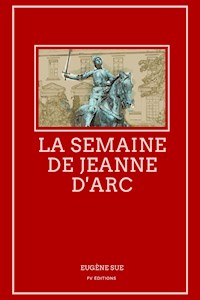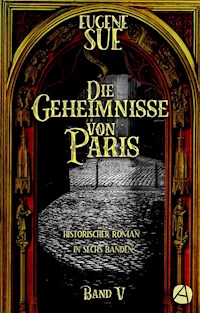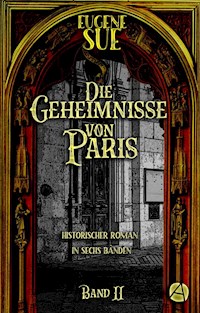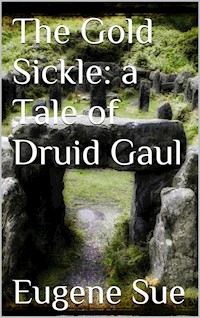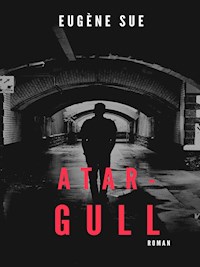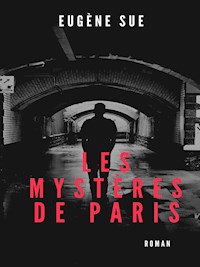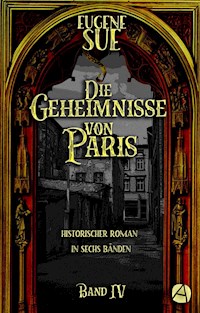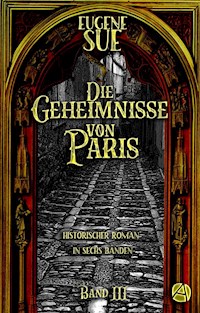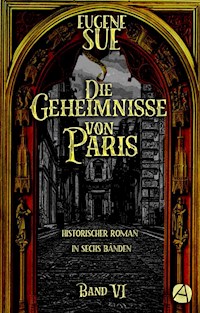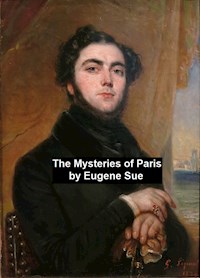Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Après un Prologue merveilleux: la rencontre, de part et d'autre du détroit de Béring, du Juif errant et de sa soeur Hérodiade, le lecteur se trouve plongé en pleine action contemporaine. Le roman nous conte en effet les multiples péripéties de la lutte menée (d'octobre 1831 à juin 1832) entre les héritiers de Marius de Rennepont, protestant persécuté au XVIIe siècle, et descendant du Juif errant, et les membres de la Compagnie de Jésus, bien décidés à capter la fortune des Rennepont, qui, accumulée depuis des siècles, est devenue immense. Les descendants de Marius de Rennepont sont au nombre de sept. Tous ces personnages ont été mystérieusement convoqués pour le 13 février 1832 à Paris, où doit leur être remise la fortune convoitée par les jésuites, à la tête desquels se trouvent un séduisant prêtre mondain, l'abbé d'Aigrigny, et le vieux, laid, pauvre, mais énergique Rodin...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Juif errant
Le Juif errantDouzième partie. Les promesses de RodinTreizième partie. Un protecteurQuatorzième partie. La fabriqueQuinzième partie. Rodin démasquéSeizième partie. Le choléraÉpiloguePage de copyrightLe Juif errant
Eugène Sue
Douzième partie. Les promesses de Rodin
I. L’inconnu.
La scène suivante se passait le lendemain du jour où le père d’Aigrigny avait été si rudement rejeté par Rodin dans la position subalterne naguère occupée par le socius.
* * * * *
La rue Clovis est, on le sait, un des endroits les plus solitaires du quartier de la montagne Sainte-Geneviève ; à l’époque de ce récit, la maison portant le numéro 4 dans cette rue se composait d’un corps de logis principal, traversé par une allée obscure qui conduisait à une petite cour sombre, au fond de laquelle s’élevait un second bâtiment singulièrement misérable et dégradé. Le rez-de-chaussée de la façade formait une boutique demi-souterraine, où l’on vendait du charbon, du bois en falourdes, quelques légumes et du lait.
Neuf heures du matin sonnaient ; la marchande, nommée la mère Arsène, vieille femme d’une figure douce et maladive, portant une robe de futaine brune et un fichu de rouennerie rouge sur la tête, était montée sur la dernière marche de l’escalier qui conduisait à son antre et finissait son étalage, c’est-à-dire que d’un côté de sa porte elle plaçait un seau à lait en fer-blanc, et de l’autre quelques bottes de légumes flétris accostés de têtes de choux jaunâtres ; au bas de l’escalier, dans la pénombre de cette cave, on voyait luire des reflets de la braise ardente d’un petit fourneau.
Cette boutique, située tout auprès de l’allée, servait de loge de portier, et la fruitière servait de portière.
Bientôt une gentille petite créature, sortant de la maison, entra, légère et frétillante, chez la mère Arsène. Cette jeune fille était Rose-Pompon, l’amie intime de la reine Bacchanal ; Rose-Pompon, momentanément veuve, et dont le bachique, mais respectueux sigisbée, était, on le sait, Nini-Moulin, ce chicard orthodoxe qui, le cas échéant, se transfigurait après boire en Jacques Dumoulin, l’écrivain religieux, passait ainsi allègrement de la danse échevelée à la polémique ultramontaine, de la Tulipe orageuse à un pamphlet catholique. Rose-Pompon venait de quitter son lit, ainsi qu’il apparaissait au négligé de sa toilette matinale et bizarre ; sans doute à défaut d’autre coiffure elle portait crânement sur ses charmants cheveux blonds, bien lissés et peignés, un bonnet de police emprunté à son costume de coquet débardeur ; rien n’était plus espiègle que cette mine de dix-sept ans, rose, fraîche, potelée, brillamment animée par deux yeux bleus, gais et pétillants. Rose-Pompon s’enveloppait si étroitement le cou jusqu’aux pieds dans son manteau écossais à carreaux rouges et verts un peu fané, que l’on devinait une pudibonde préoccupation ; ses pieds nus, si blancs que l’on ne savait si elle avait ou non des bas, étaient chaussés de petits souliers de maroquin rouge à boucle argentée… Il était facile de s’apercevoir que son manteau cachait un objet qu’elle tenait à la main.
– Bonjour, mademoiselle Rose-Pompon, dit la mère Arsène d’un air avenant, vous êtes matinale aujourd’hui, vous n’avez donc pas dansé hier ?
– Ne m’en parlez pas, mère Arsène, je n’avais guère le cœur à la danse ; cette pauvre Céphyse (la reine Bacchanal, sœur de la Mayeux) a pleuré toute la nuit, elle ne peut se consoler de ce que son amant est en prison.
– Tenez, dit la fruitière, tenez, mademoiselle, faut que je vous dise une chose à propos de votre Céphyse. Ça ne vous fâchera pas ?
– Est-ce que je me fâche, moi ?… dit Rose-Pompon en haussant les épaules.
– Croyez-vous que M. Philémon, à son retour, ne me grondera pas ?
– Vous gronder ! Pourquoi ?
– À cause de son logement, que vous occupez…
– Ah ça, mère Arsène, est-ce que Philémon ne vous a pas dit qu’en son absence je serai maîtresse de ses deux chambres comme je l’étais de lui-même ?
– Ce n’est pas pour vous que je parle, mademoiselle, mais pour votre amie Céphyse, que vous avez aussi amenée dans le logement de M. Philémon.
– Et où serait-elle allée sans moi, ma bonne mère Arsène ? Depuis que son amant a été arrêté, elle n’a pas osé retourner chez elle, parce qu’ils y devaient toutes sortes de termes. Voyant sa peine, je lui ai dit. « Viens toujours loger chez Philémon ; à son retour nous verrons à te caser autrement. »
– Dame, mademoiselle, si vous m’assurez que M. Philémon ne sera pas fâché… à la bonne heure.
– Fâché, et de quoi ? qu’on lui abîme son ménage ? Il est si gentil, son ménage ! Hier, j’ai cassé la dernière tasse… et voilà dans quelle drôle de chose je suis réduite à venir chercher du lait.
Et Rose-Pompon, riant aux éclats, sortit son joli petit bras blanc de son manteau et fit voir à la mère Arsène un de ces verres à vin de champagne de capacité colossale, qui tiennent une bouteille environ.
– Ah ! mon Dieu ! dit la fruitière ébahie, on dirait une trompette de cristal.
– C’est le verre de grande tenue de Philémon, dont on l’a décoré quand il a été reçu canotier flambard, dit gravement Rose-Pompon.
– Et dire qu’il va falloir vous mettre votre lait là-dedans ! ça me rend toute honteuse, dit la mère Arsène.
– Et moi donc… si je rencontrais quelqu’un dans l’escalier… en tenant ce verre à la main comme un cierge… Je rirais trop… je casserais la dernière pièce du bazar à Philémon et il me donnerait sa malédiction.
– Il n’y a pas de danger que vous rencontriez quelqu’un ; le premier est déjà sorti, et le second ne se lève que tard.
– À propos de locataire, dit Rose-Pompon, est-ce qu’il n’y a pas à louer une chambre au second, dans le fond de la cour ? Je pense à ça pour Céphyse, une fois que Philémon sera de retour.
– Oui, il y a un mauvais petit cabinet sous le toit… au-dessus des deux pièces du vieux bonhomme qui est si mystérieux, dit la mère Arsène.
– Ah ! oui, le père Charlemagne… vous n’en savez pas davantage sur son compte ?
– Mon Dieu, non, mademoiselle, si ce n’est qu’il est venu ce matin au point du jour ; il a cogné aux contrevents :
« – Avez-vous reçu une lettre pour moi, ma chère dame ? m’a-t-il dit (il est toujours si poli, ce brave homme).
« – Non, monsieur, que je lui ai répondu.
« – Bien ! bien ! alors ne vous dérangez pas, ma chère dame, je repasserai.
« Et il est reparti.
– Il ne couche donc jamais dans la maison ?
– Jamais. Probablement qu’il loge autre part, car il ne vient passer ici que quelques heures dans la journée tous les quatre ou cinq jours.
– Et il y vient tout seul ?
– Toujours seul.
– Vous en êtes sûre ? Il ne ferait pas entrer par hasard de petite femme en minon-minette ? car alors Philémon vous donnerait congé, dit Rose-Pompon d’un air plaisamment pudibond.
– M. Charlemagne ! une femme chez lui ! Ah ! le pauvre cher homme ! dit la fruitière en levant les mains au ciel ; si vous le voyiez, avec son chapeau crasseux, sa vieille redingote, son parapluie rapiécé et son air bonasse ; il a plutôt l’air d’un saint que d’autre chose.
– Mais alors, mère Arsène, qu’est-ce qu’il peut venir faire ainsi tout seul pendant des heures dans ce taudis du fond de la cour, où on voit à peine clair en plein midi.
– C’est ce que je vous demande, mademoiselle ; qu’est-ce qu’il y peut faire ? car pour venir s’amuser à être dans ses meubles, ce n’est pas possible : il y a en tout chez lui un lit de sangle, une table, un poêle, une chaise et une vieille malle.
– C’est dans les prix de l’établissement de Philémon, dit Rose-Pompon.
– Et, malgré ça, mademoiselle, il a autant de peur qu’on entre chez lui que si on était des voleurs et qu’il aurait des meubles en or massif ; il a fait mettre à ses frais une serrure de sûreté ; il ne me laisse jamais sa clef ; enfin il allume son feu lui-même dans son poêle, plutôt que de laisser entrer quelqu’un chez lui.
– Et vous dites qu’il est vieux.
– Oui, mademoiselle… dans les cinquante à soixante.
– Et laid ?
– Figurez-vous comme deux petits yeux de vipère percés avec une vrille, dans une figure toute blême, comme celle d’un mort… si blême enfin que les lèvres sont blanches, voilà pour son visage. Quant à son caractère, le vieux brave homme est si poli, il vous ôte si souvent son chapeau en vous faisant un grand salut, que c’en est embarrassant.
– Mais j’en reviens toujours là, reprit Rose-Pompon, qu’est-ce qu’il peut faire tout seul dans ces deux chambres ? Après ça, si Céphyse prend le cabinet au-dessus quand Philémon sera revenu, nous pourrons nous amuser à en savoir quelque chose… Et combien veut-on louer ce cabinet ?
– Dame… mademoiselle, il est en si mauvais état que le propriétaire le laisserait, je crois bien, pour cinquante à cinquante-cinq francs par an, car il n’y a guère moyen d’y mettre de poêle, et il est seulement éclairé par une petite lucarne en tabatière.
– Pauvre Céphyse ! dit Rose-Pompon en soupirant et en secouant tristement la tête ; après s’être tant amusée, après avoir tant dépensé d’argent avec Jacques Rennepont, habiter-là et se mettre à vivre de son travail !… Faut-il qu’elle ait du courage !…
– Le fait est qu’il y a loin de ce cabinet à la voiture à quatre chevaux où Mlle Céphyse est venue vous chercher l’autre jour, avec tous ces beaux masques, qui étaient si gais… surtout ce gros en casque de papier d’argent avec un plumeau et en bottes à revers… Quel réjoui !
– Oui, Nini-Moulin : il n’y a pas son pareil pour danser le fruit défendu… Il fallait le voir en vis-à-vis avec Céphyse… la reine Bacchanal… Pauvre rieuse… pauvre tapageuse !… Si elle fait du bruit maintenant, c’est en pleurant…
– Ah !… les jeunesses… les jeunesses !… dit la fruitière.
– Écoutez donc, mère Arsène, vous avez été jeune aussi… vous…
– Ma foi, c’est tout au plus ! et à vrai dire, je me suis toujours vue à peu près comme vous me voyez.
– Et les amoureux, mère Arsène ?
– Les amoureux ! ah bien, oui ! D’abord j’étais laide, et puis j’étais trop bien préservée.
– Votre mère vous surveillait donc beaucoup ?
– Non, mademoiselle… mais j’étais attelée…
– Comment, attelée ? s’écria Rose-Pompon ébahie, en interrompant la fruitière.
– Oui, mademoiselle, attelée à un tonneau de porteur d’eau avec mon frère. Aussi, voyez-vous, quand nous avions tiré comme deux vrais chevaux pendant huit ou dix heures par jour je n’avais guère le cœur de penser aux gaudrioles.
– Pauvre mère Arsène, quel rude métier ! dit Rose-Pompon avec intérêt.
– L’hiver surtout, dans les gelées… c’était le plus dur… moi et mon frère nous étions obligés de nous faire clouter à glace, à cause du verglas.
– Et une femme encore… faire ce métier-là !… ça fend le cœur… et on défend d’atteler les chiens[1] !… ajouta très sensément Rose-Pompon.
– Dame ! c’est vrai, reprit la Mère Arsène, les animaux sont quelquefois plus heureux que les personnes ; mais que voulez-vous ? Il faut vivre… Où la bête est attachée, faut qu’elle broute… mais c’était dur… J’ai gagné à cela une maladie de poumons, ce n’est pas ma faute ! Cette espèce de bricole dont j’étais attelée… en tirant, voyez-vous, ça me pressait tant et tant la poitrine, que je ne pouvais pas respirer… aussi j’ai abandonné l’attelage et j’ai pris une boutique. C’est pour vous dire que si j’avais eu des occasions et de la gentillesse, j’aurais peut-être été comme tant de jeunesses qui commencent par rire et finissent…
– Par tout le contraire, c’est vrai, mère Arsène ; mais aussi, tout le monde n’aurait pas le courage de s’atteler pour rester sage… Alors on se fait une raison, on se dit qu’il faut s’amuser tant qu’on est jeune et gentille… et puis qu’on n’a pas dix-sept ans tous les jours… Eh bien, après… après… la fin du monde, ou bien on se marie…
– Dites donc, mademoiselle, il aurait peut-être mieux valu commencer par là.
– Oui, mais on est trop bête, on se sait pas enjôler les hommes, ou leur faire peur ; on est simple, confiante, et ils se moquent de vous… Tenez, moi, mère Arsène, c’est ça qui serait un exemple à faire frémir la nature si je voulais… Mais c’est bien assez d’avoir eu des chagrins sans s’amuser encore à s’en faire de la graine de souvenirs.
– Comment ça, mademoiselle ?… vous si jeune, si gaie, vous avez eu des chagrins ?
– Ah ! mère Arsène : je crois bien : à quinze ans et demi j’ai commencé à fondre en larmes, et je n’ai tari qu’à seize ans… C’est assez gentil, j’espère ?
– On vous a trompée, mademoiselle ?
– On m’a fait pis… comme on fait à tant d’autres pauvres filles qui pas plus que moi, n’avaient d’abord envie de mal faire… Mon histoire n’est pas longue… Mon père et ma mère sont des paysans du côté de Saint-Valéry, mais si pauvres, si pauvres, que sur cinq enfants que nous étions ils ont été obligés de m’envoyer à huit ans chez ma tante, qui était femme de ménage ici, à Paris. La bonne femme m’a prise par charité ; et c’était bien à elle, car elle ne gagnait pas grand’chose. À onze ans, elle m’a envoyée travailler dans une des manufactures du faubourg Saint-Antoine. C’est pas pour dire du mal des maîtres de fabriques, mais ça leur est bien égal que les petites filles et les petits garçons soient pêle-mêle entre eux… Alors vous concevez… il y a là-dedans, comme partout, des mauvais sujets ; ils ne se gênent ni en paroles ni en actions, et je vous demande quel exemple pour des enfants qui voient et qui entendent plus qu’ils n’en ont l’air ! Alors, que voulez-vous ?… on s’habitue en grandissant à entendre et à voir tous les jours des choses qui plus tard ne vous effarouchent plus.
– C’est vrai, au moins, ce que vous dites là, mademoiselle Rose-Pompon, pauvres enfants ! qui est-ce qui s’en occupe ? Ni le père ni la mère ; ils sont à leur tâche…
– Oui, oui, allez, mère Arsène, on a bien vite dit d’une jeune fille qui a mal tourné : « C’est une ci, c’est une ça », mais si on savait le pourquoi des choses, on la plaindrait plus qu’on ne la blâmerait… Enfin, pour en revenir à moi, à quinze ans j’étais très gentille… Un jour, j’ai une réclamation à faire au premier commis de la fabrique. Je vais le trouver dans son cabinet ; il me dit qu’il me rendra justice, et que même il me protégera si je veux l’écouter, et il commence par vouloir m’embrasser. Je me débats… Alors il me dit : « Tu me refuses ? tu n’auras plus d’ouvrage ; je te renvoie de la fabrique. »
– Oh ! le méchant homme ! dit la mère Arsène.
– Je rentre chez nous tout en larmes, ma pauvre tante m’encourage à ne pas céder et à me placer ailleurs… Oui… mais impossible ; les fabriques étaient encombrées. Un malheur ne vient jamais seul : ma tante tombe malade ; pas un sou à la maison : je prends mon grand courage ; je retourne à la fabrique, supplie le commis. Rien n’y fait. « Tant pis pour toi, me dit-il : tu refuses ton bonheur, car si tu avais voulu être gentille, plus tard je t’aurais peut-être épousée… » Que voulez-vous que je vous dise, mère Arsène ? La misère était là, je n’avais pas d’ouvrage ; ma tante était malade ; le commis disait qu’il m’épouserait… j’ai fait comme tant d’autres.
– Et quand plus tard, vous lui avez demandé le mariage ?
– Il m’a ri au nez, bien entendu, et, au bout de six mois, il m’a plantée là… C’est alors que j’ai tant pleuré toutes les larmes de mon corps… qu’il ne m’en reste plus… J’en ai fait une maladie… et puis enfin, comme on se console de tout… je me suis consolée… De fil en aiguille, j’ai rencontré Philémon. Et c’est sur lui que je me revenge des autres… Je suis son tyran, ajouta Rose-Pompon d’un air tragique.
Et l’on vit se dissiper le nuage de tristesse qui avait assombri son joli visage pendant son récit à la mère Arsène.
– C’est pourtant vrai, dit la mère Arsène en réfléchissant. On trompe une pauvre fille… qu’est-ce qui la protège, qu’est-ce qui la défend ? Ah ! oui, bien souvent le mal qu’on fait ne vient pas de vous… et…
– Tiens !… Nini-Moulin !… s’écria Rose-Pompon en interrompant la fruitière et en regardant de l’autre côté de la rue ; est-il matinal !… Qu’est-ce qu’il peut me vouloir ?
Et Rose-Pompon s’enveloppa de plus en plus pudiquement dans son manteau.
Jacques Dumoulin s’avançait en effet le chapeau sur l’oreille, le nez rubicond et l’œil brillant ; il était vêtu d’un paletot-sac qui dessinait la rotondité de son abdomen ; ses deux mains, dont l’une tenait une grosse canne au port d’arme, étaient allongées dans les vastes poches de ce vêtement. Au moment où il s’avançait sur le seuil de la boutique, sans doute pour interroger la portière, il aperçut Rose-Pompon.
– Comment ! ma pupille déjà levée !… ça se trouve bien !… moi qui venais pour la bénir au lever de l’aurore !
Et Nini-Moulin s’avança, les bras ouverts, à l’encontre de Rose-Pompon qui recula d’un pas.
– Comment ! enfant ingrat… reprit l’écrivain religieux, vous refusez mon accolade matinale et paternelle ?
– Je n’accepte d’accolades paternelles que de Philémon… J’ai reçu hier une lettre de lui avec un petit baril de raisiné, deux oies, une cruche de ratafia de famille et une anguille. Hein ! voilà un présent ridicule ! J’ai gardé le ratafia de famille et j’ai troqué le reste pour deux amours de pigeons vivants que j’ai installés dans le cabinet de Philémon, ce qui me fait un petit colombier bien gentil. Du reste, mon époux arrive avec sept cents francs qu’il a demandés à sa respectable famille sous le prétexte d’apprendre la basse, le cornet à pistons et le porte-voix, afin de séduire en société et de faire un mariage… chicandard… comme vous dites, bon sujet.
– Eh bien, ma pupille chérie ! nous pourrons déguster le ratafia de famille et festoyer en attendant Philémon et ses sept cents francs.
Ce disant, Nini-Moulin frappa sur les poches de son gilet, qui rendirent un son métallique et il ajouta :
– Je venais vous proposer d’embellir ma vie aujourd’hui et même demain, et même après-demain, si le cœur vous en dit…
– Si c’est des amusements décents et paternels, mon cœur ne dit pas non.
– Soyez tranquille, je serai pour vous un aïeul, un bisaïeul, un portrait de famille… Voyons, promenade, dîner, spectacle, bal costumé, et souper ensuite, ça vous va-t-il ?
– À condition que cette pauvre Céphyse en sera. Ça la distraira.
– Va pour Céphyse.
– Ah ça, vous avez donc fait un héritage, gros apôtre ?
– Mieux que cela, ô la plus rose de toutes les Rose-Pompon… Je suis rédacteur en chef d’un journal religieux… Et comme il faut de la tenue dans cette respectable boutique, je demande tous les mois un mois d’avance et trois jours de liberté ; à cette condition-là, je consens à faire le saint pendant vingt-sept jours sur trente, et à être grave et assommant comme le journal.
– Un journal, vous ? En voilà un qui sera drôle, et qui dansera tout seul, sur les tables des cafés, des pas défendus.
– Oui, il sera drôle, mais pas pour tout le monde ! Ce sont tous sacristains cossus qui font les frais… ils ne regardent pas à l’argent, pourvu que le journal morde, déchire, brûle, broie, extermine et assassine… Parole d’honneur ! je n’aurai jamais été plus forcené, ajouta Nini-Moulin en riant d’un gros rire ; j’arroserai les blessures toutes vives avec mon venin premier cru ou avec mon fiel grrrrand mousseux !!!
Et, pour péroraison, Nini-Moulin imita le bruit que fait en sautant le bouchon d’une bouteille de vin de Champagne, ce qui fit beaucoup rire Rose-Pompon.
– Et comment s’appelle-t-il, votre journal de sacristains ? reprit-elle.
– Il s’appelle l’Amour du prochain.
– À la bonne heure ! voilà un joli nom !
– Attendez donc, il en a un second.
– Voyons le second. L’Amour du prochain, ou l’Exterminateur des incrédules, des indifférents, des tièdes et autres ; avec cette épigraphe du grand Bossuet : Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous.
– C’est aussi ce que dit toujours Philémon dans ses batailles à la Chaumière en faisant le moulinet.
– Ce qui prouve que le génie de l’aigle de Meaux est universel. Je ne lui reproche qu’une chose, c’est d’avoir été jaloux de Molière.
– Bah ! jalousie d’acteur, dit Rose-Pompon.
– Méchante !… reprit Nini-Moulin en la menaçant du doigt.
– Ah ça, vous allez donc exterminer Mme de Sainte-Colombe… car elle est un peu tiède, celle-là… et votre mariage ?
– Mon journal le sert au contraire. Pensez donc ! rédacteur en chef… c’est une position superbe ; les sacristains me prônent, me poussent, me soutiennent, me bénissent. J’empaume la Sainte-Colombe… et alors une vie… une vie à mort !
À ce moment, un facteur entra dans la boutique et remit une lettre à la fruitière en disant :
– Pour M. Charlemagne… Affranchie… rien à payer.
– Tiens, dit Rose-Pompon, c’est pour le petit vieux si mystérieux, qui a des allures si extraordinaires. Est-ce que cela vient de loin ?…
– Je crois bien, ça vient d’Italie, de Rome, dit Nini-Moulin en regardant à son tour la lettre que la fruitière tenait à la main.
– Ah çà, ajouta-t-il, qu’est-ce donc que cet étonnant petit vieux dont vous parlez ?
– Figurez-vous, mon gros apôtre, dit Rose-Pompon, un vieux bonhomme qui a deux chambres au fond de la cour ; il n’y couche jamais, et il vient s’y renfermer de temps en temps pendant des heures sans laisser monter personne chez lui… et sans qu’on sache ce qu’il y fait.
– C’est un conspirateur ou un faux-monnayeur… dit Nini-Moulin en riant.
– Pauvre cher homme ! dit la mère Arsène, où serait-elle donc, sa fausse monnaie ? il me paye toujours en gros sous le morceau de pain et le radis noir que je lui fournis pour son déjeuner, quand il déjeune.
– Et comment s’appelle ce mystérieux caduc ?… demanda Dumoulin.
– M. Charlemagne, dit la fruitière. Mais tenez… quand on parle du loup on en voit la queue.
– Où est-elle donc cette queue ?
– Tenez… ce petit vieux, là-bas… le long de la maison ; il marche le cou de travers avec son parapluie sous son bras.
– M. Rodin ! s’écria Nini-Moulin ; et se reculant brusquement, il descendit en hâte trois marches de l’escalier, afin de n’être pas vu.
Puis il ajouta :
– Et vous dites que ce monsieur s’appelle ?…
– M. Charlemagne… Est-ce que vous le connaissez ? demanda la fruitière.
– Que diable vient-il faire ici sous un faux nom ? dit Jacques Dumoulin à voix basse en se parlant à lui-même.
– Mais vous le connaissez donc ? reprit Rose-Pompon avec impatience. Vous voilà tout interdit.
– Et ce monsieur a pour pied-à-terre deux chambres dans cette maison ? et il vient mystérieusement ? dit Jacques Dumoulin de plus en plus surpris.
– Oui, reprit Rose-Pompon, on voit ses fenêtres du colombier de Philémon.
– Vite ! vite ! passons par l’allée ; qu’il ne me rencontre pas, dit Dumoulin.
Et, sans avoir été aperçu de Rodin, il passa de la boutique dans l’allée, et de l’allée monta l’escalier qui conduisait à l’appartement occupé par Rose-Pompon.
– Bonjour, monsieur Charlemagne, dit la mère Arsène à Rodin qui s’avançait alors sur le seuil de la porte, vous venez deux fois en un jour, à la bonne heure, car vous êtes joliment rare.
– Vous êtes trop honnête, ma chère dame, dit Rodin avec un salut fort courtois.
Et il entra dans la boutique de la fruitière.
II. Le réduit.
La physionomie de Rodin, lorsqu’il était entré chez la mère Arsène, respirait la simplicité la plus candide ; il appuya ses deux mains sur la pomme de son parapluie et lui dit :
– Je regrette bien, ma chère dame, de vous avoir éveillée ce matin de très bonne heure…
– Vous ne venez pas assez souvent, mon digne monsieur, pour que je vous fasse des reproches.
– Que voulez-vous, chère dame ! j’habite la campagne, et je ne peux venir que de temps à autre dans ce pied-à-terre pour y faire mes petites affaires.
– À propos de ça, monsieur, la lettre que vous attendiez hier est arrivée ce matin ; elle est grosse et vient de loin. La voilà, dit la fruitière en la tirant de sa poche, elle n’a pas coûté de port.
– Merci, ma chère dame, dit Rodin en prenant la lettre avec une indifférence apparente ; et il la mit dans la poche de côté de sa redingote, qu’il reboutonna ensuite soigneusement.
– Allez-vous monter chez vous, monsieur ?
– Oui, ma chère dame.
– Alors je vais m’occuper de vos petites provisions, dit mère Arsène. Est-ce toujours comme à l’ordinaire, mon digne monsieur ?
– Toujours comme à l’ordinaire.
– Ça va être prêt en un clin d’œil.
Ce disant, la fruitière prit un vieux panier ; après y avoir jeté trois ou quatre mottes à brûler, un petit fagotin de cotrets, quelques morceaux de charbon, elle recouvrit ces combustibles d’une feuille de chou, puis, allant au fond de sa boutique, elle tira d’un bahut un gros pain rond, en coupa une tranche, et choisit ensuite d’un œil connaisseur un magnifique radis noir parmi plusieurs de ces racines, le divisa en deux, y fit un trou qu’elle remplit de gros sel gris, rajusta les deux morceaux et les plaça soigneusement auprès du pain, sur la feuille de chou qui séparait les combustibles des comestibles. Prenant enfin à son fourneau quelques charbons allumés, elle les mit dans un petit sabot rempli de cendres qu’elle posa aussi dans le panier.
Remontant alors jusqu’à la dernière marche de son escalier, la mère Arsène dit à Rodin :
– Voici votre panier, monsieur.
– Mille remerciements, ma chère dame, répondit Rodin ; et plongeant la main dans le gousset de son pantalon, il en tira huit sous qu’il remit un à un à la fruitière, et lui dit en emportant le panier :
– Tantôt, en redescendant de chez moi, je vous rendrai, comme d’habitude, votre panier.
– À votre service, mon digne monsieur, à votre service, dit la mère Arsène.
Rodin prit son parapluie sous son bras gauche, souleva de sa main droite le panier de la fruitière, entra dans l’allée obscure, traversa une petite cour, monta d’un pas allègre jusqu’au second étage d’un corps de logis fort délabré, puis arrivé là, sortant une clef de sa poche, il ouvrit une première porte, qu’ensuite il referma soigneusement sur lui.
La première des deux chambres qu’il occupait était complètement démeublée ; quant à la seconde, on ne saurait imaginer un réduit d’un aspect plus triste, plus misérable. Un papier tellement éraillé, passé, déchiré, que l’on ne pouvait reconnaître sa nuance primitive, couvrait les murailles ; un lit de sangle boiteux, garni d’un mauvais matelas et d’une couverture de laine mangée par les vers, un tabouret, une petite table de bois vermoulu, un poêle de faïence grisâtre aussi craquelée que la porcelaine de Japon, une vieille malle à cadenas placée sous son lit, tel était l’ameublement de ce taudis délabré. Une étroite fenêtre aux carreaux sordides éclairait à peine cette pièce entièrement privée d’air et de jour par la hauteur du bâtiment qui donnait sur la rue ; deux vieux mouchoirs à tabac attachés l’un à l’autre avec des épingles, et qui pouvaient à volonté glisser sur une ficelle tendus devant la fenêtre, servaient de rideaux ; enfin le carrelage disjoint, rompu, laissant voir le plâtre du plancher, témoignait de la profonde incurie du locataire de cette demeure.
Après avoir fermé sa porte, Rodin jeta son chapeau et son parapluie sur le lit de sangle, posa par terre son panier, en tira le radis noir et le pain, qu’il plaça sur la table ; puis s’agenouillant devant son poêle, il le bourra de combustible et l’alluma en soufflant d’un poumon puissant et vigoureux sur la braise apportée dans un sabot. Lorsque, selon l’expression consacrée, son poêle tira, Rodin alla étendre sur leur ficelle les deux mouchoirs à tabac qui lui servaient de rideaux ; puis, se croyant bien celé à tous les yeux, il tira de la poche de côté de sa redingote la lettre que la mère Arsène lui avait remise. En faisant ce mouvement, il amena plusieurs papiers et objets différents ; l’un de ces papiers, gras et froissé, plié en petit paquet, tomba sur une table et s’ouvrit ; il renfermait une croix de la Légion d’honneur en argent noirci par le temps, le ruban rouge de cette croix avait presque perdu sa couleur primitive.
À la vue de cette croix, qu’il remit dans sa poche avec la médaille dont Faringhea avait dépouillé Djalma, Rodin haussa les épaules en souriant d’un air méprisant et sardonique ; puis il tira sa grosse montre d’argent et la plaça sur la table à côté de la lettre de Rome. Il regardait cette lettre avec un singulier mélange de défiance et d’espoir, de crainte et d’impatiente curiosité. Après un moment de réflexion, il s’apprêtait à décacheter cette enveloppe… Mais il la rejeta brusquement sur la table, comme si, par un étrange caprice, il eût voulu prolonger de quelques instants l’angoisse d’une incertitude aussi poignante, aussi irritante que l’émotion du jeu. Regardant sa montre, Rodin résolut de n’ouvrir la lettre que lorsque l’aiguille marquerait neuf heures et demie ; il s’en fallait alors de sept minutes. Par une de ces bizarreries puérilement fatalistes, dont de très grands esprits n’ont pas été exempts, Rodin se disait :
– Je brûle du désir d’ouvrir cette lettre ; si je ne l’ouvre qu’à neuf heures et demie, les nouvelles qu’elle m’apporte seront favorables.
Pour employer ces minutes, Rodin fit quelques pas dans sa chambre, et alla se placer, pour ainsi dire, en contemplation devant deux vieilles gravures jaunâtres, rongées de vétusté, attachées au mur par des clous rouillés.
Le premier de ces objets d’art, seuls ornements dont Rodin eût jamais décoré ce taudis, était une de ces images grossièrement dessinées et enluminées de rouge, de jaune, de vert et de bleu que l’on vend dans les foires ; une inscription italienne annonçait que cette gravure avait été fabriquée à Rome. Elle représentait une femme couverte de guenilles, portant une besace et ayant sur ses genoux un petit enfant, une horrible diseuse de bonne aventure tenait dans ses mains la main du petit enfant, et semblait y lire l’avenir, car ces mots sortaient de sa bouche en grosses lettres bleues : Sarà papa (il sera pape).
Le second de ces objets d’art qui semblaient inspirer les profondes méditations de Rodin était une excellente gravure en taille-douce dont le fini précieux, le dessin à la fois hardi et correct contrastaient singulièrement avec la grossière enluminure de l’autre image. Cette rare et magnifique gravure, payée par Rodin six louis (luxe énorme), représentait un jeune garçon vêtu de haillons. La laideur de ses traits était compensée par l’expression spirituelle de sa physionomie vigoureusement caractérisée ; assis sur une pierre, entouré çà et là d’un troupeau qu’il gardait, il était vu de face, accoudé sur son genou, et appuyant son menton dans la paume de sa main. L’attitude pensive, réfléchie de ce jeune homme vêtu comme un mendiant, la puissance de son large front, la finesse de son regard pénétrant, la fermeté de sa bouche rusée, semblaient révéler une indomptable résolution jointe à une intelligence supérieure et à une astucieuse adresse. Au-dessous de cette figure, les attributs pontificaux s’enroulaient autour d’un médaillon au centre duquel se voyait une tête de vieillard dont les lignes, fortement accentuées, rappelaient d’une manière frappante, malgré leur sénilité, les traits du jeune gardeur de troupeaux.
Cette gravure portait enfin pour titre : LA JEUNESSE DE SIXTE-QUINT, et l’image enluminée, la Prédiction[2] !
À force de contempler ces gravures de plus en plus près, d’un œil de plus en plus ardent et interrogatif, comme s’il eût demandé des inspirations ou des espérances à ces images, Rodin s’en était tellement rapproché que, toujours debout et repliant son bras droit derrière sa tête, il se tenait pour ainsi dire appuyé et accoudé à la muraille, tandis que, cachant sa main gauche dans la poche de son pantalon noir, il écartait ainsi un des pans de sa vieille redingote olive.
Pendant plusieurs minutes il garda cette attitude méditative.
* * * * *
Rodin, nous l’avons dit, venait rarement dans ce logis ; selon les règles de son ordre, il avait jusqu’alors toujours demeuré avec le père d’Aigrigny, dont la surveillance lui était spécialement confiée : aucun membre de la congrégation, surtout dans la position subalterne où Rodin s’était jusqu’alors tenu, ne pouvait ni se renfermer chez soi, ni même posséder un meuble fermant à clef ; de la sorte, rien n’entravait l’exercice d’un espionnage mutuel, incessant, l’un des plus puissants moyens d’action et d’asservissement employés par la compagnie de Jésus. En raison de diverses combinaisons qui lui étaient personnelles, bien que se rattachant par quelques points aux intérêts généraux de son ordre, Rodin avait pris à l’insu de tous ce pied-à-terre de la rue Clovis. C’est du fond de ce réduit ignoré que le socius correspondait directement avec les personnages les plus éminents et les plus influents du sacré collège.
On se souvient peut-être qu’au commencement de cette histoire, lorsque Rodin écrivait à Rome que le père d’Aigrigny, ayant reçu l’ordre de quitter la France sans voir sa mère mourante, avait hésité à partir ; on se souvient, disons-nous, que Rodin avait ajouté en forme de post-scriptum, au bas du billet qui annonçait au général de l’ordre l’hésitation du père d’Aigrigny :
« Dites au cardinal-prince qu’il peut compter sur moi, mais qu’à son tour il me serve activement. »
Cette manière familière de correspondre avec le plus puissant dignitaire de l’ordre, le ton presque protecteur de la recommandation que Rodin adressait à un cardinal-prince, prouvaient assez que le socius, malgré son apparente subalternité, était à cette époque regardé comme un homme très important par plusieurs princes de l’Église ou autres dignitaires, qui lui adressaient leurs lettres à Paris sous un faux nom, et d’ailleurs chiffrées avec les précautions et les sûretés d’usage.
Après plusieurs moments de méditation contemplative passés devant le portrait de Sixte-Quint, Rodin revint lentement à sa table, où était cette lettre, que, par une sorte d’atermoiement superstitieux, il avait différé d’ouvrir, malgré sa vive curiosité. Comme il s’en fallait encore de quelques minutes que l’aiguille de sa montre ne marquât neuf heures et demie, Rodin, afin de ne pas perdre de temps, fit méthodiquement les apprêts de son frugal déjeuner ; il plaça sur sa table, à côté d’une écritoire garnie de plumes, le pain et le radis noir ; puis, s’asseyant sur son tabouret, ayant pour ainsi dire le poêle entre ses jambes, il tira de son gousset un couteau à manche de corne, dont la lame aiguë était aux trois quarts usée, coupa alternativement un morceau de pain et un morceau de radis, et commença son frugal repas avec un appétit robuste, l’œil fixé sur l’aiguille de sa montre… L’heure fatale atteinte, Robin décacheta l’enveloppe d’une main tremblante.
Elle contenait deux lettres.
La première parut le satisfaire médiocrement ; car, au bout de quelques instants, il haussa les épaules, frappa impatiemment sur la table avec le manche de son couteau, écarta dédaigneusement cette lettre du revers de sa main crasseuse et parcourut la seconde missive, tenant son pain d’une main, et, de l’autre, trempant par un mouvement machinal une tranche de radis dans le sel gris répandu sur un coin de table.
Tout à coup, la main de Rodin restait immobile. À mesure qu’il avançait dans sa lecture, il paraissait de plus en plus intéressé, surpris, frappé. Se levant brusquement, il courut à la croisée, comme pour s’assurer, par un second examen des chiffres de la lettre, qu’il ne s’était pas trompé, tant ce qu’on lui annonçait lui paraissait inattendu. Sans doute Rodin reconnut qu’il avait bien déchiffré, car, laissant tomber ses bras, non pas avec abattement, mais avec la stupeur d’une satisfaction aussi imprévue qu’extraordinaire, il resta quelque temps la tête basse, le regard fixe, profond ; la seule marque de joie qu’il donnât se manifestait par une sorte d’aspiration sonore, fréquente et prolongée.
Les hommes aussi audacieux dans leur ambition que patients et opiniâtres dans leur sape souterraine sont surpris de leur réussite lorsque cette réussite devance et dépasse incroyablement leurs sages et prudentes prévisions. Rodin se trouvait dans ce cas. Grâce à des prodiges de ruse, d’adresse et de dissimulation, grâce à de puissantes promesses de corruption, grâce enfin au singulier mélange d’admiration, de frayeur et de confiance que son génie inspirait à plusieurs personnages influents, Rodin apprenait du gouvernement pontifical, que, selon une éventualité possible et probable, il pourrait, dans un temps donné, prétendre avec chance de succès à une position qui n’a que trop excité la crainte, la haine ou l’envie de bien des souverains, et qui a été quelquefois occupée par de grands hommes de bien, par d’abominables scélérats ou par des gens sortis des derniers rangs de la société. Mais, pour que Rodin atteignît plus sûrement ce but il lui fallait absolument réussir, dans ce qu’il s’était engagé à accomplir, sans violence, et seulement par le jeu et par le ressort des passions habilement maniées, à savoir : Assurer à la compagnie de Jésus la possession des biens de la famille de Rennepont.
Possession qui, de la sorte, avait une double et immense conséquence ; car Rodin, selon ses visées personnelles, songeait à se faire de son ordre (dont le chef était à sa discrétion) un marchepied et un moyen d’intimidation.
Sa première impression de surprise passée, impression qui n’était pour ainsi dire qu’une sorte de modestie d’ambition, de défiance de soi, assez commune aux hommes réellement supérieurs, Rodin, envisageant plus froidement, plus logiquement les choses, se reprocha presque sa surprise.
Pourtant, bientôt après, par une contradiction bizarre, cédant encore à une de ces idées puériles auxquelles l’homme obéit souvent lorsqu’il se sait ou se croit parfaitement seul et caché, Rodin se leva brusquement, prit la lettre qui lui avait causé une si heureuse surprise, et alla pour ainsi dire l’étaler sous les yeux de l’image du jeune pâtre devenu pape ; puis, secouant fièrement, triomphalement la tête, dardant sur le portrait son regard de reptile, il dit entre ses dents, en mettant son doigt crasseux sur l’emblème pontifical :
– Hein ! frère ? et moi aussi… peut-être…
Après cette interpellation ridicule, Rodin revint à sa place, et comme si l’heureuse nouvelle qu’il venait de recevoir eût exaspéré son appétit, il plaça la lettre devant lui pour la relire encore une fois, et, la couvant des yeux, il se prit à mordre avec une sorte de furie joyeuse dans son pain dur et dans son radis noir en chantonnant un vieil air de litanies.
* * * * *
Il y avait quelque chose d’étrange, de grand et surtout d’effrayant dans l’opposition de cette ambition immense, déjà presque justifiée par les événements, et contenue, si cela peut se dire, dans un si misérable réduit.
Le père d’Aigrigny, homme sinon très supérieur, du moins d’une valeur réelle, grand seigneur de naissance, très hautain, placé dans le meilleur monde, n’aurait jamais osé avoir seulement la pensée de prétendre à ce que prétendait Rodin de prime saut ; l’unique visée du père d’Aigrigny, il la trouvait impertinente, était d’arriver à être un jour élu général de son ordre, de cet ordre qui embrassait le monde. La différence des aptitudes ambitieuses de ces personnages est concevable. Lorsqu’un homme d’un esprit éminent, d’une nature saine et vivace, concentrant toutes les forces de son âme et de son corps sur une pensée unique, pratique obstinément ainsi que le faisait Rodin, la chasteté, la frugalité, enfin le renoncement volontaire à toute satisfaction du cœur ou des sens, presque toujours cet homme ne se révolte ainsi contre les vœux sacrés du Créateur qu’au profit de quelque passion monstrueuse et dévorante, divinité infernale qui, par un acte sacrilège, lui demande, en échange d’une puissance redoutable, l’anéantissement de tous les nobles penchants, de tous les ineffables attraits, de tous les tendres instincts dont le Seigneur, dans sa sagesse éternelle, dans son inépuisable munificence, a si paternellement doué la créature.
* * * * *
Pendant la scène muette que nous venons de dépeindre, Rodin ne s’était pas aperçu que les rideaux d’une des fenêtres situées au troisième étage du bâtiment qui dominait le corps de logis où il habitait s’étaient légèrement écartés et avaient à demi découvert la mine espiègle de Rose-Pompon et la face de Silène de Nini-Moulin.
Il s’ensuivait que Rodin, malgré son rempart de mouchoirs à tabac, n’avait été nullement garanti de l’examen indiscret et curieux des deux coryphées de la Tulipe orageuse.
III. Une visite inattendue.
Rodin, quoiqu’il eût éprouvé une profonde surprise à la lecture de la seconde lettre de Rome, ne voulut pas que sa réponse témoignât de cet étonnement. Son frugal déjeuner terminé, il prit une feuille de papier et chiffra rapidement la note suivante, de ce ton rude et tranchant qui lui était habituel lorsqu’il n’était pas obligé de se contraindre :
« Ce que l’on m’apprend ne me surprend point. J’avais tout prévu. Indécision et lâcheté portent toujours ces fruits-là. Ce n’est pas assez. La Russie hérétique égorge la Pologne catholique. Rome bénit les meurtriers et maudit les victimes[3].
« Cela me va.
« En retour, la Russie garantit à Rome, par l’Autriche, la compression sanglante des patriotes de la Romagne.
« Cela me va toujours.
« Les bandes d’égorgeurs du bon cardinal Albani ne suffisent plus au massacre des libéraux impies ; elles sont lasses.
« Cela ne me va plus. Il faut qu’elles marchent. »
Au moment où Rodin venait d’écrire ces derniers mots, son attention fut tout à coup distraite par la voix fraîche et sonore de Rose-Pompon, qui, sachant son Béranger par cœur, avait ouvert la fenêtre de Philémon, et assise sur la barre d’appui, chantait avec beaucoup de charme et de gentillesse ce couplet de l’immortel chansonnier :
Mais, quelle erreur ! non, Dieu, n’est pas colère,
S’il créa tout… à tout il sera d’appui :
Vins qu’il nous donne, amitié tutélaire,
Et vous, amours, qui créez après lui,
Prêtez un charme à ma philosophie ;
Pour dissiper des rêves affligeants,
Le verre en main, que chacun se confie
Au Dieu des bonnes gens !
Ce chant, d’une mansuétude divine, contrastait si étrangement avec la froide cruauté des quelques lignes écrites par Rodin, qu’il tressaillit et se mordit les lèvres de rage en reconnaissant ce refrain du poète véritablement chrétien qui avait porté de si rudes coups à la mauvaise Église. Rodin attendit quelques instants dans une impatience courroucée, croyant que la voix allait continuer ; mais Rose-Pompon se tut, ou du moins ne fit plus que fredonner, et bientôt passa à un autre air, celui du Bon papa, qu’elle vocalisa, même sans paroles. Rodin, n’osant pas aller regarder par sa croisée quelle était cette importune chanteuse, haussa les épaules, reprit sa plume et continua :
« Autre chose : Il faudrait exaspérer les indépendants de tous les pays, soulever la rage philosophaille de l’Europe, et faire écumer le libéralisme, ameuter contre Rome tout ce qui vocifère. Pour cela, proclamer à la face du monde les trois propositions suivantes :
« 1° Il est abominable de soutenir que l’on peut faire son salut dans quelque profession de foi que ce soit, pourvu que les mœurs soient pures ;
« 2° Il est odieux et absurde d’accorder aux peuples la liberté de conscience ;
« 3° L’on ne saurait avoir trop d’horreur contre la liberté de la presse.
« Il faut amener l’homme faible à déclarer ces propositions de tout point orthodoxes, lui vanter leur bon effet sur les gouvernements despotiques, sur les vrais catholiques, sur les museleurs de populaire. Il se prendra au piège. Les propositions formulées, la tempête éclate. Soulèvement général contre Rome, scission profonde ; le sacré collège se divise en trois partis. L’un approuve, l’autre blâme, l’autre tremble. L’homme faible, encore plus épouvanté qu’il ne l’est aujourd’hui d’avoir laisser égorger la Pologne, recule devant les clameurs, les reproches, les menaces, les ruptures violentes qu’il soulève.
« Cela me va toujours, et beaucoup.
« Alors, à notre père vénéré d’ébranler la conscience de l’homme faible, d’inquiéter son esprit, d’effrayer son âme.
« En résumé : abreuver de dégoûts, diviser son conseil, l’isoler, l’effrayer, redoubler l’ardeur féroce du bon Albani, réveiller l’appétit des Sanfédistes[4], leur donner des libéraux à leur faim ; pillage, viol, massacre comme à Césène, vraie marée montante de sang carbonaro, l’homme faible en aura le déboire, tant de tueries en son nom !!! il reculera… il reculera… chacun de ses jours aura son remords, chaque nuit sa terreur, chaque minute son angoisse. Et l’abdication dont il menace déjà viendra enfin, peut-être trop tôt. C’est le seul danger à présent, à vous d’y pourvoir.
« En cas d’abdication… le grand pénitencier m’a compris. Au lieu de confier à un général le commandement de notre ordre, la meilleure milice du saint-siège, je la commande moi-même. Dès lors cette milice ne m’inquiète plus : exemple… les janissaires et les gardes prétoriennes toujours funestes à l’autorité ; pourquoi ? parce qu’ils ont pu s’organiser comme défenseurs du pouvoir en dehors du pouvoir ; de là, leur puissance d’intimidation.
« Clément XIV ? un niais. Flétrir, abolir notre compagnie, faute absurde. La défendre, l’innocenter, s’en déclarer le général, voilà ce qu’il devait faire. La compagnie, alors à sa merci, consentait à tout ; il nous absorbait, nous inféodait au saint-siège, qui n’avait plus à redouter… nos services !!! Clément XIV est mort de la colique. À bon entendeur, salut. Le cas échéant, je ne mourrai pas de cette mort. »
La voix vibrante et perlée de Rose-Pompon retentit de nouveau.
Rodin fit un bond de colère sur sa chaise ; mais bientôt, et à mesure qu’il entendit le couplet suivant, qu’il ne connaissait pas (il ne possédait pas son Béranger comme la veuve de Philémon), le jésuite, accessible à certaines idées bizarrement superstitieuses, resta interdit, presque effrayé de ce singulier rapprochement. C’est le bon pape de Béranger qui parle :
Que sont les rois ? de sots bélîtres
Ou des brigands qui, gros d’orgueil,
Donnant leurs crimes pour des titres,
Entre eux se poussent au cercueil.
À prix d’or je puis les absoudre
Ou changer leur sceptre en bourdon ;
Ma Dondon,
Riez donc !
Sautez donc !
Regardez-moi lancer la foudre
Jupin m’a fait son héritier,
Je suis entier.
Rodin, à demi levé de sa chaise, le cou tendu, l’œil fixe, écoutait encore, que Rose-Pompon, voltigeant comme une abeille d’une fleur à une autre de son répertoire, chantonnait déjà le ravissant refrain de Colibri. N’entendant plus rien, le jésuite se rassit avec une sorte de stupeur ; mais au bout de quelques minutes de réflexion, sa figure rayonna tout à coup ; il voyait un heureux présage dans ce singulier incident. Il reprit sa plume, et ses premiers mots se ressentirent pour ainsi dire de cette étrange confiance dans la fatalité :
« Jamais je n’ai cru plus au bon succès qu’en ce moment. Raison de plus pour ne rien négliger. Tout pressentiment commande un redoublement de zèle. Une nouvelle pensée m’est venue hier. On agira ici de concert. J’ai fondé un journal ultra-catholique : l’Amour du prochain. À sa furie ultramontaine, tyrannique, liberticide, on le croira l’organe de Rome. J’accréditerai ces bruits. Nouvelles furies.
« Cela me va.
« Je vais soulever la question de liberté d’enseignement ; les libéraux du cru nous appuieront. Niais, ils nous admettent au droit commun, quand nos privilèges, nos immunités, notre influence du confessionnal, notre obédience à Rome, nous mettent en dehors du droit commun même, par les avantages dont nous jouissons. Doubles niais, ils nous croient désarmés parce qu’ils le sont eux-mêmes contre nous. Question brûlante ; clameurs irritantes, nouveaux dégoûts pour l’homme faible. Tout ruisseau grossit le torrent.
« Cela me va toujours.
« Pour résumer en deux mots : la fin, c’est l’abdication. Le moyen, harcèlement, torture incessante. L’héritage Rennepont paye l’élection. Prix faits, marchandise vendue. »
Rodin s’interrompit brusquement d’écrire, croyant avoir entendu quelque bruit à la porte de sa chambre, qui ouvrait sur l’escalier ; il prêta l’oreille, suspendit sa respiration, tout redevint silencieux. Il croyait s’être trompé, et reprit sa plume.
« Je me charge de l’affaire Rennepont, unique pivot de nos combinaisons temporelles ; il faut reprendre en sous-œuvre, substituer le jeu des intérêts, le ressort des passions, aux stupides coups de massue du père d’Aigrigny ; il a failli tout compromettre ; il a pourtant de très bonnes parties ; mais une seule gamme ; et puis pas assez grand pour savoir se faire petit. Dans son vrai milieu, j’en tirerai parti, les morceaux en sont bons. J’ai usé à temps du franc pouvoir du révérend père général ; j’apprendrai, si besoin est, au père d’Aigrigny, les engagements secrets pris envers moi par le général ; jusqu’ici on lui a laissé forger pour cet héritage la destination que vous savez ; bonne pensée, mais inopportune : même but par autre voie.
« Les renseignements faux. Il y a plus de deux cents millions ; l’éventualité échéant, le douteux est certain ; reste une latitude immense. L’affaire Rennepont est à cette heure deux fois mienne, avant trois mois ces deux cents millions seront à nous, par la libre volonté des héritiers, il le faut. Car, ceci manquant, le parti temporel m’échappe ; mes chances diminuent de moitié. J’ai demandé pleins pouvoirs ; le temps presse, j’agis comme si je les avais. Un renseignement m’est indispensable pour mes projets ; je l’attends de vous ; il me le faut, vous m’entendez ? la haute influence de votre frère à la cour de Vienne vous servira. Je veux avoir les détails les plus précis sur la position actuelle du duc de Reichstadt, le Napoléon II des impérialistes. Peut-on, oui ou non, nouer par votre frère une correspondance secrète avec le prince ou à l’insu de son entourage ? Avisez promptement, ceci est urgent ; cette note part aujourd’hui : je la compléterai demain… Elle vous parviendra, comme toujours, par le petit marchand. »
Au moment où Rodin venait de mettre et de cacheter cette lettre sous une double enveloppe, il crut de nouveau entendre du bruit au dehors… Il écouta. Au bout de quelques moments de silence, plusieurs coups frappés à sa porte retentirent dans la chambre. Rodin tressaillit : pour la première fois, l’on heurtait à sa porte depuis près d’une année qu’il venait dans ce logis. Serrant précipitamment dans la poche de sa redingote la lettre qu’il venait d’écrire, le jésuite alla ouvrir la vieille malle cachée sous le lit de sangle, y prit un paquet de papiers enveloppé d’un mouchoir à tabac en lambeaux, joignit à ce dossier les deux lettres chiffrées qu’il venait de recevoir, et cadenassa soigneusement la malle.
L’on continuait de frapper au dehors avec un redoublement d’impatience.
Rodin prit le panier de la fruitière à la main, son parapluie sous son bras, et, assez inquiet, alla voir quel était l’indiscret visiteur. Il ouvrit la porte, et se trouva en face de Rose-Pompon, la chanteuse importune, qui, faisant une accorte et gentille révérence, lui demanda d’un air parfaitement ingénu :
– M. Rodin, s’il vous plaît ?
IV. Un service d’ami.
Rodin, malgré sa surprise et son inquiétude, ne sourcilla pas ; il commença par fermer sa porte après soi, remarquant le coup d’œil curieux de la jeune fille, puis il lui dit avec bonhomie :
– Qui demandez-vous, ma chère fille ?
– M. Rodin, reprit crânement Rose-Pompon en ouvrant ses jolis yeux bleus de toute leur grandeur, et regardant Rodin bien en face.
– Ce n’est pas ici… dit-il en faisant un pas pour descendre. Je ne connais pas… Voyez plus haut ou plus bas.
– Oh ! que c’est joli ! Voyons… faites donc le gentil, à votre âge ! dit Rose-Pompon en haussant les épaules, comme si on ne savait pas que c’est vous qui vous appelez M. Rodin.
– Charlemagne, dit le socius en s’inclinant, Charlemagne, pour vous servir, si j’en étais capable.
– Vous n’en êtes pas capable, répondit Rose-Pompon d’un ton majestueux, et elle ajouta d’un air narquois : – Nous avons donc des cachettes à la minon-minette, que nous changeons de nom ?… Nous avons peur que maman Rodin nous espionne ?
– Tenez, ma chère fille, dit le socius en souriant d’un air paternel, vous vous adressez bien : je suis un vieux bonhomme qui aime la jeunesse… la joyeuse jeunesse. Ainsi, amusez-vous, même à mes dépens… mais laissez-moi passer, car l’heure me presse…
Et Rodin fit de nouveau un pas vers l’escalier.
– Monsieur Rodin, dit Rose-Pompon d’une voix solennelle, j’ai des choses très importantes à vous communiquer, des conseils à vous demander sur une affaire de cœur.
– Ah çà ! voyons, petite folle, vous n’avez donc personne à tourmenter dans votre maison que vous venez dans celle-ci ?
– Mais je loge ici, monsieur Rodin, répondit Rose-Pompon en appuyant malicieusement sur le nom de sa victime.
– Vous ? ah bah ! j’ignorais un si joli voisinage.
– Oui… je loge ici depuis six mois, monsieur Rodin.
– Vraiment ! et où donc ?
– Au troisième, dans le bâtiment du devant, monsieur Rodin.
– C’est donc vous qui chantiez si bien tout à l’heure ?
– Moi-même, monsieur Rodin.
– Vous m’avez fait le plus grand plaisir, en vérité.
– Vous êtes bien honnête, monsieur Rodin.
– Et vous logez avec votre respectable famille, je suppose ?
– Je crois bien, monsieur Rodin, dit Rose-Pompon en baissant les yeux d’un air ingénu : j’habite avec grand-papa Philémon et grand’maman Bacchanal… une reine, rien que ça.
Rodin avait été jusqu’alors assez gravement inquiet, ignorant de quelle manière Rose-Pompon avait surpris son véritable nom ; mais, en entendant nommer la reine Bacchanal et en apprenant qu’elle logeait dans cette maison, il trouva une compensation à l’incident désagréable soulevé par l’apparition de Rose-Pompon ; il importait en effet beaucoup à Rodin de savoir où trouver la reine Bacchanal, maîtresse de Couche-tout-Nu et sœur de la Mayeux, de la Mayeux signalée comme dangereuse depuis son entretien avec la supérieure du couvent, et depuis la part qu’elle avait prise aux projets de fuite de Mlle de Cardoville. De plus, Rodin espérait, grâce à ce qu’il venait d’apprendre, amener adroitement Rose-Pompon à lui confesser le nom de la personne dont elle tenait que M. Charlemagne s’appelait M. Rodin.
À peine la jeune fille eut-elle prononcé le nom de la reine Bacchanal, que Rodin, joignit les mains, paraissant aussi surpris que vivement intéressé.
– Ah ! ma chère fille, s’écria-t-il, je vous en conjure, ne plaisantons pas… S’agirait-il, par hasard, d’une jeune fille qui porte ce surnom et qui est sœur d’une ouvrière contrefaite ?…
– Oui, monsieur, la reine Bacchanal est son surnom, dit Rose-Pompon assez étonnée à son tour ; elle s’appelle Céphyse Soliveau : c’est mon amie.
– Ah ! c’est votre amie ! dit Rodin en réfléchissant.
– Oui, monsieur, mon amie intime…
– Et vous l’aimez ?
– Comme une sœur… Pauvre fille ! je fais ce que je peux pour elle ! et ce n’est guère… Mais comment un respectable homme de votre âge connaît-il la reine Bacchanal ?… Ah ! ah ! c’est ce qui prouve que vous portez des faux noms…
– Ma chère fille ! je n’ai plus envie de rire maintenant, dit si tristement Rodin que Rose-Pompon, se reprochant sa plaisanterie, lui dit : – Mais enfin, comment connaissez-vous Céphyse ?
– Hélas ! ce n’est pas elle que je connais… mais un brave garçon qui l’aime comme un fou !…
– Jacques Rennepont !
– Autrement dit Couche-tout-Nu… À cette heure, il est en prison pour dettes, reprit Rodin avec un soupir. Je l’y ai vu hier.
– Vous l’avez vu hier ? Mais, comme ça se trouve ! dit Rose-Pompon en frappant dans ses mains. Alors, venez vite, venez tout de suite chez Philémon, vous donnerez à Céphyse des nouvelles de son amant… elle est si inquiète !…
– Ma chère fille… je voudrais ne lui donner que de bonnes nouvelles de ce digne garçon que j’aime malgré ses folies… car qui n’en a pas fait des folies ? ajouta Rodin avec une indulgente bonhomie.
– Pardieu ! dit Rose-Pompon en se balançant sur ses hanches comme si elle eût été encore costumée en débardeur.
– Je dirai plus, ajouta Rodin, je l’aime à cause de ses folies ; car, voyez-vous, on a beau dire, ma chère fille, il y a toujours un bon fonds, un bon cœur, quelque chose enfin, chez ceux qui dépensent généreusement leur argent pour les autres.
– Eh bien ! tenez, vous êtes un très brave homme, vous ! dit Rose-Pompon enchantée de la philosophie de Rodin. Mais pourquoi ne voulez-vous pas venir voir Céphyse pour lui parler de Jacques ?
– À quoi bon lui apprendre ce qu’elle sait ? Que Jacques est en prison ?… Ce que je voudrais, moi, ce serait de tirer ce pauvre garçon d’un si mauvais pas…
– Oh ! monsieur, faites cela, tirez Jacques de prison, s’écria vivement Rose-Pompon, et nous vous embrasserons nous deux, Céphyse et moi.
– Ce serait du bien perdu, chère petite folle, dit Rodin en souriant ; mais rassurez-vous, je n’ai pas besoin de récompense pour vous faire un peu de bien quand je le puis.
– Ainsi vous espérez tirer Jacques de prison ?…
Rodin secoua la tête et reprit d’un air chagrin et contrarié :
– Je l’espérais… mais, à cette heure… que voulez-vous ? tout est changé…
– Et pourquoi donc ? demanda Rose-Pompon surprise.
– Cette mauvaise plaisanterie que vous me faites en m’appelant M. Rodin doit vous paraître très amusante, ma chère fille, je le comprends : vous n’êtes en cela qu’un écho… Quelqu’un vous aura dit : « Allez dire à M. Charlemagne qu’il s’appelle M. Rodin… ça sera fort drôle. »
– Bien sûr qu’il ne me fût pas venu à l’idée de vous appeler M. Rodin… on n’invente pas un nom comme celui-là soi-même, répondit Rose-Pompon.
– Eh bien ! cette personne, avec ses mauvaises plaisanteries, a fait sans le savoir un grand tort au pauvre Jacques Rennepont.
– Ah ! mon Dieu ! et cela parce que je vous ai appelé M. Rodin, au lieu de M. Charlemagne ? s’écria Rose-Pompon tout attristée, regrettant alors la plaisanterie qu’elle avait faite à l’instigation de Nini-Moulin. Mais enfin monsieur, reprit-elle, qu’est-ce que cette plaisanterie a de commun avec le service que vous vouliez rendre à Jacques ?
– Il ne m’est pas permis de vous le dire, ma chère fille. En vérité… je suis désolé de tout ceci pour ce pauvre Jacques… croyez-le bien ; mais permettez-moi de descendre.
– Monsieur… écoutez-moi, je vous en prie, dit Rose-Pompon : si je vous disais le nom de la personne qui m’a engagée à vous appeler M. Rodin, vous intéresseriez-vous toujours à Jacques ?
– Je ne cherche pas à surprendre les secrets de personne… ma chère fille… vous avez été dans tout ceci le jouet ou l’écho de personnes peut-être fort dangereuses, et, ma foi ! malgré l’intérêt que m’inspire Jacques Rennepont, je n’ai pas envie, vous entendez bien, de me faire des ennemis, moi, pauvre homme… Dieu m’en garde !
Rose-Pompon ne comprenait rien aux craintes de Rodin et il y comptait bien ; car après une seconde de réflexion la jeune fille lui dit :
– Tenez, monsieur, c’est trop fort pour moi, je n’y entends rien ; mais ce que je sais, c’est que je serais désolée d’avoir fait tort à un brave garçon pour une plaisanterie. Je vais donc vous dire tout bonnement ce qui en est ; ma franchise sera peut-être utile à quelque chose…
– La franchise éclaire souvent les choses obscures, dit sentencieusement Rodin.
– Après tout, dit Rose-Pompon, tant pis pour Nini-Moulin. Pourquoi me fait-il dire des bêtises qui peuvent nuire à l’amant de cette pauvre Céphyse ? Voilà, monsieur, ce qui est arrivé : Nini-Moulin, un gros farceur, vous a vu tout à l’heure dans la rue ; la portière lui a dit que vous vous appeliez M. Charlemagne. Il m’a dit à moi : « Non, il s’appelle Rodin, il faut lui faire une farce : Rose-Pompon, allez à sa porte, frappez-y, appelez-le M. Rodin. Vous verrez la drôle de figure qu’il fera. » J’ai promis à Nini-Moulin de ne pas le nommer ; mais dès que ça pourrait risquer de nuire à Jacques… tans pis, je le nomme.
Au nom de Nini-Moulin, Rodin n’avait pu retenir un mouvement de surprise. Ce pamphlétaire, qu’il avait fait charger de la rédaction de l’Amour du prochain, n’était pas personnellement à craindre ; mais Nini-Moulin, très bavard et très expansif après boire, pouvait être inquiétant, gênant, surtout si Rodin, ainsi que cela était probable, devait revenir plusieurs fois dans cette maison pour exécuter ses projets sur Couche-tout-Nu, par l’intermédiaire de la reine Bacchanal. Le socius se promit donc d’aviser à cet inconvénient.
– Ainsi, ma chère fille, dit-il à Rose-Pompon, c’est un M. Desmoulins qui vous a engagée à me faire cette mauvaise plaisanterie ?
– Non pas Desmoulins… mais Dumoulin, reprit Rose-Pompon. Il écrit dans les journaux des sacristains, et il défend les dévots pour l’argent qu’on lui donne, car si Nini-Moulin est un saint… ses patrons sont saint Soiffard et saint Chicard, comme il dit lui-même.
– Ce monsieur me paraît fort gai.
– Oh ! très bon enfant !
– Mais attendez donc, attendez donc, reprit Rodin en paraissant rappeler ses souvenirs ; n’est-ce pas un homme de trente-six à quarante ans, gros… la figure colorée ?
– Colorée comme un verre de vin rouge, dit Rose-Pompon, et, par dessus, le nez bourgeonné… comme une framboise…
– C’est bien lui… M. Dumoulin… oh ! alors vous me rassurez complètement, ma chère fille ; la plaisanterie ne m’inquiète plus guère. Mais c’est un très digne homme que M. Dumoulin, aimant peut-être un peu trop le plaisir…
– Ainsi, monsieur, vous tâcherez toujours d’être utile à Jacques ? La bête de plaisanterie de Nini-Moulin ne vous en empêchera pas ?
– Non, je l’espère.
– Ah çà ! il ne faudra pas que je dise à Nini-Moulin que vous savez que c’est lui qui m’a dit de vous appeler M. Rodin, n’est-ce pas, monsieur ?
– Pourquoi non ? En toutes choses, ma fille, il faut toujours dire franchement la vérité.
– Mais, monsieur, Nini-Moulin m’a tant recommandé de ne pas vous le nommer…
– Si vous me l’avez nommé, c’est par un très bon motif ; pourquoi ne pas le lui avouer ? Du reste, ma chère fille, ceci vous regarde, et non pas moi… Faites comme vous voudrez…
– Et pourrais-je dire à Céphyse vos intentions pour Jacques ?
– La franchise, ma chère fille, toujours la franchise… on ne risque jamais rien de dire ce qui est…
– Pauvre Céphyse, va-t-elle être heureuse !… dit vivement Rose-Pompon. Et cela lui viendra bien à propos…
– Seulement, il ne faut pas qu’elle s’exagère trop ce bonheur. Je ne promets pas positivement… de faire sortir ce digne garçon de prison… je dis que je tâcherai ; mais ce que je promets positivement, car depuis l’emprisonnement de Jacques, je crois votre amie dans une position bien gênée…
– Hélas ! monsieur…
– Ce que je promets, dis-je, c’est un petit secours… que votre amie recevra aujourd’hui, afin qu’elle ait le moyen de vivre honnêtement… et si elle est sage, eh bien !… si elle est sage, plus tard on verra…
– Ah ! monsieur, vous ne savez pas comme vous venez à temps au secours de cette pauvre Céphyse… On dirait que vous êtes son vrai bon ange… Ma foi, que vous vous appeliez M. Rodin ou M. Charlemagne, tout ce que je puis jurer, c’est que vous êtes un excellent…
– Allons, allons, n’exagérons rien, dit Rodin en interrompant Rose-Pompon ; dites un bon vieux brave homme et rien de plus, ma chère fille. Mais voyez donc comme les choses s’enchaînent quelquefois ! Je vous demande un peu qui m’aurait dit, lorsque j’entendais frapper à ma porte, ce qui m’impatientait fort, je l’avoue, qui m’aurait dit que c’était une petite voisine qui, sous le prétexte d’une mauvaise plaisanterie, me mettait sur la voie d’une bonne action… Allons, donnez courage à votre amie… ce soir elle recevra un secours, et, ma foi, confiance et espoir ! Dieu merci ! il est encore de bonnes gens sur la terre.
– Ah ! monsieur… vous le prouvez bien.
– Que voulez-vous ? c’est tout simple : le bonheur des vieux… c’est de voir le bonheur des jeunes…
Ceci fut dit par Rodin avec une bonhomie si parfaite que Rose-Pompon sentit ses yeux humides et reprit tout émue :
– Tenez, monsieur, Céphyse et moi, nous ne sommes que de pauvres filles ; il y en a de plus vertueuses, c’est encore vrai, mais nous avons, j’ose le dire, bon cœur : aussi, voyez-vous, si jamais vous étiez malade, appelez-nous ; il n’y a pas de bonnes sœurs qui vous soigneraient mieux que nous… C’est tout ce que nous pouvons vous offrir ; sans compter Philémon que je ferais se scier en quatre morceaux pour vous ; je m’y engage sur l’honneur ; comme Céphyse, j’en suis sûre, s’engagerait aussi pour Jacques, qui serait pour vous à la vie, à la mort.
– Vous voyez donc bien, chère fille, que j’avais raison de dire : tête folle bon cœur… Adieu et au revoir !
Puis Rodin, reprenant son panier, qu’il avait posé à terre à côté de son parapluie, se disposa à descendre l’escalier.
– D’abord vous allez me donner ce panier-là, il vous gênerait pour descendre, dit Rose-Pompon en retirant en effet le panier des mains de Rodin, malgré la résistance de celui-ci.
Puis elle ajouta :
– Appuyez-vous sur mon bras : l’escalier est si noir… vous pourriez faire un faux pas.
– Ma foi, j’accepte votre offre, ma chère fille, car je ne suis pas bien vaillant.
En s’appuyant paternellement sur le bras droit de Rose-Pompon, qui portait le panier de la main gauche, Rodin descendit l’escalier et traversa la cour.
– Tenez, voyez-vous là-haut, au troisième, cette grosse face collée aux carreaux ? dit tout à coup Rose-Pompon à Rodin en s’arrêtant au milieu de la petite cour, c’est Nini-Moulin… Le reconnaissez-vous ? Est-ce bien le vôtre ?
– C’est bien le mien, dit Rodin après avoir levé la tête ; et il fit de la main un salut très affectueux à Jacques Dumoulin, qui, stupéfait, se retira brusquement de la fenêtre.
– Le pauvre garçon… Je suis sûr qu’il a peur de moi… depuis sa mauvaise plaisanterie, dit Rodin en souriant. Il a bien tort !
Et il accompagna les mots il a bien tort d’un sinistre pincement de lèvres dont Rose-Pompon ne put s’apercevoir.
– Ah çà ! ma chère fille, lui dit-il lorsque tous deux entrèrent dans l’allée, je n’ai plus besoin de votre aide ; remontez vite chez votre amie lui donner les bonnes nouvelles que vous savez.
– Oui, monsieur, vous avez raison, car je grille d’aller lui dire quel brave homme vous êtes.
Et Rose-Pompon s’élança dans l’escalier.
– Eh bien !… eh bien !… et mon panier qu’elle emporte, cette petite folle ! dit Rodin.
– Ah ! c’est vrai… Pardon, monsieur, le voici… Pauvre Céphyse ! va-t-elle être contente ! Adieu, monsieur.
Et la gentille figure de Rose-Pompon disparut dans les limbes de l’escalier, qu’elle gravit d’un pied alerte et impatient.
Rodin sortit de l’allée.
– Voici votre panier, chère dame, dit-il en s’arrêtant sur le seuil de la boutique de la mère Arsène. Je vous fais mes humbles remerciements… de votre obligeance…
– Il n’y a pas de quoi, mon digne monsieur ; c’est tout à votre service… Eh bien ! le radis était-il bon ?
– Succulent, ma chère dame, succulent et excellent.
– Ah ! j’en suis bien aise. Vous reverra-t-on bientôt ?
– J’espère que oui… Mais pourriez-vous m’indiquer un bureau de poste voisin ?
– En détournant la rue à gauche, la troisième maison, chez l’épicier.
– Mille remerciements.
– Je parie que c’est un billet doux pour votre bonne amie, dit la mère Arsène, mise en gaieté par le contact de Rose-Pompon et de Nini-Moulin.
– Eh !… eh !… eh !… cette chère dame, dit Rodin en ricanant ; puis redevenant tout à coup parfaitement sérieux, il fit un profond salut à la fruitière en lui disant :
– Votre serviteur de tout mon cœur… Et il gagna la rue.
* * * * *
Nous conduirons maintenant le lecteur dans la maison du docteur Baleinier, où était encore enfermée Mlle de Cardoville.
V. Les conseils.
Adrienne de Cardoville avait été encore plus étroitement renfermée dans la maison du docteur Baleinier depuis la double tentative nocturne d’Agricol et de Dagobert, en suite de laquelle le soldat, assez grièvement blessé, était parvenu, grâce au dévouement intrépide d’Agricol, assisté de l’héroïque Rabat-Joie, à regagner la petite porte du jardin du couvent et à fuir par le boulevard extérieur avec le jeune forgeron.