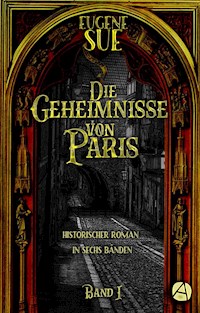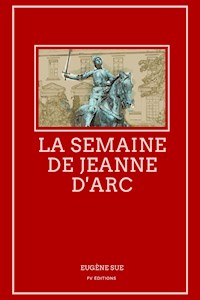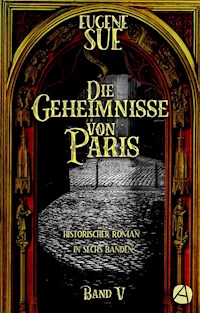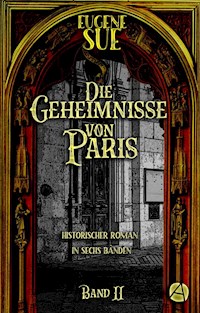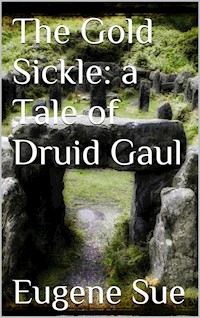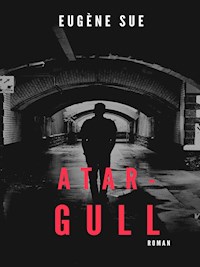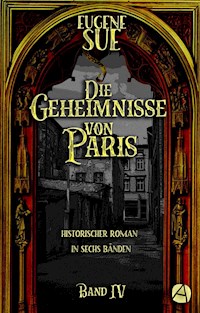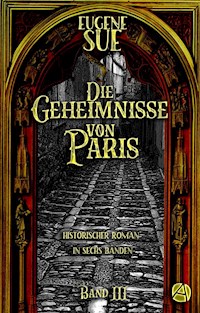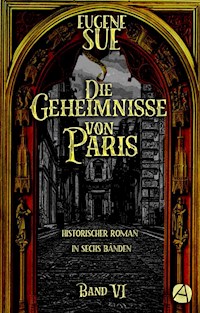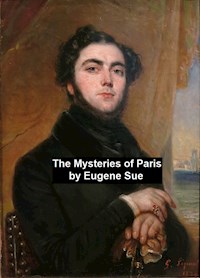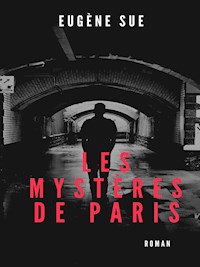
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Voici un roman mythique, presque à l'égal du Comte de Monte-Cristo ou des Trois mousquetaires, un grand roman d'aventures, foisonnant, qui nous décrit un Paris mystérieux et inconnu, dévoilé dans ses recoins les plus secrets, un Paris exotique où les apaches de Paris remplacent ceux de l'Amérique. Errant dans les rues sombres et dangereuses de la Cité, déguisé en ouvrier, le prince Rodolphe de Gérolstein sauve une jeune prostituée, Fleur-de-Marie, dite la Goualeuse, des brutalités d'un ouvrier, le Chourineur. Sans rancune contre son vainqueur, le Chourineur entraîne Rodolphe et Fleur-de-Marie dans un tripot, Au Lapin Blanc. Là, le Chourineur et Fleur-de-Marie content leur triste histoire à Rodolphe. Tous deux, livrés dès l'enfance à l'abandon et à la misère la plus atroce, malgré de bons instincts, sont tombés dans la dégradation: le meurtre pour le Chourineur, dans un moment de violence incontrôlée, la prostitution pour Fleur-de-Marie. Rodolphe se fait leur protecteur et entreprend de les régénérer en les arrachant à l'enfer du vice et de la misère où ils sont plongés...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les mystères de Paris
Les mystères de ParisPREMIÈRE PARTIEDEUXIÈME PARTIEPage de copyrightLes mystères de Paris
Eugène Sue
PREMIÈRE PARTIE
I Le tapis-franc
Un tapis-franc, en argot de vol et de meurtre, signifie un estaminet ou un cabaret du plus bas étage.
Un repris de justice, qui, dans cette langue immonde, s’appelle un ogre, ou une femme de même dégradation, qui s’appelle une ogresse, tiennent ordinairement ces tavernes, hantées par le rebut de la population parisienne ; forçats libérés, escrocs, voleurs, assassins y abondent.
Un crime a-t-il été commis, la police jette, si cela se peut dire, son filet dans cette fange ; presque toujours elle y prend les coupables.
Ce début annonce au lecteur qu’il doit assister à de sinistres scènes ; s’il y consent, il pénétrera dans des régions horribles, inconnues ; des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ces cloaques impurs comme les reptiles dans les marais.
Tout le monde a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, a tracé les mœurs féroces des sauvages, leur langue pittoresque, poétique, les mille ruses à l’aide desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis.
On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes, en songeant que si près d’eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares, que leurs habitudes sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation.
Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d’autres barbares aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper.
Seulement les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous ; nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repaires où ils vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes.
Ces hommes ont des mœurs à eux, des femmes à eux, un langage à eux, langage mystérieux, rempli d’images funestes, de métaphores dégouttantes de sang.
Comme les sauvages, enfin, ces gens s’appellent généralement entre eux par des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à certains avantages ou à certaines difformités physiques.
Nous abordons avec une double défiance quelques-unes des scènes de ce récit.
Nous craignons d’abord qu’on ne nous accuse de rechercher des épisodes repoussants, et, une fois même cette licence admise, qu’on ne nous trouve au-dessous de la tâche qu’impose la reproduction fidèle, vigoureuse, hardie, de ces mœurs excentriques.
En écrivant ces passages dont nous sommes presque effrayé, nous n’avons pu échapper à une sorte de serrement de cœur… nous n’oserions dire de douloureuse anxiété… de peur de prétention ridicule.
En songeant que peut-être nos lecteurs éprouveraient le même ressentiment, nous nous sommes demandé s’il fallait nous arrêter ou persévérer dans la voie où nous nous engagions, si de pareils tableaux devaient être mis sous les yeux du lecteur.
Nous sommes presque resté dans le doute ; sans l’impérieuse exigence de la narration, nous regretterions d’avoir placé en si horrible lieu l’explosion du récit qu’on va lire. Pourtant nous comptons un peu sur l’espèce de curiosité craintive qu’excitent quelquefois les spectacles terribles.
Et puis encore nous croyons à la puissance des contrastes.
Sous ce point de vue de l’art, il est peut-être bon de reproduire certains caractères, certaines existences, certaines figures, dont les couleurs sombre, énergiques, peut-être même crues, serviront de repoussoir, d’opposition à des scènes d’un tout autre genre.
Le lecteur, prévenu de l’excursion que nous lui proposons d’entreprendre parmi les naturels de cette race infernale qui peuple les prisons, les bagnes, et dont le sang rougit les échafauds… le lecteur voudra peut-être bien nous suivre. Sans doute cette investigation sera nouvelle pour lui ; hâtons-nous de l’avertir d’abord que, s’il pose d’abord le pied sur le dernier échelon de l’échelle sociale, à mesure que le récit marchera, l’atmosphère s’épurera de plus en plus.
Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d’une taille athlétique, vêtu d’une mauvaise blouse, traversa le pont au Change et s’enfonça dans la Cité, dédale de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s’étend depuis le Palais de Justice jusqu’à Notre-Dame.
Le quartier du Palais de Justice, très-circonscrit, très-surveillé, sert pourtant d’asile ou de rendez-vous aux malfaiteurs de Paris. N’est-il pas étrange, ou plutôt fatal, qu’une irrésistible attraction fasse toujours graviter ces criminels autour du formidable tribunal qui les condamne à la prison, au bagne, à l’échafaud !
Cette nuit-là, donc, le vent s’engouffrait violemment dans les espèces de ruelles de ce lugubre quartier ; la lueur blafarde, vacillante, des réverbères agités par la bise, se reflétait dans le ruisseau d’eau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux.
Les maisons, couleur de boue, étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus et presque sans carreaux. De noires, d’infectes allées conduisaient à des escaliers plus noirs, plus infects encore, et si perpendiculaires, que l’on pouvait à peine les gravir à l’aide d’une corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer.
Le rez-de-chaussée de quelques-unes de ces maisons était occupé par des étalages de charbonniers, de tripiers ou de revendeurs de mauvaises viandes.
Malgré le peu de valeur de ces denrées, la devanture de presque toutes ces misérables boutiques était grillagée de fer, tant les marchands redoutaient les audacieux voleurs de ce quartier.
L’homme dont nous parlons, en entrant dans la rue aux Fèves, située au centre de la Cité, ralentit beaucoup sa marche : il se sentait sur son terrain.
La nuit était profonde, l’eau tombait à torrents, de fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles.
Dix heures sonnaient dans le lointain à l’horloge du Palais de Justice.
Des femmes embusquées sous des porches voûtés, obscurs, profonds comme des cavernes, chantaient à demi-voix quelques refrains populaires.
Une de ces créatures était sans doute connue de l’homme dont nous parlons ; car, s’arrêtant brusquement devant elle, il la saisit par le bras.
– Bonsoir, Chourineur[1].
Cet homme, repris de justice, avait été ainsi surnommé au bagne.
– C’est toi, la Goualeuse[2], dit l’homme en blouse ; tu vas me payer l’eau d’aff[3], ou je te fais danser sans violons !
– Je n’ai pas d’argent, répondit la femme en tremblant ; car cet homme inspirait une grande terreur dans le quartier.
– Si ta filoche est à jeun[4], l’ogresse du tapis-franc te fera crédit sur ta bonne mine.
– Mon Dieu ! je lui dois le loyer des vêtements que je porte…
– Ah ! tu raisonnes ? s’écria le Chourineur. Et il donna dans l’ombre et au hasard un si violent coup de poing à cette malheureuse, qu’elle poussa un cri de douleur aigu.
– Ça n’est rien que ça, ma fille ; c’est pour t’avertir…
À peine le brigand avait-il dit ces mots, qu’il s’écria avec un effroyable jurement :
– Je suis piqué à l’aileron ; tu m’as égratigné avec tes ciseaux. Et furieux, il se précipita à la poursuite de la Goualeuse dans l’allée noire.
– N’approche pas, ou je te crève les ardents avec mes fauchants[5], dit-elle d’un ton décidé. Je ne t’avais rien fait, pourquoi m’as-tu battue ?
– Je vais te dire ça, s’écria le bandit en s’avançant toujours dans l’obscurité. Ah ! je te tiens ! et tu vas la danser ! ajouta-t-il en saisissant dans ses larges et fortes mains un poignet mince et frêle.
– C’est toi qui vas danser ! dit une voix mâle.
– Un homme ! Est-ce toi, Bras-Rouge ? réponds donc et ne serre pas si fort… j’entre dans l’allée de ta maison… ça peut bien être toi…
– Ça n’est pas Bras-Rouge, dit la voix.
– Bon, puisque ça n’est pas un ami, il va y avoir du raisiné[6] par terre, s’écria le Chourineur. Mais à qui donc la petite patte que je tiens là ?
– C’est la pareille de celle-ci.
Sous la peau délicate et douce de cette main qui vint le saisir brusquement à la gorge, le Chourineur sentit se tendre des nerfs et des muscles d’acier.
La Goualeuse, réfugiée au fond de l’allée, avait lestement grimpé plusieurs marches ; elle s’arrêta un moment, et s’écria en s’adressant à son défenseur inconnu :
– Oh ! merci, monsieur, d’avoir pris mon parti. Le Chourineur m’a battue parce que je ne voulais pas lui payer d’eau-de-vie. Je me suis revengée, mais je n’ai pu lui faire grand mal avec mes petits ciseaux. Maintenant je suis en sûreté, laissez-le ; prenez bien garde à vous, c’est le Chourineur.
L’effroi qu’inspirait cet homme était bien grand.
– Mais vous ne m’entendez donc pas ? Je vous dis que c’est le Chourineur ! répéta la Goualeuse.
– Et moi je suis un ferlampier qui n’est pas frileux[7], dit l’inconnu.
Puis tout se tut.
On entendit pendant quelques secondes le bruit d’une lutte acharnée.
– Mais tu veux donc que je t’escarpe[8] ? s’écria le bandit en faisant un violent effort pour se débarrasser de son adversaire, qu’il trouvait d’une vigueur extraordinaire. Bon, bon, tu vas payer pour la Goualeuse et pour toi, ajouta-t-il en grinçant les dents.
– Payer en monnaie de coups de poing, oui, répondit l’inconnu.
– Si tu ne lâches pas ma cravate, je te mange le nez, murmura le Chourineur d’une voix étouffée.
– J’ai le nez trop petit, mon homme, et tu n’y vois pas clair !
– Alors, viens sous le pendu glacé[9].
– Viens, reprit l’inconnu, nous nous y regarderons le blanc des yeux.
Et, se précipitant sur le Chourineur, qu’il tenait toujours au collet, il le fit reculer jusqu’à la porte de l’allée et le poussa violemment dans la rue, à peine éclairée par la lueur du réverbère.
Le bandit trébucha ; mais, se raffermissant aussitôt, il s’élança avec furie contre l’inconnu, dont la taille très-svelte et très-mince ne semblait pas annoncer la force incroyable qu’il déployait.
Le Chourineur, quoique d’une constitution athlétique et de première habileté dans une sorte de pugilat appelé vulgairement la savate, trouva, comme on dit, son maître.
L’inconnu lui passa la jambe (sorte de croc-en-jambe) avec une dextérité merveilleuse, et le renversa deux fois.
Ne voulant pas encore reconnaître la supériorité de son adversaire, le Chourineur revint à la charge en rugissant de colère.
Alors le défenseur de la Goualeuse, changeant brusquement de méthode, fit pleuvoir sur la tête du bandit une grêle de coups de poing aussi rudement assenés qu’avec un gantelet de fer.
Ces coups de poing, dignes de l’envie et de l’admiration de Jack Turner, l’un des plus fameux boxeurs de Londres, étaient d’ailleurs si en dehors des règles de la savate, que le Chourineur en fut doublement étourdi ; pour la troisième fois le brigand tomba comme un bœuf sur le pavé en murmurant :
– Mon linge est lavé[10].
– S’il renonce, ne l’achevez pas, ayez pitié de lui ! dit la Goualeuse, qui pendant cette rixe s’était hasardée sur le seuil de l’allée de la maison de Bras-Rouge. Puis elle ajouta avec étonnement : Mais qui êtes-vous donc ? Excepté le Maître d’école, il n’y a personne, depuis la rue Saint-Éloi jusqu’à Notre-Dame, capable de battre le Chourineur. Je vous remercie bien, monsieur ; hélas ! sans vous il m’assommait.
L’inconnu, au lieu de répondre à cette femme, écoutait attentivement sa voix.
Jamais timbre plus doux, plus frais, plus argentin, ne s’était fait entendre à son oreille ; il tâcha de distinguer les traits de la Goualeuse : il ne put y parvenir, la nuit était trop sombre, la clarté du réverbère était trop pâle.
Après être resté quelques minutes sans mouvement, le Chourineur remua la jambe, les bras, et enfin se leva sur son séant.
– Prenez garde ! s’écria la Goualeuse en se réfugiant de nouveau dans l’allée et en tirant son protecteur par le bras, prenez garde, il va peut-être vouloir se revenger !
– Sois tranquille, ma fille, s’il en veut encore, j’ai de quoi le servir.
Le brigand entendit ces mots.
– J’ai la coloquinte en bringues, dit-il à l’inconnu. Pour aujourd’hui j’en ai assez, je n’en mangerai plus ; une autre fois je ne dis pas, si je te retrouve.
– Est-ce que tu n’es pas content ? est-ce que tu te plains ? s’écria l’inconnu d’un ton menaçant. Est-ce que j’ai macarone[11] ?
– Non, non, je ne me plains pas : tu es un cadet qui a de l’atout, dit le brigand d’un ton bourru, mais avec cette sorte de considération respectueuse que la force physique impose toujours aux gens de cette espèce. Tu m’as rincé ; et, excepté le Maître d’école, qui mangerait trois Alcides à son déjeuner, personne jusqu’à cette heure ne peut se vanter de me mettre le pied sur la tête.
– Eh bien ! après ?
– Après ?… j’ai trouvé mon maître, voilà tout. Tu auras le tien un jour ou l’autre, tôt ou tard… tout le monde trouve le sien… À défaut d’hommes, il y a toujours bien le meg des megs[12], comme disent les sangliers[13]. Ce qui est sûr, c’est que, maintenant que tu as mis le Chourineur sous tes pieds, tu peux faire les quatre cents coups dans la Cité. Toutes les filles d’amour seront tes esclaves : ogres et ogresses n’oseront pas refuser de te faire crédit. Ah çà ! mais qui es-tu donc ?… tu dévides le jars[14] comme père et mère ! Si tu es grinche[15], je ne suis pas ton homme. J’ai chouriné[16], c’est vrai ; parce que, quand le sang me monte aux yeux, j’y vois rouge, et il faut que je frappe… mais j’ai payé mes chourinades en allant quinze ans au pré[17]. Mon temps est fini, je ne dois rien aux curieux[18], et je n’ai jamais grinché[19] : demande à la Goualeuse.
– C’est vrai, ce n’est pas un voleur, dit celle-ci.
– Alors, viens boire un verre d’eau d’aff, et tu me connaîtras, dit l’inconnu ; allons, sans rancune.
– C’est honnête de ta part… Tu es mon maître, je le reconnais, tu sais rudement jouer des poignets… il y a eu surtout la grêle de coups de poing de la fin… Tonnerre ! comme ça me pleuvait sur la boule ! je n’ai jamais rien vu de pareil… comme c’était festonné ! ça allait comme un marteau de forge. C’est un nouveau jeu… faudra me l’apprendre.
– Je recommencerai quand tu voudras.
– Pas sur moi, toujours, dis donc ; eh ! pas sur moi. J’en ai encore des éblouissements. Mais tu connais donc Bras-Rouge, que tu étais dans l’allée de sa maison ?
– Bras-Rouge ! dit l’inconnu surpris de cette question ; je ne sais pas ce que tu veux dire ; il n’y a pas que Bras-Rouge qui habite cette maison, sans doute ?
– Si fait, mon homme… Bras-Rouge a ses raisons pour ne pas aimer les voisins, dit le Chourineur en souriant d’un air singulier.
– Eh bien ! tant mieux pour lui, reprit l’inconnu, qui semblait ne pas vouloir continuer la conversation à ce sujet. Je ne connais pas plus Bras-Rouge que Bras-Noir ; il pleuvait, j’étais entré un moment dans cette allée pour me mettre à l’abri : tu as voulu battre cette pauvre fille, je t’ai battu, voilà tout.
– C’est juste : d’ailleurs tes affaires ne me regardent pas ; tous ceux qui ont besoin de Bras-Rouge ne vont pas le dire à Rome. N’en parlons plus.
Puis, s’adressant à la Goualeuse :
– Foi d’homme, tu es une bonne fille ; je t’ai donné une calotte, tu m’as rendu un coup de ciseaux, c’était de jeu ; mais, ce qui est gentil de ta part, c’est que tu n’as pas aguiché cet enragé-là contre moi, quand je n’en voulais plus. Tu viendras boire avec nous ! c’est monsieur qui paye. À propos de ça, mon brave, dit-il à l’inconnu, si, au lieu d’aller pitancher[20] de l’eau d’aff, nous allions nous refaire de sorgue[21] chez l’ogresse du Lapin-Blanc : c’est un tapis-franc.
– Tope, je paye à souper. Veux-tu venir, la Goualeuse ? dit l’inconnu.
– Oh ! j’avais bien faim, répondit-elle : mais de voir des batteries ça m’écœure, je n’ai plus d’appétit.
– Bah ! bah ! ça te viendra en mangeant, dit le Chourineur ; et la cuisine est fameuse au Lapin-Blanc.
Les trois personnages, alors en parfaite intelligence, se dirigèrent vers la taverne.
Pendant la lutte du Chourineur et de l’inconnu, un charbonnier d’une taille colossale, embusqué dans une autre allée, avait observé avec anxiété les chances du combat, sans toutefois, ainsi qu’on l’a vu, prêter le moindre secours à l’un des deux adversaires.
Lorsque l’inconnu, le Chourineur et la Goualeuse se dirigèrent vers la taverne, le charbonnier les suivit.
Le bandit et la Goualeuse entrèrent les premiers dans le tapis-franc ; l’inconnu les suivait, lorsque le charbonnier s’approcha et lui dit tout bas en anglais et d’un ton de respectueuse remontrance :
– Monseigneur, prenez bien garde !
L’inconnu haussa les épaules et rejoignit ses compagnons. Le charbonnier ne s’éloigna pas de la porte du cabaret ; prêtant l’oreille avec attention, il regardait de temps à autre au travers d’un petit jour pratiqué dans l’épaisse couche de blanc d’Espagne dont les vitres de ces repaires sont toujours enduites intérieurement.
II L’ogresse
Le cabaret du Lapin-Blanc est situé vers le milieu de la rue aux Fèves. Cette taverne occupe le rez-de-chaussée d’une haute maison dont la façade se compose de deux fenêtres dites à guillotine.
Au-dessus de la porte d’une sombre allée voûtée se balance une lanterne oblongue dont la vitre fêlée porte ces mots écrits en lettres rouges : « Ici on loge à la nuit. »
Le Chourineur, l’inconnu et la Goualeuse entrèrent dans la taverne.
C’est une vaste salle basse, au plafond enfumé, rayé de solives noires, éclairée par la lumière rougeâtre d’un mauvais quinquet. Les murs, recrépis à la chaux, sont couverts çà et là de dessins grossiers ou de sentences en termes d’argot.
Le sol battu, salpêtré, est imprégné de boue : une brassée de paille est déposée, en guise de tapis, au pied du comptoir de l’ogresse, situé à droite de la porte et au-dessous du quinquet.
De chaque côté de cette salle, il y a six tables ; d’un bout elles sont scellées au mur, ainsi que les bancs qui les accompagnent. Au fond une porte donne dans une cuisine ; à droite, près du comptoir, existe une sortie sur l’allée qui conduit aux taudis où l’on couche à trois sous la nuit.
Maintenant quelques mots de l’ogresse et de ses hôtes.
L’ogresse s’appelle la mère Ponisse ; sa triple profession consiste à loger, à tenir un cabaret, et à louer des vêtements aux misérables créatures qui pullulent dans ces rues immondes.
L’ogresse a quarante ans environ. Elle est grande, robuste, corpulente, haute en couleur et quelque peu barbue. Sa voix rauque, virile, ses gros bras, ses larges mains, annoncent une force peu commune ; elle porte sur son bonnet un vieux foulard rouge et jaune ; un châle de poil de lapin se croise sur sa poitrine et se noue derrière son dos ; sa robe de laine verte laisse voir des sabots noirs souvent incendiés par sa chaufferette ; enfin le teint de l’ogresse est cuivré, enflammé par l’abus des liqueurs fortes.
Le comptoir, plaqué de plomb, est garni de brocs cerclés de fer et de différentes mesures d’étain ; sur une tablette attachée au mur, on voit plusieurs flacons de verre façonnés de manière à représenter la figure en pied de l’empereur.
Ces bouteilles renferment des breuvages frelatés de couleur rose et verte, connus sous le nom de parfait-amour et de consolation.
Enfin, un gros chat noir à prunelles jaunes, accroupi près de l’ogresse, semble le démon familier de ce lieu.
Par un contraste qui semblerait impossible si l’on ne savait que l’âme humaine est un abîme impénétrable… une sainte branche de buis de Pâques, achetée à l’église par l’ogresse, était placée derrière la boîte d’une ancienne pendule à coucou.
Deux hommes à figure sinistre, à barbe hérissée, vêtus presque de haillons, touchaient à peine au broc de vin qu’on leur avait servi, ils parlaient à voix basse d’un air inquiet.
L’un d’eux surtout, très-pâle, presque livide, rabattait souvent jusque sur ses sourcils un mauvais bonnet grec dont il était coiffé ; il tenait sa main gauche presque toujours cachée, ayant soin de la dissimuler, autant que possible, lorsqu’il était obligé de s’en servir.
Plus loin s’attablait un jeune homme de seize ans à peine, à la figure imberbe, hâve, creuse, plombée, au regard éteint ; ses longs cheveux noirs flottaient autour de son cou ; cet adolescent, type du vice précoce, fumait une courte pipe blanche. Le dos appuyé au mur, les deux mains dans les poches de sa blouse, les jambes étendues sur le banc, il ne quittait sa pipe que pour boire à même d’une canette d’eau-de-vie placée devant lui.
Les autres habitués du tapis-franc, hommes ou femmes, n’offraient rien de remarquable, leurs physionomies étaient féroces ou abruties, leur gaieté grossière ou licencieuse, leur silence sombre ou stupide.
Tels étaient les hôtes du tapis-franc lorsque l’inconnu, le Chourineur et la Goualeuse y entrèrent.
Ces trois derniers personnages jouent un rôle trop important dans ce récit, leurs figures sont trop caractérisées, pour que nous ne les mettions pas en relief.
Le Chourineur, homme de haute taille et de constitution athlétique, a des cheveux d’un blond pâle tirant sur le blanc, des sourcils épais et d’énormes favoris d’un roux ardent.
Le hâle, la misère, les rudes labeurs du bagne ont bronzé son teint de cette couleur sombre, olivâtre, pour ainsi dire, particulière aux forçats.
Malgré son terrible surnom, les traits de cet homme expriment plutôt une sorte d’audace brutale que la férocité ; quoique la partie postérieure de son crâne, singulièrement développée, annonce la prédominance des appétits meurtriers et charnels.
Le Chourineur porte une mauvaise blouse bleue, un pantalon de gros velours primitivement vert, et dont on ne peut distinguer la couleur sous l’épaisse couche de boue qui le couvre.
Par une anomalie étrange, les traits de la Goualeuse offrent un de ces types angéliques et candides qui conservent leur idéalité même au milieu de la dépravation, comme si la créature était impuissante à effacer par ses vices la noble empreinte que Dieu a mise au front de quelques êtres privilégiés.
La Goualeuse avait seize ans et demi.
Le front le plus pur, le plus blanc, surmontait son visage d’un ovale parfait ; une frange de cils, tellement longs qu’ils frisaient un peu, voilait à demi ses grands yeux bleus. Le duvet de la première jeunesse veloutait ses joues rondes et vermeilles. Sa petite bouche purpurine, son nez fin et droit, son menton à fossette, étaient d’une adorable suavité de lignes. De chaque côté de ses tempes satinées, une natte de cheveux d’un blond cendré magnifique descendait en s’arrondissant jusqu’au milieu de la joue, remontait derrière l’oreille dont on apercevait le lobe d’ivoire rosé, puis disparaissait sous les plis serrés d’un grand mouchoir de cotonnade à carreaux bleus, et noué, comme on dit vulgairement, en marmotte.
Un collier de grains de corail entourait son cou d’une beauté et d’une blancheur éblouissantes. Sa robe d’alépine brune, beaucoup trop large, laissait deviner une taille fine, souple et ronde comme un jonc. Un mauvais petit châle orange, à franges vertes, se croisait sur son sein.
Le charme de la voix de la Goualeuse avait frappé son défenseur inconnu. En effet, cette voix douce, vibrante, harmonieuse, avait un attrait si irrésistible, que la tourbe de scélérats et de femmes perdues au milieu desquels vivait cette jeune fille la suppliaient souvent de chanter, l’écoutaient avec ravissement et l’avaient surnommée la Goualeuse (la chanteuse).
La Goualeuse avait reçu un autre surnom, dû sans doute à la candeur virginale de ses traits…
On l’appelait encore Fleur-de-Marie, mots qui en argot signifient la Vierge.
Pourrons-nous faire comprendre au lecteur notre singulière impression, lorsqu’au milieu de ce vocabulaire infâme, où les mots qui signifient le vol, le sang, le meurtre, sont encore plus hideux et plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu’ils expriment, lorsque nous avons, disons-nous, surpris cette métaphore d’une poésie si douce, si tendrement pieuse : Fleur-de-Marie ?
Ne dirait-on pas un beau lis élevant la neige odorante de son calice immaculé au milieu d’un champ de carnage ?
Bizarre contraste, étrange hasard ! Les inventeurs de cette épouvantable langue se sont ainsi élevés jusqu’à une sainte poésie ! Ils ont prêté un charme de plus à la chaste pensée qu’ils voulaient exprimer !
Ces réflexions n’amènent-elles pas à croire, en songeant ainsi à d’autres contrastes qui rompent souvent l’horrible monotonie des existences les plus criminelles, que certains principes de moralité, de piété, pour ainsi dire innés, jettent encore quelquefois çà et là de vives lueurs dans les âmes les plus ténébreuses ? Les scélérats tout d’une pièce sont des phénomènes assez rares.
Le défenseur de la Goualeuse (nous nommerons cet inconnu Rodolphe) paraissait âgé de trente à trente-six ans ; sa taille moyenne, svelte, parfaitement proportionnée, ne semblait pas annoncer la vigueur surprenante que cet homme venait de déployer dans sa lutte avec l’athlétique Chourineur.
Il eût été très-difficile d’assigner un caractère certain à la physionomie de Rodolphe ; elle réunissait les contrastes les plus bizarres.
Ses traits étaient régulièrement beaux, trop beaux peut-être pour un homme.
Son teint d’une pâleur délicate, ses grands yeux d’un brun orangé, presque toujours à demi fermés et entourés d’une légère auréole d’azur, sa démarche nonchalante, son regard distrait, son sourire ironique, semblaient annoncer un homme blasé, dont la constitution était sinon délabrée, du moins affaiblie par les aristocratiques excès d’une vie opulente.
Et pourtant, de sa main élégante et blanche, Rodolphe venait de terrasser un des bandits les plus robustes, les plus redoutés de ce quartier de bandits.
Nous disons aristocratiques excès, parce que l’ivresse d’un vin généreux diffère complètement de l’ivresse d’un affreux breuvage frelaté ; parce qu’en un mot, aux yeux de l’observateur, les excès diffèrent de symptômes comme ils diffèrent de nature et d’espèce.
Certains plis du front de Rodolphe révélaient le penseur profond, l’homme essentiellement contemplatif… et pourtant la fermeté des contours de sa bouche, son port de tête quelquefois impérieux et hardi, décelaient alors l’homme d’action dont la force physique, dont l’audace, exercent toujours sur la foule un irrésistible ascendant.
Souvent son regard se chargeait d’une triste mélancolie, et tout ce que la commisération a de plus secourable, tout ce que la pitié a de plus touchant, se peignait sur son visage. D’autres fois, au contraire, le regard de Rodolphe devenait dur, méchant ; ses traits exprimaient tant de dédain et de cruauté qu’on ne pouvait le croire capable de ressentir aucune émotion douce.
La suite de ce récit montrera quel ordre de faits ou d’idées excitait chez lui des passions si contraires.
Dans sa lutte avec le Chourineur, Rodolphe n’avait témoigné ni colère ni haine contre cet adversaire indigne de lui. Confiant dans sa force, dans son adresse, dans son agilité, il n’avait eu qu’un mépris railleur pour l’espèce de bête brute qu’il venait de terrasser.
Pour achever le portrait de Rodolphe, nous dirons que ses cheveux étaient châtain clair, de la même nuance que ses sourcils noblement arqués et que sa petite moustache fine et soyeuse ; son menton un peu saillant était soigneusement rasé.
Du reste, les manières et le langage qu’il affectait avec une incroyable aisance donnaient à Rodolphe une complète ressemblance avec les hôtes de l’ogresse. Son cou svelte, aussi élégamment modelé que celui du Bacchus indien, était entouré d’une cravate noire nouée négligemment, et dont les bouts retombaient sur le collet de sa blouse bleue, d’une nuance blanchâtre annonçant la vétusté. Une double rangée de clous armait ses gros souliers. Enfin, sauf ses mains d’une distinction rare, rien ne le distinguait matériellement des hôtes du tapis-franc ; tandis que son air de résolution, et, pour ainsi dire, d’audacieuse sérénité, mettait entre eux et lui une distance énorme.
En entrant dans le tapis-franc, le Chourineur, posant une de ses larges mains velues sur l’épaule de Rodolphe, s’écria :
– Salut au maître du Chourineur !… Oui, les amis, ce cadet-là vient de me rincer… Avis aux amateurs qui auraient l’idée de se faire casser les reins ou crever la sorbonne[22], en comptant le Maître d’école qui, cette fois-ci, trouvera son maître… J’en réponds et je le parie !
À ces mots, depuis l’ogresse jusqu’au dernier des habitués du tapis-franc, tous regardèrent le vainqueur du Chourineur avec un respect craintif.
Les uns reculèrent leurs verres et leurs brocs au bout de la table qu’ils occupaient, s’empressant de faire une place à Rodolphe, dans le cas où il aurait voulu se placer à côté d’eux ; d’autres s’approchèrent du Chourineur pour lui demander à voix basse quelques détails sur cet inconnu qui débutait si victorieusement dans le monde.
L’ogresse, enfin, avait adressé à Rodolphe l’un de ses plus gracieux sourires. Chose inouïe, exorbitante, fabuleuse dans les fastes du Lapin-Blanc, elle s’était levée de son comptoir pour venir prendre les ordres de Rodolphe et savoir ce qu’il fallait servir à sa société, attention que l’ogresse n’avait jamais eue pour le fameux Maître d’école, terrible scélérat qui faisait trembler le Chourineur lui-même.
Un des deux hommes à figure sinistre que nous avons signalés (celui qui, très-pâle, cachait sa main gauche et rabattait toujours son bonnet grec sur son front) se pencha vers l’ogresse, qui essuyait soigneusement la table de Rodolphe, et lui dit d’une voix enrouée :
– Le Maître d’école n’est pas venu aujourd’hui ?
– Non, dit la mère Ponisse.
– Et hier ?
– Il est venu.
– Avec sa nouvelle largue[23] ?
– Ah çà ! est-ce que tu me prends pour un raille[24], avec des drogueries ? Est-ce que tu crois que je vais manger mes pratiques sur l’orgue[25] ? dit l’ogresse d’une voix brutale.
– J’ai rendez-vous ce soir avec le Maître d’école, répéta le brigand, nous avons des affaires ensemble.
– Ça doit être du propre, vos affaires, tas d’escarpes[26] que vous êtes !
– Escarpes ! répéta le bandit d’un air irrité, c’est les escarpes qui te font vivre !
– Ah çà ! vas-tu me donner la paix ! s’écria l’ogresse d’un air menaçant, en levant sur le questionneur le broc qu’elle tenait à la main.
L’homme se remit à sa place en grommelant.
Fleur-de-Marie, entrant dans la taverne de l’ogresse sur les pas du Chourineur, avait échangé un signe de tête amical avec l’adolescent à figure flétrie.
Le Chourineur dit à ce dernier :
– Eh ! Barbillon, tu pitanches donc toujours de l’eau d’aff[27] ?
– Toujours ! j’aime mieux faire la tortue et avoir des philosophes aux arpions que d’être sans eau d’aff dans l’avaloir et sans tréfoin dans ma chiffarde[28], dit le jeune homme d’une voix cassée, sans changer de position et en lançant d’énormes bouffées de tabac.
– Bonsoir, mère Ponisse, dit la Goualeuse.
– Bonsoir, Fleur-de-Marie, répondit l’ogresse en s’approchant de la jeune fille pour inspecter les vêtements qui couvraient la malheureuse et qu’elle lui avait loués.
Après cet examen, elle lui dit avec une sorte de satisfaction bourrue :
– C’est un plaisir de te louer des effets, à toi… tu es propre comme une petite chatte… aussi je n’aurais pas confié ce joli châle orange à des canailles comme la Tourneuse ou la Tête-de-Mort. Mais aussi c’est moi qui t’ai éduquée depuis ta sortie de prison… et il faut être juste, il n’y a pas un meilleur sujet que toi dans toute la Cité.
La Goualeuse baissa la tête et ne parut nullement fière des louanges de l’ogresse.
– Tiens ! dit Rodolphe, vous avez du buis bénit sur votre coucou, la mère ?
Et il montra du doigt le saint rameau placé derrière la vielle horloge.
– Eh bien, faut-il pas vivre comme des païens ! répondit naïvement l’horrible femme.
Puis, s’adressant à Fleur-de-Marie, elle ajouta :
– Dis donc, la Goualeuse, est-ce que tu ne vas pas nous goualer une de tes goualantes[29] ?
– Après souper, mère Ponisse, dit le Chourineur.
– Qu’est-ce que je vais vous servir, mon brave ? dit l’ogresse à Rodolphe, dont elle voulait se faire bien venir et peut-être au besoin acheter le soutien.
– Demandez au Chourineur, la mère ; il régale ; moi, je paye.
– Eh bien ! dit l’ogresse en se tournant vers le bandit, qu’est-ce que tu veux à souper, mauvais chien ?
– Deux doubles cholettes de tortu à douze, un arlequin et trois croûtons de lartif bien tendre (deux litres de vin à douze sous, trois croûtons de pain très-tendre) et un arlequin[30], dit le Chourineur, après avoir un moment médité sur la composition de ce menu.
– Je vois que tu es toujours un fameux licheur et que tu as toujours une passion pour les arlequins.
– Eh bien ! maintenant, la Goualeuse, dit le Chourineur, as-tu faim ?
– Non, Chourineur.
– Veux-tu autre chose qu’un arlequin, ma fille ? dit Rodolphe.
– Oh ! non… ma faim a passé…
– Mais regarde donc mon maître… ma fille ! dit le Chourineur en riant d’un gros rire et indiquant Rodolphe du regard. Est-ce que tu n’oses pas le reluquer ?
La Goualeuse rougit et baissa les yeux sans répondre.
Au bout de quelques moments, l’ogresse vint elle-même placer sur la table de Rodolphe un broc de vin, un pain et l’arlequin, dont nous n’essayerons pas de donner une idée au lecteur, mais que le Chourineur sembla trouver parfaitement de son goût, car il s’écria :
– Quel plat ! Dieu de Dieu !… quel plat ! C’est comme un omnibus ! Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui font gras et pour ceux qui font maigre, pour ceux qui aiment le sucre et ceux qui aiment le poivre… Des pilons de volaille, des queues de poisson, des os de côtelette, des croûtes de pâté, de la friture, du fromage, des légumes, des têtes de bécasse, du biscuit et de la salade. Mais mange donc, la Goualeuse… c’est du soigné… Est-ce que tu as nocé aujourd’hui ?
– Nocé ! ah bien oui ! J’ai mangé ce matin comme toujours, mon sou de lait et mon sou de pain.
L’entrée d’un nouveau personnage dans le cabaret interrompit toutes les conversations et fit lever toutes les têtes.
C’était un homme entre les deux âges, alerte et robuste, portant veste et casquette, parfaitement au fait des usages du tapis-franc ; il employa le langage familier à ses hôtes pour demander à souper.
Quoique cet étranger ne fût pas un des habitués du tapis-franc, on ne fit bientôt plus attention à lui : il était jugé.
Pour reconnaître leurs pareils, les bandits, comme les honnêtes gens, ont un coup d’œil sûr.
Ce nouvel arrivant s’était placé de façon à pouvoir observer les deux individus à figure sinistre dont l’un avait demandé le Maître d’école. Il ne les quittait pas du regard ; mais, par leur position, ceux-ci ne pouvaient s’apercevoir de la surveillance dont ils étaient l’objet.
Les conversations, un moment interrompues, reprirent leur cours. Malgré son audace, le Chourineur témoignait une sorte de déférence à Rodolphe ; il n’osait pas le tutoyer.
Cet homme ne respectait pas les lois, mais il respectait la force.
– Foi d’homme ! dit-il à Rodolphe, quoique j’aie eu ma danse, je suis tout de même flatté de vous avoir rencontré.
– Parce que tu trouves l’arlequin de ton goût ?
– D’abord… et puis parce que je grille de vous voir vous crocher avec le Maître d’école, lui qui m’a toujours rincé… le voir rincé à son tour… ça me flattera…
– Ah çà, est-ce que tu crois que pour t’amuser je vais sauter comme un bouledogue sur le Maître d’école ?
– Non, mais il sautera sur vous dès qu’il entendra dire que vous êtes plus fort que lui, répondit le Chourineur en se frottant les mains.
– J’ai encore assez de monnaie pour lui donner sa paye ! dit nonchalamment Rodolphe ; puis il reprit : Ah çà, il fait un temps de chien… si nous demandions un pot d’eau d’aff avec du sucre, ça mettrait peut-être la Goualeuse en train de chanter…
– Ça me va, dit le Chourineur.
– Et pour faire connaissance nous nous dirons qui nous sommes, ajouta Rodolphe.
– L’Albinos, dit Chourineur, fagot affranchi (forçat libéré), débardeur de bois flotté au quai Saint-Paul, gelé pendant l’hiver, rôti pendant l’été, voilà mon caractère, dit le convive de Rodolphe en faisant le salut militaire avec sa main gauche. Ah çà, ajouta-t-il, et vous, mon maître, c’est la première fois qu’on vous voit dans la Cité… C’est pas pour vous le reprocher, mais vous y êtes entré crânement sur mon crâne et tambour battant sur ma peau. Nom d’un nom, quel roulement !… surtout les coups de poing de la fin… J’en reviens toujours là, comme c’était fignolé !… Mais vous avez un autre métier que de rincer le Chourineur ?
– Je suis peintre en éventails ! et je m’appelle Rodolphe.
– Peintre en éventails ! C’est donc ça que vous avez les mains si blanches, dit le Chourineur. C’est égal, si tous vos camarades sont comme vous, il paraît qu’il faut être pas mal fort pour faire cet état-là… Mais puisque vous êtes ouvrier, et sans doute un honnête ouvrier… pourquoi venez-vous dans un tapis-franc, où il n’y a que des grinches, des escarpes ou des fagots affranchis comme moi, et qui ne peuvent aller ailleurs ?
– Je viens ici, parce que j’aime la bonne société.
– Hum !… hum !… dit le Chourineur en secouant la tête d’un air de doute. Je vous ai trouvé dans l’allée de Bras-Rouge ; enfin… suffit… Vous dites que vous ne le connaissez pas ?
– Est-ce que tu vas m’ennuyer encore longtemps avec ton Bras-Rouge, que l’enfer confonde… si ça plaît à Lucifer !…
– Tenez, mon maître, vous vous défiez peut-être de moi, et vous n’avez pas tort… Mais, si vous voulez, je vous raconterai mon histoire… à condition que vous m’apprendrez à donner les coups de poing qui ont été le bouquet de ma raclée… j’y tiens.
– J’y consens, Chourineur, tu me diras ton histoire… et la Goualeuse dira aussi la sienne.
– Ça va, reprit le Chourineur… Il fait un temps à ne pas mettre un sergent de ville dehors… ça nous amusera… Veux-tu, la Goualeuse ?
– Je veux bien ; mais ça ne sera pas long, dit Fleur-de-Marie…
– Et vous nous direz la vôtre, camarade Rodolphe ? ajouta le Chourineur.
– Oui, je commencerai…
– Peintre d’éventails, dit la Goualeuse, c’est un bien joli métier.
– Et combien gagnez-vous, à vous éreinter à ça ? dit le Chourineur.
– Je suis à ma tâche, répondit Rodolphe ; mes bonnes journées vont à quatre francs, quelquefois à cinq, mais dans l’été, parce que les jours sont longs.
– Et vous flânez souvent, gueusard ?
– Oui, tant que j’ai de l’argent : d’abord six sous pour ma nuit dans mon garni.
– Excusez, monseigneur… vous couchez à six sous, vous ! dit le Chourineur en portant la main à son bonnet…
Ce mot monseigneur, dit ironiquement par le Chourineur, fit sourire imperceptiblement Rodolphe, qui reprit :
– Oh ! je tiens à mes aises et à la propreté.
– En voilà un pair de France ! un banquier ! un riche ! s’écria le Chourineur, il couche à six.
– Avec ça, continua Rodolphe, quatre sous de tabac, ça fait dix ; quatre sous à déjeuner, quatorze ; quinze sous à dîner ; un ou deux sous d’eau-de-vie, ça me fait dans les environs de trente ronds (sous) par jour. Je n’ai pas besoin de travailler toute la semaine ; le reste du temps je fais la noce.
– Et votre famille ? dit la Goualeuse.
– Le choléra l’a mangée, reprit Rodolphe.
– Qu’est-ce qu’ils étaient, vos parents ? demanda la Goualeuse.
– Fripiers sous les piliers des Halles, négociants en vieux chiffons.
– Et combien que vous avez vendu leur fonds ? dit le Chourineur.
– J’étais trop jeune, c’est mon tuteur, qui l’a vendu ; quand j’ai été major, je lui ai redû trente francs… Voilà mon héritage.
– Et votre maître fabricant, à cette heure ? demanda le Chourineur.
– Mon singe[31] ? Il s’appelle M. Borel, rue des Bourdonnais, bête… mais brutal ;… voleur… mais avare ; il aime autant se faire crever un œil que faire la paye aux ouvriers. Voilà son signalement ; s’il s’égare, laissez-le se perdre, ne le ramenez pas à sa fabrique. J’ai été apprenti chez lui depuis l’âge de quinze ans, j’ai eu un bon numéro à la conscription ; je demeure rue de la Juiverie, au quatrième sur le devant ; je m’appelle Rodolphe Durand… Voilà mon histoire.
– Maintenant, à ton tour, la Goualeuse, dit le Chourineur ; je garde mon histoire pour la bonne bouche.
III Histoire de la Goualeuse
– Commençons d’abord par le commencement, dit le Chourineur.
– Oui… tes parents ? reprit Rodolphe.
– Je ne les connais pas, dit Fleur-de-Marie.
– Ah ! bah ! fit le Chourineur.
– Ni vus, ni connus ; née sous un chou, comme on dit aux enfants.
– Tiens, c’est drôle, la Goualeuse !… nous sommes de la même famille…
– Toi aussi, Chourineur ?
– Orphelin du pavé de Paris, tout comme toi, ma fille.
– Et qu’est-ce qui t’a élevée, la Goualeuse ? demanda Rodolphe.
– Je ne sais pas… Du plus loin qu’il m’en souvient, je crois, sept à huit ans, j’étais avec une vieille borgnesse qu’on appelait la Chouette… parce qu’elle avait un nez crochu, un œil vert tout rond, et qu’elle ressemblait à une chouette qui aurait un œil crevé.
– Ah !… ah !… Ah !… Je la vois d’ici, la Chouette ! s’écria le Chourineur en riant.
– La borgnesse, reprit Fleur-de-Marie, me faisait vendre, le soir, du sucre d’orge sur le Pont-Neuf ; manière de demander l’aumône… Quand je n’apportais pas au moins dix sous en rentrant, la Chouette me battait au lieu de me donner à souper.
– Je comprends, ma fille, dit le Chourineur, un coup de pied en guise de pain, avec des calottes pour mettre dessus.
– Oh ! mon Dieu, oui…
– Et tu es sûre que cette femme n’était pas ta mère ? demanda Rodolphe.
– J’en suis sûre, la Chouette me l’a assez reproché, d’être sans père et mère ; elle me disait toujours qu’elle m’avait ramassée dans la rue.
– Ainsi, reprit le Chourineur, tu avais une danse pour fricot, quand tu ne faisais pas une recette de dix sous ?
– Un verre d’eau par là-dessus, et j’allais grelotter toute la nuit dans une paillasse étendue par terre et où la borgnesse avait fait un trou pour me fourrer… Tenez, on croit comme ça que la paille est chaude ; eh bien on se trompe.
– La plume de Beauce[32] ! s’écria le Chourineur, tu as raison, ma fille, c’est une vraie gelée ; le fumier vaudrait cent fois mieux ! Mais on fait sa tête, on dit : C’est canaille… ç’a été porté !
Cette plaisanterie fit sourire Fleur-de-Marie qui continua :
– Le lendemain matin la borgnesse me donnait la même ration pour déjeuner que pour souper, et je m’en allais à Montfaucon chercher des vers de terre pour amorcer le poisson ; car dans le jour la Chouette tenait sa boutique de lignes à pêcher sous le pont Notre-Dame… Pour un enfant de sept ans qui meurt de faim et de froid, il y a loin, allez… de la rue de la Mortellerie à Montfaucon.
– L’exercice t’a fait pousser droite comme un jonc, ma fille ; faut pas te plaindre de ça, dit le Chourineur battant le briquet pour allumer sa pipe.
– Enfin, je revenais éreintée avec un plein panier de vers. Alors, sur le midi, la Chouette me donnait un bon morceau de pain, et je ne laissais pas la mie, je t’en réponds.
– De ne pas manger, ça t’a rendu la taille fine comme une guêpe, ma fille : faut pas te plaindre de ça, dit le Chourineur en aspirant bruyamment quelques bouffées de tabac. Mais qu’est-ce que vous avez donc, camarade ? Non, je veux dire maître Rodolphe ? Vous avez l’air tout chose… Est-ce parce que c’te jeunesse a eu de la misère ? Tiens… nous en avons tous eu de la misère !
– Oh ! je te défie bien d’avoir été aussi malheureux que moi, Chourineur, dit Fleur-de-Marie.
– Moi, la Goualeuse !… Mais figure-toi donc, ma fille, que t’étais comme une reine auprès de moi ! Au moins, quand tu étais petite, tu couchais sur de la paille et tu mangeais du pain… Moi, je couchais les bonnes nuits dans les fours à plâtre de Clichy, en vrai gouépeur (vagabond), et je me restaurais avec des feuilles de chou que je ramassais au coin des bornes ; mais, le plus souvent, comme il y avait trop loin pour aller aux fours à plâtre de Clichy, vu que la fringale me cassait les jambes, je me couchais sous les grosses pierres du Louvre… et l’hiver j’avais des draps blancs… quand il tombait de la neige.
– Tiens, un homme, c’est bien plus dur ; mais une pauvre petite fille, dit Fleur-de-Marie ; avec ça, j’étais grosse comme une mauviette.
– Tu te rappelles ça, toi ?
– Je crois bien : quand la Chouette me battait, je tombais toujours du premier coup ; alors elle se mettait à trépigner sur moi en criant : « Cette petite gueuse-là ! elle n’a pas pour deux liards de force : ça ne peut pas seulement supporter deux calottes. » Et puis elle m’appelait la Pégriotte ; j’ai pas eu d’autre nom, ç’a été mon baptême.
– C’est comme moi, j’ai eu le baptême des chiens perdus : on m’appelait chose… machin… ou l’Albinos. C’est étonnant, comme nous nous ressemblons, ma fille, dit le Chourineur.
– C’est vrai, dit Fleur-de-Marie, qui s’adressait presque toujours à cet homme ; ressentant malgré elle une sorte de honte en présence de Rodolphe, elle osait à peine lever les yeux, quoiqu’il parût appartenir à l’espèce de gens avec lesquels elle vivait habituellement.
– Et quand tu avais été chercher des vers pour la Chouette, qu’est-ce que tu faisais ? demanda le Chourineur.
– La borgnesse m’envoyait mendier autour d’elle jusqu’à la nuit ; car le soir elle allait faire de la friture sur le Pont-Neuf. Dame ! à cette heure-là, mon morceau de pain était bien loin : mais si j’avais le malheur de demander à manger à la Chouette, elle me battait en me disant : « Fais dix sous d’aumône, Pégriotte, et tu auras à souper ! » Alors, moi, comme j’avais bien faim, et qu’elle me faisait mal, je pleurais toutes les larmes de mon corps. La borgnesse me passait mon petit éventaire de sucre d’orge au cou, et elle me plantait sur le Pont-Neuf. Comme je sanglotais ! et que je grelottais de froid et de faim !…
– Toujours comme toi, ma fille, dit le Chourineur en interrompant la Goualeuse ; on ne croirait pas ça… mais la faim fait grelotter autant que le froid.
– Enfin, je restais sur le Pont-Neuf jusqu’à onze heures du soir, ma boutique de sucre d’orge au cou et pleurant bien fort. De me voir pleurer… souvent ça touchait les passants, et quelquefois on me donnait jusqu’à dix, jusqu’à quinze sous, que je rendais à la Chouette.
– Fameuse soirée pour une mauviette !
– Mais voilà-t-il pas que la borgnesse, qui voyait ça…
– D’un œil, dit le Chourineur en riant.
– D’un œil, si tu veux, puisqu’elle n’en avait qu’un ; ne voilà-t-il pas que la borgnesse prend le pli de me donner toujours des coups avant de me mettre en faction sur le Pont-Neuf, afin de me faire pleurer devant les passants et d’augmenter ainsi ma recette.
– Ce n’était pas déjà si bête !
– Oui, tu crois ça, toi, Chourineur ? J’ai fini par m’endurcir aux coups ; je voyais que la Chouette rageait quand je ne pleurais pas : alors, pour me venger d’elle, plus elle me faisait de mal, plus je riais ; et le soir, au lieu de sangloter en vendant mes sucres d’orge, je chantais comme une alouette, quoique je n’en eusse guère envie… de chanter.
– Dis donc… des sucres d’orge… c’est ça qui devait te faire envie, ma pauvre Goualeuse !
– Oh ! je crois bien, Chourineur ; mais je n’en avais jamais goûté ; c’était mon ambition… et c’est cette ambition qui m’a perdue, tu vas voir comment. Un jour, en revenant de mes vers, des gamins m’avaient battue et volé mon panier. Je rentre, je savais ce qui m’attendait, je reçois ma paye et pas de pain. Le soir, avant d’aller au pont, la borgnesse, furieuse de ce que je n’avais pas étrenné la veille, au lieu de me donner des coups comme d’habitude pour me mettre en train de pleurer, me martyrise jusqu’au sang en m’arrachant des cheveux du côté des tempes, où c’est le plus sensible.
– Tonnerre ! ça c’est trop fort ! s’écria le bandit en frappant du poing sur la table et en fronçant les sourcils. Battre un enfant, bon… mais le martyriser, c’est trop fort !
Rodolphe avait attentivement écouté le récit de Fleur-de-Marie ; il regarda le Chourineur avec étonnement. Cet éclair de sensibilité le surprenait.
– Qu’as-tu donc, Chourineur ? lui dit-il.
– Ce que j’ai ! Comment ! ça ne vous fait rien, à vous ? Ce monstre de Chouette qui martyrise cet enfant ! Vous êtes donc aussi dur que vos poings !
– Continue, ma fille, dit Rodolphe à Fleur-de-Marie, sans répondre à l’interpellation du Chourineur.
– Je vous disais donc que la Chouette me martyrisait pour me faire pleurer : moi, ça me butte ; pour la faire endêver, je me mets à rire, et je m’en vas au pont avec mes sucres d’orge. La borgnesse était à sa poêle… De temps en temps, elle me montrait le poing. Alors, au lieu de pleurer, je chantais plus fort : avec tout ça, j’avais une faim, une faim ! Depuis six mois que je portais des sucres d’orge, je n’en avais jamais goûté un… Ma foi ! ce jour-là, je n’y tiens pas… Autant par faim que pour faire enrager la Chouette, je prends un sucre d’orge et je le mange.
– Bravo, ma fille !
– J’en mange deux.
– Bravo ! Vive la charte ! ! !
– Dame ! je trouvais ça bon, mais ne voilà-t-il pas une marchande d’oranges qui se met à crier à la borgnesse : « Dis donc, la Chouette… Pégriotte mange ton fonds. »
– Oh ! tonnerre ! ça va chauffer… ça va chauffer, dit le Chourineur singulièrement intéressé. Pauvre petit rat ! quel tremblement quand la Chouette s’est aperçue de ça, hein !
– Comment t’es-tu tirée de là, ma pauvre Goualeuse ? dit Rodolphe aussi intéressé que le Chourineur.
– Ah ! dame ! ç’a été dur ; seulement, ce qu’il y avait de drôle, ajouta Fleur-de-Marie en riant, c’est que la borgnesse, tout en enrageant de me voir manger ses sucres d’orge, ne pouvait pas quitter sa poêle, car sa friture était bouillante.
– Ah !… ah !… ah !… c’est vrai. En voilà une position difficile ! s’écria le Chourineur en riant aux éclats.
Après avoir partagé l’hilarité du bandit, Fleur-de-Marie reprit :
– Ma foi ! moi, en pensant aux coups qui m’attendaient, je me dis : Tant pis ! je ne serai pas plus battue pour trois que pour un. Je prends un troisième bâton, et avant de le manger, comme la Chouette me menaçait encore de loin avec sa grande fourchette de fer… aussi vrai que voilà une assiette, je lui montre le sucre d’orge et je le croque à son nez.
– Bravo ! ma fille !… Ça m’explique ton coup de ciseaux de tout à l’heure… Allons… allons, je te l’ai dit, tu as de l’atout (du courage). Mais la Chouette a dû t’écorcher vive après ce coup-là ?
– Sa friture finie, elle vient à moi… On m’avait donné trois sous d’aumône et j’avais mangé pour six… Quand la borgnesse m’a prise par la main pour m’emmener, j’ai cru que j’allais tomber sur la place, tant j’avais peur, je me rappelle ça comme si j’y étais… car justement c’était dans le temps du jour de l’an. Tu sais, il y a toujours des boutiques de joujoux sur le Pont-Neuf : toute la soirée j’en avais eu des éblouissements… rien qu’à regarder toutes ces belles poupées, tous ces beaux petits ménages… tu penses, pour un enfant…
– Et tu n’avais jamais eu de joujoux, Goualeuse ? dit le Chourineur.
– Moi ! es-tu bête, va… Qui est-ce qui m’en aurait donné ? Enfin, la soirée finit : quoiqu’en plein hiver, je n’avais qu’une mauvaise guenille de robe de toile, ni bas, ni chemise, et des sabots aux pieds ! il n’y avait pas de quoi étouffer, n’est-ce pas ? Eh bien, quand ma borgnesse m’a pris la main, je suis devenue tout en nage. Ce qui m’effrayait le plus, c’est qu’au lieu de jurer, de tempêter, sa Chouette ne faisait que marronner tout le long du chemin entre ses dents… Seulement, elle ne me lâchait pas, et me faisait marcher si vite, si vite, qu’avec mes petites jambes j’étais obligée de courir pour la suivre. En courant, j’avais perdu un de mes sabots : je n’osais pas le lui dire ; je l’ai suivie tout de même avec un pied nu… En arrivant, je l’avais tout en sang.
– La mauvaise chienne de borgnesse ! s’écria le Chourineur en frappant de nouveau sur la table avec colère ; ça me fait un drôle d’effet de penser à cette enfant qui trotte après cette vieille voleuse, avec son pauvre petit pied tout saignant.
– Nous perchions dans un grenier de la rue de la Mortellerie : à côté de la porte de l’allée, il y avait un rogomiste : la Chouette y entra en me tenant toujours par la main. Là, elle but une demi-chopine d’eau-de-vie sur le comptoir.
– Morbleu ! je ne la boirais pas, moi, sans être soûl comme une grive.
– C’était la ration de la borgnesse ; aussi elle se couchait toujours dans les bringues-zingues. C’est peut-être pour cela qu’elle me battait tant. Enfin, nous montons chez nous ; je n’étais pas à la noce, je t’en réponds. Nous arrivons : la Chouette ferme la porte à double tour ; je me jette à ses genoux en lui demandant bien pardon d’avoir mangé ses sucres d’orge. Elle ne répond pas, et je l’entends marmotter en marchant dans la chambre : « Qu’est-ce donc que je vas lui faire ce soir, à cette Pégriotte, à cette voleuse de sucre d’orge ?… Voyons, qu’est-ce donc que je vas lui faire ? » Et elle s’arrêtait pour me regarder en roulant son œil vert. Moi, j’étais toujours à genoux. Tout d’un coup, la borgnesse va à une planche et y prend une paire de tenailles.
– Des tenailles ! s’écria le Chourineur.
– Oui, des tenailles.
– Et pour quoi faire ?
– Pour te frapper ? dit Rodolphe.
– Pour te pincer ? dit le Chourineur.
– Ah bien, oui !
– Pour t’arracher les cheveux ?
– Vous n’y êtes pas : donnez-vous votre langue aux chiens ?
– Je la donne.
– Nous la donnons.
– Eh bien, c’était pour m’arracher une dent[33] !
Le Chourineur poussa un tel blasphème, et l’accompagna d’imprécations si furieuses, que tous les hôtes du tapis-franc se retournèrent avec étonnement.
– Eh bien, qu’est-ce qu’il a donc ? dit la Goualeuse.
– Ce que j’ai ?… Mais je l’escarperais[34] si je la tenais, la borgnesse !… Où est-elle ? dis-le moi. Où est-elle ? Si je la trouve, je la refroidis[35] !
Et le regard du bandit s’injecta de sang.
Rodolphe avait partagé l’horreur du Chourineur pour la cruauté de la borgnesse ; mais il se demandait par quel phénomène un assassin entrait en fureur en entendant raconter qu’une méchante vieille femme avait voulu, par méchanceté, arracher une dent à un enfant.
Nous croyons ce sentiment de pitié possible, même probable, chez une nature pourtant féroce.
– Et elle te l’a arrachée ta dent, ma pauvre petite, cette vieille misérable ? demanda Rodolphe.
– Je crois bien, qu’elle me l’a arrachée !… et pas du premier coup encore ! Mon Dieu ! y a-t-elle travaillé ! Elle me tenait la tête entre les genoux comme dans un étau. Enfin, moitié avec les tenailles, moitié avec ses doigts, elle m’a tiré cette dent : et puis elle m’a dit, pour m’effrayer, bien sûr : « Maintenant, je t’en arracherai une comme ça tous les jours, Pégriotte ; et, quand tu n’auras plus de dents, je te ficherai à l’eau : tu seras mangée par les poissons ; y se revengeront sur toi de ce que tu as été chercher des vers pour les prendre. » Je me souviens de ça, parce que ça me paraissait injuste… Tiens, comme si c’était pour mon plaisir que j’allais aux vers !
– Ah ! la gueuse ! casser, arracher les dents à une pauvre petite enfant ! s’écria le Chourineur avec un redoublement de fureur.
– Eh bien, après ? Est-ce qu’il y paraît maintenant, voyons ? dit Fleur-de-Marie.
Et elle entr’ouvrit en souriant une de ses lèvres roses, en montrant deux rangées de petites dents blanches comme des perles.
Était-ce insouciance, oubli, générosité instinctive de la part de cette malheureuse créature ? Rodolphe remarqua qu’il n’y eut pas dans son récit un seul mot de haine contre la femme atroce qui l’avait martyrisée.
– Eh bien, après, qu’as-tu fait ? reprit le Chourineur.
– Ma foi, j’en ai eu assez comme ça. Le lendemain, au lieu d’aller aux vers, je me suis sauvée du côté du Panthéon. J’ai marché toute la journée de ce côté-là, tant j’avais peur de la Chouette. J’aurais été au bout du monde plutôt que de retomber dans ses griffes.
« Comme je me trouvais dans des quartiers perdus, je n’avais rencontré personne à qui demander l’aumône, et puis je n’aurais pas osé. Pendant la nuit, j’avais couché dans un chantier, sous des piles de bois. J’étais grosse comme un rat ; en me glissant sous une vieille porte, je m’étais nichée au milieu d’un tas d’écorces. La faim me dévorait : j’essayai de mâcher un peu de pelure de bois pour tromper ma fringale, mais je ne pouvais pas : je n’ai pu mordre un peu que sur l’écorce de bouleau : c’était plus tendre. Par là-dessus je me suis endormie. Au jour, entendant du bruit, je me suis encore plus enfoncée sous la pile de bois. Il y faisait presque chaud, comme dans une cave. Si j’avais eu à manger, je n’aurais jamais mieux été de l’hiver.
– C’était comme moi dans un four à plâtre.
– Je n’osais pas sortir du chantier, je me figurais que la Chouette me cherchait partout pour m’arracher les dents et me jeter aux poissons, et qu’elle saurait bien me rattraper si je bougeais de là.
– Tiens, ne m’en parle plus de cette vieille gueuse-là, tu me fais monter le sang aux yeux !
– Enfin, le deuxième jour, j’avais encore mâché un peu d’écorce de bouleau et je commençais à m’endormir, lorsque j’entends aboyer un gros chien. Ça me réveille en sursaut. J’écoute… Le chien aboyait toujours en se rapprochant de la pile de bois. Voilà une autre frayeur qui me galope : heureusement le chien, je ne sais pourquoi, n’osait pas avancer… mais tu vas rire, Chourineur.
– Avec toi, il y a toujours à rire… tu es une brave fille, tout de même. Tiens, vois-tu, maintenant, foi d’homme, je suis fâché de t’avoir battue.
– Pourquoi ne m’aurais-tu pas battue ? je n’ai personne pour me défendre…
– Et moi ? dit Rodolphe.
– Vous êtes bien bon, monsieur Rodolphe, mais le Chourineur ne savait pas que vous seriez là… ni moi non plus…
– C’est égal, j’en suis pour ce que j’ai dit… je suis fâché de t’avoir battue, reprit le Chourineur.
– Continue ton histoire, mon enfant, reprit Rodolphe.
– J’étais blottie sous la pile de bois, lorsque j’entends un chien aboyer. Pendant que le chien jappait, une grosse voix se met à dire : « Mon chien aboie ! il y a quelqu’un de caché dans ce chantier. » « C’est des voleurs », reprend une autre voix… Et « kiss ! kiss ! » les voilà à agacer leur chien en lui criant : « Pille ! pille ! »
« Le chien accourt sur moi, j’ai peur d’être mordue, et je me mets à crier de toutes mes forces. « Tiens ! dit la voix, on dirait les cris d’un enfant… » On rappelle le chien, on va chercher une lanterne ; je sors de mon trou, je me trouve en face d’un gros homme et d’un garçon en blouse. « Qu’est-ce que tu fais dans mon chantier, petite voleuse ? » me dit ce gros homme d’un air menaçant. « Mon bon monsieur, je n’ai pas mangé depuis deux jours ; je me suis sauvée de chez la Chouette, qui m’a arraché une dent et voulait me jeter aux poissons ; ne sachant où coucher, j’ai passé par-dessous votre porte, j’ai dormi la nuit dans vos écorces, sous vos piles de bois, ne croyant faire de mal à personne. »
« Voilà-t-il pas le marchand qui se met à dire à son garçon : « – Je ne suis pas dupe de ça, c’est une petite voleuse, elle vient me voler mes bûches. »
– Ah ! le vieux panné ! le vieux plâtras ! s’écria le Chourineur. Voler ses bûches ; et t’avais huit ans !
– C’était une bêtise… car son garçon lui répondit : « Voler vos bûches, bourgeois ? Et comment donc qu’elle ferait ? Elle n’est pas tant si grosse que la plus petite de vos bûches. »
« – T’as raison, dit le marchand de bois ; mais si elle ne vient pas pour son compte, c’est tout de même. Les voleurs ont comme ça des enfants qu’ils envoient espionner et se cacher, pour ouvrir la porte aux autres. Il faut la mener chez le commissaire. »
– Ah ! la fichue bête de marchand de bois…
– On me mène chez le commissaire. Je défile mon chapelet ; je m’accuse d’être vagabonde ; on m’envoie en prison ; je suis citée à la correctionnelle ; condamnée, toujours comme vagabonde, à rester jusqu’à seize ans dans une maison de correction. Je remercie bien les juges de leur bonté… Dame !… tu penses, dans la prison… j’avais à manger ; on ne me battait pas, c’était pour moi un paradis auprès du grenier de la Chouette. De plus, en prison, j’ai appris à coudre. Mais voilà le malheur ! j’étais paresseuse et flâneuse ; j’aimais mieux chanter que travailler, surtout quand je voyais le soleil… Oh ! quand il faisait bien beau dans la cour de la geôle, je ne pouvais pas me retenir de chanter… et alors… comme c’est drôle… à force de chanter, il me semblait que je n’étais plus prisonnière.
– C’est-à-dire, ma fille, que tu es un vrai rossignol de naissance, dit Rodolphe en souriant.
– Vous êtes bien honnête, monsieur Rodolphe ; c’est depuis ce temps-là qu’on m’a appelée la Goualeuse au lieu de la Pégriotte. Enfin j’attrape mes seize ans, je sors de prison… Voilà qu’à la porte je trouve l’ogresse d’ici et deux ou trois vieilles femmes qui étaient quelquefois venues voir mes camarades prisonnières, et qui m’avaient toujours dit que, le jour de ma sortie, elles auraient de l’ouvrage à me donner.
– Ah ! bon ! bon ! j’y suis, dit le Chourineur.
– « Mon dauphin, mon bel ange, ma belle petite, me dirent l’ogresse et les vieilles… voulez-vous venir loger chez nous ? Nous vous donnerons de belles robes, et vous n’aurez qu’à vous amuser. »
– Tu sens bien, Chourineur, qu’on n’a pas été huit ans en prison sans savoir ce que parler veut dire. Je les envoie promener, ces vieilles embaucheuses. Je me dis : « Je sais bien coudre, j’ai trois cents francs devant moi, de la jeunesse… »
– Et de la jolie jeunesse… ma fille ! dit le Chourineur.
– Voilà huit ans que je suis en prison, je vas jouir un peu de la vie, ça ne fait de mal à personne ; l’ouvrage viendra quand l’argent me manquera… Et je me mets à faire danser mes trois cents francs. Ç’a été mon grand tort, ajouta Fleur-de-Marie avec un soupir ; j’aurais dû, avant tout, m’assurer de l’ouvrage… mais je n’avais personne pour me conseiller… Enfin, ce qui est fait est fait… Je me mets donc à dépenser mon argent. D’abord j’achète des fleurs pour mettre tout plein ma chambre ; j’aime tant les fleurs ! et puis j’achète une robe, un beau châle, et je vais me promener au bois de Boulogne à âne, à Saint-Germain aussi à âne.
– Avec un amoureux, ma fille ? dit le Chourineur.
– Ma foi, non : je voulais être ma maîtresse. Je faisais mes parties avec une de mes camarades de prison qui avait été aux Enfants-Trouvés, une bien bonne fille ; on l’appelait Rigolette, parce qu’elle riait toujours.
– Rigolette ! Rigolette ! je ne connais pas ça, dit le Chourineur, en ayant l’air d’interroger ses souvenirs.
– Je crois bien que tu ne la connais pas ! Elle est bien honnête, Rigolette ; c’est une très-bonne ouvrière ; maintenant elle gagne au moins vingt-cinq sous par jour ; elle a un petit ménage à elle… Aussi je n’ai jamais osé la revoir. Enfin, à force de faire danser mon argent, il ne me restait plus que quarante-trois francs.
– Il fallait acheter un fonds de bijouterie avec ça, dit le Chourineur.
– Ma foi ! j’ai mieux fait que ça… J’avais pour blanchisseuse une femme appelée la Lorraine, la brebis du bon Dieu ; elle était alors grosse à pleine ceinture, avec ça toujours les pieds et les mains dans l’eau à son bateau ! Tu juges ! Ne pouvant plus travailler, elle avait demandé à entrer à la Bourbe ; il n’y avait plus de place, on l’avait refusée, elle ne gagnait plus rien. La voilà près d’accoucher, n’ayant pas seulement de quoi payer un lit dans un garni ! Heureusement elle rencontra par hasard, un soir, au coin du pont Notre-Dame, la femme à Goubin, qui se cachait depuis quatre jours dans la cave d’une maison qu’on démolissait derrière l’Hôtel-Dieu.
– Eh ! pourquoi donc qu’elle se cachait dans le jour, la femme à Goubin ?
– Pour se sauver de son homme, qui voulait la tuer ! Elle ne sortait qu’à la nuit pour aller acheter son pain. C’est comme ça qu’elle avait rencontré la pauvre Lorraine, qui ne savait plus où donner de la tête, car elle s’attendait à accoucher d’un moment à l’autre… Voyant ça, la femme Goubin l’avait emmenée dans la cave où elle se cachait. C’était toujours un asile.
– Attends donc, attends donc, la femme à Goubin, c’est Helmina ? dit le Chourineur.
– Oui, une brave fille, répondit la Goualeuse… une couturière qui avait travaillé pour moi et pour Rigolette… Dame, elle a fait ce qu’elle a pu en donnant la moitié de sa cave, de sa paille et de son pain à la Lorraine, qui est accouchée d’un pauvre petit enfant ; et pas seulement une couverture, rien que de la paille !… Voyant ça, la femme à Goubin n’y tient pas ; au risque de se faire assassiner par son homme qui la cherchait partout, elle sort en plein jour de sa cave et elle vient me trouver. Elle savait que j’avais encore un petit peu d’argent, et que je n’étais pas méchante ; justement j’allais monter en milord[36] avec Rigolette ; nous voulions finir mes quarante-trois francs, nous faire mener à la campagne, dans les champs… j’aime tant les champs, les arbres… les prés… Mais, bah ! quand Helmina me raconte le malheur de la Lorraine, je renvoie le milord, je cours à ma chambre prendre ce que j’avais de linge, mon matelas, ma couverture, je fais mettre ça sur le dos d’un commissionnaire, et je trotte à la cave avec la femme à Goubin… Ah ! fallait voir comme elle était contente, la pauvre Lorraine ! Nous l’avions veillée nous deux, Helmina ; quand elle a pu se lever, je l’ai aidée du reste de mon argent jusqu’à ce qu’elle ait pu se remettre à son bateau. Maintenant elle gagne sa vie ; mais je ne puis pas venir à bout de lui faire donner ma note de blanchissage ! Je vois bien qu’elle veut s’acquitter comme ça ! D’abord… si ça continue, je lui ôterai ma pratique…, dit la Goualeuse d’un air important.
– Et la femme à Goubin ? demanda le Chourineur.
– Comment ! tu ne sais pas ? dit la Goualeuse.
– Non, quoi donc ?
– Ah ! la malheureuse !… Goubin ne l’a pas manquée ! Trois coups de couteau entre les deux épaules ! On lui avait dit qu’elle rôdait du côté de l’Hôtel-Dieu ; et un soir, comme elle sortait de sa cave pour aller chercher du lait pour la Lorraine, il l’a tuée.
– C’est donc pour ça qu’il a une fièvre cérébrale[37], et qu’il sera, dit-on, fauché[38] dans huit jours ? dit le Chourineur.
– Justement, dit la Goualeuse.
– Et quand tu as eu donné ton argent à la Lorraine, qu’as-tu fait, ma fille ? dit Rodolphe.