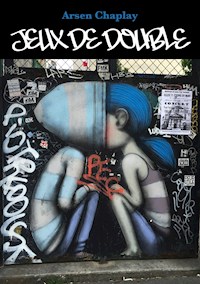
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un homme victime d’une amnésie se perd dans son reflet, lors d’une traversée de l’Atlantique à bord du paquebot Normandie. Un enfant et un bouc se fixent, hypnotisés, yeux bleus contre yeux noirs, sur la scène sacrificielle d’une cérémonie vaudou à laquelle assiste Max, le pécheur.
Et pour Alban, fils et petit-fils de ces deux hommes, tout commence l’été 1966 quand il découvre Éric, le garçon mystérieusement apparu dans son royaume de pierre, un château en trompe-l’œil qui domine la Loire. Ces quelques jours où la lumière le dispute à l’ombre, où les extrêmes du bonheur et du malheur s’affrontent, vont changer le destin d’Alban jusqu’à la scène ultime au fond d’un placard oublié. Entre-temps, les nouvelles d’Alban nous parviennent, tous les sept ans exactement, allant d’un carrefour anglais qui le conduit avec son ami Vic sur la route fatale des Highlands, aux routes déroutées de ses échappées sahariennes.
Défilent enfin les passantes, ces sirènes duales qui croisent les vies des deux fils d’Alban, Samy et Théo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arsen Chaplay
Jeux de double
A la mémoire de ma mère Anne-Marie, à l’écho de sa voix,
de mon père Gustave, le pécheur
et de mon frère Bernard qui repose à l’ombre de ses géants, Brassens, Brel et Ferré
À Christine qui navigue avec moi aux quatre points cardinaux
À ma famille mélangée, à ses rêves
Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait !
–Arthur Rimbaud,Lettre à Georges Izambard
Si la volonté divine implique le supplice d’un enfant innocent par une brute, je rends mon billet.
–Dostoïevski, Les Frères Karamazov
Dans toute œuvre d’imagination, il y a un récit de soi.
–Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t’appelle
1 REFLETS
FélixJuillet 1938 – Le Havre-NewYork
À bord du Normandie, jeudi 7 juillet1938
Ma tête résonne encore !
L’aube découvrait le lit étranger. Une sensation d’ensevelissement le retenait toujours, quand il entendit ces mots venus des profondeurs de lanuit.
Il se leva et alla se placer devant le large hublot derrière lequel s’agitait l’horizon. Sa ligne s’abaissait et se relevait sans cesse, elle s’inclinait d’un côté puis de l’autre. Il pensa qu’elle était comme l’écho du trouble où il se trouvait.
Tout se mit à tourner autour de lui alors que des bribes de souvenirs remontaient comme des bulles à la surface de sa mémoire, avant de disparaître en éclatant : un homme ensanglanté, couché dans un bouge à marins, une enquête rebondissante sur les pages d’un livre qu’il n’arrivait pas à fixer, et tant d’autres visions qui passaient à une vitesse folle. Il respira lentement, lentement pour retrouver son calme, en s’accrochant aux seules images dont il était certain. Les premières le ramenèrent à la sortie de son coma la veille, après l’appareillage du Normandie.
Le médecin général à bord, Jean Dupuy, venait d’entrer dans la pièce où des passagers l’avaient transporté sans connaissance. Aux questions de Jean Dupuy, il avait répondu qu’il ne se souvenait ni du lieu ni des circonstances de l’accident, et pas davantage des heures qui l’avaient conduit jusqu’à la porte de la cabine. Tout s’était évanoui, tout sauf un nom : Félix, et la pensée d’un vague métier de détective.
Jean Dupuy avait recousu la large entaille à l’arrière de sa tête avant de la bander. « Vous avez été salement touché, lui avait-il dit. Je vais vous revoir tous les jours jusqu’à notre arrivée à New York. D’ici là, vous irez mieux… » Ses propos auraient été rassurants s’ils n’avaient été suivis de ce compliment stupéfiant : « Bon courage, Monsieur Daussy. Ah ! J’allais oublier de vous dire que j’ai bien aimé votre dernier livre ! » Après le départ du médecin, il avait trouvé une carte d’embarquement au nom de Paul Daussy, écrivain. Mais Félix, lui, était bien détective !
Resté seul, il s’était précipité devant la glace de la cabine qui ressemblait à un tableau dans son cadre en bois fixé au mur, au-dessus d’une cuvette de toilette et d’un broc en porcelaine blanche. Il avait regardé son reflet, un visage de craie, qu’il n’avait pas reconnu, assombri par une barbe de deux jours sous une broussaille de cheveux bruns.
C’est à ce moment qu’il avait décidé d’enquêter. Il avait pensé : Comme tu sais le faire, Félix, toi qui occupes si étrangement ma mémoire, alors que je me suis perdu dans le portrait de la glace. Il lui raconterait les péripéties et les rencontres du voyage, ce qu’elles révéleraient. Il lui confierait ses troubles et ses interrogations. Et tout au bout de ces mots qu’il écrirait chaque matin sur le papier à lettres à l’en-tête de la « French Line – S.S. NORMANDIE » dans sa cabine, isolé des autres passagers que le hasard d’une traversée avait réunis là, il espérait bien les dénouer, ces liens qui le rattachaient aux deux hommes : Félix et Paul, Paul et Félix.
Il quitta le bureau où il avait jeté les premières phrases de cette correspondance vitale, pour ouvrir le grand dressing en face du lit. Il fut surpris de découvrit une garde-robe élégante. Il choisit la tenue qui lui paraissait la mieux adaptée au bateau : pantalon et chemise de coton blanc, gilet de flanelle pour le vent. Puis il prit connaissance d’une liasse de documents à l’effigie du Normandie : plaquette de la Compagnie, gazettes, liste de l’état-major et du staff, brochures détaillant les services fournis à bord et le plus utile enfin, la série des plans repérés selon les classes (1re, touriste, etc.) et la position des ponts depuis le sundeck à l’étage supérieur jusqu’au pont D en descendant tous les niveaux.
Muni de ces plans, il se risqua à sortir de sa cabine. Il resta d’abord étourdi par toutes les salles ornementées et éclairées qu’il découvrait en enfilade, allant et venant entre leur luxe étincelant et la netteté blanche et brune des plages au-dehors. Il commença par le grand hall et ses quatre ascenseurs, pour s’élever jusqu’au pont-promenade. À l’extérieur, trois jeunes femmes lui sourirent un peu effrontément, en plissant des yeux dans l’ombre de leurs chapeaux. Elles pressaient contre elles de drôles de petits chiens, sur des transats serrés à se toucher. Rentré à l’intérieur, il jeta un coup d’œil au théâtre dont les rideaux étaient tirés derrière des alignements de chaises vides, avant d’aller s’installer dans le jardin de première classe. En buvant un thé au lait, il remarqua autour de lui d’étranges roues de plus d’un mètre de diamètre et des piliers qui montaient au plafond en se courbant. Les plantes exotiques qui s’enroulaient sur les roues et les piliers imprégnaient le jardin d’une ambiance tropicale.
Ce fut une courte accalmie dans la verdure, car, midi approchant, il se rappela que Jean Dupuy l’avait convié à sa table pour la durée du voyage. Les plans lui indiquèrent de descendre jusqu’au pont C où se trouvait la grande salle à manger que la brochure disait s’étendre sur trois étages. Elle précisait : l’espace le plus impressionnant du navire. Au pied de son immense porte ornée de médaillons, l’angoisse, à l’idée d’être confronté de nouveau au médecin, le retint d’en franchir le seuil. Il reprit alors sa course en s’enfonçant encore plus profondément dans le Normandie, pour se retrouver à l’entrée de la piscine intérieure.
L’eau clapotait au bord du gradin périphérique. Le bar de la piscine la prolongeait dans un décor de fine mosaïque, mélangeant les blancs et les bleus qui rayonnaient sous un éclairage diffus. Il s’approcha d’un groupe de personnes rassemblées près du comptoir. Une jeune femme conversait avec un homme vêtu d’un peignoir écru. Il remarqua son élégant maillot de bain noir coupé à la taille par une ceinture mauve, et l’élancement de sa silhouette sous une courte chevelure d’un blond polaire, avant de s’asseoir à côté d’un type énorme, perché de guingois sur un tabouret. Celui-ci le fixait d’un regard net et sombre dans un visage rougeaud, un regard plutôt envahissant.
À son passage, la femme en peignoir leva légèrement la tête avec un sourire fugitif dans les yeux. Le gros homme, lui, le salua d’un retentissant : « Bonjour, sir, je crois vous reconnaître, moi je m’appelle Lewis Cook. » Il était presque chauve avec de rares cheveux roux aux tempes et, vu de près, il semblait encore plus gros tant son corps s’affaissait pour déborder son tabouret. Cet aspect, renforcé par un regard impudemment accroché à ses mouvements, l’aurait d’ordinaire fait fuir toute conversation, mais son « je crois vous reconnaître » l’arrêta, pour entendre une très curieuse histoire, dans ce bar où résonnaient les éclats d’eau de la piscine.
« Je reviens à New York après un séjour en France de deux semaines, un séjour pour affaires, et j’ignore si je retrouverai jamais ma femme », commença-t-il. L’Américain s’interrompit un instant pour le laisser commander un Jack Rose, avant de poursuivre son propos : « Vous devez me trouver indiscret ! C’est que je vous ai déjà vu dans les journaux, des images publiées avec ce commentaire élogieux : “One of the most famous detective”. C’est pourquoi j’ai pris la liberté de vous parler de la disparition de ma femme. Je suis persuadé que vos conseils me seront utiles. »
Félix venait soudain de faire irruption, transporté par la voix du gros homme qui poursuivit : « Celle-ci s’est littéralement volatilisée il y a deux semaines. Elle a pénétré le 26 juin vers vingt-deux heures, si j’en crois le rendez-vous noté sur son agenda, dans un hall d’immeuble de la 42e rue, et elle n’en est pas ressortie. »
Il lui fit remarquer qu’elle l’avait peut-être quitté sans avoir été vue, le temps qu’il soit alerté et prenne des dispositions.
« Je pense que non, lui répondit Lewis Cook. Le fait est que ma femme n’a reparu nulle part. J’ai donc décidé de la chercher là où elle avait disparu, puisqu’en somme il n’existait pas d’autres réalités que ce lieu. Et puis, dans son agenda, elle avait écrit ces mots mystérieux : “Rdv urgent avec l’homme rencontré à la gare”et juste en dessous :“curiosités”. Des mots suspects, vous en conviendrez. Quelles curiosités l’homme de l’agenda avait-il promis de lui dévoiler ? Et que signifiait cette urgence à le voir ? Je l’ignore ! Mais la solution se trouve forcément là, cachée dans cet immeuble. »
À cet instant, Lewis Cook se pencha vers lui en quête d’une approbation qu’il se garda bien de lui donner. Il le questionna simplement sur ses entreprises pour retrouver sa femme.
« J’ai engagé un détective, enfin pas seulement un, vous allez voir. » Celui-ci, assis sur le banc d’un petit square situé en face de l’immeuble de la 42e rue, devait lui signaler les allers et retours de ses habitants à toute heure du jour et de la nuit. Il l’interrogea sur l’étonnante constance de cet homme cloué sur son banc, qui attendait sans être distrait une minute qu’une femme sorte d’un hall d’entrée. Lewis Cook précisa qu’en fait ils étaient deux, Georges et William Johnson, Georges pour le jour et William pour la nuit, des détectives jumeaux réputés entre l’East River et l’Hudson, et toujours habillés de vêtements identiques. Si bien qu’ils passeraient pour une seule et même personne dans l’ombre des platanes.
Au moment de se quitter, l’Américain lui proposa de lire les rapports des deux frères le lendemain, vers onze heures, dans la salle de correspondance où une ambiance feutrée les assurait de n’être pas dérangés. Il pensa que cet homme ne recherchait rien d’autre que les encouragements du most famous detective, car il s’était fait sa religion : N’est-ce pas, Félix ? Enchaîné à son hypothèse de départ, il tentait curieusement de rendre prévisible l’imprévisible.
Il laissa Lewis Cook à son whisky et à ses comptes rendus télégraphiques pour remonter au pont-promenade. De là, il rejoignit le grand salon que le plan situait à l’opposé du jardin par rapport au hall des ascenseurs. Il s’installa confortablement dans un des fauteuils tendus de tapisserie florale à dominante rouge – tendus de tapisserie d’Aubusson d’après des cartons d’Émile Gaudissart, annonçait la brochure –, s’attardant à boire du café et à grignoter des en-cas, tout en lisant distraitement un roman policier d’Agatha Christie, Cards on the Table. Quatre inconnus s’y révélaient être chacun un criminel impuni. Le talent de l’écrivain n’était nullement en cause pour juger de la distraction de sa lecture. Seulement il n’arrivait pas à défaire son cerveau en déroute de ces détectives jumeaux fixés à leur banc new-yorkais ni de Félix surgi du fond de sa nuit comateuse. Le seul moment d’accalmie vint d’un court spectacle, comme il s’en produisait souvent dans le grand salon. Quatre anneaux blancs s’élevaient en l’air, les uns à la suite des autres, au-dessus d’un jongleur tenant des ballons en équilibre. Et les mouvements du jongleur s’accordaient mystérieusement aux objets qui volaient autour delui.
Le soir, vêtu d’un smoking emprunté au vestiaire masculin, il rejoignit la grande salle à manger illuminée par des cascades de verres en feu. Ils étaient quatre, assis autour de la table, avec Jean Dupuy, Bernard Ameil – le commissaire des touristes – et Marie Jourdan, une psychanalyste à la quarantaine fine et agréable, coiffée de cheveux châtains mi-longs au-dessus d’un visage étroit. Mariée, elle vivait à Paris et partait à New York pour participer à un congrès de psychanalyse. Il suivit vaguement les propos convenus de ses voisins : son accident, les équipements du Normandie qu’aucun palace sur terre n’égalait, les rumeurs de guerre, etc., à l’exception du bref échange avec Marie Jourdan qui le ramena à la table. La voix de Marie lui parut chaude, attentive, et surtout elle avait reconnu son nom. Il la corrigea silencieusement : Non ! Pas mon nom, celui de l’écrivain.
Il souhaitait la revoir, parce que toute sa vie se résumait là, il le sentait bien, dans ces cinq jours flottant entre deux mondes où il devrait examiner chaque indice, clarifier chaque révélation pour se libérer enfin du sinistre huis clos où il se débattait. Il pensa : Comme ces pauvres jumeaux fixés sur leurbanc.
À bord du Normandie, vendredi 8 juillet1938
Le soleil traversait le hublot avec une luminosité unique sur un bleu à perte de vue, qu’on ne voit qu’au milieu de lamer.
Il laissa son carnet pour prendre le petit-déjeuner qu’il avait commandé, avant de rejoindre Lewis Cook dans la salle de correspondance contiguë au jardin d’hiver.
Le siège de l’Américain se trouvait le plus éloigné de l’entrée quand il l’aperçut, la tête légèrement inclinée sur son épaule droite, qui saisissait des feuilles, les replaçait, en saisissait d’autres. Il se dirigea sans bruit vers l’homme qui se débattait avec ses papiers roses, en suivant un chemin zigzagant entre les tables qui le mettait juste à la limite de son champ de vision. Lewis Cook sursauta en le découvrant devant lui. Il le salua en prenant soin d’éviter tout contact, avant de s’asseoir. Et il commença à lire les télégrammes des frères Johnson.
Les premières lignes de leurs comptes rendus quotidiens en donnaient le ton. Ils étaient tous écrits par Georges Johnson, qui avait obtenu de la concierge le nom et la situation de chacun des occupants de l’immeuble.
« 8 h – Mr Miles, employé de banque, logé au 2e, porte à droite, est le premier à sortir, 1,80 m, 40 ans, mince, nez allongé, un peu voûté, costume bleu étriqué, ne se laisse distraire par rien. Ah si ! il vient de se pencher sur un petit chat, mais celui-ci a fui. 8 h 07 – Mr et Mrs Jones, logés au 3e, quittent ensemble l’immeuble, possèdent une agence immobilière, lui 1,70 m, 50 ans, vif et rond, costume cintré anthracite, elle 1,75 m, 30 ans, beauté asymétrique, en robe léopard imprimée assortie au gilet, cheveux mi-longs plats sur le dessus et bouclés en bas, semblent s’ignorer quand ils marchent. 8 h 23 – Donald Amos, logé au 2e, porte à gauche, sort à son tour, 1,85 m, 35 ans, jean et veste de coton noir, brun avec une moustache à la Clark Gable, doit séduire, rejoint son atelier d’architecte, lâche deux mots à un clochard en passant dans le square, alerte, voit tout, je crois qu’il m’avu… »
Alors qu’il se levait, il dit à Lewis Cook : « Elles sont impressionnantes, ces notes émiettées, un sacré puzzle en tout cas ! Mais que faites-vous de ce type du quatrième étage qu’on n’aperçoit jamais ? Vous devriez demander aux Johnson d’y prêter attention ! » Lewis Cook lui répondit : « Oui, cet homme, ils m’en ont déjà parlé… Et ce puzzle, j’y travaille, j’y travaille sans cesse en rassemblant leurs informations. » En quittant Lewis Cook et ses télégrammes, il s’interrogea sur le résultat de cette collecte minutieuse. Chaque indice recueilli ne mènerait-il pas à une nouvelle désillusion ?
Toujours occupé de ces habitants new-yorkais dont il venait de faire la connaissance, il se rendit dans le grill-room aménagé à la poupe du navire, juste à l’étage au-dessus, pour déjeuner. Sous la grande structure vitrée, seul à nouveau, il renoua avec le fil de sa pensée dissipée par les papiers roses de l’Américain. Il voyait que Félix se rapprochait de lui tout en s’en éloignant, un paradoxe étrange qu’il essayait de comprendre. S’il se représentait de mieux en mieux les activités du détective et le détail de ses enquêtes, il comprenait aussi que le temps vécu sur le paquebot depuis sa sortie du coma avait, par une succession de petits signaux, creusé des différences entre eux.
Soudain, le big band du salon se réveilla pour répandre dans la salle les notes du fameux Sing, Sing, Sing. Un couple d’artistes se précipita aussitôt sur la piste ronde pour se lancer dans un swing joyeusement syncopé. Un entracte bien venu, qui le libéra pour un instant de ses errances, et lui permit de s’abandonner à l’image facétieuse d’une danse désertée par la musique. Elle se transforma alors en une série de sautillements dans un accéléré de film muet. Il sourit à cette image, il sourit et décida de descendre nager dans la piscine intérieure, avec l’espoir d’y retrouver la belle garçonne de la veille.
Elle se trouvait bien là, assise sur sa serviette, près des deux grandes cornes d’abondance sculptées à l’extrémité du bassin. Au-dessous d’elle, une irisation mouvante éparpillait dans l’eau les motifs de la fresque murale éclairée par la corniche. Leurs regards se croisèrent, lui attentif, déjà séduit – plus tard elle lui dira qu’elle avait été saisie par cette attention étirée dans deux yeux bruns –, elle avec son regard lumineux, du bleu en harmonie avec tous les bleus autour. Le galbe de ses jambes allongées négligemment le troubla, comme l’arrondi de ses seins dont le maillot de bain noir dénudait la naissance. Il fut surpris quand elle se leva pour l’aborder sans façon : « Hello ! l’homme célèbre. Tout le monde ne parle ici que de votre arrivée : vous rampiez tel un lézard devant la porte de votre cabine. Et puis votre nom ne m’est pas inconnu… » À l’évocation de son nom, il pâlit et hocha la tête sans oser la questionner. Puis ils allèrent nager en causant tranquillement, dans le décor carrelé du bassin et des murs qui se reflétait autour d’eux. Elle lui apprit qu’elle était venue participer à un défilé qui présentait la collection « Croisière » de mademoiselle Chanel. Mannequin, elle s’appelait Anna, mais quand elle ne défilait pas, elle redevenait Paula, étudiante en droit. Il nota d’aller assister à la prochaine présentation programmée le lendemain, à vingt et une heures, sur la scène du théâtre. En sortant du bain, ils allèrent se faire masser dans une salle parfumée d’huiles essentielles.
Leurs banquettes se trouvaient disposées parallèlement. Paula, allongée sur le ventre, était recouverte d’une large serviette que sa masseuse déplaçait doucement, au rythme de ses palpations, dévoilant ainsi chacune des parties de son corps à mesure qu’elle les effleurait et les pressait. Il suivait le lent cheminement des mains sur le dos de Paula… et soudain lui revint une image : une femme de pierre nue sur la place d’une ville italienne ensoleillée, tellement belle, tellement parfaite. Les deux images se superposèrent, le corps de pierre que l’artiste avait délicatement fait émerger de sa minéralité et celui de chair que des mains brillantes d’huile sculptaient à leur façon.
Il était ému quand ils quittèrent la chambre de massage, curieusement ému et détendu à la fois. Ils se séparèrent sur un frôlement, pour se retrouver le soir sur la terrasse du grill-room.
Les dernières lueurs du jour tombaient sur leur conversation. À peine installée, Paula lui dit qu’elle le connaissait, qu’elle avait lu presque tous ses livres : « C’est une distraction utile pour un futur avocat que de lire des romans policiers, vous savez. »
Il la fixait, surpris : « Vous me connaissez ! Vous allez être avocat quand moi j’écris des romans policiers ! Et si l’on ajoute nos prénoms : Paul et Paula, ça en fait des rencontres. »
Paula lui répondit que c’était ainsi, le hasard ou le destin, ou un peu des deux peut-être. « Mais parlons de vous, poursuivit-elle, pour une fois que j’ai la chance de me trouver en face d’un écrivain qui m’a touchée. »
Il aperçut comme une lueur dans son errance : « Mais de quelle façon, dites-moi ?
–D’abord, j’ai pensé que le genre policier ne représentait pour vous qu’un prétexte », commença-t-elle en lui jetant un regard interrogateur.
Paul eut le sentiment que, derrière ce regard, elle cherchait son approbation. Il lui répondit en théorisant un peu au hasard, mais également avec sincérité : « Peut-être… Dans ce genre, on a affaire à un crime, donc à un criminel. Ça donne lieu à une enquête colorée par le milieu, ou le décor si vous voulez. Et à la fin, le coupable est identifié et arrêté. Une trame aussi simple qu’évidente, voyez-vous. Et c’est souvent son cadre : une ville, un quartier, qui en est le véritable acteur. Mais l’enquête constitue en plus, pour moi, le motif ou le prétexte d’autre chose, comme vous dites. »
Il ajouta pour la provoquer, mais aussi pour l’engager à poursuivre : « Le monde n’est pas si net, vous savez. »
Paula se rapprocha. Sa main droite effleura celle de Paul : « Justement, vous-même ne le rendez pas net ! Vous brouillez les pistes. Vous refermez les portes, souvent, et c’est à nous d’en découvrir les clefs. Mais j’aime ça. J’aime que vos enquêtes se perdent ainsi. Oh ! Pardonnez-moi ! Vous devez me trouver un peu intrusive, non ? »
Cette fois-ci, elle lui pressait vraiment la main. L’air du Normandie lui sembla soudain plus léger. Il pensa : Enquêtes, écritures, portes fermées, ça me livre quoi tout ça ? Et pourtant je sens, jesens…
Paula reprit : « Ce fil conducteur de vos romans, voilà ce qui me touche, Paul, et aussi vos ruptures, vos échappées, vos mises en abyme ! Vous écrivez souvent des romans dans le roman, de sorte qu’on ne sait plus où s’arrête la vie et où commence l’imagination. »
Il vit que Paula l’emmenait dans un monde situé au bord de sa mémoire, un monde qui continuait de le fuir. Il chercha à faire diversion en riant : « Je veux bien vous croire, Paula. Et là, j’ignore si vous êtes réelle ou bien l’un des personnages de mon dernier roman. »
Elle lui sourit encore, et la sensualité s’installa à leur table : « Suis-je réelle, Paul ? Mon corps est-il réel ? Eh bien ! Si nous allions nous en assurer ? »
Ils rejoignirent sa cabine, mystérieusement accordés, leurs mains qui s’effleuraient, la douceur de leurs lèvres. La porte refermée, ils se débarrassèrent ensemble de leurs vêtements, vite, vite, avant de se découvrir lentement par le jeu des caresses symétriques. L’un parcourait le corps de l’autre, juste là où il voulait être caressé et les doigts de l’autre le suivaient sur le chemin du plaisir. Puis les rôles s’inversaient…, et ils s’inversaient encore.
Paula était allongée sur le lit, presque à le toucher. Il repensa à Félix qu’il avait trahi, d’une certaine façon. En effet, le détective ne lui semblait pas très intéressé par les personnages féminins que ses enquêtes l’amenaient à côtoyer. Sur ce plan-là, il le voyait un peu comme le Tintin d’Hergé qui parcourait en tous sens un monde d’où les relations amoureuses étaient absentes. Lui, il n’éprouvait pas cette insensibilité. L’ombre d’un sourire dans le visage d’une femme, une chute de rein effrontément cambrée, des pas qui découvrent un mollet ou la musculature fine d’une jambe, ça l’émouvait. Il comprenait que si des portes s’étaient fermées, d’autres s’étaient ouvertes, mais sur qui ? Sur quoi ? Comme il observait le sommeil de Paula, il eut l’impression d’étouffer. Un cri dans sa tête se répétait : Vivre ! Vivre ! Vivre enfin.
À bord du Normandie, samedi 9 juillet1938
Le jour avançait dans la cabine. Paula dormait encore. Sa jambe droite était dégagée jusqu’à la hanche. Il était ému par cet abandon, une forme blanche d’une ligne si parfaite ! Il ne pouvait plus se détacher de cette cuisse qui s’incurvait, inerte, jusqu’à ce qu’un infime sursaut, une brève contraction la rendent à lavie.
Il fit servir leur déjeuner sur la table du petit salon, puis Paula partit rejoindre les autres mannequins pour les essayages du défilé de mode du soir, lui laissant en souvenir une inclinaison, un léger baiser, des pas dansants qui s’éloignaient.
À onze heures, il croisa Lewis Cook sur le pont des embarcations, face à la mer. Allongés sur leur transat, ils commandèrent du champagne. Lewis Cook semblait plus détendu quand il lui fit part d’un rebondissement dans l’enquête de la 42e rue : le mystérieux locataire du quatrième étage, enfermé dans son appartement, avait soudainement quitté l’immeuble la veille, à la nuit tombante. Georges Johnson l’avait reconnu à la description de la concierge, petit et malingre, une allure furtive, malgré son écharpe sur le menton et le capuchon de son caban. William avait rejoint Georges rapidement pour le relayer sur le banc, tandis que Georges allait explorer l’appartement déserté. Il ne trouvait aucune trace du passage de sa femme, jusqu’à ce qu’il lise, sur un papier abandonné dans un coin de table, les mots : « Elle doit me voir sans tarder » puis : « Curiosité à lui montrer ! » Cette importante révélation avait conduit Lewis Cook à recruter un troisième détective pour ne pas troubler l’ordre de la veille des frères Johnson. Celui-ci devait s’attacher aux pas de l’homme au capuchon à toute heure, dès qu’il se manifesterait. Paul eut pitié des jumeaux prisonniers d’une obscure porte d’entrée. Tout en se dirigeant vers le café grill-room à l’intérieur du pont des embarcations, il pensa que ça ne s’arrêterait peut-être jamais.
Au milieu de l’après-midi, il descendit au grand salon, à l’étage en dessous, rejoindre Marie Jourdan. Voulant prolonger leur conversation de la veille, ils avaient décidé de se revoir.
Marie se rendait à New York, invitée à participer à un congrès de psychanalyse portant sur l’identité. Mais ce congrès, lui confia-t-elle – sans doute que sur cet espace flottant, affranchi de ses attaches, les secrets s’échappaient sans difficulté –, lui fournissait l’alibi qui la libérait pour deux semaines de ses liens. Elle lui parla de son affection pour son mari, un vieux professeur de philosophie un peu statufié entre les murs de la Sorbonne, puis elle en vint à la vraie raison de son voyage. Elle avait décidé de s’abandonner à ses désirs, en rejoignant son amant américain rencontré à Paris. Celui-ci y avait séjourné, comme tant d’autres journalistes étrangers, pour être au plus près de ce qui se jouait dans une Europe agitée par des prémices de guerre.
Il la trouva émouvante, cette femme qui s’était accordé cet entracte dans une vie sans doute bien rangée. Puis ils commencèrent à parler de lui et de « ses livres ». Marie les connaissait seulement par leur succès de librairie. Et son nom lui était obscurément revenu la veille, quand ils avaient été présentés.
« Mais c’est que je lis peu de romans et jamais des romans policiers », lui avoua-t-elle en s’excusant presque.
Il lui répondit que l’intrigue policière de son dernier roman n’était qu’un prétexte, que son vrai motif se trouvait dans le questionnement sur l’identité. Il voulait amener Marie à lui parler de son congrès, pour avoir l’éclairage de la psychanalyste sur les chemins tourmentés où il se perdaitici.
« L’identité, les composantes de l’identité, ce sont là des thèmes qui nous interpellent, commença Marie, en réponse à son interrogation informulée. Prenons d’abord l’identité imaginaire, celle qui nous invite à vivre avec notre prochain, en acceptant l’image que celui-ci nous renvoie. C’est une identité plastique qui s’adapte à la société des autres. Mais cette dernière change selon les lieux, les moments, alors nous devons être un peu caméléon… »
Marie s’arrêta à ce moment, distraite par le spectacle du salon annoncé par le réveil musical de l’orchestre. Un contorsionniste facial se métamorphosait en Popeye, le marin aux épinards.
« La voilà, l’identité mouvante, affirma-t-elle en riant. Maintenant, passons à l’identité qui nous donne un axe. Elle se fonde sur notre histoire personnelle, notre origine, notre religion, notre sexe, etc. C’est elle qui assure notre permanence. Comme vous l’imaginez, ces deux identités ne concordent pas toujours : il existe souvent de la distance entre l’être mimétique qui cherche à s’adapter à un milieu et celui que la vie a constitué par toutes ses empreintes. Je parlerais ainsi de discordance et de souffrance aussi à s’éloigner de soi. »
Paul se perdait derrière ses mots jusqu’au moment où elle invita l’amnésique d’identité à leur table.
« C’est la victime ultime de ce symptôme de discordance, lui dit-elle. Il voit bien le milieu où il évolue et lui au-dedans. Il se moule petit à petit dans l’image commune que ce milieu lui renvoie, mais il a tout oublié de son identité personnelle. »
Un autre spectacle vint interrompre Marie. Un géant américain– le présentateur annonça : de 2,40 m –, la tête coiffée d’un grand chapeau du Texas, se tenait auprès d’un nain qu’un vélo à une roue avec la selle surhaussée élevait presque à sa hauteur. Les vêtements du nain apparaissaient comme le modèle réduit de ceux du géant. On les aurait crus venant de deux mondes éloignés, mais en même temps ils semblaient si proches, plus proches que d’aucune autre personne présente, par leurs jeux d’acrobates et leur costume de cow-boy. Leur opposition était impressionnante et drôle à la fois, dans un rapport de domination inversé : le nain querellait le géant.
« Oh là là, quel duo ! s’exclama Marie. Je pense à mon petit chien, un carlin. Il baisse les oreilles quand il croise dans la rue le grand berger du concierge, mais il lui aboie dessus quand il s’agite et le toise du haut de notre fenêtre au premier étage.
–Oui, et moi je dois ressembler à votre carlin, courant en tous sens d’un bout à l’autre de ce fichu bateau. Vous avez deviné mon amnésie, je sais. Vous en avez soigné, je veux dire des personnes qui auraient perdu la mémoire à la suite d’un traumatisme ?
–Parfois, ça m’est arrivé… »
Marie parut rêver un instant. Elle eut comme une hésitation avant de reprendre.
« Je me revois dans mon cabinet, en face de sujets que je dois aider à retrouver des souvenirs effacés, tant ils sont douloureux ou angoissants, des souvenirs enfouis plus ou moins profondément sous leur conscience… Les amnésiques sont seulement des questions, si ça peut vous soutenir. Ne vous perdez pas dans les réponses ! »
Elle s’arrêta en souriant : « Rassurez-vous, Paul, je suis bien là avec vous dans le salon du Normandie. Et il est temps d’aller respirer l’air marin sur la promenade du pont, avant que le jour s’en aille. »
Il était légèrement balloté par l’agitation de la houle. Un vent du sud-ouest le frappait au visage. Accoudé à la rambarde, il regardait le soleil arroser en gerbes de reflets orangés l’horizon américain de Marie Jourdan.
Après qu’elle l’eut quitté, il se retrouva seul avec Félix. Il lui avoua qu’il y voyait de moins en moins clair, qu’à un moment il se rapprochait de lui en le rejoignant dans ses exercices d’investigations et de recherche, tous ces jeux cérébraux qui font avancer une enquête, et qu’à d’autres il s’en éloignait, quand il pensait à ces nouveaux jeux, ceux de l’écriture qu’il avait entrevus avec Paula.
Une rencontre, l’amorce d’un dilemme le saisissaient avec Félix d’une sorte d’emportement à explorer, à rassembler, à reconstituer le puzzle que les ruses de la vie avaient éparpillé. Une autre rencontre, un charme jeté avec des mots ouvrant sur des univers, et il aurait voulu rejoindre Paul pour disperser la réalité, la multiplier, lui offrir tous les possibles.
Mais quand il pénétra dans le théâtre, il fut projeté loin des interrogations du salon, car il ne trouvait Paula nulle part ! Il assistait à un défilé de mode où manquait le treizième mannequin. Aucun des membres du défilé ne l’avait vue, et ni Anna ni même Paula n’avaient jamais appartenu à leur troupe.
À bord du Normandie, dimanche 10 juillet1938
La nuit s’attardait quand il s’éveilla, une nuit noircie par les orages qui n’avaient cessé de rebondir entre les murs de la cabine. Ceux-ci l’avaient tenu en alerte longtemps, ajoutant leurs grondements à son angoisse, puis le sommeil était venu de guerre lasse, saccadé, traversé de cauchemars qui s’évanouissaient pour renaître encore et encore.
Il revint à la vie avec l’aube qui commençait de découvrir chacun des recoins autour de lui. Et dans cet entre-deux du combat du jour et de la nuit, il pensa que jamais il ne cesserait d’être ce pantin sans mémoire, courant d’un bord à l’autre d’un navire fantôme à la poursuite de ses chimères. Seulement, il craignait, depuis sa sidération de la veille, à vingt et une heures exactement, que sa poursuite ait changé d’univers, ou plutôt qu’il ait été projeté dans un univers parallèle qui pouvait faire disparaître à sa guise les êtres humains qu’il avait créés.
Il s’essaya d’abord à dessiner le portrait de Paula, neuf brouillons tous jetés à la poubelle avant d’arriver à une esquisse acceptable pour sa recherche. Il parcourrait le bateau en tous sens, pour interroger employés et passagers, en leur présentant le petit portrait en papier.
Il commença par les lieux qui les avaient vus ensemble : la piscine intérieure tout en bas, où il chercha en vain les baigneurs croisés près du bar ou dans l’eau, le salon de massage transformé mystérieusement en gymnase, le grill-room dont la lumière à travers les baies vitrées n’éclairait que des gens inconnus, le théâtre enfin et ses coulisses où la troupe du défilé revenue plier ses bagages lui répéta ne rien savoir de la Paula du portrait.
Tout au long de la journée, il poursuivit sa quête éperdue. Il repartit l’après-midi du sundeck, le pont le plus élevé, pour redescendre les étages en empruntant les ascenseurs du grand hall.
Sur la promenade du pont des embarcations, il croisa à nouveau les trois filles avec leurs petits chiens, regroupées sur leurs transats. L’une d’elles lui déclara que la jeune femme du portrait avait une allure à la garçonne, mais qu’elle en revanche…, enfin si la solitude lui pesait. Il se détourna vite de leurs rires pour rejoindre le jardin d’hiver où le couple de danseurs se reposait. « Vous savez, lui dirent-ils, soit nous rêvons comme ici, la tête dans nos tasses à thé ou nos assiettes, soit nous dansons sans distinguer aucun des visages qui tournent autour de nous ; tout nous semble flou en dehors de l’espace qui nous enferme l’un l’autre. » Il répondit qu’ils avaient de la chance, car pour lui, proche ou lointain, rien ne lui paraissait net. Il repassa dans le grand salon, à l’heure des spectacles. Le contorsionniste facial ne prêtait attention qu’aux visages dont l’étrangeté pouvait l’inspirer, donc non, il n’avait pas remarqué la femme du portrait. Le géant et le nain lui dirent sérieusement que l’un voyait trop haut et l’autre trop bas, si bien qu’ils n’avaient pas aperçu ladame.
Et chacune des réponses apportait sa part de confusion, quand on ne lui tournait pas le dos d’un haussement d’épaules. Du grand salon à la piscine en passant par le théâtre, le jardin d’hiver, le fumoir, la salle de lecture, la salle de correspondance, la chapelle, la grande salle à manger, nulle part il ne trouva trace de Paula.





























