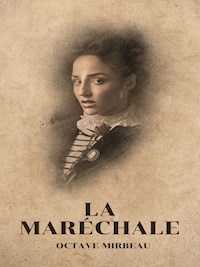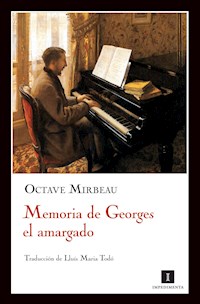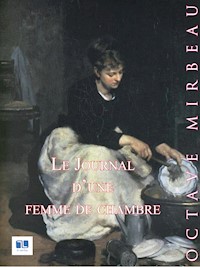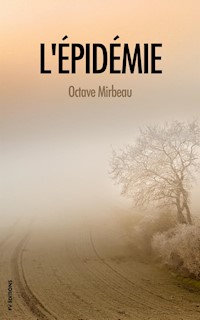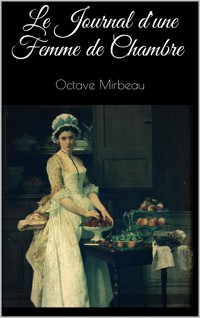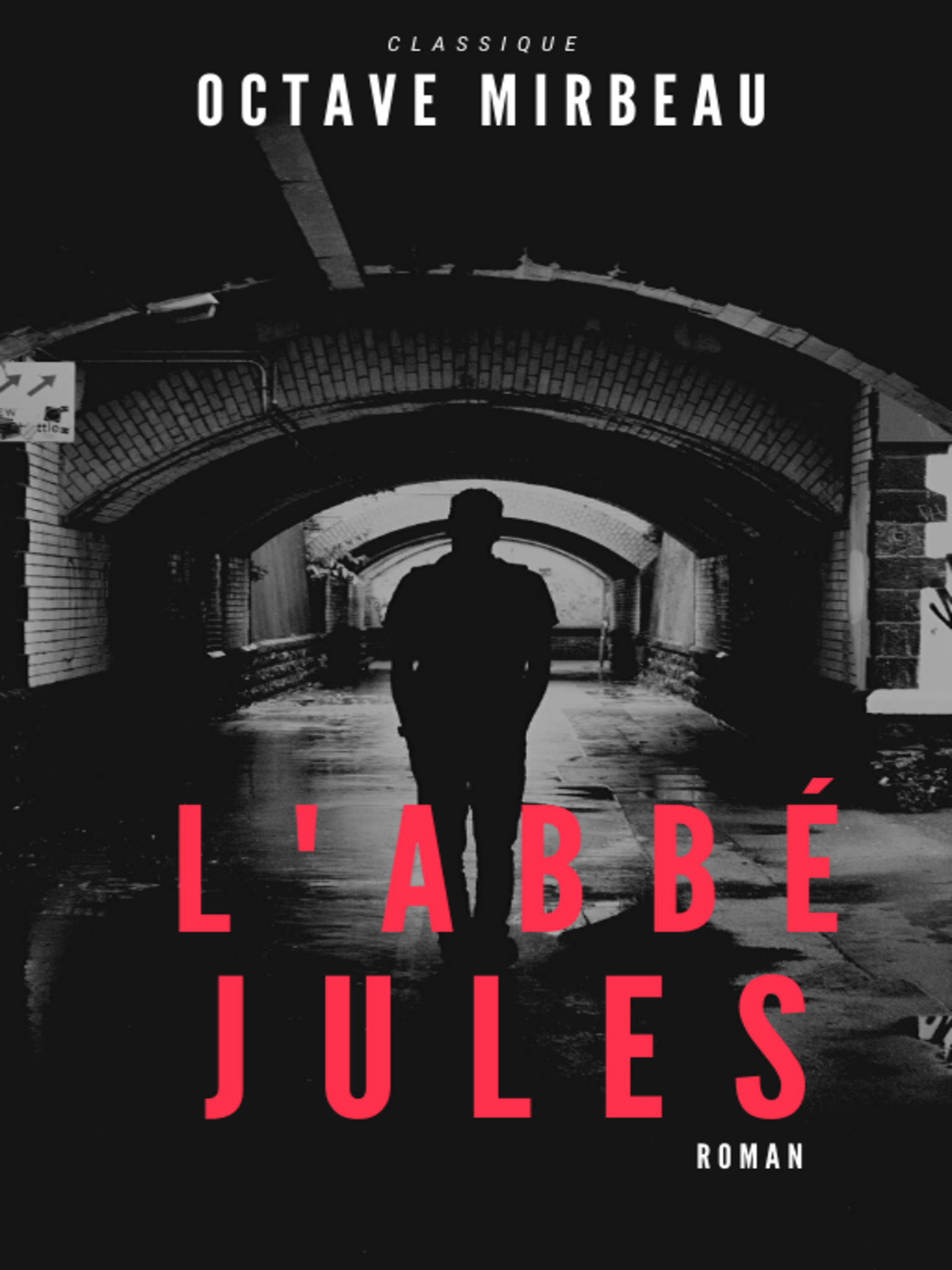
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le retour de l'abbé Jules cause une terrible agitation à Viantais et bien de l'inquiétude aux parents du jeune Albert, le narrateur, qui apprend ainsi l'existence d'un oncle redouté. Qui est-il? Et surtout qu'a-t-il fait depuis six ans à Paris? Jules, enfant violent, sensuel et versatile, est devenu prêtre. À son premier sermon, il confesse ses fautes passées. Mais ce repentir est bref car, nommé secrétaire de l'évêque, homme doux et timoré, Jules ne tarde pas à faire régner la terreur sur l'évêché par une série de calomnies. Tantôt tyrannique, tantôt regrettant ses excès, Jules lutte constamment contre la tentation de la chair... Ce roman se fonde sur une triple dénonciation. Dénonciation de la ville de province, représentée par Viantais, peuplée de mesquins et d'hypocrites. Dénonciation de l'Église, composée de prêtres cupides dépourvus de spiritualité. Dénonciation de la société et de ses valeurs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
L'Abbé Jules
L'Abbé JulesPREMIÈRE PARTIEIIIIIIIVDEUXIÈME PARTIEI. 2II. 2III. 2IV. 2V. 2VI. 2Page de copyrightL'Abbé Jules
Octave Mirbeau
À
PAUL HERVIEU
En témoignage de mon affection profonde
Ce livre est dédié
O. M.
PREMIÈRE PARTIE
I
Hormis les jours où mon père avait pratiqué une opération difficile, un accouchement important, et qu’il en expliquait, à table, par des termes techniques, souvent latins, les plus émouvantes phases, mes parents ne se parlaient presque jamais. Non qu’ils se boudassent ; ils s’aimaient beaucoup au contraire, s’entendaient, en toutes choses, le mieux du monde, et l’on ne pouvait rencontrer un ménage plus uni ; mais, habitués à penser la même pensée, à vivre les mêmes impressions, et n’étant point romanesques de leur nature, ils n’avaient rien à se dire. Ils n’avaient rien à me dire non plus, me trouvant ou trop grand pour m’amuser à des chansons, ou trop petit pour m’ennuyer à des questions sérieuses. Et puis, ils étaient très imprégnés de cette idée qu’un enfant bien élevé ne doit ouvrir la bouche que pour manger, réciter ses leçons, faire sa prière. S’il m’arrivait quelquefois de m’insurger contre ce système de pédagogie familiale, mon père, sévèrement, m’imposait silence par cet argument définitif :
– Eh bien ! qu’est-ce que c’est ?… Et les trappistes, est-ce qu’ils parlent, eux ?
À part cela, s’ils n’étaient pas toujours gais et affectueux comme je l’eusse souhaité, ils me chérissaient du mieux qu’ils pouvaient.
Pour qu’ils se crussent autorisés à desserrer les lèvres, il fallait, en dehors des aventures professionnelles et du train-train de la vie, des occasions considérables, telles qu’un déplacement de fonctionnaire, un chevreuil tué à l’affût, dans les bois de M. de Blandé, la mort d’un voisin, la nouvelle imprévue d’un mariage. Les grossesses probables des clientes riches servaient aussi de thèmes à de brefs entretiens qui se résumaient de la sorte :
– Pourvu que je ne me trompe pas ! disait mon père… pourvu qu’elle soit vraiment enceinte !
– Ah ! ce sera un bel accouchement !… affirmait ma mère… quatre par mois, comme celui-là, je n’en demande pas plus… nous pourrions nous acheter un piano.
Et mon père faisait claquer sa langue.
– Quatre par mois !… Fichtre !… Tu es trop gourmande, aussi, mignonne !… Et puis, je suis toujours inquiet avec cette sacrée femme-là… Elle a le bassin si étroit !
Sans savoir d’une façon précise quelle partie mystérieuse du corps désignait ce mot : bassin, j’avais fini, dès l’âge de neuf ans, par connaître exactement le jaugeage et les facultés puerpérales des bassins de toutes les femmes de Viantais. Ce qui n’empêchait nullement mon père, après ces constatations scientifiques, après des énumérations d’utérus, de placentas, de cordons ombilicaux, de m’assurer que les enfants naissaient sous des choux. Je n’ignorais rien non plus de ce qui constitue un cancer, une tumeur, un phlegmon ; mon esprit délaissé s’était peu à peu empli de l’horrible image des plaies qu’on cache comme un déshonneur ; une lamentation d’hôpital avait passé sur lui, glaçant le sourire confiant de la toute petite enfance. Et à voir mon père sortir, chaque soir, sa trousse de sa poche, étaler, sur la table, les menus et redoutables instruments d’acier brillant, souffler dans les sondes, essuyer les bistouris, faire miroiter, à la lampe, les minces lames des lancettes, mes si beaux rêves d’oiseaux bleus et de fées merveilleuses se transformaient en un cauchemar chirurgical, où le pus ruisselait, où s’entassaient les membres coupés, où se déroulaient les bandages et les charpies hideusement ensanglantés. Parfois aussi, il employait une soirée à nettoyer son forceps, qu’il oubliait, très souvent, dans la capote de son cabriolet. Il en astiquait les branches rouillées, avec de la poudre jaune, en fourbissait les cuillers, en huilait le pivot. Et quand l’instrument reluisait, il prenait plaisir à le manœuvrer, faisait mine de l’introduire, en des hiatus chimériques, avec délicatesse. Le recouvrant ensuite de son enveloppe de serge verte, il disait :
– C’est égal !… Je n’aime pas me servir de cela… J’ai toujours peur d’un accident !… C’est si fragile, ces sacrés organes !
– Sans doute ! répondait ma mère… Mais tu oublies que, dans ces cas-là, tu prends le double d’honoraires !…
Si ces choses m’instruisaient de ce que les enfants ignorent habituellement, elles ne m’amusaient pas. En mon existence chétive, rien ne m’était plus pénible que ces heures de repas, si lentes à s’écouler. J’aurais voulu m’échapper, gambader quelque part, dans l’escalier, dans le corridor, à la cuisine, près de la vieille Victoire qui, au risque d’encourir les reproches de ma mère, me laissait barboter dans ses chaudrons, jouer avec les robinets du fourneau, remonter le tourne-broche, et, parfois, me contait d’extraordinaires histoires de brigands qui me terrifiaient, délicieusement. Mais l’obéissance m’obligeait à me morfondre, sans bouger, sur ma chaise, dont le siège trop bas était exhaussé par deux in-folio, deux tomes dépareillés et très vieux de la Vie des Saints, et je ne devais quitter la table que lorsque ma mère donnait, en se levant, le signal du départ. L’été, je m’arrangeais pour ne pas trop souffrir de l’ennui. Le vol grenu des mouches, le ronflement des guêpes, au-dessus des assiettes de fruits, les papillons et les insectes qui, avec la fraîche odeur des fleurs arrosées, venaient s’abattre sur la nappe, suffisaient à distraire mon esprit. Et puis, par la fenêtre ouverte, j’aimais à regarder le jardin, la vallée, là-bas, et, plus loin, les coteaux de Saint-Jacques, violets et brumeux, derrière lesquels se couchait le soleil. Hélas ! l’hiver, il n’y avait plus de mouches, plus de guêpes, plus de papillons, plus de ciel, plus rien… plus rien que cette salle morne, et que mes parents, absorbés, chacun de son côté, en des combinaisons inconnues, d’où je me sentais si absent, toujours.
Il avait plu toute la journée, je me souviens, et ce soir-là, un soir d’hiver particulièrement triste, mes parents n’avaient pas prononcé une parole. Ils semblaient plus moroses que jamais. Mon père plia sa serviette, soigneusement, en forme de cœur, comme il avait coutume de faire, chaque soir, le repas terminé, et, tout à coup, il se demanda :
– Mais qu’a-t-il pu fabriquer à Paris ?… C’est inconcevable.
Par menues chiquenaudes, il chassa les miettes de pain tombées dans les plis de son gilet et de son pantalon, rapprocha sa chaise de la cheminée, où des tisons achevaient de se consumer, et, le corps légèrement penché vers le feu, les coudes aux genoux, il se chauffa les mains qu’il frottait, de temps en temps, l’une contre l’autre, en faisant craquer les jointures. Victoire vint desservir, tournant autour de la table, les manches de sa robe retroussées jusqu’au coude ; quand elle fut partie, mon père répéta, accentuant son interrogation :
– Mais, qu’a-t-il pu fabriquer à Paris ?… pendant six ans… sans donner de ses nouvelles, jamais ?… Un prêtre !… C’est bien curieux !… Ça me chiffonne de le savoir.
Je compris qu’il s’agissait de mon oncle, l’abbé Jules. Le matin, mon père avait reçu une lettre de lui, annonçant son très prochain retour. La lettre était brève, ne contenait aucune explication. On y eût vainement cherché une émotion, une tendresse, une excuse de ses longs oublis. Il revenait à Viantais, et se bornait à en informer son frère, par une lettre semblable aux lettres d’avis que les fournisseurs envoient à leurs clients. Mon père avait même remarqué que l’écriture en était plus hargneuse que jamais.
Pour la troisième fois, il s’écria :
– Mais qu’a-t-il pu fabriquer à Paris ?…
Ma mère, le buste droit devant la table, raide, les bras croisés, l’œil vague, hochait la tête. Elle avait une expression de dureté conventuelle, qu’exagérait encore sa robe de sergé noir, plate, sans un ornement, sans une blancheur de lingerie au col et aux poignets.
– Un original de son espèce ! fit-elle… Sûr que ça n’est pas très édifiant !
Et, après un silence, d’une voix sèche, elle ajouta :
– Il aurait bien dû y rester, à Paris… Moi, je n’attends rien de bon de son retour.
Mon père approuva.
– Sans doute !… sans doute !… dit-il ; avec un caractère comme le sien, la vie ne sera pas heureuse, tous les jours !… Oh ! non, par exemple !… Pourtant…
Il réfléchit pendant quelques secondes et reprit :
– Pourtant, il y a un avantage, mignonne, à ce que l’abbé reste près de nous… un avantage considérable… considérable !
Ma mère riposta vivement, en haussant les épaules :
– Un avantage !… Tu crois cela, toi !… D’abord, la famille, il s’en moque, autant que de dire sa messe… A-t-il seulement une pauvre fois envoyé des étrennes au petit, son filleul ?… Quand tu l’as soigné dans sa grande maladie, passant les nuits, négligeant pour lui tes affaires, t’a-t-il seulement remercié ? Tu disais : « Il nous fera un beau cadeau. » Où est-il, son beau cadeau ?… Et les lapins, et les bécasses, et les grosses truites, et tout ce dont on le gavait !… Ce que nous nous sommes privés de bonnes choses pour lui !… Il semblait, en vérité, que cela lui était dû…
– Dame ! voyons, interrompit mon père… on faisait pour le mieux…
– Non, vois-tu, nous avons été des imbéciles, avec lui… C’est un mauvais parent, un mauvais prêtre, un être indécrottable !… S’il revient à Viantais, c’est qu’il ne possède plus rien, qu’il a tout mangé, qu’il est a quia… Et nous l’aurons à notre charge !… Eh bien vrai ! il ne nous manquait plus que ça !
– Allons, allons, mignonne, voilà encore que tu exagères !… S’il revient, mon Dieu, c’est qu’il n’a jamais pu rester en place… C’est un diable !… Il quitte Paris, comme il a quitté l’évêché, où il serait arrivé à tout, comme il a quitté sa cure de Randonnai, où il était si tranquille, où il y avait tant de casuel… Il lui faut du changement, du nouveau… Il ne se trouve à son aise nulle part !… Quant à sa fortune, hé, hé, je ne suis pas du tout de ton avis… Il était joliment avare, l’abbé, joliment pingre, souviens-toi ?
– D’être pingre, mon ami, cela n’empêche point de gaspiller son bien en de sottes manigances… Sait-on quelles lubies traversent des cervelles pareilles ?… Enfin, tu oublies qu’avant de partir pour Paris, l’abbé a vendu sa ferme, vendu ses deux prés, vendu le bois de la Faudière ?… Pourquoi ? Et tout cet argent, où est-il maintenant ?
– Ça, c’est vrai ! dit mon père, devenu subitement rêveur.
– Sans compter qu’il n’est pas aimé dans le pays… qu’il te nuira dans tes élections, peut-être même dans ta clientèle… Ainsi les Bernard, que tu as tant de peine à maintenir, je ne serais pas étonnée qu’ils te lâchent… Dame ! ça se peut !… Et puis, va donc chercher des gens qui soient aussi souvent malades, et qui paient aussi bien !
Mon père se renversa sur le dossier de sa chaise, eut une grimace aux lèvres, se gratta la nuque.
– Oui, oui ! murmura-t-il, à plusieurs reprises… Tu as raison… Ça se peut !
La voix de ma mère prit un ton confidentiel.
– Écoute, je n’ai jamais voulu te le dire, pour ne pas te tourmenter… Mais je tremblais toujours d’apprendre un malheur… Tiens ! Verger, qui a tué l’archevêque, Verger était un prêtre aussi, un fou, un exalté, comme l’abbé Jules…
Mon père se retourna d’un mouvement brusque. Une épouvante était dans ses yeux. Il semblait que, tout d’un coup, son regard eût plongé dans un abîme plein d’horreur. Frissonnant, il balbutia :
– Verger !… qu’est-ce que tu dis là ?… Verger !… sacristi !
– Eh bien ! oui, j’ai souvent pensé à cela… Jamais je n’ouvrais ton journal sans une angoisse au cœur… Est-ce qu’on sait ?… D’abord, dans ta famille, ils sont si originaux, tous !
La conversation cessa, et un grand silence de nouveau s’établit.
Au dehors, le vent sifflait, secouait les arbres, et la pluie s’était remise à tambouriner sur les vitres. Mon père, le visage bouleversé, regardait le feu mourir ; ma mère, songeuse, plus pâle d’avoir tant parlé, avait les yeux perdus dans le vide familier. Et moi, dans cette salle à manger, à moitié baignée d’ombre, dans cette salle, sans meubles, aux murs nus, aux fenêtres pleines de nuit, je me sentais bien seul, bien abandonné, bien triste. Du plafond, des murs, des yeux même de mes parents, un froid tombait sur moi, qui m’enveloppait comme d’un manteau de glace, me pénétrait, me serrait le cœur. J’avais envie de pleurer. Je comparais notre intérieur claustral, renfrogné, avec celui des Servière, des amis chez qui, toutes les semaines, le jeudi, nous allions dîner. Comme j’enviais l’intime et douce chaleur de cette maison, ses tapis caressants, ses murs ornés de tentures consolatrices, ses portraits de famille dans des cadres ovales, ses souvenirs anciens pieusement gardés, tous ces jolis riens épars, qui étaient, chacun, un sourire, la joie constante du regard, la révélation d’une habitude chère ! Pourquoi ma mère n’était-elle pas, comme Mme Servière, gaie, vive, aimante, vêtue de belles étoffes, avec des dentelles et des fleurs à son corsage, et des parfums dans ses cheveux roulés en torsades blondes ? Elle était si charmante, Mme Servière, tout en elle m’attendrissait tellement, que j’aimais à m’asseoir sur les sièges qu’elle venait de quitter, à respirer, à embrasser la place où son corps avait reposé. Pourquoi ne faisais-je pas ainsi avec ma mère ?… Pourquoi n’étais-je pas comme Maxime et comme Jeanne, des enfants de mon âge, qui pouvaient causer, courir, jouer dans les coins, être heureux, et qui avaient de grands livres dorés, dont le père expliquait les images, au milieu des admirations et des rires ?…
Retenant des bâillements, je me tournais, me retournais sur cette exécrable Vie des Saints, qui me servait de siège, sans parvenir à trouver une position qui me contentât. Afin d’intéresser mes oreilles à quelque bruit, mes yeux à quelque spectacle, j’écoutais Victoire qui, derrière la porte, traînait ses sabots sur les dalles de la cuisine, remuait de la vaisselle, et je considérais le rond de lumière jaune qui tremblotait, au plafond, au-dessus de la lampe.
Ce soir-là, mon père oublia d’inscrire sur son agenda les visites et les courses qu’il avait faites, dans la journée, chez des malades ; je remarquai aussi qu’il ne lut point son journal, deux choses que, dans l’ordinaire de la vie, il accomplissait avec une impitoyable régularité.
Pour me distraire un peu, je voulus penser à mon oncle l’abbé, dont le retour avait amené entre mes parents une conversation d’une longueur, d’une vivacité inaccoutumées. J’étais bien petit quand il avait quitté le pays : trois ans à peine, et pourtant je m’étonnais de ne le revoir dans mes souvenirs que comme une chose très incertaine ; car, depuis cette époque, il ne se passait pas de jours qu’on me menaçât de mon oncle, ainsi que d’une sorte de diable noir, d’ogre terrible qui emporte les enfants méchants. Ne m’avait-on pas raconté qu’une fois, jouant dans son jardin de Randonnai, j’étais tombé au beau milieu d’une corbeille de tulipes et que mon oncle, furieux, m’avait cruellement fouetté, avec le martinet qui lui servait à battre ses soutanes. Et lorsqu’il s’agissait de dépeindre vigoureusement la laideur physique ou la laideur morale de quelqu’un, mes parents ne manquaient jamais d’employer cette comparaison : « Il est laid comme l’abbé Jules… sale comme l’abbé Jules… gourmand comme l’abbé Jules… violent comme l’abbé Jules… menteur comme l’abbé Jules. » Si je pleurais, ma mère, pour me faire honte, s’écriait : « Oh ! qu’il est vilain !… Il ressemble à l’abbé Jules ! » Si je commettais un acte de désobéissance : « Continue, continue, mon garçon, tu finiras comme l’abbé Jules. » L’abbé Jules ! c’est-à-dire tous les défauts, tous les vices, tous les crimes, toutes les hideurs, tout le mystère. Très souvent, le curé Sortais venait nous voir, et, chaque fois, il demandait :
– Eh bien ? toujours pas de nouvelles de l’abbé Jules ?
– Hélas ! non, monsieur le curé.
Le curé croisait alors ses mains courtes et potelées sur son gros ventre, dodelinait de la tête d’un air navré.
– Si c’est possible, des choses comme ça !… Pourtant, hier, j’ai encore dit une messe pour lui.
– Il est peut-être mort, monsieur le curé.
– Oh ! s’il était mort, ma petite dame, ça se saurait !…
– Ça vaudrait peut-être mieux, monsieur le curé.
– Peut-être bien, ma petite dame ! La miséricorde de Dieu est si grande !… On ne sait pas ! Mais c’est bien triste pour le clergé, bien triste… bien, bien triste !
– Et pour sa famille aussi, allez, monsieur le curé.
– Et pour le pays ! Et pour tout, pour tout… bien triste, pour tout !
Et le curé humait sa prise en reniflant fortement.
Je me souvenais aussi des histoires de jeunesse de l’abbé que, dans ses jours de bonne humeur, mon père m’avait dites, moitié scandalisé, moitié réjoui. Il les commençait sur un ton sévère, promettait d’en tirer des morales bien senties, puis il se laissait gagner, peu à peu, par la gaîté sinistre de ces farces, et il achevait son récit, dans une quinte de rires, en se tapant la cuisse. Une, entre autres, avait produit sur moi une vive impression. Quelquefois, lorsque je voyais le visage de mon père se dérider un peu, je demandais :
– Petit père, raconte mon oncle Jules et ma tante Athalie.
– As-tu été bien sage, au moins ? As-tu bien appris tes leçons ?
– Oui, oui, petit père. Oh ! t’en prie, raconte.
Et mon père contait :
– Toute petite, ta pauvre tante Athalie, que nous avons perdue, hélas ! était très gourmande ; si gourmande qu’on ne pouvait laisser, à portée de sa main, aucune friandise, qu’elle ne la dévorât. À l’office, elle chipait les restes des fricots ; dans les placards, elle découvrait les pots de confitures, et sauçait ses doigts dedans ; au jardin, elle mordait à même les pommes sur les espaliers, et le jardinier se désespérait, pensant que c’étaient les loirs et les autres bêtes malfaisantes qui causaient ces ravages. Il multipliait les pièges, passait les nuits à l’affût, et ta tante se moquait de lui : « Eh bien, père François, et les loirs ? – Ah ! ne m’en parlez point, mam’zelle, c’est des sorciers, ben sûr… Mais j’les pincerai, tout d’même. » Ce fut ta tante qu’il pinça. On la punit sévèrement, parce que ce sont de vilains péchés que la gourmandise et la désobéissance. Quoiqu’elle fût espiègle – un vrai, petit diable – Athalie ne se portait pas bien. Elle toussait beaucoup, et l’on craignait pour sa poitrine… Afin de la guérir, ta grand’mère lui faisait boire, tous les matins, une cuillerée d’huile de foie de morue. Ça n’est pas bon, l’huile de foie de morue, et, je te l’ai dit, ta tante était gourmande. Pour la décider, il fallait la croix et la bannière. Cependant, au bout de quelques mois, elle se trouva bien de ce régime ; les couleurs lui étaient revenues, sa toux diminuait. Ce qui ne l’a pas empêchée, plus tard, de mourir d’une phtisie pulmonaire. Elle avait des cavernes… Quand on a des cavernes, vois-tu, il n’y a rien à faire : il faut mourir un jour ou l’autre. Et les enfants qui ne sont pas sages, ont toujours des cavernes…
Pour donner sans doute à mon imagination le temps de peser ces paroles prophétiques, mon père avait l’habitude de s’arrêter un instant, à cet endroit de son récit. Il me regardait d’un air affirmatif, se mouchait longuement, et, tandis qu’un petit frisson me secouait le corps, à la pensée que moi aussi, comme ma tante Athalie, je pourrais bien avoir des cavernes, il poursuivait d’une voix joviale :
– Un matin, ton oncle Jules – il avait dix ans, alors – entra, en chemise, chez sa sœur. D’une main, il tenait la bouteille d’huile de foie de morue, de l’autre, un sac de papier rempli de pastilles de chocolat, qu’il avait découvertes, je ne sais où, au fond d’un tiroir. La pauvre petite dormait ; brutalement, il la réveilla. « Allons, bois ta cuillerée ! » lui dit-il. Ta tante, d’abord, refusa : « Bois ta cuillerée, répéta Jules, et je te donnerai une pastille de chocolat. » Il avait ouvert le sac, remuait les pastilles, en prenait des poignées qu’il lui montrait, en claquant de la langue : « C’est bon, lui disait-il, c’est fameusement bon… et il y a de la crème à la vanille… Allons, bois. » Athalie but, en faisant d’horribles grimaces. « Prends-en une autre, maintenant, dit Jules, et je te donnerai deux pastilles, tu entends bien, deux belles pastilles. » Elle but une seconde cuillerée. « Tiens, encore celle-ci, et tu auras trois pastilles. » Elle but une troisième cuillerée… Elle en but quatre, puis six, puis dix, puis quinze, elle but toute la bouteille… Alors ton oncle ne se tint plus de joie. Il dansa dans la chambre, agitant la bouteille vide, criant : « C’est une bonne farce… Ha ! ha ! ha !… quelle bonne farce !… Et tu seras malade, et pendant deux jours, tu vomiras… Ah ! que je m’amuse ! » Ta tante Athalie pleurait, se sentait le cœur tout brouillé. Elle fut malade, en effet, très malade, faillit mourir. Pendant huit jours, elle eut la fièvre et des vomissements, et, deux semaines, elle garda le lit. Ton oncle, lui, fut fouetté ; on le mit au cachot noir, mais il fut impossible de lui arracher un mot de repentir. Au contraire, il ne cessait de répéter : « Elle a vomi, elle a vomi !… Ah ! que je m’amuse ! »
Et mon père, éclatant de rire, concluait :
– Sacré Jules, va !
Ces particularités, incessamment renouvelées, auraient dû graver, pour toujours, les traits d’un tel oncle dans mon esprit d’enfant craintif. Mais non !… Il ne me restait de lui qu’une vision confuse et changeante, à laquelle mon imagination, surexcitée par les récits de ma famille, prêtait mille formes différentes et pénibles. Mon oncle l’abbé ! En me répétant ces mots, tout bas, je voyais se dresser devant moi une figure de fantôme, hérissée, sabrée de grimaces, grotesque et terrible, tout ensemble, et je ne savais pas si je devais m’en effrayer, ou bien en rire. Mon oncle l’abbé ! Je m’efforçai d’évoquer sa véritable physionomie, j’appelai à mon aide toutes les circonstances graves de ma vie, desquelles elle pouvait surgir, éclatante et réelle. Ce fut en vain !… De toute la personne de mon oncle, vague ainsi qu’un vieux pastel effacé, je ne retrouvais qu’un long corps osseux, affaissé dans un fauteuil à oreillettes, avec des jambes croisées sous la soutane, des jambes maigres et sèches, aux chevilles pointues, qui se terminaient par des pieds énormes, carrés du bout, et chaussés de chaussons verts. Autour de lui, des livres ; sur un mur gris, dans une chambre claire, un tableau représentant des personnages à barbes rousses, penchés au-dessus d’une tête de mort. Puis, une voix, dont j’avais encore dans l’oreille le timbre désagréable, une voix sifflante de pneumonique, toujours pleine de gronderies et de reproches irrités. « Polisson ! » par-ci, « polisson ! » par-là. Et c’était tout !
Je n’éprouvais pas un bien vif désir de le revoir, comprenant, instinctivement, qu’il ne m’apporterait pas un élément nouveau d’affection ou d’amusement, certain aussi que je n’avais rien à attendre d’un mauvais parrain qui, lors de mon baptême, avait refusé de payer les dragées, d’offrir un cadeau à ma mère, et ne me donnait jamais d’étrennes, à la nouvelle année, pas même des oranges ! J’avais entendu dire également qu’il ne m’aimait pas, qu’il n’aimait personne, qu’il ne respectait pas le bon Dieu, qu’il était toujours en colère ; et j’eus une serrée au cœur à l’idée qu’il me battrait peut-être, comme autrefois, avec son martinet. Cependant, je ne pouvais me défendre d’une certaine curiosité, qu’avivaient les exclamations de mon père : « Mais qu’a-t-il pu fabriquer à Paris, pendant six ans ? » Ce point d’interrogation me semblait renfermer un impénétrable mystère ; il me faisait voir l’abbé Jules, dans un lointain obscur et grouillant, entouré de formes vagues, et se livrant à des pratiques défendues, dont je souffrais de ne pas connaître le but… En effet, pourquoi était-il parti ?… Pourquoi ne savait-on rien de sa vie, là-bas ?… Pourquoi revenait-il ?… Quelle impression me causerait-il ? Son corps osseux, ses jambes sèches, ses chaussons verts, la bouteille d’huile de foie de morue, les tulipes, le martinet, tout cela dansait, dans ma tête, une éperdue sarabande. À la veille de retrouver cet oncle inquiétant, je ressentais la même peur attractive, qui me prenait les jours de foire, sur le seuil des ménageries et des boutiques de saltimbanques. N’allais-je pas être, tout à coup, en présence d’un personnage prodigieux, incompréhensible, doué de facultés diaboliques, plus hallucinant mille fois que ce paillasse à perruque rouge, qui avalait des sabres et de l’étoupe enflammée, plus dangereux que ce nègre, mangeur d’enfants, qui montrait ses dents blanches dans un rire d’ogre affamé ?… Tout le surnaturel que mon cerveau exalté était capable d’imaginer, je l’associai à la personne de l’abbé Jules, qui, tour à tour, minuscule et géante, se dissimulait comme un insecte, entre les brins d’herbe, et soudain emplissait le ciel, plus massive, plus haute qu’une montagne… Je ne voulus pas réfléchir plus longtemps aux conséquences possibles de l’installation, à Viantais, de l’abbé Jules, car la terreur s’emparait de moi, peu à peu, et mon oncle m’apparaissait, maintenant, avec un nez crochu, des yeux de braise ardente et deux cornes effilées que son front dardait contre moi, férocement.
La lampe filait. Une âcre odeur d’huile brûlée se répandait dans la salle. Mais, chose extraordinaire, personne n’y prenait garde. Mes parents étaient restés silencieux. Ma mère, immobile, les yeux vagues, le front sévère, continuait de rêver ; mon père tisonnait avec rage, écrasait des charbons du bout de la pincette, fouillait la cendre, qui voletait, dans le foyer, en flocons blanchâtres. Et le vent s’apaisait. Les arbres ronflaient doucement, la pluie s’égouttait sur la terre, avec un bruit monotone. Tout à coup, dans le silence, la sonnette de la grille sonna.
– Ce sont les Robin, dit ma mère… Montons dans la chambre.
Elle se leva, prit la lampe, dont elle baissa la mèche, et nous la suivîmes, moi heureux de me dégourdir les jambes, mon père répétant à voix basse :
– Mais qu’a-t-il pu fabriquer à Paris ?
II
Les maisons de Viantais sont bâties, au versant d’un petit coteau, de chaque côté de la route de Mortagne, qui débouche de la forêt, à un kilomètre de là, par une belle trouée dans la futaie, maisons propres et riantes, la plupart de briques, avec des toits hauts et des fenêtres gaiement ornées, l’été, de pots de fleurs et de plantes grimpantes. Quelques-unes attiennent à des jardins symétriquement disposés en plates-bandes et dont le mur qui les enclôt se couvre d’espaliers et s’encadre de vignes. Des venelles, ouvrant de brusques horizons sur les champs, aboutissent à l’unique rue, qui, vers le milieu du bourg, s’élargit en une vaste place, au centre de laquelle une fontaine se dresse ; puis la rue continue de descendre jusqu’à la vallée et la grand’route, franchissant la rivière sur un pont de granit rose, reprend son cours paisible à travers les prés, les cultures et les boqueteaux. Dans le haut du pays, et reliée à lui par une vaste allée d’ormes – rendez-vous des gamins qui jouent à la marelle – l’église apparaît, vieille, tassée, coiffée d’un clocher pointu, en forme de bonnet de coton. À droite, sont les écoles et notre habitation ; à gauche, le presbytère, séparé du cimetière par un mur démoli, creusé en brèches, de-ci, de-là, au-dessus desquelles l’on voit les croix qui se démantibulent et les tombes qui verdissent. Au milieu de l’allée d’ormes, un calvaire s’élève, dont le christ de bois peint, pourri par l’humidité, n’a plus qu’une jambe et qu’un bras, ce qui n’empêche pas les dévotes de venir s’agenouiller au pied de la croix, et de marmotter des oraisons, en égrenant leur chapelet.
À cette époque Viantais comptait deux mille cinq cents habitants, et ne renfermait pas plus de vingt familles bourgeoises et ménages de fonctionnaires. On s’y voyait très peu, même entre parents qui, presque tous, se trouvaient divisés pour de féroces et mesquines considérations de vanité, ou brouillés par des affaires de succession. Nos relations, à nous, se bornaient aux Servière, dont le luxe gênait mes parents, les inquiétait, les mettait en méfiance ; au curé Sortais, vieillard excellent, charitable et compromettant, à cause de l’excessive candeur de son âme, qui l’incitait à commettre sans cesse les plus lourdes bévues ; enfin, aux Robin, devenus tout de suite les intimes de la maison. Nous recevions bien, de loin en loin, la visite du cousin Debray, ancien capitaine d’infanterie, original fieffé, qui passait son temps, mangeait l’argent de sa retraite à empailler des belettes et des putois dans des attitudes comiques et prétentieuses, mais on lui faisait mauvais accueil, parce qu’il ne pouvait prononcer deux mots sans jurer, et qu’il « sentait la bête morte », disait ma mère. Les Robin, dès leur arrivée – ils n’habitaient le pays que depuis quatre ans – s’étaient étroitement liés avec nous. À la première entrevue, nous nous étions reconnus pour des êtres de même race. Comme il n’existait, entre les Robin et ma famille, aucune rivalité d’intérêt ou d’ambition, qu’ils avaient les mêmes instincts, les mêmes goûts, une compréhension pareille de la vie, l’amitié s’établit durable ; amitié d’ailleurs restreinte à la facile observance d’un égoïsme cordial, qui n’eût point résisté aux plus légères secousses du sacrifice et du dévouement.
M. Robin, ancien avoué de Bayeux, avait été, sa charge vendue, nommé juge de paix, à Viantais, grâce à la protection d’un sénateur, dont il parlait sans cesse et à propos de tout, avec enthousiasme. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, vaniteux, solennel et stupide, irréparablement. Au physique, il ressemblait à un singe, à cause de sa lèvre supérieure, un large morceau de peau, bombante et mal rasée, qui mettait une distance anormale entre le nez aplati et la bouche fendue jusqu’aux oreilles. Pour le reste, petit, gras, la face jaune, dans un collier de barbe grisonnante, le ventre rond, les mains poilues. Par une habitude de citadin, qui a beaucoup traîné, des dossiers sous le bras, dans les greffes et les tribunaux, il ne se montrait qu’en chapeau de forme haute, en redingote de casimir noir, en cravate blanche, et aussi en galoches, – la seule concession qu’il eût faite aux mœurs locales. Sans qu’on en connût les raisons historiques, on le disait d’une incorruptibilité presque farouche, – un vieux Romain – et cependant, à la veille des audiences, on voyait entrer chez lui des paysans avec des paniers bondés de volaille et de gibier, qu’ils remportaient vides, à la suite de quelque discussion juridique, sans doute. Ses adversaires politiques eux-mêmes rendaient justice à son indépendance et à sa dignité, bien qu’il les condamnât toujours et de parti pris, au maximum de la peine, quand ils avaient le malheur de paraître à sa barre. Enfin, aucun professeur de droit n’était plus ferré que lui sur le code civil, qu’il pouvait réciter de mémoire, tout entier, dans l’ordre inflexible des articles. Du moins, il aimait à se vanter de ce tour de force, et, quoique très prudent, proposait à qui voulait d’extravagants paris que personne, jusqu’ici, n’avait osé relever, ce qui lui valait une réputation de jurisconsulte phénomène dans tout le canton et au delà. Il savait aussi, de la même manière, les arrêts de la Cour de cassation ; il savait tout. Mais il avait un curieux défaut d’articulation dans la langue. Il prononçait les B comme les D, et les P comme les T. Aussi, c’étaient souvent des combinaisons de mots fort comiques, dont on s’étonnait à l’audience. Un jour, au père Provost, qui s’embarrassait dans une explication, il dit :
– Mon tère Trovost, vous vous endrouillez, vous vous endrouillez.
À quoi le bonhomme avait répondu, tout rougissant :
– Quoi qu’m’chantez là, mossieu l’juge ?… C’est-y des saloperies ?
Cela ne nuisait du reste en rien à son prestige établi de magistrat considérable et d’homme du monde accompli. Il avait même, parmi les plaideurs mécontents, l’honneur d’un sobriquet : on l’appelait le juge Lendrouille.
Quelquefois, M. Robin venait me chercher pour l’accompagner en ses promenades. Et nous allions par les routes. Brusquement, il s’arrêtait, soufflait un instant, et, le buste renversé en arrière, la figure de trois quarts, le geste dominateur, il s’essayait à des éloquences futures.
– Et, Messieurs, clamait-il, que dire de ce jeune homme, élevé chrétiennement tar une famille tieuse, et que les tassions dasses du tlaisir et de l’amdition, ont conduit, jusque sur ce danc d’infamie ?… Oui, Messieurs.
Il s’animait, invoquait la justice, adjurait la loi, prenait Dieu à témoin. Ses bras tournaient sur le ciel, incohérents et rapides, comme des ailes de moulin à vent…
– Oui, Messieurs, la société moderne, dont les dases fondamentales…
Et tandis qu’il parlait, enflant la voix, les oiseaux s’enfuyaient en poussant de petits cris ; les pies effarées gagnaient les branches hautes des arbres. Au loin, les chiens aboyaient.
– Mais tleure donc, mâtin, tleure donc ! me criait M. Robin qui, à bout de souffle, s’affaissait sur la berge de la route et restait là, pendant dix minutes, à s’éponger le front, dans une extase tribunitienne, où il voyait Berryer lui sourire.
En rentrant, il me faisait des recommandations.
– Tu travailleras ton droit, ou ta médecine ; tlus tard, tu iras à Taris… Eh dien !… rattelle-toi, mon ami, qu’il faut être économe… L’économie, vois-tu, tout est là… quand on a l’économie, on a toutes les autres vertus…
Pour la centième fois, il me citait l’exemple d’un jeune homme de Bayeux, à qui son père, très riche industriel, allouait deux mille francs par mois pour vivre à Paris. Le jeune homme se privait de tout, s’habillait et mangeait comme un pauvre, ne sortait jamais, dépensait à peine cent francs par mois, et avec ses économies entassées dans un bas de laine, achetait des actions de chemins de fer et des rentes sur l’État.
– C’est sudlime, ajoutait-il, en me tapotant la joue… C’est sudlime une conduite comme ça… Sois économe, mon garçon. Avec de l’économie, non seulement un sou c’est un sou, mais c’est deux sous, comme dit ma femme qui connaît toutes choses… Et tuis…
Mettant son chapeau sur l’oreille, en casseur d’assiettes, et traçant dans l’air, avec sa canne, de fantastiques moulinets, il concluait gaillardement :
– Et tuis… ça n’emtêche toint qu’on s’amuse, mâtin !… Il faut dien que jeunesse se tasse…
Il appelait cela m’apprendre la vie, et me préparer aux luttes de l’avenir.
Un corps sec, anguleux, très long, un visage rouge où l’épiderme, par endroits, s’exfoliait, un nez en l’air, court, aux narines écartées ; les cheveux d’un blond verdâtre, plaqués en bandeaux minces sur les tempes meurtries, telle était Mme Eustoquie Robin, qui « connaissait toutes choses ». Il était impossible de voir une femme plus disgracieuse. Sa laideur naturelle se compliquait de toutes les manies ridicules dont on eût dit qu’elle prenait plaisir à la souligner. Elle avait, en parlant, une façon aigre et sifflante de détacher chaque syllabe, entre deux aspirations, qui agaçait les nerfs autant que le frottement d’un doigt sur du verre mouillé. Et c’étaient, à chaque mot, des sourires pincés, des trémoussements, des révérences, toute une série de gesticulations gauches et de poses prétentieuses, qui donnaient à son corps l’aspect d’un mannequin désajusté. Obsédée du désir qu’on s’occupât d’elle sans cesse, sans cesse elle se plaignait d’une indisposition à la tête, au ventre, à la poitrine, soupirait, soufflait, et demandait finalement la permission de délacer son corset.
– Ouf ! faisait-elle… Ce n’est pas qu’il me serre trop… Au contraire… Mais tous les soirs, à cette heure-ci, je gonfle, je gonfle du double… C’est très inquiétant… Qu’en pensez-vous, monsieur Dervelle ?
– Un peu de dyspepsie, sans doute, professait mon père… Les fonctions sont bonnes… régulières ?
Et Mme Robin, baissant les yeux, minaudait :
– Mon Dieu, oui… à peu de choses près… C’est-à-dire… Enfin… Ah ! que les médecins ont donc des questions qui dépoétisent, n’est-ce pas, chère madame ?… Vraiment, je n’aimerais pas être médecin… On doit en voir de toutes les couleurs… Et puis, j’ai horreur des malades… Ça me fait l’effet de bêtes !
Je la détestais, ayant eu à pâtir de ses méchancetés. Mme Robin avait deux fils : l’un, Robert, garçon de vingt-trois ans, soldat en Afrique, dont on évitait de parler, et qui jamais ne venait à Viantais ; l’autre, Georges, de deux ans moins âgé que moi, un pauvre être souffreteux et difforme, que sa mère montrait rarement, honteuse de son visage fripé, de ses petites jambes torses, de la faiblesse de ce corps d’enfant tardif et mal venu… Ma figure, qui passait pour jolie, ma santé robuste me donnaient, sur le pitoyable avorton, une supériorité qui m’eût fait l’aimer tendrement. Il était, d’ailleurs, doux et bon, et si résigné ! J’eusse souhaité qu’il devînt le compagnon habituel de mes jeux, heureux de le protéger, de me servir de ma force en faveur de sa débilité. Lui aussi le désirait, je le devinais à son regard implorant, d’où partaient vers moi les élans de son âme, comprimée et plaintive, son regard de prisonnier, avide de soleil et de liberté, son regard nostalgique qui, au travers des fenêtres closes, s’accrochait désespérément au vol des oiseaux, pour monter, porté sur leurs ailes, dans la lumière et dans l’infini… Mais Mme Robin mettait sans cesse entre nous son ombre jalouse, son ombre haute et rêche, comme un mur de pierre. Elle nous séparait, ne permettant pas qu’on pût nous voir l’un à côté de l’autre, car je faisais ressortir davantage la laideur de son fils. Frappée, à la fois, dans son orgueil de mère et dans son amour-propre de femme, elle en voulait à tout ce qui était jeune, beau et vivant ; elle m’en voulait surtout, à moi, de mes joues roses, de mes membres solides, du sang pur et chaud qui coulait sous ma peau. Il semblait que j’avais volé cela à son fils et c’était à moi qu’elle demandait compte de ses déceptions et de ses souffrances. Parfois, elle me marchait sur les pieds, si fort que la douleur m’arrachait des larmes et elle s’excusait, ensuite, de sa maladresse, avec mille tendresses hypocrites. Lorsqu’elle me trouvait seul, elle me souffletait, me bourrait de coups de pied et de coups de poing ; souvent, dans un coin, traîtreusement, elle me pinçait le bras jusqu’au sang, disant d’une voix mielleuse : « Oh ! le chéri ! Oh ! comme il est joli ! », tandis que sur ses lèvres, amincies et desséchées par la haine, un horrible sourire grimaçait. Un dimanche, à la promenade, comme nous longions un remblai très élevé, d’une poussée légère du coude, elle me fit rouler en bas du talus, et l’on me releva, le poignet foulé, la figure déchirée par les ronces, le corps couvert de contusions. Je ne me plaignais pas à mes parents, retenu par la crainte de persécutions plus cruelles et puis, comme Mme Robin ne parlait de moi qu’en termes affectueux et admiratifs, ma mère l’aimait davantage de me tant aimer.
– Allons, mon petit Albert, sois gentil avec Mme Robin… Elle est si bonne pour toi.
Cette recommandation, qui revenait à chaque instant, m’exaspérait, me révoltait dans tous mes sentiments de justice. Mais que faire à cela ? On ne m’eût pas cru ; si j’avais parlé, on m’eût peut-être puni.
Tous les jours, sauf le jeudi, les Robin venaient passer la soirée chez nous. Ma mère et Mme Robin se livraient à des travaux d’aiguille, causaient de leurs affaires de ménage, se lamentaient sur la cherté croissante de la viande.
– Et le pain, qu’on ne taxe plus !… N’est-ce pas une indignité ?… Aussi est-ce étonnant de voir sur le dos de Mme Chaumier, la boulangère, des châles comme nous n’en portons pas, nous autres ?… Dame ! avec notre argent !
Ce mot : l’argent, tintait sur leurs lèvres avec une persistance qui m’agaçait, qui me gênait, autant qu’un mot obscène.
Quant à M. Robin et à mon père, ils jouaient au piquet, très graves, méditatifs, préparant, dans un silence hostile, des capotes formidables et de prodigieux quatre-vingt-dix. Parfois, ils s’entretenaient de politique, tremblaient aux souvenirs sanglants de 1848, s’extasiaient sur les mérites de M. de la Guéronnière, comparaient Jules Favre à Marat.
– Il est venu tlaider une fois, à Dayeux, disait M. Robin… Je l’ai vu… Ah ! mon ami ! quelle effrayante figure il a ! Il fait teur, tositivement… Mais, tar exemtle, soyons justes, il tarle dien… Ce qu’il dit, tout de même, vous savez, c’est envoyé !…
Le dimanche, on organisait une partie de bog, avec le curé Sortais ; et, bien que les enjeux fussent représentés par de modestes haricots, Mme Robin se montrait d’une âpreté farouche, dans le gain, exigeait, au moindre coup douteux, qu’on se référât à la règle écrite. En sa qualité d’homme habitué aux obscurités des exégèses juridiques, M. Robin était chargé d’expliquer, de commenter, de discuter, de juger.
– Le dog, affirmait-il, en prenant la pose auguste d’un président de cour d’assises, le dog n’est toint comme le code… Cetendant, il est dien évident que les rattorts, les rattrochements, et je dirai même, les analogies…
Finalement, il tranchait toujours les difficultés, en faveur de sa femme.
Sous prétexte qu’ils n’avaient rien trouvé de convenable, pour s’installer avec leurs meubles, restés à Bayeux, sous la garde d’une tante, les Robin occupaient provisoirement le premier étage d’une maison que leur louaient les demoiselles Lejars, deux vieilles filles, riches et dévotes, grosses et roulantes, toutes deux vêtues de même façon, toutes deux pourvues d’un goître monstrueux – une des curiosités de Viantais. L’appartement était triste, petit, réduit aux meubles indispensables. Les Robin n’avaient pas de domestiques et ne recevaient point.
– Comment voulez-vous, s’excusait Mme Robin, que nous forcions nos amis à venir dans un taudis pareil ?… Mais quand nous aurons une maison, quand nous aurons nos meubles !… Alors !
Ses réticences, et le regard et le balancement de tête qui les accompagnaient, cachaient des promesses de fêtes inouïes, de dîners extraordinaires, insoupçonnés dans le pays. Il y avait, dans ce « quand nous aurons nos meubles », prononcé sur un ton de voix mystérieux et revendicatif, tout un jaillissement de lumières versicolores, tout un éblouissement d’argenterie, de cristaux, de porcelaines ; on y voyait s’allumer la flamme rouge des vins rares, défiler des pièces parées, s’ériger des architectures odorantes de biscuits et de nougats, se balancer des grappes de fruits dorés, ce qui faisait dire à des gens de Viantais :
– Oh ! les Robin !… Il paraît que personne ne sait recevoir comme eux… Vous verrez ça quand ils auront leurs meubles.
On les consultait sur des questions d’étiquette, sur « ce qui se fait » et sur « ce qui ne se fait pas », sur l’ordonnance symbolique du dessert, étude grave et passionnante. Chaque fois qu’ils acceptaient à dîner chez nous, M. Robin s’écriait :
– Oh ! nous vous en devons, des dîners !… nous vous en devons plus de cent !… C’est honteux !… Mais quand nous aurons nos meudles…
On parlait alors de ces meubles fameux, pour qui les maisons de Viantais étaient ou trop grandes ou trop petites, ou trop sombres, ou trop claires, ou trop au soleil, ou trop humides. Mme Robin racontait les splendeurs de sa chambre à coucher, en reps bleu ; du salon, en damas jaune. Elle disait sa lingerie, brodée de rouge ; sa verrerie relevée de filets dorés ; son service à café, tout en chine, dont on ne se servait jamais, étant trop fragile, et qui ornait la vitrine de son buffet-bibliothèque en acajou. M. Robin, lui, s’étendait sur la magnificence de sa cave à liqueurs, qui contenait « un comtartiment tour les cigares » et de son bureau, « un dureau en chêne sculpté et à secret ».
– Enfin, répétait-il, vous verrez tout ça, quand nous aurons nos meudles !
La vérité, c’est que les Robin, confiants dans les promesses du sénateur, attendaient un avancement prochain, et ne voulaient pas payer les frais de deux déménagements. Ils attendirent douze ans, dans la maison des demoiselles Lejars et, durant ces douze années, ils ne cessèrent de s’excuser, à chaque invitation nouvelle.
– Oh ! nous vous en devons, des dîners !… C’est honteux vraiment !… Mais quand nous aurons nos meubles !…
Ma mère ne s’était pas trompée. C’étaient bien les Robin qui avaient sonné à la grille. Ils arrivèrent, lui, soufflant, sa figure enfouie dans le triple tour d’un cache-nez à carreaux noirs et blancs ; elle, minaudant sous une capeline de laine rouge, qu’ornait un large ruban de velours noir.
– Quel temps ! mes amis, s’exclama M. Robin, qui s’ébrouait ainsi qu’un vieux cheval, quel temps !… Et le daromètre daisse toujours.
Mme Robin arrondit la bouche, prit un air affectueux et navré.
– Nous nous disions, tout à l’heure, mon mari et moi, en dînant : « Pourvu que ce pauvre monsieur Dervelle n’ait pas été obligé d’aller voir des malades, par un temps pareil !… » Pauvre monsieur !… Quel dur métier… la nuit… Il fait si noir !…
– Le fait est, déclara mon père, que ça n’encourage pas, des temps comme ça !… Mais qu’est-ce que vous voulez ?… Quand il faut, il faut !… Et pas toujours sûr d’être payé, voilà le triste ! D’abord, les pauvres… ce sont les plus exigeants !
– Tardleu ! lança M. Robin… ils ne regardent toint à la détense des autres… hé ! hé ! hé !
Ma mère aidait Mme Robin à se débarrasser de sa capeline et de son manteau.
– Et votre petit Georges ? demanda-t-elle… vous ne l’avez pas encore amené ?