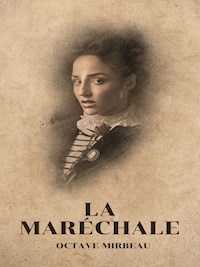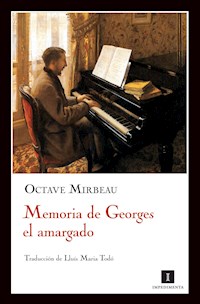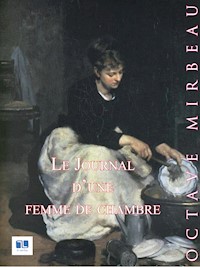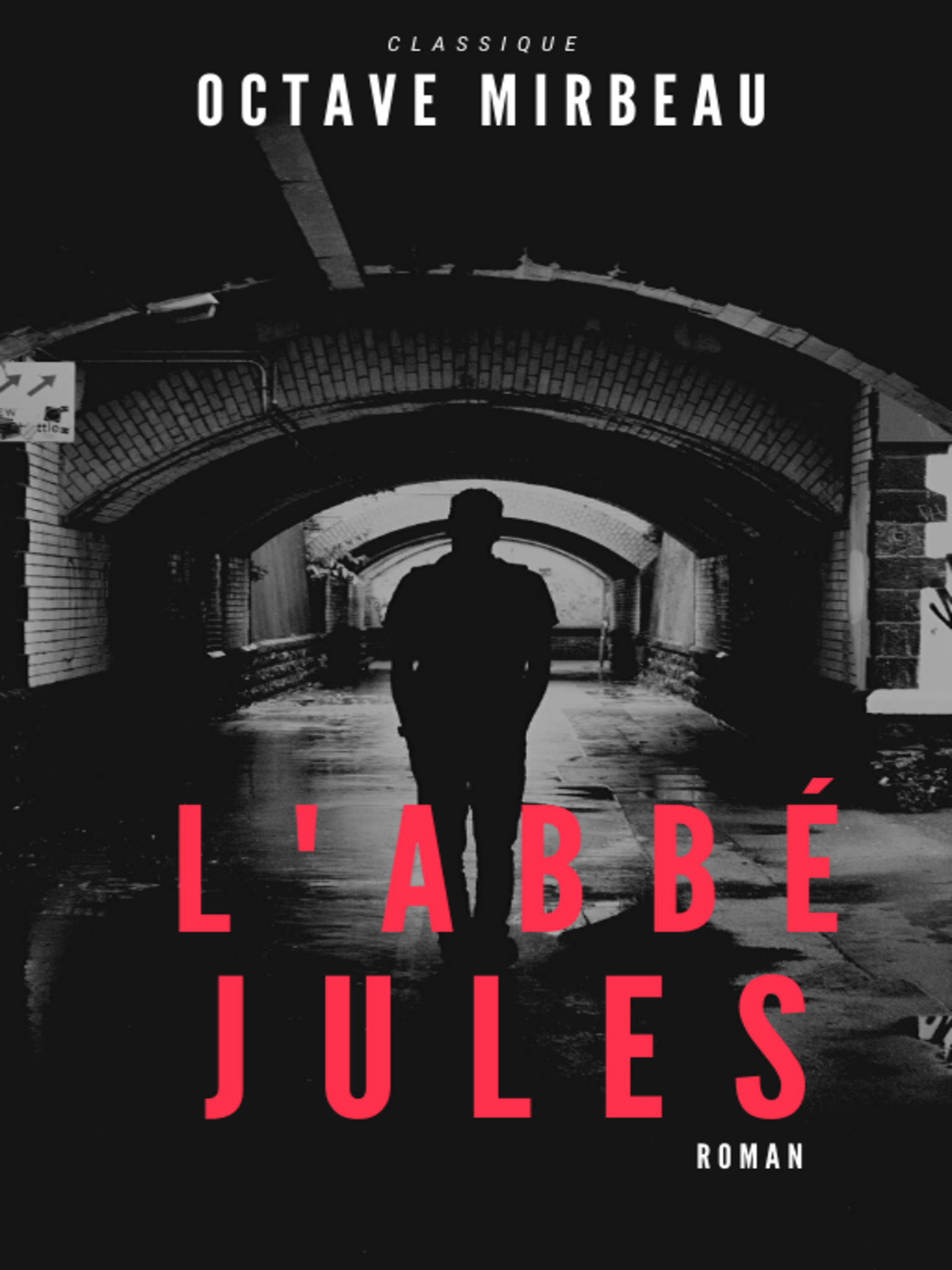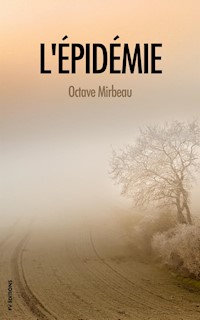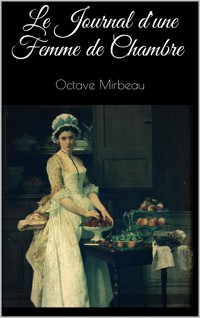3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1862, Sébastien est envoyé par son père, quincaillier, au collège de jésuites de Vannes. S'il est désespéré d'abandonner son monde familier et son amie Marguerite, il est aussi soulagé d'en quitter la médiocrité. Mais tout de suite il se sent rejeté par ses camarades, tous riches et nobles. Il finit cependant par s'habituer aux brimades et, après l'échec d'une amitié avec un jeune aristocrate, se lie avec Bolorec, élève renfermé et révolté. Deux années se sont écoulées. Le jeune père de Kern s'intéresse à l'éducation de Sébastien. Mais son dévouement cache de noirs desseins: une nuit, il le viole... Dans ce roman d'inspiration autobiographique, Mirbeau s'attaque aux jésuites, à l'armée et, au-delà, à tout ce qui provoque une soumission de l'esprit au dogme et à l'arbitraire. Cette dénonciation n'est pas vraiment sous-tendue par une analyse idéologique, mais plutôt par l'affectivité. Elle se situe plus au niveau «des tripes», c'est une révolte primaire devant le viol, viol de l'esprit qui se terminera par un viol physique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sébastien Roch
Sébastien RochLIVRE PREMIERIIIIIIIVVVIVIILIVRE DEUXIÈMEI. 2II. 2III. 2IV. 2Page de copyrightSébastien Roch
Octave Mirbeau
Au
maître vénérable et fastueux du livre moderne
à
EDMOND DE GONCOURT
ces pages sont respectueusement dédiées
O. M.
LIVRE PREMIER
I
L’école Saint-Francois-Xavier, que dirigeaient, que dirigent encore les Pères Jésuites, en la pittoresque ville de Vannes, se trouvait, vers 1862, dans tout l’éclat de sa renommée. Aujourd’hui, par un de ces caprices de la mode qui atteignent et changent la forme des gouvernements, des royautés féminines, des chapeaux et des collèges, bien plus que par les récentes persécutions politiques, lesquelles n’amenèrent qu’un changement de personnel vite rétabli, elle est tombée au niveau d’un séminaire diocésain quelconque. Mais, à cette époque, il en existait peu, soit parmi les congréganistes, soit parmi les laïques, d’aussi florissantes. Outre les fils des familles nobles de la Bretagne, de l’Anjou, de la Vendée, qui formaient le fond de son ordinaire clientèle, la célèbre institution recevait des élèves de toutes les parties de la France bien-pensante. Elle en recevait même de l’étranger catholique, d’Espagne, d’Italie, de Belgique, d’Autriche, où l’impatience des révolutions et la prudence des partis forcèrent jadis les Jésuites de se réfugier, et où ils ont laissé d’inarrachables racines. Cette vogue, ils la tenaient de leur programme d’enseignement, réputé paternel et routinier ; ils la tenaient surtout de leurs principes d’éducation, qui offraient d’exceptionnels avantages et de rares agréments : une éducation de haut ton, religieuse et mondaine à la fois, comme il en faut à de jeunes gentilshommes, nés pour faire figure dans le monde, et y perpétuer les bonnes doctrines et les belles manières.
Ce n’était point par hasard que les Jésuites, à leur retour de Brugelette, s’étaient installés, en plein cœur du pays armoricain. Aucun décor de paysage et d’humanité ne leur convenait mieux pour pétrir les cerveaux et manier les âmes. Là, les mœurs du moyen âge sont encore très vivantes, les souvenirs de la chouannerie respectés comme des dogmes. De tous les pays bretons, le taciturne Morbihan est demeuré le plus obstinément breton, par son fatalisme religieux, sa résistance sauvage au progrès moderne, et la poésie, âpre, indiciblement triste de son sol qui livre l’homme, abruti de misères, de superstitions et de fièvres, à l’omnipotente et vorace consolation du prêtre. De ces landes, de ces rocs, de cette terre barbare et souffrante, plantée de pâles calvaires et semée de pierres sacrées, émanent un mysticisme violent, une obsession de légende et d’épopée, bien faits pour impressionner les jeunes âmes délicates, les pénétrer de cette discipline spirituelle, de ce goût du merveilleux et de l’héroïque, qui sont le grand moyen d’action des Jésuites, et par quoi ils rêvent d’établir, sur le monde, leur toute-puissance… Les prospectus de l’établissement – chefs-d’œuvre typographiques – ornés de dessins pieux, de vues affriolantes, de noms sonores, de prières rimées et de certificats hygiéniques, ne tarissaient pas d’éloges sur la supériorité morale du milieu breton, en même temps qu’une description lyrique des paysages et des monuments excitait la passion des archéologues et la curiosité des touristes. Entre de glorieuses évocations de l’histoire locale, de ses luttes, de ses martyres, ces prospectus avertissaient aussi les familles que, par une grâce spéciale, due à la proximité de Sainte-Anne-d’Auray, les miracles n’étaient pas rares, au collège, principalement vers l’époque du baccalauréat, que les élèves prenaient des bains de mer sur une plage bénite, et qu’ils mangeaient de la langouste, une fois par semaine.
Devant un tel programme, et malgré la modestie de sa condition, M. Joseph-Hippolyte-Elphège Roch, quincaillier à Pervenchères, petite ville du département de l’Orne, osa concevoir l’orgueilleuse pensée d’envoyer, chez les Jésuites de Vannes, son fils Sébastien qui venait d’avoir ses onze ans. Il s’en fut trouver le curé qui approuva chaudement.
– Cristi ! Monsieur Roch, c’est une crâne idée… Quand on sort de ces maisons-là, voyez-vous ?… Mazette !… Quand on sort de là !… Puu… ut !…
Et, prolongeant en sifflement le son de cette exclamation qui lui était familière, il traça dans l’air, avec son bras, un geste dont l’amplitude embrassait le monde.
– Hé ! parbleu !… je le sais bien, acquiesça M. Roch qui répéta, en l’élargissant encore, le geste du curé. Hé ! parbleu !… à qui le dites-vous ?… Oui, mais c’est très cher ; c’est trop cher…
– C’est trop cher ?… riposta le curé… Ah ! dame… Écoutez donc… Toute la noblesse, toute l’élite… Ça n’est pas non plus de la petite bière, ça, Monsieur Roch !… Les Jésuites… Bigre ! ne confondons pas, je vous prie, autour avec alentour… Ainsi, moi, j’ai connu un général et deux évêques… Eh bien, ils en venaient… voilà !… Et les marquis, mon cher monsieur, y en a ! y en a !… Vous comprenez, ça se paie, ces choses-là !…
– Hé ! parbleu ! Je ne dis pas non… protesta M. Roch, ébloui… Évidemment, ça doit se payer !
Il ajoute, en se rengorgeant :
– D’ailleurs où serait le mérite ?… Car enfin, soyons justes… C’est comme moi, Monsieur le curé… Une belle lampe, n’est-ce pas ? je la vends plus cher qu’une vilaine…
– Voilà la question ! résuma le curé qui tapota l’épaule de M. Roch à menus coups, affectueux et encourageants… Vous avez, mon cher paroissien, mis le doigt sur la question… Les Jésuites !… Bigre ! ça n’est pas rien !
Longtemps, ils se promenèrent, judicieux et prolixes, sous les tilleuls du presbytère, préparant à Sébastien un avenir splendide. Le soleil gouttelait d’entre les feuilles, sur leurs vêtements et sur les herbes de l’allée. L’air était lourd. Lentement, les mains croisées derrière le dos, ils marchaient, s’arrêtant, tous les cinq pas, très rouges, en sueur, l’âme remplie de rêves grandioses. Un petit chien les suivait qui, derrière eux, trottinait en boitant et tirait la langue. M. Roch répéta :
– Quand on a les Jésuites dans sa manche, on est sûr de faire son chemin !
Sur quoi, le curé appuya de son enthousiasme :
– Et quel chemin !… Car ce qu’ils ont le bras long, ces messieurs !… On ne peut pas… non, on ne peut pas s’en faire une idée.
Et sur un ton de confidence, il murmura d’une voix qui tremblait de respect et d’admiration :
– Et puis, vous savez… On dit qu’ils mènent le pape… Tout simplement !
Sébastien, en faveur de qui s’agitaient ces projets merveilleux, était un bel enfant, frais et blond, avec une carnation saine, embue de soleil, de grand air, et des yeux très francs, très doux, dont les prunelles n’avaient jusqu’ici reflété que du bonheur. Il avait la viridité fringante, la grâce élastique des jeunes arbustes qui ont poussé, pleins de sève, dans les terres fertiles ; il avait aussi la candeur introublée de leur végétale vie. À l’école où il allait, depuis cinq ans, il n’avait rien appris, sinon à courir, à jouer, à se faire des muscles et du sang. Ses devoirs bâclés, ses leçons vite retenues, plus vite oubliées, n’étaient qu’un travail mécanique, presque corporel, sans plus d’importance mentale que le saut du mouton ; ils n’avaient développé, en lui, aucune impulsion cérébrale, déterminé aucun phénomène de spiritualité. Il aimait à se rouler dans l’herbe, grimper aux arbres, guetter le poisson au bord de la rivière, et il ne demandait à la nature que d’être un perpétuel champ de récréation. Son père, absorbé tout le jour par les multiples détails d’un commerce bien achalandé, n’avait pas eu le temps de semer, en cet esprit vierge, les premières semences de la vie intellectuelle. Il n’y songeait pas, aimant mieux, aux heures de loisir, prononcer des discours aux voisins assemblés devant sa boutique. Majestueux et hanté de transcendantales sottises, jamais, du reste, il n’eût consenti à descendre jusqu’aux naïves curiosités d’un enfant. Il faut dire, tout de suite, qu’il eût été l’homme le plus embarrassé du monde, car son ignorance égalait ses prétentions, lesquelles étaient infinies. Un soir d’orage, Sébastien désira savoir ce que c’était que le tonnerre : « C’est le bon Dieu qui n’est pas content », expliqua M. Roch, interloqué par cette brusque question qu’il n’avait pas prévue. À plusieurs autres interrogations qui mettaient, chaque fois, sa science en défaut, il se tirait d’affaire, avec cet invariable aphorisme : « Il y a des connaissances auxquelles un gamin de ton âge ne doit pas être initié. » Sébastien s’en tenait là, ne se sentant pas le goût de fouiller le secret des choses, ni de continuer cette vaine incursion à travers le domaine moral. Et il était retourné à ses jeux, sans en demander plus. À l’âge où le cerveau des enfants est déjà bourré de mensonges sentimentaux, de superstitions, de poésies déprimantes, il eut la chance de ne subir aucune de ces déformations habituelles, qui font partie de ce qu’on appelle l’éducation de la famille. En grandissant, loin de s’étioler, sa peau se colora d’un sang plus vif ; loin de se raidir, ses membres sans cesse en mouvement s’assouplirent, et ses yeux gardèrent cette expression profonde, qui est comme le reflet des grands espaces, et qui met de l’infini au mystérieux regard des bêtes. Mais on disait, dans le pays, que pour le fils d’un homme aussi spirituel, aussi savant, aussi à son aise que M. Roch, il était bien en retard, et que c’était bien malheureux. Le père ne s’en inquiétait pas. Il ne pouvait entrer dans sa pensée qu’un enfant, sorti de sa propre chair, pût mentir à sa naissance et manquer aux destinées brillantes qui l’attendaient.
– Comment m’appellé-je ? interrogeait-il parfois, en plongeant dans les yeux de Sébastien un regard dominateur.
– Joseph, Hippolyte, Elphège, Roch, répondait l’enfant sur le ton d’une leçon récitée.
– Souviens-toi toujours de cela… Aie sans cesse présent à l’esprit mon nom… le nom des Roch… et tout ira bien. Répète un peu.
Et d’une voix précipitée, mangeant la moitié des syllabes, le petit Sébastien recommençait :
– J’seph… p’lyte… phège Roch !
– Allons… c’est très bien ! complimentait le quincaillier, satisfait d’entendre un nom qu’il trouvait beau et magique comme un talisman.
M. Roch habitait, dans la rue de Paris, une maison reconnaissable à ses deux étages, et à son magasin, peint en vert foncé, réchampi de larges filets rouges. Derrière les glaces de la devanture, reluisaient des cuivreries, des lampes en porcelaine, des irrigateurs richement bronzés, dont les tuyaux de caoutchouc, déroulés en guirlandes, formaient avec les bouillottes, les couronnes tombales, les abat-jour dentelés, les soufflets en cuir rouge, cloutés d’or, des motifs de décoration ingénieux et séducteurs. Il tirait grande vanité de cette maison, la seule de la rue qui eût deux étages et fût couverte en ardoise, ainsi que de ce magasin, le seul du pays qui montrât, inscrite sur un fond de marbre noir, une enseigne éblouissante, aux lettres dorées et en relief. Les voisins enviaient l’air de supériorité et de confortable rare que donnaient, à cette habitation luxueuse, la façade, crépie de deux tons de jaune, et les fenêtres, encadrées de moulures historiées, d’une blancheur crue de plâtre neuf. Mais ils en étaient fiers pour la ville. M. Roch n’était point, d’ailleurs, un individu quelconque, et faisait honneur au pays, autant par son caractère que par sa maison. Il jouissait à Pervenchères d’une situation privilégiée. Sa réputation d’homme riche, ses qualités de beau parleur et l’orthodoxie de ses opinions le mettaient au-dessus de l’état d’un commerçant ordinaire. La bourgeoisie fusionnait avec lui, sans crainte de déchoir, les fonctionnaires les plus importants s’arrêtaient volontiers, au seuil de sa boutique, et causaient avec lui, sur « le pied d’égalité » ; chacun, selon son rang, lui marquait l’amitié la plus cordiale, ou la considération la plus respectueuse.
M. Roch était gros et rond, soufflé de graisse rose, avec un crâne tout petit que le front coupait carrément en façade plate et luisante. Le nez, d’une verticalité géométrique, continuait, sans inflexions ni ressauts, entre des joues, sans ombres ni plans, la ligne rigide du front. Un collier de barbe reliait, de sa frange cotonneuse, les deux oreilles, vastes, profondes, inverties et molles comme des fleurs d’arum. Les yeux, enchâssés dans les capsules charnues et trop saillantes des paupières, accusaient des pensées régulières, l’obéissance aux lois, le respect des autorités établies, et je ne sais quelle stupidité animale, tranquille, souveraine, qui s’élevait parfois jusqu’à la noblesse. Ce calme bovin, cette majesté lourde de ruminant en imposaient beaucoup aux gens qui croyaient y reconnaître tous les caractères de la race, de la dignité et de la force. Mais ce qui lui conciliait, mieux encore que ces avantages physiques, l’universelle estime, c’est que, opiniâtre liseur de journaux et de livres juridiques, il expliquait des choses, répétait, en les dénaturant, des phrases pompeuses, que ni lui, ni personne ne comprenait, et qui laissaient néanmoins, dans l’esprit des auditeurs, une impression de gêne admirative.
Sa conversation avec le curé l’avait fort excité. Toute la journée, il demeura plus grave que de coutume, plus préoccupé, distrait de sa besogne par une foule de pensées tumultueuses qui se livraient dans son crâne à de trop rudes combats. Le soir, après le dîner, il retint, longtemps, auprès de lui, le petit Sébastien qu’il observait à la dérobée, d’un air profond, sans lui parler de rien. Il dit seulement le lendemain, à quelques clients notables, sur un ton de confidence : « Peut-être se passera-t-il, ici, bientôt, un événement important. Attendez-vous à une grosse nouvelle. » Si bien que, rentrés chez eux, les gens intrigués se livraient aux plus improbables conjectures. De maison en maison, le bruit courut que M. Roch allait se remarier. Il fut obligé de dissiper cette erreur flatteuse, et de mettre Pervenchères au courant de ses projets. D’ailleurs, quoiqu’il aimât à accaparer la curiosité publique par de petits mystères ingénieux, qui amenaient des commentaires et des discussions sur sa personne, il n’était point homme à garder, de longs jours, un secret dont il pouvait tirer un hommage direct et prompt. Mais il ajouta :
– C’est un simple projet… il n’y a rien de fait encore… Je réfléchis, je pèse, je compare.
Deux raisons puissantes l’encourageaient dans le choix dispendieux qu’il avait fait du collège de Vannes : l’intérêt de Sébastien qui recevrait là une instruction « cossue », et ne pouvait manquer d’être façonné à de grandes choses ; sa propre vanité, surtout, qui serait délicieusement caressée, quand on dirait, en parlant de lui : « C’est le père du petit jeune homme qui est aux Jésuites. » Il accomplissait un devoir, plus qu’un devoir, un sacrifice dont il entendait bien écraser son fils, et se parer aux yeux de tous. En même temps, il augmentait notablement sa considération locale. C’était tentant. Cela méritait aussi de graves, de longues réflexions, car M. Roch ne pouvait jamais se résigner à prendre un parti avec simplicité. Il fallait qu’il tournât et retournât les choses sous toutes leurs faces, qu’il les étudiât sous tous leurs angles, et que, finalement, il se perdît dans une série de complications absurdes, lointaines, inextricables, tout à fait étrangères au sujet. Quoiqu’il connût, à un centime près, sa fortune, il voulut établir sa caisse à nouveau, repasser ses inventaires, vérifier minutieusement l’état de ses revenus. Il fit des comptes, équilibra des budgets, se posa des objections irréfutables, les réfuta par d’irréfutables raisonnements. Et ce furent les paroles du curé, qui toujours résonnaient à ses oreilles : « Et les marquis !… Y en a ! Y en a ! », bien plus que la bonne situation de ses affaires, qui achevèrent de le décider. En écrivant au Père recteur du collège de Vannes, il lui sembla qu’il entrait de plainpied dans l’armorial de France.
Mais ce n’était point aussi facile qu’il l’avait tout d’abord supposé, et son amour-propre fut soumis à de dures épreuves. Les Révérends Pères, en pleine vogue, obligés, chaque vacance, d’agrandir leur établissement, se montraient sévères dans le choix des élèves, et quelque peu dégoûtés. En principe, ils n’admettaient à l’internat que les fils de nobles et de ceux-là dont la position sociale pût faire honneur à leur palmarès. Pour le reste, pour le menu fretin des bourgeoisies obscures et mal rentées, ils demandaient à réfléchir ; après quoi, ayant réfléchi, ils ne demandaient, le plus souvent, qu’à s’abstenir, sauf, bien entendu, lorsqu’on leur présentait un petit prodige, qu’ils s’attribuaient généreusement, en vue des prospectus à venir. M. Joseph-Hippolyte-Elphège Roch – bien qu’il passât pour riche, à Pervenchères – n’était point dans le cas des privilégiés de la fortune, des hors concours de la naissance ; quoique marguillier, il était notoirement classé « parmi le reste » ; et Sébastien n’annonçait, en rien, un prodige. Une première année, les Jésuites opposèrent aux démarches réitérées de M. Roch des objections spécieuses et polies… l’encombrement… l’extrême jeunesse de l’élève… et toute la série dilatoire des : « Ne craignait-il pas ? »… Ce fut une cruelle déception pour le vaniteux quincaillier. Si les Jésuites refusaient de prendre son fils, qu’allait-on penser de lui, à Pervenchères ? Sa situation s’en trouverait sûrement diminuée. Déjà il croyait reconnaître des regards ironiques dans les yeux de ses amis, qui lui demandaient : « Hé bien !… Vous gardez donc Sébastien ? » Il faisait bonne contenance, et répondait : « Vous savez, ce n’est qu’un projet… Il n’y a rien de fait encore. Je réfléchis, je pèse, je compare… Et puis les Jésuites !… Hé !… Hé !… Je me tâte… J’ai peur qu’on exagère… Là, vraiment, n’exagère-t-on pas ? » Mais il avait la mort dans l’âme. Il est probable que le pauvre Sébastien en eût été réduit à pomper la vie intellectuelle aux vulgaires et coriaces tétines des séminaires diocésains, ou des lycées départementaux, si, son père, en des lettres mémorables, ne s’était vigoureusement réclamé de la glorieuse histoire de sa famille, sous la Révolution.
Il expliqua, qu’en 1786, le comte du Plessis-Boutoir, dont le vaste domaine occupait tout le pays de Pervenchères et les communes circonvoisines, voulant être agréable à Dieu, ainsi que l’atteste une plaque commémorative de marbre noir, restaura de ses deniers l’église paroissiale, construction romane du douzième siècle, connue pour le beau tympan sculpté de sa porte et l’admirable ordonnance de ses arcatures. Le comte amena de Paris des tailleurs de pierre, parmi lesquels se trouvait un jeune homme, du nom de Jean Roch, originaire de Montpellier, et, d’après des probabilités flatteuses, mais malheureusement non établies, descendant de saint Roch qui vécut et mourut en cette ville. Ce Jean Roch fut, à n’en pas douter, un ouvrier d’un rare mérite. On lui doit la réfection de deux chapiteaux représentant le massacre des Innocents, et celle des animaux symboliques qui ornent le portail. Il s’installa dans le pays, s’y maria, car c’était un homme rangé, fonda la dynastie actuelle des Roch, exécuta divers travaux importants, entre autres le chœur de la chapelle de la Vierge, qu’on peut voir au couvent des Dames de l’Éducation chrétienne, et qui est considéré, par les connaisseurs, comme une merveille d’art. En 1793, les révolutionnaires, armé de pioches et de torches enflammées, tentèrent de démolir l’église que Jean Roch, soutenu par quelques compagnons seulement, défendit. Capturé, tout sanglant, après une lutte héroïque, les bandits l’attachèrent à califourchon sur un âne, le visage tourné vers la croupe et, dans la main, la queue de l’animal, en guise de cierge. Ensuite, ils le lâchèrent, lui et son âne, à travers les rues, où tous les deux furent massacrés à coups de bâton. Et M. Roch, rappelant chaque détail de la tragique mort de cet ancêtre martyr, qu’il comparait à Louis XVI, à la princesse de Lamballe, à Marie-Antoinette, suppliait les Jésuites d’avoir égard à de « tels antécédents et références » qui lui constituaient une véritable noblesse. Il expliqua encore que, si Jean Roch n’avait point été supplicié en pleine vigueur de talent – ce dont il était loin de se plaindre, d’ailleurs –, Robert-Hippolyte-Elphège Roch, son fils, fondateur de la maison de quincaillerie, et Joseph-Hippolyte-Elphège Roch, le soussigné, son petit-fils, qui continua le commerce, n’eussent point végété en d’obscurs métiers, où ils s’étaient efforcés, toutefois, par leur probité, leur amour de Dieu, leur fidélité aux anciennes croyances, de glorifier les traditions de l’aïeul vénéré. Et ce fut l’histoire de sa propre existence, contée avec des amertumes grandioses et des navrements comiques : les aspirations de sa jeunesse, étouffées par un père très pieux, il est vrai, mais avare et borné ; ses résignations dans un travail indigne de lui ; les courtes joies de son mariage ; les douleurs de son veuvage ; l’effroi de ses responsabilités paternelles ; enfin l’espérance – qu’un refus détruirait – de voir revivre, en son fils, les nobles ambitions défuntes, les beaux rêves envolés, car M. Roch avait rêvé d’être fonctionnaire. Ces récits, ces supplications, coupés de parenthèses, et noyés en une incroyable phraséologie, vainquirent les primitives répugnances des bons Pères, qui consentirent enfin l’année suivante, à se charger de l’éducation de Sébastien.
Le matin qu’il en eut la nouvelle, M. Roch éprouva une des plus fortes joies de sa vie. Mais il avait la joie austère. Chez cet homme grave, si grave que personne ne pouvait se vanter de l’avoir vu rire ou sourire, la joie ne se manifestait que par un redoublement de gravité, et une particulière contraction de la bouche qui lui donnait l’air de pleurer. Il commença par sortir dans la rue, la tête haute, s’arrêta de porte en porte, éblouissant les voisins de ses racontars sentencieux, de ses savantes exégèses sur la Société de Jésus. Les bouches étaient béantes d’étonnement respectueux. On l’entoura, fier de l’entendre discourir sur saint Ignace de Loyola, dont il parlait comme s’il l’eût connu familièrement. Et c’est escorté d’amis nombreux qu’il se rendit d’abord au presbytère, où s’échangèrent d’interminables congratulations, puis chez sa sœur, Mlle Rosalie Roch, vieille fille, paralysée des deux jambes, acariâtre, méchante, avec laquelle il se disputa plus que de coutume, en raison de l’heureux événement qu’il lui annonçait.
– Oui ! je te reconnais bien là, cria-t-elle… Toujours péter plus haut que le derrière !… Eh bien, je te le dis, tu feras le malheur de ton fils, avec tes bêtes d’idées !…
– Taisez-vous, vieille sotte !… Vous ne savez pas ce que vous dites !… D’abord, pour parler comme vous faites, savez-vous ce que c’est que les Jésuites ?… où donc auriez-vous appris cela ?… Eh bien, demandez-le au curé ; il le sait peut-être mieux que vous, lui !… Le curé vous dira que les Jésuites sont une puissance, il vous dira qu’ils mènent le pape…
– Mais tu ne vois donc pas, pauvre imbécile, que c’est pour se moquer de toi qu’on te met ces stupidités dans la tête… D’abord tu es donc bien riche ? Où donc as-tu volé tout cet argent ?
– Cet argent ?…
Et M. Roch se redressa, la taille plus haute, le verbe plus grave.
– Cet argent !… prononça-t-il avec lenteur… Je l’ai gagné par mon travail, par mon in-tel-li-gen-ce !… par mon in-tel-li-gen-ce !… entendez-vous ?
De retour en sa boutique, ayant retiré son habit et passé le tablier de travail en cotonnade grise, il appela Sébastien à qui, tout en triant des pitons de cuivre, il adressa un discours pompeux. M. Roch, naturellement éloquent et dédaigneux des familiarités de la conversation, ne s’exprimait jamais que par solennelles harangues.
– Écoute-moi, ordonna-t-il… et retiens bien ce que je vais te dire, car nous touchons à une heure grave de ta vie… une heure décisive… ce que j’appelle… Écoute-moi bien…
Il était plus majestueux qu’à l’ordinaire, sur ce fond sombre de magasin, rempli de ferrailles, où des marmites bombaient leurs ventres noirs, où des casseroles de cuivre luisaient, l’auréolant parfois de leur ronde clarté ménagère… Et l’ampleur de ses gestes interrompant le triage des pitons, faisait bouffer sa chemise, dans l’intervalle du gilet au pantalon.
– Je ne t’ai pas mis au courant des négociations entamées entre les Révérends Pères Jésuites de Vannes et moi, débutat-il… Il y a des choses auxquelles un enfant de ton âge ne doit pas être initié… Ces négociations…
Il appuyait sur ce mot qui l’ennoblissait à ses propres yeux, qui lui attribuait l’importance d’un diplomate traitant une question de paix ou de guerre… Et sa voix faisait un bruit de gargarisme qu’il prenait plaisir à prolonger en le modulant.
– Ces négociations… difficiles… parfois douloureuses… sont heureusement terminées. Dès à présent tu peux te considérer comme appartenant au collège Saint-François-Xavier… Ce collège que j’ai choisi entre tous est situé au chef-lieu du Morbihan… Peut-être ne sais-tu pas où se trouve le Morbihan ? Il se trouve en Bretagne, le pays par excellence !… Grâce à moi, tu vas être élevé avec la fleur de la jeunesse française… Il est même probable, si mes renseignements sont exacts, que tu auras pour compagnons des fils de princes… Tu ne verras autour de toi que les grands exemples de la richesse héréditaire et de l’illustration nationale, si j’ose m’exprimer ainsi… Cela, mon enfant, n’est pas donné à tout le monde, et crée des devoirs importants, ce que j’appelle… En outre, sais-tu qu’un Jésuite – le moindre des Jésuites – c’est presque un évêque ?… Il n’en a pas le titre, j’en conviens, mais il en a la puissance, et, m’est-il permis de le dire… la distinction… Quant aux Jésuites, considérés comme ensemble, un mot suffira… Ils mènent le pape… J’ignore si je me fais bien comprendre ?… si tu te rends compte exactement de ce que sont les Jésuites ?… Oui, n’est-ce pas ?… Eh bien, tâche par ton application au travail, par ta soumission, ta piété, ta conduite en général, tâche de mériter le grand honneur auquel tu es appelé… N’oublie pas surtout les sacrifices énormes que je fais pour ton éducation… et remercie le ciel d’avoir un père tel que je suis… Car je me saigne aux quatre membres…
Et, délaissant les pitons, il montra de quatre chiquenaudes rapides, ses deux bras, ses deux jambes.
– Aux quatre membres, ce que j’appelle !…
Après une pause de quelques minutes où il triompha de l’air ahuri de son fils, il poursuivit lentement, avec de nouvelles modulations.
– Aujourd’hui même, je vais m’occuper de ton trousseau, avec la mère Cébron… Il te faut un trousseau convenable, car, en principe, je ne veux pas t’exposer à rougir devant tes nouveaux camarades… et je comprends que, portant mon nom – le nom des Roch – et vivant dans une société d’élite, dans un monde essentiellement aristocratique, je comprends que tu doives représenter… Nous chercherons, la mère Cébron et moi, dans mes anciennes hardes, celles qui, remises à ta taille, pourront te faire le plus d’honneur et le plus d’usage. Applique-toi à être aisé dans tes manières et soigneux… L’élégance va bien avec le bon ordre… Ainsi, moi, j’ai encore mon habit de mariage… Ta pauvre mère !
S’étant attendri juste le temps qu’il fallait pour couper d’une note émue l’insolite longueur de son discours, il recommença de trier les pitons, de ressasser les conseils, insistant de préférence sur ses hautes qualités et ses paternelles vertus. Sébastien n’écoutait plus. Il ne savait ce qu’il ressentait : quelque chose comme un accablement et aussi comme un déchirement, dont l’intense douleur le laissait bouche béante, et mains cramponnées au rebord du comptoir. Certes, il connaissait de longue date l’éloquence de son père. Elle lui avait toujours semblé un bruit naturel. Jamais il n’y avait prêté plus d’attention qu’au ronflement du vent dans les arbres, ou bien au gouglou de l’eau, coulant sans cesse, par le robinet de la fontaine municipale. Aujourd’hui, cela tombait sur son corps avec des craquements d’avalanche, des heurts de rochers roulés, des lourdeurs de trombes, des fracas de tonnerre qui l’aveuglaient, l’étourdissaient, lui donnaient l’intolérable impression d’une chute dans un gouffre, d’une dégringolade dans des escaliers sans fin.
Son regard, affolé de vertige, allait du ventre de M. Roch, énorme et menaçant sous le tablier de cotonnade, aux ventres menus des marmites de fonte, rangées sur le rayon du haut, près du plafond, qui paraissaient rouler sur leurs trépieds, et lâcher, elles aussi, de furieux borborygmes. Et les disques rouges des casseroles de cuivre, où dansaient des reflets capricants, prenaient d’impossibles aspects d’astres exaspérés. Quand il fut à bout de phrases et à bout de pitons, M. Roch conclut ainsi :
– C’est pourquoi, mon enfant, jusqu’au jour de ton départ, il est nécessaire de briser là toute espèce de relations avec tes camarades d’ici… Je ne prétends point qu’on doive être fier avec les petits, mais il existe en toutes choses des limites… Et la société impose à ses membres des hiérarchies qu’il est dangereux de transgresser… Ces méchants gamins, pour la plupart fils de pauvres et de simples ouvriers – je ne les blâme pas, remarque bien, je constate seulement – ne sont plus de ton rang. Entre eux et toi, désormais, il y a un abîme… Saisis-tu bien la portée de mes paroles ?… Un abîme, ce que j’appelle !
Pour figurer l’abîme, il mesurait la largeur du comptoir qui le séparait de Sébastien, et il répétait en élevant la voix :
– Un abîme ! Comprends-moi, Sébastien… un infranchissable abîme !… Que diable ! Où en serait un pays sans aristocratie ?
M. Roch grimpa sur un escabeau, tira successivement plusieurs cases numérotées, remplies de cadenas, et, tandis qu’il les comparait l’un à l’autre, qu’il faisait jouer leurs serrures rouillées, il soupira mélancoliquement :
– Ah ! je t’envie !… Tu es bien petit pourtant, et tu ne sais rien… Eh bien, je t’envie tout de même… Où ne serais-je pas arrivé, moi ?… moi ?… si j’avais eu un père comme le tien !… Tu en es, toi, maintenant, de cette aristocratie… Tu peux arriver, à tout, à tout !… Et moi !… moi !… quel avenir gâché ! quel…
À ce moment, la porte de la boutique s’ouvrit : un client entra.
– Voilà ! voilà ! fit M. Roch qui, prestement, redescendit de son escabeau, en même temps que des hauteurs idéales où sa noble imagination promenait de très vagues, de très immenses rêves de gloire à jamais perdue !
Malgré ces hautes leçons et ces brillantes promesses, Sébastien ne se sentit ni fier, ni heureux. Il était abasourdi. Des successifs discours de son père, de cet amas de phrases incohérentes et discordes, il ne retenait qu’une chose positive : il lui fallait quitter le pays, partir pour un inconnu que ni les Jésuites, ni les fils de princes, ni les immémoriales redingotes dont la mère Cébron allait l’affubler, ne parvenaient à rendre attrayant, ni même explicable. Au contraire, sa naturelle méfiance de petite bête sauvage le peuplait de mille dangers, de mille devoirs confus, trop lourds pour lui. Jusqu’ici, il avait poussé librement dans le soleil, la pluie, le vent, la neige, en pleine activité physique, sans penser à rien, sans concevoir un autre pays que le sien, une autre maison que la sienne, un autre air que celui qu’il respirait. Jamais il ne s’était bien familiarisé avec l’idée du collège, ou, plutôt, jamais il n’y avait songé sérieusement. Entre l’école et le collège, il n’établissait pas d’autres rapports que celui-ci. L’école était pour les petits, le collège pour les grands, les bien plus grands que lui, et il ne se disait pas qu’il grandirait un jour. Lorsque son père en parlait, cela lui semblait tellement lointain, si vague, que son esprit, sensible seulement aux formes immédiates et présentes, ne s’y arrêtait pas, mais devant la menace prochaine, devant la date implacable, il frissonnait. Il redoutait maintenant, à l’égal d’une catastrophe, cette séparation de lui-même, avec tout ce dont il avait l’accoutumance. Il ne comprenait pas, non plus, pourquoi on exigeait de lui qu’il sacrifiât ses camaraderies de la petite enfance à il ne savait quelle mystérieuse et soudaine nécessité ; en ce moment surtout, déjà bien assez pénible, où il éprouvait le besoin d’une protection, d’un resserrement plus intime avec les choses plus amies et les êtres plus chéris. Cela le rendit très triste et très tendre. Le cœur bien gros, il se retira dans l’arrière-boutique, qui servait de salle à manger, et où il avait coutume, entre les heures de l’école, d’apprendre ses leçons et de préparer ses devoirs.
C’était une pièce sombre que le soleil n’avait jamais visitée. Sa vue le glaça comme s’il y entrait pour la première fois ; et, sur le seuil, il hésita, étonné de ces objets, de ces meubles, au milieu desquels il avait vécu et qu’il ne reconnaissait plus, tant ils paraissaient avoir revêtu des aspects de brusque laideur, un air d’hostilité renfrognée, par quoi il se trouvait tout déconcerté. La table, recouverte d’un tapis de toile cirée, sur lequel étaient imprimées, par ordre chronologique et en rond « les ressemblances » de tous les rois de France, avec leur généalogie, la date de leur avènement et de leur mort, occupait le centre de la pièce. « On s’instruit en mangeant », disait M. Roch qui, la bouche pleine, souvent jetait, dans le froid silence des repas, les retentissants noms de Clotaire, de Clovis, de Pharamond, aussitôt suivis d’un geste qui les ponctuait de points d’exclamation. Çà et là, des chaises de paille ; un dressoir de noyer, garni de vaisselle ébréchée, faisait face à une vieille armoire normande. Chaque chose, maintenant, renvoyait à Sébastien l’image de son père, avilie par un ridicule ; il ne se mêlait plus à tout cela que des révélations de scènes grotesques et diminuantes. Le long des murs tapissés de papier vert, en maint endroit pourri par l’humidité, s’étalaient des portraits au daguerréotype de M. Joseph-Hippolyte-Elphège Roch, en des attitudes diverses, toutes plus oratoires et augustes les unes que les autres. Sébastien le revoyait s’arrêter complaisamment devant chacun d’eux, les comparer, reprendre les poses et soupirer, en haussant les épaules : « On dit que je ressemble à Louis-Philippe !… Il a eu plus de chance que moi, voilà tout ! » Il le revoyait allumer, chaque soir, avec les mêmes précautions méthodiques et les mêmes soins de maniaque, la suspension de zinc dédoré qu’un client lui avait laissée pour compte, jadis : aventure dont il gardait une inoubliable rancune, que, depuis dix ans, il narrait toujours, de la même façon indignée, répétant : « Oser prétendre que c’était de la camelote ! Comme si cela était croyable qu’un Roch pût vendre de la camelote !… De la camelote !… moi !… » Et il prenait à témoin le solide mécanisme de la lampe, la douceur des chaînettes, la résistance du fumivore, l’opinion de ses compatriotes. C’était aussi, sur la cheminée, entre deux vases bleus, gagnés à des loteries foraines, la photographie de sa mère que Sébastien n’avait pas connue ; une jeune femme frêle, un peu raide, le visage presque effacé, les tempes ornées de longs repentirs, et tenant à la main, du bout des doigts, en un mouvement maniéré, son mouchoir de dentelles. Et il entendait son père redire quotidiennement : « Il faudra que je remonte ta pauvre mère dans ma chambre, et que je mette, à sa place, une pendule ! » Tout cela qu’il revivait en cette minute précise, l’âme affadie d’ennuis, de désenchantements, de dégoûts, tout cela était enveloppé par la morne clarté du dehors, taché par les reflets sales des carreaux de brique qui dallaient ce sombre réduit. Sébastien dirigea ses yeux vers la fenêtre, comme pour y chercher une échappée de ciel. La fenêtre, unique et sans rideaux, s’ouvrait sur une étroite cour, et le regard se cognait aux murs des maisons voisines, crasseux, purulents, écaillés de lèpres verdâtres, fendillés de suintantes lézardes, percés d’ignobles jours de souffrance, par où se devinaient vaguement des pauvretés entassées et de vermiculaires ordures. Sans cesse, des tuyaux dégorgeaient des eaux pourries ; des bouches noires vomissaient des puanteurs, s’écoulant vers un caniveau commun, entre des amas de vieille ferraille et des débris de toutes sortes. Ce repoussant spectacle, cette lumière louche, aux sordides pâleurs, et jusques à cette vulgarité, cette inintimité des choses familiales, qui lui arrivaient, dépouillées du voile de l’habitude, en formes désolantes et nues, changèrent rapidement l’état de son âme. Sans qu’il en eût conscience, l’incohérent discours de son père, les Jésuites, les fils du prince éveillèrent en lui le rêve d’un au-delà, remuèrent des imaginations latentes qui, peu à peu, se dégageaient devant l’horreur de la réalité révélée. À la pensée qu’il avait pu demeurer là, toute sa vie, parmi ces gluantes ombres, à regarder les murs hideux qui lui dérobaient la joie du ciel, une mélancolie rétrospective l’envahit. Oubliant le passé d’insouciance tranquille, il se persuada qu’il avait été infiniment malheureux, et que ce qu’il souffrait, à cette heure, il l’avait toujours souffert. Tandis qu’il végétait, misérable, à d’autres étaient réservées des joies, des beautés, des magnificences. Il savait maintenant – son père le lui avait dit, avec quel accent de certitude, d’admiration ! – qu’il n’avait qu’à allonger le bras, pour les étreindre lui aussi. Le collège ne l’effraya plus. Il se surprit même à désirer cet inconnu, qui le troublait encore, mais voluptueusement, comme l’incertaine approche d’une vague délivrance.
Sébastien s’assit auprès de la table, le dos tourné à la fenêtre, ouvrit un livre de classe qu’il ne lut point, et, la tête dans les mains, les yeux très graves, lointains et songeurs, il rêva longtemps à d’autres ciels, à d’autres compagnons, à d’autres maîtres. Graduellement, tous les objets de l’arrière-boutique, la cour, les murs, se reculèrent, s’effacèrent ainsi que s’effacent et se reculent les choses ambiantes, dans l’engourdissement du demi-sommeil, et l’enfant se vit transporté en une contrée de lumière, dans une sorte de féerique palais, à travers des nefs spacieuses et des colonnades où des êtres charmants et bons venaient vers lui, vêtus de longues robes brillantes qui faisaient, en glissant, un doux bruissement de soie, cependant que, sur les vitres brouillées de la porte qui séparait la salle à manger du magasin, se mouvait ironiquement l’ombre démesurée de son père.
Les jours passèrent, pleins d’anxiétés différentes. Sébastien restait à la maison et ne sortait qu’accompagné de M. Roch, qui veillait scrupuleusement à ce qu’aucun des camarades de son fils ne pénétrât près de lui : « Les Jésuites ne veulent pas… Allez-vous-en ! » leur criait-il, lorsque, surpris de ne plus rencontrer nulle part Sébastien, ils venaient le relancer jusque dans la boutique. L’apprenti, un gamin de quinze ans, eut l’ordre de ne plus tutoyer le fils du patron et de lui prodiguer les plus grands respects : « Tu l’appelleras, dorénavant, monsieur Sébastien. La situation n’est plus la même », expliqua le quincaillier. Lui-même avait jugé nécessaire et digne de mettre plus de hauteur dans ses relations avec les voisins, de les tenir à distance, sans toutefois les priver du régal quotidien de sa conversation. Au contraire, de jour en jour, son éloquence grandissait, s’exubérait. En même temps, il redoublait de conseils mille fois rabâchés, d’aphorismes saugrenus, de raisonnements magistraux, qui jetaient l’enfant dans des ahurissements profonds. Excédé de l’entendre répéter à tout propos : « Je ne sais si je me fais bien comprendre ? Saisis-tu bien toute la portée de mes paroles ? », les promenades, les visites, les tête-à-tête plus fréquents devenaient pour Sébastien un intolérable supplice ; et, afin d’y échapper, il souhaitait ardemment que vînt l’heure du départ. Mais seul, en sa chambrette, le soir, parmi ces riens familiers qui l’entouraient, auxquels il rattachait des souvenirs naïfs et précieux, la terreur du collège le reprenait, et il eût voulu qu’elle n’arrivât jamais, cette heure brutale où il lui faudrait dire adieu à tout cela qui était partie intégrante de lui-même, moitié de sa chair, moitié de son âme. Ce qui lui faisait mal, plus encore que ces douloureuses alternatives, c’était de penser. L’inquiétude, maintenant, tenaillait son être tout entier, depuis que la réflexion s’installait en son cerveau. En lui infusant la semence d’une vie nouvelle, ce brusque viol de sa virginité intellectuelle lui infusait aussi le germe de la souffrance humaine. La paix de sa conscience était détruite, ses sens perdaient de la simplicité de leurs perceptions. Le moindre mot, le moindre objet, le moindre fait, autrefois sans signification morale, sans prolongements intérieurs, ouvraient à son esprit, par déchirements aigus, successifs, des horizons indéfinis et redoutables. Des questions de toute nature, grosses de mystères, se dressaient devant lui, trop faible pour les étreindre ; et il voyait confusément, au-dessus des limbes de son enfance physique, remuer des rudiments d’idées, s’agiter des formes embryonnaires de la vie sociale, fonctionner tout un appareil inexpliqué, discordant, de lois, de devoirs, de hiérarchies, de relativités, s’embranchant l’un sur l’autre, mis en mouvement par une multitude d’engrenages, dans lesquels sa frêle personnalité serait infailliblement prise et broyée. En attendant, cela lui causait des maux de tête violents, exacerbait jusqu’à l’ébranlement nerveux le fragile organisme de sa sensibilité.
La maison contiguë au magasin de quincaillerie appartenait aussi à M. Roch. Le bureau de la poste l’occupait, et la titulaire, Mme Lecautel, veuve d’un général, mort alcoolique et fou, disait-on, passait pour une femme instruite, supérieure. Sa personne, maigre et longue, d’aspect triste, souffrant sous le deuil perpétuel des robes noires, révélait, en effet, une distinction inhabituelle aux dames du pays et suscitait des sympathies respectueuses et cancanières, comme on en accorde aux être tombés d’une situation brillante dans le malheur. Elle avait une fille, Marguerite, du même âge que Sébastien ; et les deux enfants s’étaient liés d’amitié assez vive. M. Roch, fier de cette relation pour son fils, l’encourageait dans ses visites. Lui-même s’ingéniait à entourer d’égards fatigants et d’obsédantes politesses, Mme Lecautel, qu’il appelait galamment : « ma belle locataire » ; ce qui ne l’empêchait pas, du reste, de refuser toutes les réparations qu’elle lui demandait. De son côté, Mme Lecautel, sentant l’abandon moral de ce gentil enfant, réservé et silencieux, s’était pris d’intérêt pour lui, et le recevait maternellement. Il fut convenu que, tous les jeudis et tous les dimanches, il viendrait passer, chez elle, quelques heures. Souvent, par les beaux temps, son bureau fermé, elle l’emmenait à la promenade, avec sa fille.
Dans ces moments de crise, Sébastien éprouva un soulagement véritable, à la société de sa petite amie, Marguerite. Un instant de protection plus tendre, la chaleur d’une atmosphère plus douce, le poussèrent, plus fort, vers elle. Ce n’était point qu’il parlât, qu’il se confiât davantage. Il était trop timide pour cela. D’ailleurs, il n’aurait su que dire, il n’aurait su quoi exprimer, en ce tumulte de sensations brouillées, de chagrins vagues, qui grondait en lui. Mais la seule vue de Marguerite le rassérénait. Près d’elle, son cœur s’apaisait ; sa tête endolorie redevenait plus calme. Peu à peu, il se remettait à la joie de ne plus penser à rien. Elle était charmante de câlineries inventives. Deux grands yeux noirs, trop brillants, trop humides, toujours cernés de bleu, éclairaient sa jolie figure d’une lumière d’amour précoce et profonde. Ses manières non plus n’étaient pas d’une petite fille, bien que son langage fût demeuré enfantin, et qu’il contrastât avec la grâce, savante, presque perverse qui émanait d’elle, une grâce de sexe épanoui, trop tôt, en ardente et maladive fleur. Depuis qu’elle avait appris qu’il devait partir, elle se faisait plus empressée auprès de lui, plus audacieuse de gestes et de caresses. Elle parlait, parlait, s’étourdissait à dire des riens qui emplissaient d’aise son jeune ami. Ensuite, elle le regardait de ses grands yeux possesseurs, qui allaient éveiller, au fond de l’âme de Sébastien, un sentiment obscur encore, mais puissant, si puissant que cela montait en lui, avec des sursauts et des heurts, s’agitait comme de la vie prisonnière qui veut sortir de l’ombre ; et il en avait parfois la poitrine haletante et la gorge sèche. Le torse cambré ou bien ondulant sous le sarrau noir froncé de mille plis, elle s’approchait de lui, avec des mouvements de joli animal, lissait ses cheveux mal peignés, de sa main très longue, maigre et déjà veinée de bleu, arrangeait le nœud de sa cravate défaite. Les petits doigts couraient sur sa peau, légers, souples, brûlants comme des ailes de flamme, semblaient multiplier leurs frôlements, qui le laissaient presque défaillant de terreur et de joie. Il se sentait vivre en elle réellement. Si intime, si magnétique était la pénétration de sa vie à lui, dans sa vie à elle, que bien souvent, lorsqu’elle se cognait à l’angle d’un meuble, et se piquait les doigts à la pointe d’une aiguille, il éprouvait immédiatement la douleur physique de ce choc et de cette piqûre.
– Est-ce qu’il y aura des petites filles dans le collège où tu vas, dis ? demandait-elle.
– Oh ! non.
– Je voudrais bien aller avec toi, être toujours avec toi !…
Et les prunelles agrandies, plus brillantes :
– Alors, il y a beaucoup de petits garçons… rien que de petits garçons… comme toi – gentils comme toi ?…
– Oh ! oui.
– Que ça doit être amusant !… Comme j’aimerais ça, moi, le collège !
Tout d’un coup, elle courait, auprès de sa mère, la figure striée de grimaces nerveuses, pleurant :
– Maman !… maman !… Je voudrais aller avec lui… je voudrais…
De ces heures trop brèves, passées au contact de cette étrange enfant, Sébastien rapportait une chaleur prompte à s’évaporer, dès qu’il se retrouvait avec son père, ou seul, dans le froid de l’arrière-boutique.
C’étaient aussi des appréhensions angoissantes de cette farouche Bretagne, de ce pays mystérieux des légendes, dont M. Roch, en guise d’études préparatoires, l’obligeait à lire des récits très sombres et terribles. Les âpres paysages, les mers tragiques, les vieux châteaux hantés, les mauvaises fées planant au-dessus des étangs nocturnes, les naufrageurs tordant leurs chevelures calibanesques sur les grèves hurlantes, tout ce fantastique de mélodrame se combinait, en sa pensée, avec les divagations paternelles, qui lui donnaient des Jésuites et de leur collège une surhumaine et fulgurante image. Jamais il ne pourrait s’habituer à vivre en un tel milieu, en contact journalier avec des êtres si loin de lui, dont le plus humble rayonnait de « l’insoutenable éclat des évêques ». Et, renchérissant sur les hyperboliques comparaisons de M. Roch, il se représentait alors les Jésuites, dans des embrasements ecclésiaux, vêtus d’orfroi, auréolés d’encens, révérés comme des papes, inabordables comme des dieux. Tiraillé sans cesse, entre des craintes vagues et des espérances chimériques, privé de ses camarades, la seule joie qui l’eût aidé à travers les difficiles heures de l’attente, énervé par les quotidiens essayages de la mère Cébron, abruti par les prêches de son père, il se trouvait infiniment malheureux. Hormis le jeudi et le dimanche, il ne savait que faire de ses longues journées. Plus de jeux à la marelle, sur la grand-place ; plus de vagabondages à travers champs, le long des haies chantantes et fleuries, ou bien au bord de la rivière, lorsqu’il suivait les jeteurs d’épervier, et que, les bras nus, ses culottes retroussées au-dessus des genoux, il soulevait, dans les endroits peu profonds, les pierres sous lesquelles dorment les écrevisses. Quel crève-cœur, pour lui, que d’entendre de sa chambre, ou du fond de l’arrière-boutique, les cris connus de ses camarades, partant en maraude, qui semblaient l’appeler !
Parfois, il se réfugiait au jardin, situé en dehors du bourg, près du cimetière. Là non plus, il ne pouvait goûter un seul instant le repos cherché. L’absence des belles fleurs, des arbres ombreux, l’ennuyeux dessin des plates-bandes, l’absurdité des ornementations artificielles que la fantaisie horticole du quincaillier avait prodiguées partout, lui rappelaient involontairement les lourdes apostrophes, les écrasantes prosopopées, l’incontinence, l’incohérence de cette rhétorique, à laquelle il avait cru se soustraire et qu’il retrouvait décuplée dans le silence des choses. Et puis le voisinage des cyprès, dont les cônes noirâtres dépassaient les murs, les croix funèbres, montrant çà et là leurs bras chargés de couronnes, ajoutaient, à cette obsession domestique, un malaise aigu. Après avoir fait deux fois le tour des allées, entre les bordures de buis que décoraient des coques d’escargot, peintes de couleurs vives et figurant alternativement des losanges et les initiales J. R. emmêlées, il rentrait plus mécontent, plus perplexe, en proie à de pénibles dégoûts.
Chaque jour, après le déjeuner, il allait aussi chez sa tante Rosalie : un autre supplice auquel le condamnait son père. Étendue dans un fauteuil à roulettes, près de la fenêtre, un ouvrage de tricot en ses mains, la vieille fille occupait toutes les heures de son existence sédentaire à dire du mal des gens, à faire souffrir sa bonne qu’elle s’était attachée par des promesses d’héritage. Sa face grosse, molle et blanchâtre de vieille procureuse, ombrée sur le menton et sur les lèvres de quelques poils grisonnants, son œil égrillard et malicieux, le cynisme de ses propos gênaient Sébastien, demeuré très chaste, très ignorant, mais qui ne pouvait s’empêcher de rougir à des mots inintelligibles pour lui, et où cependant il devinait un sens coupable et des intentions honteuses. Souvent, il la trouvait entourée de ses amies, vieilles filles comme elle, paillardes et chattemites, comme elle obsédées de préoccupations obscènes, et, sous le couvert de la morale, de la vertu blessée, combinant des adultères locaux, imaginant des histoires polissonnes, parlant des amours de leurs chattes, répandant, autour d’elles, de fades odeurs de linge sale et de lit.
– Des Jésuites !… Il lui faut des Jésuites… criait la tante Rosalie à la vue de son neveu… Je vous demande un peu, à ce gamin !… Ah ! c’est moi qui t’aurais mis en apprentissage, mon garçon ! Des Jésuites !… Non ! Mais c’est incroyable !… Tout ça, pour faire des embarras, pour jouer au grand seigneur, pour montrer qu’on est riche !… C’est du propre… Et je lui conseille de se vanter de son argent, à ton père !… Quand on vend vingt sous une chose qui ne vous en coûte pas seulement deux !… C’est facile d’être riche !… Viens ici, toi, plus près !
Sébastien s’approchait timidement, les coudes collés au corps, effrayé par les deux coques blanches qui nouaient le bonnet tuyauté de la vieille, et pointaient sur le sommet de son crâne comme des cornes de diable.
– Na !… Est-ce pas un bel homme ?…
Elle lui empoignait le bras, le faisait virer ainsi qu’une toupie ; et, dardant sur lui ses petits yeux méchants :
– Est-ce pas un bel homme ?… répétait-elle. Regardez-moi ça !… Et qu’est-ce qu’ils feront de toi, les Jésuites ? Tu crois peut-être qu’ils te garderont chez eux, avec ton air godiche, et tourné comme tu l’es ! Ah ! bien oui !… Mais sitôt qu’ils t’auront vu, ils se mettront à rire et te ramèneront ici. Veux-tu que je te dise une vérité, moi ?… Allons, nigaud, parle, réponds !… Veux-tu que je te dise une vérité ?
– Oui, ma tante.
– Oui, ma tante ! reprenait sur un ton moqueur et traînard la vieille Rosalie… Oui, ma tante !… Est-il bête cet enfant ?… Eh bien, ton père, le cher cœur, ton père est un imbécile, un gros imbécile, tu entends !… et tu le lui diras de ma part !… Tu lui diras : « Tante Rosalie a dit que tu étais un imbécile ! » Mon Dieu ! Mon Dieu !… Ça envoie son fils chez les Jésuites, et ça ne sait seulement pas nettoyer les lampes !… Et ça fait, toutes les nuits, des saletés avec sa bonne !
Elle haussait les épaules, méprisante, riait d’un rire mauvais, tandis que les yeux des vieilles filles s’allumaient de lueurs obliques.
De retour à la maison, l’enfant, de plus en plus découragé, se demandait si vraiment, il n’était point trop petit, trop laid, trop mal bâti, pour être accepté de ces terribles Jésuites, que les moqueries de la vieille fille revêtaient d’un caractère plus troublant, et d’une plus inexorable sévérité ; il se demandait si, vraiment, il ne serait pas plus heureux en apprentissage. Durant une minute, il le voulait ; et, la minute d’après, il ne le voulait plus. Il ne savait pas, toutes ces choses lui semblant, désormais, pareillement douloureuses. Ce qu’il savait, c’est que, dans la persistante lutte de deux volontés contraires, dans cet antagonisme incessant des résolutions prises et déprises, il avait perdu le repos et le bonheur. Poursuivi par les paroles de sa tante, sourdement travaillé par les démoralisantes constatations que la vie lui apportait, plus nombreuses chaque jour, il sentait aussi, malgré ses révoltes contre les calomnies de la vieille femme, et ses remords de les écouter, il sentait diminuer son affection, son respect pour son père. Dans l’espoir de solidifier des sentiments de tendresse qui craquaient, maintenant, de toutes parts, il prenait l’habitude de l’observer, s’ingéniait à le comprendre ; mais il perdait pied dans le vide de cet esprit, se heurtait au mur de ce cœur égoïste, qui se dressait, ainsi qu’une séparation entre les deux natures. Plus par intuition que par raisonnement, il découvrait qu’aucun échange d’émotions pareilles, que pas un rapprochement de commun amour n’était possible entre eux, si étrangers l’un à l’autre. Tout, dans les actions, dans les discours de son père, le désenchantait, le blessait. Durant les repas, souvent interrompus par les coups de timbre du magasin, les allées et venues des clients, sa façon de manger, gloutonne et malpropre, le bruit qu’il faisait en buvant, une multitude de menus détails, non encore sentis, où se révélaient des habitudes relâchées, des inconvenances de tenue, si peu d’accord avec la rigide pompe de ses principes, tout cela causait à Sébastien une irritation qu’il avait peine à dissimuler. Il souffrait d’une réelle souffrance physique à voir la manière dégradante dont son père traitait l’apprenti : le pain spécial, un pain bis et grossier qui lui était dévolu, les maigres parts, les déchets graisseux des fricots que M. Roch lui jetait comme à un chien, et que l’autre dévorait silencieusement, en guignant les belles tranches de viande et les bons morceaux de pain blanc des patrons. Il ignorait ce que sa tante Rosalie entendait par « les saletés de son père ». Mais, sous l’obsession de ces paroles, il en était arrivé à le suspecter d’actes blâmables et déshonorants. Souvent, la nuit, il se levait, collait son oreille contre la mince cloison qui séparait sa chambre de celle de M. Roch, et il restait là, des heures à écouter…, soulagé de ne percevoir, dans le silence, qu’un ronflement sourd, tranquille, régulier, la respiration nasillante et gargaristique d’un homme plongé dans un sommeil profond de terrassier. Néanmoins, le prestige de l’autorité paternelle, qui s’accompagne chez celui qui la subit d’un besoin de protection et d’un instinct de confiance, s’en allait chaque fois, détruit par cette surveillance et aussi par mille petits faits intimes, rabaissants, dont le ridicule et la grossièreté ne lui échappaient plus, l’affligeaient comme s’ils eussent été siens. En lui, d’heure en heure, des choses mouraient qu’il avait le mieux chéries ; d’autres naissaient qui mettaient en son âme des angoisses nouvelles, des amertumes et des pitiés inconnues.
Quant à M. Joseph-Hippolyte-Elphège Roch, il n’éprouvait aucun de ces troubles intérieurs, et il attendait les événements avec un calme béat. Il était heureux, lui ; il se carrait dans son éloquence, s’exaltait dans l’apothéose de son génie, convaincu que, par sa volonté, un fait inouï, un fait historique s’accomplissait. Le dimanche, après les vêpres, strictement vêtu de noir, il entretenait, assis devant sa boutique, les voisins émerveillés de ses incommensurables histoires. Et, très digne, avec une autorité tranquille, imprimant à son buste des balancements isochrones, il lançait des phrases énormes, de colossales bourdes qui lui valaient un accroissement de respect.
Enfin arriva la date fatale.
La veille, M. Roch, depuis plusieurs jours officiellement prévenu du passage du Père Jésuite chargé de ramener les élèves, était resté, très tard, dans la soirée, à compulser l’indicateur des chemins de fer. Il vérifia et revérifia l’heure d’arrivée du train aux principales stations, compta le nombre de kilomètres, entre les différentes villes, étudia le prix des places, suivant les classes, se perdit dans le dédale des embranchements et des correspondances, d’ailleurs absolument étrangers à l’itinéraire de son fils. Une chose l’étonnait, c’est que la ligne s’arrêtât à Rennes. Cet inconnu de Rennes à Vannes, ce biffage de tout un pays, célèbre, en une énumération de villes indifférentes et ignorées, le troublaient fort. Il ne pouvait admettre que les Compagnies n’eussent pas prolongé leur ligne, jusqu’à Vannes, à cause des Jésuites.
– Car enfin, expliqua-t-il à Sébastien, tu dois comprendre qu’un collège comme celui-là donne un trafic certain… Outre la question de convenances, il y a là… saisis-tu bien ?… il y a là un intérêt méconnu… Je pétitionnerai… En attendant, tu pars demain, de Pervenchères, par le train de 10 heures 35… Oui, mon enfant, c’est demain soir, à 10 heures 35, que tu entres vraiment dans la vie. N’oublie pas mes recommandations… Dis-toi bien que tu as un père qui se saigne pour toi aux quatre membres… Ainsi, demain soir, à la gare, je dois te prendre un billet de première classe… Il paraît, je le comprends jusqu’à une certaine mesure, que les Jésuites ne voyagent jamais autrement… ce qui n’empêche pas que ce sont des frais très lourds, très lourds… Je n’ai jamais voyagé en première classe, moi… Et cependant, je suis ton père !
Le lendemain, après une nuit agitée, de très grand matin, M. Roch se leva. Il passa sa redingote de cérémonie, et, chose mémorable, se coiffa de son chapeau de haute forme, un antique chapeau, précieusement gardé au fond d’une armoire, et dont la soie, rebroussée par de maladroits et successifs frottements, était ternie de reflets jaunasses. Ainsi accoutré, il mena son fils à l’église, pour qu’il y entendît la messe ; une messe dite à son intention, et solennellement annoncée, le dimanche d’avant, au prône, par le curé. M. Roch communia. L’office terminé et ses prières dites, il conduisit Sébastien à travers les nefs, les chapelles latérales, le chœur. Sur les dalles, ses pas faisaient un bruit auguste, et ses gestes avaient l’hiératique ampleur des gestes de saints, qui bénissent les foules du fond de leurs niches de pierre.
– Regarde, lui dit-il… Regarde tout cela !… C’est Jean Roch, ton illustre ancêtre, qui restaura cette église… Je te l’ai maintes fois raconté. Ces chapiteaux, cette voûte, tout ce que tu vois, c’est de lui… Remplis tes yeux de ces nobles spectacles. Aux heures de défaillance, tu n’auras qu’à te souvenir pour être consolé, fortifié, ce que j’appelle… C’est là que moi, ton père, j’ai puisé ma force… Regarde !… Jean Roch fut un grand martyr, mon enfant… Tâche de marcher sur ses traces. Regarde ! On ne bâtit plus comme ça, maintenant.